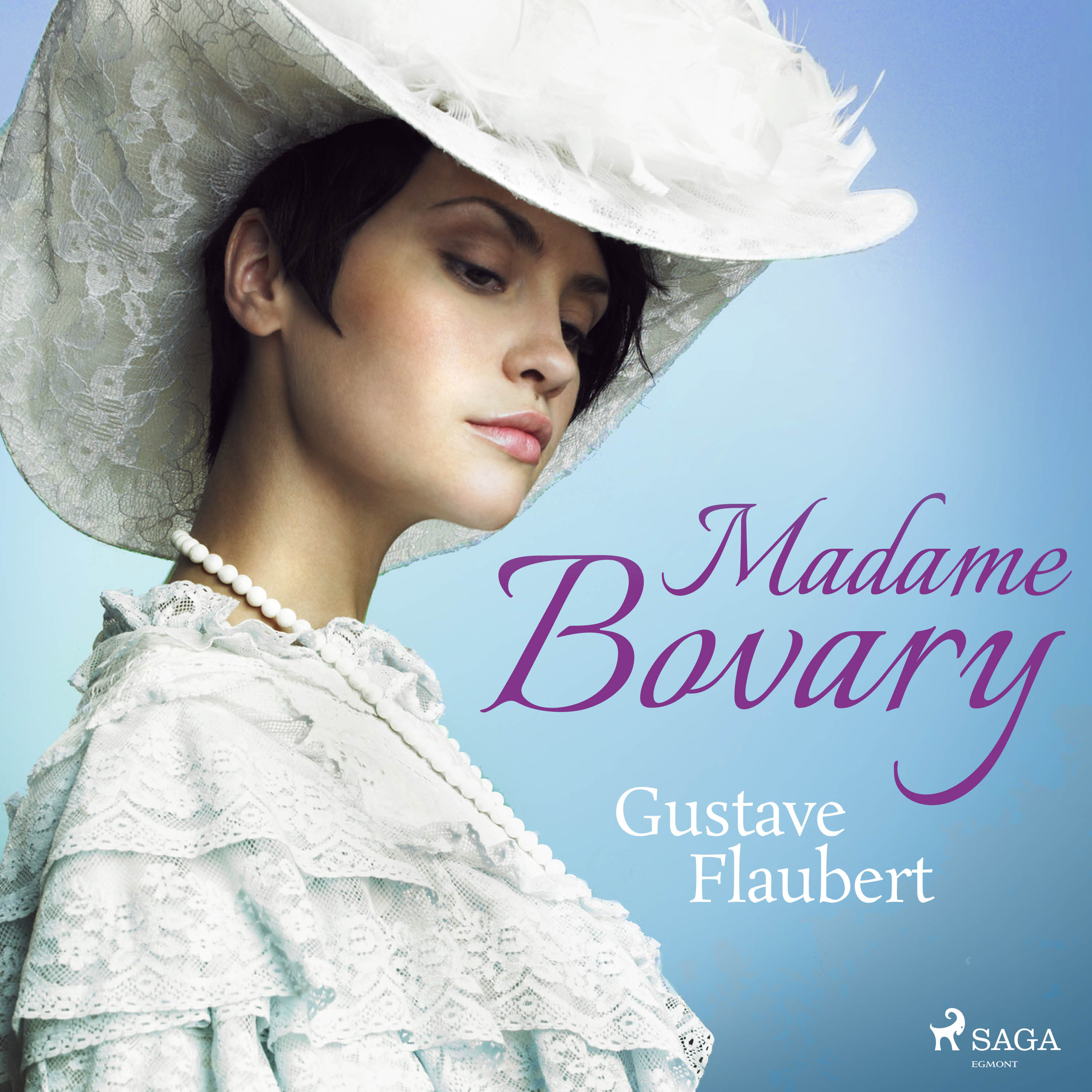
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Reclams Rote Reihe – Fremdsprachentexte
- Sprache: Deutsch
Einer der ganz großen Romane der Weltliteratur wird jetzt in Reclams Roter Reihe in einer Auswahlausgabe vorgelegt: Der ansonsten unveränderte Text wurde auf etwa die Hälfte gekürzt und mit Überleitungen in französischer Sprache versehen. Textausgabe in der Originalsprache, mit Übersetzungen schwieriger Wörter, Nachwort und Literaturhinweisen. Mit Seitenzählung der gedruckten Ausgabe: Buch und E-Book können parallel benutzt werden.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gustave FlaubertMadame Bovary
Édition abrégée
Herausgegeben von Karl Stoppel
Reclam
2005 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
Made in Germany 2017
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-960478-7
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-009142-5
www.reclam.de
Inhalt
Vorwort
Madame Bovary
Première partie
Deuxième partie
Troisième partie
Editorische Notiz
Literaturhinweise
Hinweise zur E-Book-Ausgabe
[3] Vorwort
Junger Mann trifft junge Frau, auf Seite 17 einer ungekürzten französischen Ausgabe.1 Sie kommen sich näher, auf Seite 32 ist das Paar schon auf dem Rückweg von der Hochzeitsmesse, alle Achtung. Anschließend wird ausgiebig gefeiert.
Ist das nicht Stoff, aus dem Träume sind? Nicht, wenn man Emma Bovary heißt. Wo andere Romane und die große Mehrzahl gängiger Filmprodukte enden, beginnt Gustave Flauberts Madame Bovary. Danach folgen noch 379 Seiten.
Da das ›Happy-end‹ gleich zu Beginn inszeniert wird, muss Anderes am Schluss stehen. Es sind ein Bankrott, ein realistisch-langsamer, qualvoller Selbstmord.
Was erzählt uns der normannische Romancier mit dem Schnauzbart zwischen glücklichem Auftakt und trostlosem Schluss?
Bauerntochter trifft Landarzt (»Selon la mode de la campagne, elle lui proposa de boire quelque chose«), Dorfschönheit mit untypischer Erziehung im Ursulinerinnenkloster trifft eher unfähigen Typ (»il apprit d’avance toutes les questions [de son examen] par cœur«). Ist das schon alles? Nein.
»Elle se mettait à la fenêtre pour le voir partir; et elle restait accoudée sur le bord, entre deux pots de géraniums […]. Charles, dans la rue, bouclait ses épe-rons sur la borne; et elle continuait à lui parler d’en [4] haut, tout en arrachant avec sa bouche quelque bribe de fleur ou de verdure qu’elle soufflait vers lui«. Das Burgfräulein lässt dem adligen Herrn Gemahl zum Abschied ein Blümchen hinunterschweben, während der Ritter sich aufs Ross schwingen und auf Abenteuer ausreiten darf?
Halt! Wir sind im 19. Jahrhundert, am Fenster steht eine kaum beschäftigte junge Frau (l’ennui – was für ein Thema!) mit vielen Flausen, in den Augen ihrer Schwiegermutter zumindest, das Ross ist ein schäbiger Gaul, der Reiter nicht der fähigste aller Landärzte auf dem Weg zum Broterwerb, kein Ausnahmemensch (»La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue, et les idées de tout le monde y défilaient«).
Die Klänge eines Klaviers sind zu hören, durch ein offenes Fenster: Eine Frau sitzt an diesem Fenster, genauer gesagt, dahinter. Das wahre Leben (das ailleurs, oder wie immer Emma selbst es nennen würde) spielt sich in ihren Augen ›draußen‹ ab, woanders eben: das Thema ist immer präsent. »Pourquoi, mon Dieu! me suis-je mariée?«.
Nach dem Einzug in das Haus, aus dem sie nicht mehr wegziehen wird, sitzt sie inmitten der Habseligkeiten ihrer bisherigen Existenz (»Au milieu de l’appartement, pêle-mêle, il y avait des tiroirs de commode, des bouteilles, des tringles«)‚ ihr Blick verliert sich wie von selbst in der Aussicht jenseits des noch kahlen Fensters (»On entrevoyait des cimes d’arbres, et plus loin la prairie, à demi noyée dans le brouillard, qui fumait au clair de la lune, selon le cours de la rivière«). Kaum hat Emma den Fuß in ihr neues [5] Heim gesetzt, die Kleiderbügel hängen noch nicht am Haken, die Kisten sind noch nicht ausgepackt, da schweift ihr Blick schon hinaus in das romantisch gefärbte, geheimnisvolle Anderswo. Kann das gutgehen?
Emma träumt von Glück, träumt sich ins Freie, jenseits des ›Fensters‹ sozusagen (»au delà s’étendait à perte de vue l’immense pays des félicités et des passions«). ›Fluchthelfer‹ treten in Erscheinung: Léon und Rodolphe heißen sie. Die junge Frau möchte an ihre Träume glauben, und dies gelingt ihr, wenigstens zeitweise – die Augen fest geschlossen gegenüber einer Realität, die, bei Licht betrachtet, in vielerlei Hinsicht auch die unsere ist.
Denken wir bei alledem an Flauberts oft zitierten, wenn auch vielleicht nicht zu belegenden Satz: »Madame Bovary, c’est moi, d’après moi« – »Madame Bovary, das bin ich selbst, so wie ich mich sehe«.
Emma/Gustave lebt in einer – ja: bürgerlichen Welt, die Träumereien der erwähnten Art nichts abgewinnen kann; was zählt, sind andere Werte. Jenes ›Streben nach Glück‹, wie es z. B. auch in der (nicht zuletzt von der französischen Aufklärung inspirierten) amerikanischen Verfassung als hehres Ziel der Menschheit festgehalten wird, verkommt mehr und mehr zu einem Streben nach rein materiellem Besitz. Schon Charles Bovarys Vater schnappt sich eine Mitgift – »une dot de soixante mille francs, qui s’offrait en la fille d’un marchand bonnetier«. Lässt sich der Stellenwert menschlicher Beziehungen in der Welt, von der Flaubert sich eingekreist sah, prägnanter darstellen?
Schauen wir uns die Erfolgreichen in Emmas Umgebung an. Da ist ein Händler, gleichzeitig ein [6] Darlehensberater (»Wucherer« hieß das zu Emmas Zeiten), der unter Einsatz aller finanztechnischen Mittel sein ›Glück‹ macht: Durch intensive Bemühungen (heute würde man wohl sagen: ›aggressives Marketing‹, es wäre ein positiv besetzter Begriff!) drängt er seinen Mitmenschen Waren auf, die sie nicht brauchen und auch nicht bezahlen können (Verführung zu immer mehr Konsum als Ersatz für nicht zu erfüllende Träume – was für ein Thema!), und bietet halsabschneiderische Finanzierungen an (»Il l’a assassiné de billets«, heißt es über eines seiner Opfer). Er treibt Emma in die Verschuldung und verdient noch kräftig am finanziellen Schiffbruch und damit am bürgerlichen Tod des Ehepaares Bovary. Und dass die Protagonistin unseres Romans am Ende Selbstmord begeht, ist eben nicht nur ihren sentimentalen Katastrophen zuzuschreiben, sondern auch und viel eher noch der handfesteren pekuniären … Wie heißt doch gleich dieser Mann? Lheureux, der Glückliche!
Glück gleich Gelderwerb um jeden Preis, auch über Leichen – auf eine kürzere Formel lässt sich Flauberts desillusionierter Blick auf die ihn und Emma umgebende Bürgerlichkeit kaum bringen. Was würde er zu einer Welt sagen, in der finanzieller Gewinn von Kapitalanlegern höher steht als die Lebenspläne Tausender Menschen, die von einem Glück träumen, das sich eben nur mit einem Arbeitsplatz realisieren lässt?
Und dann ist da noch ein anderer, ein fortschrittlicher Geist, Erbe der französischen Aufklärung und ihrer Ideen, Bewunderer Voltaires, Diderots, Echo aller modernen Gedanken des 18. Jahrhunderts, der großen Prinzipien der Französischen Revolution, als [7] glühender Laizist und Gegner der Geistlichkeit Vertreter staatstragender Ideen par excellence. Homais heißt der Mann, seines Zeichens Apotheker.
Dass er – und das ist der letzte Satz des Romans! – das Ehrenkreuz seines Staates erhält, gewissermaßen als Gütesiegel, als Auszeichnung für vorbildliches Wirken – bekräftigt dies nicht den Sieg des ›aufgeklärten‹ Bürgertums über alle Träumereien?
Ganz recht! Aber wie wird dieses Bürgertum in seiner Person dem Leser vorgeführt: großsprecherisch, verlogen-pathetisch, morsch bis ins Mark. Auch sein Wohlstand ist, wenigstens teilweise, Frucht widerlicher, illegaler Machenschaften.
Interessanterweise hat sich ein Autor unserer Zeit, Jean Améry, in einem eigenartigen, einzigartigen Werk2 auch dieser Figur angenommen und sie vehement gegen ihren eigenen Autor verteidigt. Seine Ausführungen gipfeln u. a. in der Feststellung, »die bürgerliche Aufklärung, das Erbe unserer Zivilisation, das unerlässliche Fundament einer jeden sozialistischen Utopie« werde in der Figur des Apothekers Homais »ins Lächerliche gezogen«. Eben, möchte man sagen – zeigt diese völlig richtige Beobachtung doch, wie scharfsichtig Flauberts vernichtend ironische Wertung ist, wie weit sie auch in eine Zukunft vorausdeutet, die wir zum Glück, wenigstens teilweise, schon wieder hinter uns haben.
Vergessen wir schließlich auch nicht jenen Mann der Kirche, bei dem Emma eines Abends in ihrer Traurigkeit Rat sucht. Ein freundlicher Mann, dieser Abbé [8] Bournisien, der sich halt nur so gar nicht vorzustellen vermag, dass ein Mensch in Not sein soll, dem es weder an Essen und Trinken noch an Feuerholz fehlt …
Darf, kann man ein Meisterwerk kürzen und damit verkürzen? Ein weltberühmtes Gemälde, sagen wir Leonardos Mona Lisa, auf halbe Höhe gestutzt, hie und da beschnitten – würde es noch bewundert? Vergessen wir nicht, dass Flaubert sich nach der ersten Veröffentlichung seines Romans 1857 in der Zeitschrift La Revue de Paris wütend von diesem ›Produkt‹ distanzierte, es verleugnete. Der Verleger hatte aus Angst vor Strafverfolgung (zu der es ja dann wirklich kam) als anstößig empfundene Passagen getilgt.
Das in Rouen aufbewahrte Manuskript der Madame Bovary entstand, wie die mit unzähligen Streichungen, Einfügungen, Abänderungen übersäten Seiten zeigen, in endlosem Ringen um jene Perfektion, die Flaubert in allem erstrebte, was er zu Papier brachte. War DER Abschnitt, DER Satz des Tages (oft nicht einmal das) zu Papier gebracht, ging’s zuweilen noch hinaus in den kleinen Garten, in seinen gueuloir, den ›Brüllhof‹, wo Wortgruppen und Sätze hinausgeschrien wurden, bis der Meister auch mit Klang und Rhythmus zufrieden war. Können bei einem Druckerzeugnis auch die noch wichtig sein? Natürlich, wenn man Gustave Flaubert heißt und davon träumt, eines Tages ein »Buch über nichts zu schreiben«3, ein Buch also, das nur noch Form wäre, ohne Inhalt.
[9] Es gibt mehr als eine Stelle, an denen um einzelne rhythmisierende Satzzeichen gerungen, vier, fünf Varianten verworfen wurden, bevor die Lösung den Schnauzbart, das ›Krokodil‹, wie er auch genannt wurde, zufriedenstellte.
Am Rande sei vermerkt, dass Kutscher aus Rouen sich seinerzeit bisweilen ein Zubrot verdienten, indem sie – vorwiegend englische – Reisende, Touristen würden wir sie heute nennen, zur Gartenmauer des ›Verrückten‹ führten, hinter der sie ihn mit etwas Glück brüllen hören konnten.
Darf, kann man ein solches Werk kürzen? Und doch – hat nicht Flaubert seinen Roman selbst schon gekürzt? Das in endloser Arbeit zurechtgefeilte Manuskript von mehreren tausend Seiten Umfang (fünf Jahre Schreibtischarbeit und Gebrüll im gueuloir!) verdichtete der Autor für die erste zu druckende Fassung auf 350 Druckseiten. Sechs Fassungen des Romans entstanden nach und nach. Wagen wir unsere Frage noch einmal?
Zurück zu Emmas Klavierspiel: »Elle frappait sur les touches avec aplomb, et parcourait du haut en bas tout le clavier sans s’interrompre«. Ist diese Passage nicht vielleicht entbehrlich? Natürlich nicht: Emma, die Bauerntochter mit den romantischen Träumen und der höheren Erziehung, tut diese unter anderem durch ihr Klavierspiel kund, das die tumben Dörfler staunen lässt, auch den Schreiber des Gerichtsvollziehers, der (womöglich mit einem [10] Vollstreckungsbescheid in der Hand – »sa feuille de papier à la main«) unter dem offenen Fenster innehält um zuzuhören. Gegen Ende des Romans wird genau so ein Bescheid ins Haus gebracht, und das Ende vom Lied ist, wie schon erwähnt, höchst bürgerlich dann, medizinisch-grausam und unromantisch, aber durch romantische Träume mit angezettelt.
Zu streichen? Natürlich nicht! Und doch …
Wenn der Herausgeber es dennoch wagt, eine Textauswahl aus Flauberts nie und nimmer zu verkürzendem Meisterwerk vorzulegen, dann aus verschiedenen Gründen:
Nicht jeder Leser mag sich auf ein derart umfangreiches Werk in einer Fremdsprache einlassen, die er vielleicht (noch) nicht ganz flüssig beherrscht, da kann eine kürzere Auswahl mit Hilfestellungen durch Wort- und Sachanmerkungen den Schritt über die Schwelle erleichtern.
Für eine Erarbeitung des Romans im Französisch-Unterricht eignet sich das Original in seiner schönen und unerhört dichten Umfänglichkeit ebenfalls nicht, zu kurz wären die zur Verfügung stehende Arbeitszeit und wohl auch der Spannungsbogen der Schülermotivation.
Und für viele andere Leser mag diese Ausgabe ein ›Köder‹ sein, ein Appetithappen besonderer Art, vielleicht eine Verführung zum Lesen ›in epischer Breite‹, in einer Originalausgabe, hinterher … Es wäre im Sinne des Herausgebers!
Karl Stoppel
Anmerkungen zum Vorwort
1. Gustave Flaubert, Madame Bovary, hrsg. von Maurice Bardèche, Paris: Librairie Générale Française, 1972 (Le Livre de Poche).
2. Jean Améry, Charles Bovary, Landarzt. Porträt eines einfachen Mannes, Stuttgart: Klett-Cotta, 2. Aufl. 1978.
3. Brief an Louise Colet vom 16. Januar 1852 (»Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c’est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, comme la terre se soutient dans l’air, un livre qui n’aurait presque pas de sujet ou du moins où le sujet serait presque invisible, si cela se peut«, Gustave Flaubert, Correspondance, hrsg. von Jean Bruneau, Bd. 2, Paris: Gallimard, 1980, S. 31).
[11] Madame BovaryMœurs de province
[12] ÀLouis Bouilhet
Louis Bouilhet: Freund Flauberts, Lyriker und Dramatiker (1821–69), der Flaubert im September 1849 empfohlen haben soll, das Schicksal der Delphine Delamare literarisch zu verarbeiten.[13] Première partie
I
Nous étions à l’Étude, quand le Proviseur entra, suivi d’un nouveau habillé en bourgeois et d’un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent, et chacun se leva comme surpris dans son travail.
Le Proviseur nous fit signe de nous rasseoir; puis, se tournant vers le maître d’études:
– Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande, il entre en cinquième. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands, où l’appelle son âge.
Resté dans l’angle, derrière la porte, si bien qu’on l’apercevait à peine, le nouveau était un gars de la campagne, d’une quinzaine d’années environ, et plus haut de taille qu’aucun de nous tous. Il avait les cheveux coupés droit sur le front, comme un chantre de village, l’air raisonnable et fort embarrassé. Quoiqu’il ne fût pas large des épaules, son habit-veste de drap vert à boutons noirs devait le gêner aux entournures[14] et laissait voir, par la fente des parements, des poignets rouges habitués à être nus. Ses jambes, en bas bleus, sortaient d’un pantalon jaunâtre très tiré par les bretelles. Il était chaussé de souliers forts, mal cirés, garnis de clous.
On commença la récitation des leçons. Il les écouta de toutes ses oreilles, attentif comme au sermon, n’osant même croiser les cuisses, ni s’appuyer sur le coude, et, à deux heures, quand la cloche sonna, le maître d’études fut obligé de l’avertir, pour qu’il se mît avec nous dans les rangs.
Nous avions l’habitude, en entrant en classe, de jeter nos casquettes par terre, afin d’avoir ensuite nos mains plus libres; il fallait, dès le seuil de la porte, les lancer sous le banc, de façon à frapper contre la muraille en faisant beaucoup de poussière; c’était là le genre.
Mais, soit qu’il n’eût pas remarqué cette manœuvre ou qu’il n’eût osé s’y soumettre, la prière était finie que le nouveau tenait encore sa casquette sur ses deux genoux. C’était une de ces coiffures d’ordre composite, où l’on retrouve les éléments du bonnet à[15] poil, du chapska, du chapeau rond, de la casquette de loutre et du bonnet de coton, une de ces pauvres choses, enfin, dont la laideur muette a des profondeurs d’expression comme le visage d’un imbécile. Ovoïde et renflée de baleines, elle commençait par trois boudins circulaires; puis s’alternaient, séparés par une bande rouge, des losanges de velours et de poils de lapin; venait ensuite une façon de sac qui se terminait par un polygone cartonné, couvert d’une broderie en soutache compliquée, et d’où pendait, au bout d’un long cordon trop mince, un petit croisillon de fils d’or, en manière de gland. Elle était neuve; la visière brillait.
– Levez-vous, dit le professeur.
Il se leva; sa casquette tomba. Toute la classe se mit à rire.
Il se baissa pour la reprendre. Un voisin la fit tomber d’un coup de coude, il la ramassa encore une fois.
– Débarrassez-vous donc de votre casque, dit le professeur qui était un homme d’esprit. Il y eut un rire éclatant des écoliers qui décontenança le pauvre garçon, si bien qu’il ne savait s’il fallait garder sa [16] casquette à la main, la laisser par terre ou la mettre sur sa tête. Il se rassit et la posa sur ses genoux.
– Levez-vous, reprit le professeur, et dites-moi votre nom.
Le nouveau articula, d’une voix bredouillante, un nom inintelligible.
– Répétez!
Le même bredouillement de syllabes se fit entendre, couvert par les huées de la classe.
– Plus haut! cria le maître, plus haut!
Le nouveau, prenant alors une résolution extrême, ouvrit une bouche démesurée et lança à pleins poumons, comme pour appeler quelqu’un, ce mot: Charbovari.
Ce fut un vacarme qui s’élança d’un bond, monta en crescendo, avec des éclatsde voix aigus (on hurlait, on aboyait, on trépignait, on répétait: Charbovari! Charbovari!), puis qui roula en notes isolées, se calmant à grand-peine, et parfois qui reprenait tout à coup sur la ligne d’un banc où saillissait encore çà et là, comme un pétard mal éteint, quelque rire étouffé.
Cependant, sous la pluie des pensums, l’ordre peu à peu se rétablit dans la classe, et le professeur, parvenu [17] à saisir le nom de Charles Bovary, se l’étant fait dicter, épeler et relire, commanda tout de suite au pauvre diable d’aller s’asseoir sur le banc de paresse, au pied de la chaire. Il se mit en mouvement, mais, avant de partir, hésita.
– Que cherchez-vous? demanda le professeur.
– Ma cas…, fit timidement le nouveau, promenant autour de lui des regards inquiets.
– Cinq cents vers à toute la classe! exclamé d’une voix furieuse, arrêta, comme le Quos ego, une bourrasque nouvelle. – Restez donc tranquilles! continuait le professeur indigné, et s’essuyant le front avec son mouchoir qu’il venait de prendre dans sa toque: Quant à vous, le nouveau, vous me copierez vingt fois le verbe ridiculus sum.
Puis, d’une voix plus douce:
– Eh! vous la retrouverez, votre casquette; on ne vous l’a pas volée!
Tout reprit son calme. Les têtes se courbèrent sur les cartons, et le nouveau resta pendant deux heures dans une tenue exemplaire, quoiqu’il y eût bien, de temps à autre, quelque boulette de papier lancée d’un bec de plume qui vînt s’éclabousser sur sa figure. Mais [18] il s’essuyait avec la main, et demeurait immobile, les yeux baissés.
Le soir, à l’Étude, il tira ses bouts de manches de son pupitre, mit en ordre ses petites affaires, régla soigneusement son papier. Nous le vîmes qui travaillait en conscience, cherchant tous les mots dans le dictionnaire et se donnant beaucoup de mal. Grâce, sans doute, à cette bonne volonté dont il fit preuve, il dut de ne pas descendre dans la classe inférieure; car, s’il savait passablement ses règles, il n’avait guère d’élégance dans les tournures. C’était le curé de son village qui lui avait commencé le latin, ses parents, par économie, ne l’ayant envoyé au collège que le plus tard possible.
Son père, M. Charles-Denis-Bartholomé Bovary, ancien aide-chirurgien-major, compromis, vers 1812, dans des affaires de conscription, et forcé, vers cette époque, de quitter le service, avait alors profité de ses avantages personnels pour saisir au passage une dotde soixante mille francs, qui s’offrait en la fille d’un marchand bonnetier, devenue amoureuse de sa tournure. Bel homme, hâbleur, faisant sonner haut ses éperons, portant des favorisrejoints aux moustaches, les doigts toujours garnis de bagues et habillé de [19] couleurs voyantes, il avait l’aspect d’un brave, avec l’entrain facile d’un commis voyageur. Une fois marié, il vécut deux ou trois ans sur la fortune de sa femme, dînant bien, se levant tard, fumant dans de grandes pipes en porcelaine, ne rentrant le soir qu’après le spectacle et fréquentant les cafés. Le beau-père mourut et laissa peu de chose; il en fut indigné, se lança dans la fabrique, y perdit quelque argent, puis se retira dans la campagne, où il voulut faire valoir. Mais, comme il ne s’entendait guère plus en culture qu’en indiennes, qu’il montait ses chevaux au lieu de les envoyer au labour, buvait son cidre en bouteilles au lieu de le vendre en barriques, mangeait les plus belles volailles de sa cour et graissait ses souliers de chasse avec le lard de ses cochons, il ne tarda point à s’apercevoir qu’il valait mieux planter là toute spéculation.
Moyennant deux cents francs par an, il trouva donc à louer dans un village, sur les confins du pays de Caux et de la Picardie, une sorte de logis moitié ferme, moitié maison de maître; et, chagrin, rongé de regrets, accusant le ciel, jaloux contre tout le monde, il [20] s’enferma dès l’âge de quarante-cinq ans, dégoûté des hommes, disait-il, et décidé à vivre en paix.
Sa femme avait été folle de lui autrefois; elle l’avait aimé avec mille servilités qui l’avaient détaché d’elle encore davantage. Enjouée jadis, expansive et tout aimante, elle était, en vieillissant, devenue (à la façon du vin éventé qui se tourne en vinaigre) d’humeur difficile, piaillarde, nerveuse. Elle avait tant souffert, sans se plaindre, d’abord, quand elle le voyait courir après toutes les gotons de village et que vingt mauvais lieux le lui renvoyaient le soir, blasé et puant l’ivresse! Puis l’orgueil s’était révolté. Alors elle s’était tue, avalant sa rage dans un stoïcisme muet, qu’elle garda jusqu’à sa mort. Elle était sans cesse en courses, en affaires. Elle allait chez les avoués, chez le président, se rappelait l’échéance des billets, obtenait des retards; et, à la maison, repassait, cousait, blanchissait, surveillait les ouvriers, soldait les mémoires, tandis que, sans s’inquiéter de rien, Monsieur, continuellement engourdi dans une somnolenceboudeuse dont il ne se [21] réveillait que pour lui dire des choses désobligeantes, restait à fumer au coin du feu, en crachant dans les cendres.
Quand elle eut un enfant, il le fallut mettre en nourrice. Rentré chez eux, le marmot fut gâté comme un prince. Sa mère le nourrissait de confitures; son père le laissait courir sans souliers, et, pour faire le philosophe, disait même qu’il pouvait bien aller tout nu, comme les enfants des bêtes. À l’encontre des tendances maternelles, il avait en tête un certain idéal viril de l’enfance, d’après lequel il tâchait de former son fils, voulant qu’on l’élevât durement, à la spartiate, pour lui faire une bonne constitution. Il l’envoyait se coucher sans feu, lui apprenait à boire de grands coups de rhum et à insulter les processions. Mais, naturellement paisible, le petit répondait mal à ses efforts. Sa mère le traînait toujours après elle; elle lui découpait des cartons, lui racontait des histoires, s’entretenait avec lui dans des monologues sans fin, pleins de gaietés mélancoliques et de chatteriesbabillardes. Dans l’isolement de sa vie, elle reporta sur cette tête d’enfant toutes ses vanitéséparses, brisées. Elle rêvait de hautes positions, elle le voyait déjà grand, beau, [22] spirituel, établi, dans les pontset chaussées ou dans la magistrature. Elle lui apprit à lire, et même lui enseigna, sur un vieux piano qu’elle avait, à chanter deux ou trois petites romances. Mais, à tout cela, M. Bovary, peu soucieux des lettres, disait que ce n’était pas la peine! Auraient-ils jamais de quoi l’entretenir dans les écoles du gouvernement, lui acheter une charge ou un fonds de commerce? D’ailleurs, avec du toupet, un homme réussit toujours dans le monde. Madame Bovary se mordait les lèvres, et l’enfant vagabondait dans le village.
Il suivait les laboureurs, et chassait, à coups de motte de terre, les corbeaux qui s’envolaient. Il mangeait des mûres le long des fossés, gardait les dindons avec une gaule, fanait à la moisson, courait dans le bois, jouait à la marelle sous le porche de l’église les jours de pluie, et, aux grandes fêtes, suppliait le bedeau de lui laisser sonner les cloches, pour se pendre de tout son corps à la grande corde et se sentir emporter par elle dans sa volée.
Aussi poussa-t-il comme un chêne. Il acquit de fortes mains, de belles couleurs.
[23] À douze ans, sa mère obtint que l’on commençât ses études. On en chargea le curé. Mais les leçons étaient si courtes et si mal suivies, qu’elles ne pouvaient servir à grand-chose. C’était aux moments perdus qu’elles se donnaient, dans la sacristie, debout, à la hâte, entre un baptême et un enterrement; ou bien le curé envoyait chercher son élève après l’Angelus, quand il n’avait pas à sortir. On montait dans sa chambre, on s’installait: les moucherons et les papillons de nuit tournoyaient autour de la chandelle. Il faisait chaud, l’enfant s’endormait; et le bonhomme, s’assoupissant les mains sur son ventre, ne tardait pas à ronfler, la bouche ouverte. D’autres fois, quand M. le curé, revenant de porter le viatique à quelque malade des environs, apercevait Charles qui polissonnait dans la campagne, il l’appelait, le sermonnait un quart d’heure et profitait de l’occasion pour lui faire conjuguer son verbe au pied d’un arbre. La pluie venait les interrompre, ou une connaissance qui passait. Du reste, il était toujours content de lui, disait même que le jeune homme avait beaucoup de mémoire.
Charles ne pouvait en rester là. Madame fut énergique. Honteux, ou fatigué plutôt, Monsieur céda sans résistance, et l’on attendit encore un an que le gamin eût fait sa première communion.
[24] Six mois se passèrent encore; et, l’année d’après, Charles fut définitivement envoyé au collège de Rouen, où son père l’amena lui-même, vers la fin d’octobre, à l’époque de la foire Saint-Romain.
Il serait maintenant impossible à aucun de nous de se rien rappeler de lui. C’était un garçon de tempérament modéré, qui jouait aux récréations, travaillait à l’étude, écoutant en classe, dormant bien au dortoir, mangeant bien au réfectoire. Il avait pour correspondant un quincaillier en gros de la rue Ganterie, qui le faisait sortir une fois par mois, le dimanche, après que sa boutique était fermée, l’envoyait se promener sur le port à regarder les bateaux, puis le ramenait au collège dès sept heures, avant le souper. Le soir de chaque jeudi, il écrivait une longue lettre à sa mère, avec de l’encre rouge et trois pains à cacheter; puis il repassait ses cahiers d’histoire, ou bien lisait un vieux volumed’Anacharsis qui traînait dans l’étude. En promenade, il causait avec le domestique, qui était de la campagne comme lui.
À force de s’appliquer, il se maintint toujours vers le milieu de la classe; une fois même, il gagna un premier accessit d’histoire naturelle. Mais à la fin de sa [25] troisième, ses parents le retirèrent du collège pour lui faire étudier la médecine, persuadés qu’il pourrait se pousser seul jusqu’au baccalauréat.
Sa mère lui choisit une chambre, au quatrième, sur l’Eau-de-Robec, chez un teinturier de sa connaissance. Elle conclut les arrangements pour sa pension, se procura des meubles, une table et deux chaises, fit venir de chez elle un vieux lit en merisier, et acheta de plus un petit poêle en fonte, avec la provision de bois qui devait chauffer son pauvre enfant. Puis elle partit au bout de la semaine, après mille recommandations de se bien conduire, maintenant qu’il allait être abandonné à lui-même.
Le programme des cours, qu’il lut sur l’affiche, lui fit un effet d’étourdissement: cours d’anatomie, cours de pathologie, cours de physiologie, cours de pharmacie, cours de chimie, et de botanique, et de clinique, et de thérapeutique, sans compter l’hygiène ni la matière médicale, tous noms dont il ignorait les étymologies et qui étaient comme autant de portes de sanctuaires pleins d’augustesténèbres.
Il n’y comprit rien; il avait beau écouter, il ne saisissait pas. Il travaillait pourtant, il avait des cahiers reliés, il suivait tous les cours, il ne perdait pas une [26] seule visite. Il accomplissait sa petite tâche quotidienne à la manière du cheval de manège, qui tourne en place les yeux bandés, ignorant de la besogne qu’il broie.
Pour lui épargner de la dépense, sa mère lui envoyait chaque semaine, par le messager, un morceau de veaucuit au four, avec quoi il déjeunait le matin, quand il était rentré de l’hôpital, tout en battant la semelle contre le mur. Ensuite il fallait courir aux leçons, à l’amphithéâtre, à l’hospice, et revenir chez lui, à travers toutes les rues. Le soir, après le maigre dîner de son propriétaire, il remontait à sa chambre et se remettait au travail, dans ses habits mouillés qui fumaient sur son corps, devant le poêle rougi.
Dans les beaux soirs d’été, à l’heure où les rues tièdes sont vides, quand les servantes jouent au volant sur le seuil des portes, il ouvrait sa fenêtre et s’accoudait. La rivière, qui fait de ce quartier de Rouen comme une ignoble petite Venise, coulait en bas, sous lui, jaune, violette ou bleue, entre ses ponts et ses grilles. Des ouvriers, accroupis au bord, lavaient leurs bras dans l’eau. Sur des perches partant du haut des [27]greniers, des écheveaux de coton séchaient à l’air. En face, au-delà des toits, le grand ciel pur s’étendait, avec le soleil rouge se couchant. Qu’il devait faire bon là-bas! Quelle fraîcheur sous la hêtrée! Et il ouvrait les narines pour aspirer les bonnes odeurs de la campagne, qui ne venaient pas jusqu’à lui.
Il maigrit, sa taille s’allongea, et sa figure prit une sorte d’expression dolente qui la rendit presque intéressante.
Naturellement, par nonchalance, il en vint à se délier de toutes les résolutions qu’il s’était faites. Une fois, il manqua la visite, le lendemain son cours, et, savourant la paresse, peu à peu, n’y retourna plus.
Il prit l’habitude du cabaret, avec la passion des dominos. S’enfermer chaque soir dans un sale appartement public, pour y taper sur des tables de marbre de petits os de mouton marqués de points noirs, lui semblait un acte précieux de sa liberté, qui le rehaussait d’estime vis-à-vis de lui-même. C’était comme l’initiation au monde, l’accès des plaisirs défendus; et, en entrant, il posait la main sur le bouton de la porte avec une joie presque sensuelle. Alors, beaucoup de choses comprimées en lui, se dilatèrent; il apprit par cœur [28] des couplets qu’il chantait aux bienvenues, s’enthousiasma pour Béranger, sut faire du punch et connut enfin l’amour.
Grâce à ces travaux préparatoires, il échoua complètement à son examen d’officier de santé. On l’attendait le soir même à la maison pour fêter son succès!
Il partit à pied et s’arrêta vers l’entrée du village, où il fit demander sa mère, lui conta tout. Elle l’excusa, rejetant l’échec sur l’injustice des examinateurs, et le raffermit un peu, se chargeant d’arranger les choses. Cinq ans plus tard seulement, M. Bovary connut la vérité; elle était vieille, il l’accepta, ne pouvant d’ailleurs supposer qu’un homme issu de lui fût un sot.
Charles se remit donc au travail et prépara sans discontinuer les matières de son examen, dont il apprit d’avance toutes les questions par cœur. Il fut reçu avec une assez bonne note. Quel beau jour pour sa mère! On donna un grand dîner.
Où irait-il exercer son art? À Tostes. Il n’y avait là qu’un vieux médecin. Depuis longtemps madame Bovary guettait sa mort, et le bonhomme n’avait point encore plié bagage, que Charles était installé en face, comme son successeur.
[29] Mais ce n’était pas tout que d’avoir élevé son fils, de lui avoir fait apprendre la médecine et découvert Tostes pour l’exercer: il lui fallait une femme. Elle lui en trouva une: la veuve d’un huissier de Dieppe, qui avait quarante-cinq ans et douze cents livres de rente.
Quoiqu’elle fût laide, sèche comme un cotret, et bourgeonnée comme un printemps, certes madame Dubuc ne manquait pas de partis à choisir. Pour arriver à ses fins, la mère Bovary fut obligée de les évincer tous, et elle déjoua même fort habilement les intrigues d’un charcutier qui était soutenu par les prêtres.
Charles avait entrevu dans le mariage l’avènement d’une condition meilleure, imaginant qu’il serait plus libre et pourrait disposer de sa personne et de son argent. Mais sa femme fut le maître; il devait devant le monde dire ceci, ne pas dire cela, faire maigre tous les vendredis, s’habiller comme elle l’entendait, harceler par son ordre les clients qui ne payaient pas. Elle décachetait ses lettres, épiait ses démarches, et [30] l’écoutait, à travers la cloison, donner ses consultations dans son cabinet, quand il y avait des femmes.
Il lui fallait son chocolat tous les matins, des égards à n’en plus finir. Elle se plaignait sans cesse de ses nerfs, de sa poitrine, de ses humeurs. Le bruit des pas lui faisait mal; on s’en allait, la solitude lui devenait odieuse; revenait-on près d’elle, c’était pour la voir mourir, sans doute. Le soir, quand Charles rentrait, elle sortait de dessous ses draps ses longs bras maigres, les lui passait autour du cou, et, l’ayant fait asseoir au bord du lit, se mettait à lui parler de ses chagrins: il l’oubliait, il en aimait une autre! On lui avait bien dit qu’elle serait malheureuse; et elle finissait en lui demandant quelque sirop pour sa santé et un peu plus d’amour.
II
Une nuit, on vient chercher Charles Bovary pour lui faire soigner un certain M. Rouault qui s’est cassé la jambe. C’est le propriétaire de la ferme des Bertaux et Charles s’en occupe de son mieux. C’est alors qu’il fait la connaissance de sa fille, Emma Rouault, et c’est pour la revoir qu’il devient un familier de la ferme.
La femme de Charles ne tarde pas de s’en apercevoir et de lui faire des scènes. Mais elle meurt peu après, ayant perdu toute sa fortune.
[31] III
Un matin, le père Rouault vint apporter à Charles le payement de sa jambe remise: soixante et quinze francs en pièces de quarante sous, et une dinde. Il avait appris son malheur, et l’en consola tant qu’il put.
Charles revient aux Bertaux.
Il arriva un jour vers trois heures; tout le monde était aux champs; il entra dans la cuisine, mais n’aperçut point d’abord Emma; les auvents étaient fermés. Par les fentes du bois, le soleil allongeait sur les pavés de grandes raies minces, qui se brisaient à l’angle des meubles et tremblaient au plafond. Des mouches, sur la table, montaient le long des verres qui avaient servi, et bourdonnaient en se noyant au fond, dans le cidre resté. Le jour qui descendait par la cheminée, veloutant la suie de la plaque, bleuissait un peu les cendres froides. Entre la fenêtre et le foyer, Emma cousait; elle n’avait point de fichu, on voyait sur ses épaules nues de petites gouttes de sueur.
[32]Selon la mode de la campagne, elle lui proposa de boire quelque chose. Il refusa, elle insista, et enfin lui offrit, en riant, de prendre un verre de liqueur avec elle. Elle alla donc chercher dans l’armoire une bouteille de curaçao, atteignit deux petits verres, emplit l’un jusqu’au bord, versa à peine dans l’autre, et, après avoir trinqué, le porta à sa bouche. Comme il était presque vide, elle se renversait pour boire; et, la tête en arrière, les lèvres avancées, le cou tendu, elle riait de ne rien sentir, tandis que le bout de sa langue, passant entre ses dents fines, léchait à petits coups le fond du verre.
[…]
Elle se plaignit d’éprouver, depuis le commencement de la saison, des étourdissements; elle demanda si les bains de mer lui seraient utiles; elle se mit à causer du couvent





























