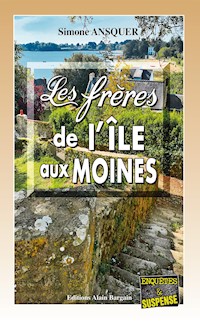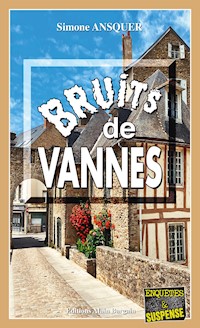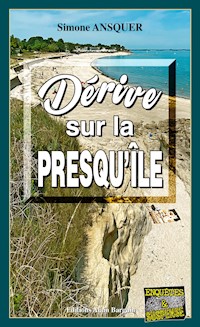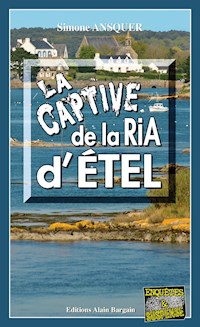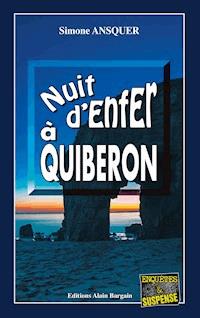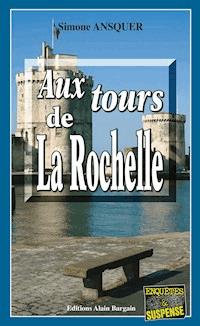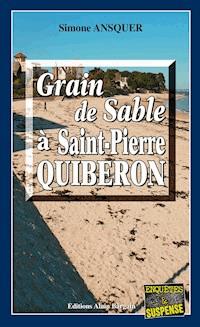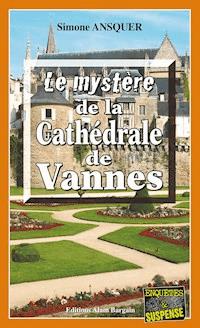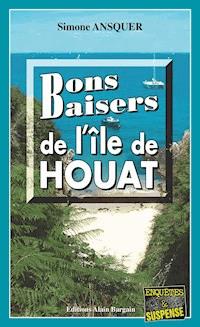
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Une carte postale glaçante…
À Houat, Juliette étudie les algues et veille sur son frère Victor, un colosse attendrissant, légèrement attardé. Mais lorsqu’un soir de tempête, son frère ramène un homme à l’agonie chez eux, sa vie va s’en trouver bouleversée.
Qui est cet inconnu ? Que signifie cette carte postale de la grande plage qu’il a dans sa poche ? Au dos de la carte, une question : « Qui a tué Gwidal ? » la glace d’effroi. Ce que Juliette ne sait pas encore, c’est que les témoins d’une terrible tragédie, survenue six ans auparavant, s’apprêtent à quitter Londres et Tokyo pour venir prendre le ferry pour Houat...
Un décor insulaire breton pour un thriller haletant !
EXTRAIT
Quoi de plus délicieux que de recevoir une carte postale avec une vue d’une plage de sable blanc ?
Un matin, elle arrive dans votre boîte aux lettres et vous en éprouvez de la nostalgie. Vous tentez de déchiffrer l’écriture, de voir qui a pu penser à vous et écrire à la main quelques mots à votre intention, puis coller un timbre et glisser dans une boîte, ce paysage de rêve sur papier cartonné. Qui a pris le temps d’accomplir ces actes dans un monde pressé où les SMS tiennent le haut du pavé ?
Et s’il n’y avait pas de signature et si les quelques mots rédigés vous glaçaient d’effroi, la déchireriez-vous ? Et si l’année suivante, à la même date, le messager se rappelait à votre bon souvenir en vous adressant une seconde carte postale identique ?
CE QU’EN PENSE LA CRITIQUE
Editions Bargain, le succès du polar breton. -
Ouest France
À PROPOS DE L'AUTEUR
Née à La Rochelle en 1960 où elle a grandi,
Simone Ansquer vit aujourd'hui dans la presqu'île de Quiberon et y cultive ses passions pour les sports nautiques, les voyages, l'histoire et la peinture. Avec ce sixième roman, l'auteure signe un thriller psychologique captivant.
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -
Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
À mes tantes.
PROLOGUE
Quoi de plus délicieux que de recevoir une carte postale avec une vue d’une plage de sable blanc ?
Un matin, elle arrive dans votre boîte aux lettres et vous en éprouvez de la nostalgie. Vous tentez de déchiffrer l’écriture, de voir qui a pu penser à vous et écrire à la main quelques mots à votre intention, puis coller un timbre et glisser dans une boîte, ce paysage de rêve sur papier cartonné. Qui a pris le temps d’accomplir ces actes dans un monde pressé où les SMS tiennent le haut du pavé ?
Et s’il n’y avait pas de signature et si les quelques mots rédigés vous glaçaient d’effroi, la déchireriez-vous ? Et si l’année suivante, à la même date, le messager se rappelait à votre bon souvenir en vous adressant une seconde carte postale identique ?
Pour Paul, Éliot et Marthe, le terrifiant jeu dura six ans. Aux quatre coins du monde, où qu’ils fussent, le 15 mai de chaque année, ils recevaient une carte postale de la grande plage de Houat avec au dos, uniquement ces quatre mots : « Qui a tué Gwidal ? » Ce rituel macabre perdura cinq ans. La sixième année, un événement terrible se produisit : l’un des destinataires disparut.
I
PAUL
Londres - Le 14 mai, en soirée.
D’un trait, Paul but son bourbon puis, avec rage, posa son verre vide sur la table basse du salon. Il se tenait prêt à crier : « Va au diable, messager de malheur ! » La haine le dévorait de l’intérieur, mais il se devait de la maîtriser en la ravalant. Survivre passait par le contrôle de cette colère autodestructrice. La gorge en feu, les nerfs à vif, il savait pertinemment qu’il devait à nouveau tourner une page de sa vie, une de plus. Son existence ressemblait à un mille-feuille avarié, au point que l’idée même de cette pâtisserie infecte lui donna la nausée. Sur les feuillets de son journal intime, il aurait pu écrire : « Cinq mois à Berlin, sept à Barcelone, huit à Rome et nulle attache dans aucune de ces villes. Je suis incapable d’aimer parce que je suis mort de l’intérieur. » Pour tenter de se calmer, il se mit à tapoter sur l’écran de son Smartphone. Son index s’agitait trop frénétiquement, trahissant son état de nervosité extrême. Paul nota « Goodbye » puis rangea son mobile dans son sac de voyage. Déterminé à se métamorphoser en un tissu imbibé d’alcool, il attrapa la bouteille et avala une rasade à même le goulot. Une fois encore, il se devait de fuir et de trouver le courage de cette fuite éperdue.
Pourtant, le 3 mars dernier, lorsqu’il avait emménagé à Notting Hill, le soleil éclairait divinement la façade victorienne de la grande maison qui allait l’accueillir. La demeure était divisée en quatre appartements. Dès la porte passée, le meublé du premier étage lui avait plu parce qu’aménagé dans un style excessivement épuré, voire impersonnel. Il ne voulait plus s’attacher au lieu. À Rome, il avait commis l’erreur de louer un duplex atypique, donnant sur cour, dans le quartier San Lorenzo. Il y faisait trop bon vivre. En quittant Rome, il s’était juré que ses états d’âme ne devraient plus jamais se lover au milieu de coussins trop moelleux. Mais, naturellement, la lune de miel entre Paul et ce nouveau cocon londonien s’était avérée, elle aussi, de courte durée. Le 8 mars, il avait senti une vilaine mélancolie le gagner, accentuée par la blancheur des quatre murs qui l’expédiaient au tombeau à vitesse grand V. Par instinct de survie, il avait décidé d’œuvrer pour l’avènement de la méchanceté gratuite en créant son blog. La malveillance lui avait toujours servi de carapace. Ainsi, depuis deux mois, il lançait des “bruits de couloir” sur la Toile, pesant ses mots, commentant à propos, avec un ton acerbe et une impertinence communicative, du gravement mauvais. Ce “Frenchie” incisif, révélait haut et fort, en fait en silence via la Toile, des secrets malodorants. Se délecter en divulguant qu’un dénommé Georges T, policier de son état, s’en mettait plein les poches en couvrant des malversations ou bien qu’un certain tabloïd se servait de tables d’écoutes pour espionner une star montante du R’n’B établie dans le quartier ou encore que la concierge du vingt-trois vendait ses charmes sur le Net, cela en faisant rire jaune certains, et surtout les concernés. L’administration locale avait Paul dans le collimateur. Redoutant son point de vue, elle se tenait prête à le faire tomber au moindre faux pas, guettant le terme diffamatoire. D’aucuns pensaient que le Français serait bientôt la cible du réseau de vidéosurveillance de Notting Hill. Les caméras ne traqueraient plus uniquement les pickpockets durant le Carnaval d’août mais s’en donneraient à cœur joie en suivant Paul Montier dans ses déplacements quotidiens, de sa librairie préférée à son pub de prédilection, tout cela en avant-saison estivale. Lui se contrefichait de cette surveillance. Il trompait l’ennui, uniquement. Dans son dos, ses voisins chuchotaient : « Comment ce mangeur d’escargots est-il entré dans les secrets d’alcôve de ce quartier résidentiel huppé londonien ? Quels sont ses indics ? De quoi vit-il ? » La police anglaise n’aurait pas le temps de se pencher sur l’affaire “Montier”, si affaire il y avait, sa décision de fuir allait clore tous les débats. Une semaine auparavant, Paul avait reçu sur son portable, un message de dix-huit caractères qui venait de déclencher sa décision : faire ses bagages au plus vite.
Ce 14 mai à vingt-deux heures, Paul mettait un point final à son existence virtuelle, hautement malsaine, clôturant son blog tout comme son compte sur Twitter. Au mieux, quelques Londoniens, addicts au croustillant, auraient un pincement au cœur. L’un d’eux lancerait sur la Toile : « Dans notre grisaille londonienne, un rayon de soleil brûlant vient de s’éteindre » et doublerait par « Coup de tonnerre à Notting Hill. » Dans trois jours, Montier n’existerait plus sur le Net. Il le savait pertinemment. Le monde virtuel se révélait cruel, les internautes surfant sur les buzz du moment et les oubliant très vite. Que personne ne cherche à connaître la cause de ce claquement de porte, Montier ne s’en offusquait pas. Les règles lui plaisaient. Il aurait pu écrire « Qui a tué Gwidal ? Tel était le message de mon enfer », mais il se garda bien de dévoiler son secret à quiconque. Avant, il s’imaginait bon ; depuis la mort de Gwidal, il pataugeait dans une bauge et s’y complaisait.
Chaque année, le lendemain de son anniversaire, Paul recevait une carte postale représentant une vue de la grande plage de Houat, une île située en Bretagne Sud. Au dos était écrit « Qui a tué Gwidal ? », uniquement ces quatre mots, sans nulle signature. Cette année, la terrifiante question était apparue sur l’écran de son portable. Ce message annonçait probablement l’arrivée de l’angoissant courrier. L’auteur de l’écrit venait de changer de mode opératoire, se tenant prêt à doubler l’annonce. Il avait joué finement en envoyant un SMS anonyme, plantant ainsi un coup de poignard dans le cœur de Paul. Après avoir découvert le message, Paul avait vainement tenté d’en retrouver la source. Se sentant traqué et impuissant, il avait décidé de réagir en rentrant en France.
Arrivé à Londres le bagage léger, il repartirait son sac sur l’épaule. Seul son cœur serait plus lourd, à peine. Il venait de rompre avec Jane, sans daigner lui fournir la moindre explication. Depuis six ans, Paul respectait un grand principe qui guidait ses actes : ne s’attacher ni aux gens ni aux biens pour ne pas avoir à souffrir en s’en séparant. En matière de relations amoureuses, il reproduisait sa façon de choisir un loft ou un deux-pièces. Comme tomber amoureux d’une femme aux mensurations parfaites et à la conversation limitée lui semblait impossible, il entretenait des relations avec de jolies filles, jeunes et adeptes des minauderies. Si Jane entrait parfaitement dans cette catégorie, elle n’en était pas moins d’une sensiblerie touchante. Pourtant, le jour de leur rencontre, il le lui avait bien dit : « Je ne suis qu’un bandit de grand chemin qui dépouille les bien-pensants et fouille les tas d’ordures… ne t’attache jamais à moi. » Il ne lui avait rien promis, mais les femmes croient toujours. Carmen, Giovanna et Kristen l’avaient oublié. Jane ferait de même, après quelques pleurs et si peu de douleur… Lui, il n’avait réellement aimé qu’une seule personne. En se perdant dans les bras de toutes ces femmes, il pensait l’oublier mais se fourvoyait.
Cette nostalgie soudaine décupla son penchant à l’irritabilité. Pour décharger sa colère, il se leva d’un bond du sofa, donna un coup de pied rageur dans la table basse, puis ouvrit en grand la porte-fenêtre donnant sur le balcon. La nuit était franchement douce, la météo propice à griller une cigarette à l’extérieur. Accoudé à la balustrade, il porta son regard vers le ciel de Londres, en tirant une bouffée. Demain, la carte postale maudite le suivrait jusque-là, traversant le Channel et finissant dans sa boîte aux lettres, à Notting Hill. Cette insupportable certitude lui gâcha le plaisir de cet instant qui aurait dû être béni des dieux, du fait de l’apparition d’une déesse d’acier. Dans la rue, une Jaguar XKR, racée, souple, féline et sportive, roulait à petite vitesse. Son compte en banque lui aurait permis de se payer un tel petit bijou et même d’offrir à Gwidal un plaisir identique. L’argent ne rendait pas la vie. Un mort ne consomme plus rien et Gwidal l’était bel et bien. Lui qui rêvait de conduire une Aston Martin. « La V12 vintage me donne le vertige. Sa vue fait s’activer des centaines de “voxels” partout dans mon cortex », disait-il, avant de rajouter : « Un coupé qui respire avec son capot ajouré de quatre ouïes ! » Une grosse boule obstrua le larynx de Paul. Ses sentiments à l’égard de Gwidal resteraient à jamais ambivalents, une fascination teintée de répulsion. Six ans déjà. Cette sixième carte marquerait la fêlure, il en était certain. Cet impitoyable jeu du chat et de la souris avait suffisamment duré. Fuir ne lui servirait à rien. Son passé le rattrapait chaque année, où qu’il aille, quoi qu’il fasse. Qu’il devienne une ordure, un malfaisant ou un saint ne changerait rien à cela. Celui qui lui envoyait la carte postale savait tout de lui et de ses penchants malsains. La rédemption n’y aurait rien changé. Alors il décida d’affronter la mort de Gwidal et de faire revivre le passé. Il venait de fêter son trente-quatrième anniversaire, seul à Londres, trinquant avec lui-même. La bouteille de bourbon dans la main, sur ce balcon londonien, il se jura que l’an prochain, à la même date, il serait mort ou bien en vie avec une existence tout autre. Cette promesse faite à lui-même valait bien plus que toute autre. Nul besoin de témoin, il ne pouvait poursuivre ainsi cette déperdition insensée.
La Jaguar disparut au coin de la rue, deux pies prirent leur envol de concert. Paul se sentit vide, car aucun amour ne remplissait sa vie. Jane, l’éconduite aux seins de velours, ne connaissait même pas sa date de naissance. Il était né le 14 mai et s’apprêtait à boucler à nouveau sa valise.
II
ÉLIOT
Noashima, l’île - Japon - Le 15 mai au matin.
Dans le hall de l’hôtel Mitschu, assis dans un petit canapé aux accoudoirs en pin, Éliot n’en revenait toujours pas. Montier venait non seulement d’écrire un laconique « Goodbye » sur son blog mais aussi de clore son compte Twitter. Éliot lâcha son IPod, le fourra dans la poche intérieure de sa veste, se sentant étrangement trahi par cette clôture. Six années qu’il n’avait pas vu Montier et pourtant, il suivait ses faits et gestes, via le Net. Ce traçage à distance lui permettait de garder le contact, en se contentant de rester voyeur. Si Montier crachait sur la Toile tout ce qui lui passait sous la dent, son blog n’en traduisait pas moins sa vivacité intellectuelle.
Inquiet, Éliot décida de s’attaquer à une valeur sûre : un quotidien parisien datant de la semaine précédente, aux feuilles légèrement froissées. La lecture dans sa langue amplifiait toujours son sentiment d’appartenance à une contrée lointaine, l’Europe. Un article expliquait comment un réseau mafieux venait de tomber dans le Sud de la France. Faussaires de caviar, des malfrats ne commercialisaient pas des œufs d’esturgeon mais une imitation des billes rondes et sombres à partir d’agar-agar, une algue, gélifiant alimentaire naturel. Éliot songea instantanément à Marthe et en fut extrêmement troublé. Pour ne plus penser à elle, il enchaîna sur un second article. Des proxénètes roumains venaient d’être interpellés par la police madrilène. Considérant leurs prostituées comme des objets, ces individus avaient tatoué sur les poignets des jeunes femmes un code-barres. Ainsi, ils les contrôlaient et les forçaient à éloigner de leurs pensées toute velléité de fuite. Ignominieux mais bien réel. Éliot frotta nerveusement la manche de sa veste. Une semaine avant son départ pour Tokyo, il avait entendu sur France Info le témoignage d’un homme, petit-fils d’un rescapé des camps de la mort. L’interviewé expliquait que son grand-père avait porté des manches longues toute sa vie, enfin celle d’après… Même en pleine canicule, le vieil homme cachait ses bras. Cette honte, Éliot avait eu du mal à l’entendre. Cette horreur qui collait à la peau, le répugnait. Avec soin, il replia le journal, enfermant les mauvaises nouvelles entre les pages.
Avant son départ, il lui restait encore une demi-heure à perdre et il ne voulait plus broyer du noir. Ce jour du 15 mai lui rappelait tant de sombres souvenirs qu’il lui fallait conjurer le mauvais sort. Alors, il s’attaqua au survol d’un tabloïd anglais carrément chiffonné, publié trois mois auparavant. En page vingt-six, il fut à nouveau interpellé par un tatouage bien en vue sur une photographie retouchée, prise au téléobjectif par un paparazzi teigneux. Tout sonnait faux dans la mise en scène. Cette image était en fait extraite d’un shooting pour la présentation d’une star du rap dans une usine désaffectée. Si la lumière latérale donnait de la présence au personnage, le détail d’un contour de la casquette trop marqué, offrait la preuve d’une retouche visible. Éliot s’en voulut de voir ce cliché au travers du prisme professionnel. Le message était tout autre. Ce “people” sur papier glacé dédramatisait l’acte du tatouage en le rendant sympathique. Il venait de se faire tatouer sur le biceps la silhouette dénudée de sa dulcinée, faisant passer l’acte pour une fun attitude. Rien ne l’y avait forcé. Peut-être que d’ici deux ans, ce gaillard le regretterait, mais pour le moment, il étalait sa belle à la une des magazines. Soudain, Éliot prit un plaisir gourmand à détailler l’image. Mieux, il mata les courbes féminines ancrées dans la chair masculine. Lui aussi avait un tatouage, souvenir de jeunesse et peut-être même erreur. Éliot referma le magazine et se dit mentalement que personne n’était parfait, hormis les Maoris qui donnaient un sens à ce fameux tatouage. Il regarda sa montre. Mieux valait se présenter à l’embarcadère en avance pour être certain de ne pas rater le ferry, aux horaires plus qu’aléatoires. Sur le ponton, la citrouille jaune à pois noirs, sculpture géante de Yayoi Kusama, marquerait le début d’un périple douloureux. Non que l’idée de quitter le Japon lui procurât un sentiment de tristesse, mais les douze heures de vol, avant de poser le pied à Roissy, le rendaient extrêmement nerveux. Rien que de penser à son long séjour à deux mille pieds, il en eut un haut-le-cœur. Avant de prendre l’avion, il se bourrait toujours de tranquillisants, dosant son cocktail en fonction de la durée du vol. Un jour, peut-être qu’il n’atterrirait pas, restant coincé entre deux mondes, celui du haut et celui du bas, la tête dans les nuages et les pieds à deux mètres du tarmac. Ce serait le nirvana. Il fallait qu’il réduise les doses ou bien qu’il change de job.
Reporter, Éliot parcourait le monde ou plus précisément l’effleurait sans même le toucher. Pareil à une brise légère, il ne laissait pas de trace sur son environnement, même l’article qu’il venait de rédiger sur Naoshima ne resterait pas dans les annales. Il n’avait fait qu’aligner des mots creux tels que : « Cette île de la mer intérieure de Seto se veut particulièrement envoûtante. » ou encore : « L’étrangeté de l’art contemporain, niché au Chichu Art Museum, au cœur de l’îlot, interpelle le visiteur. » En panne d’inspiration, il recopiait trop souvent un lieu commun, éculé, mille fois lu dans les guides touristiques. Là, il venait de dénicher « Chichu veut dire “enterré” en japonais. » Excellent photographe, l’écrit ne l’inspirait pas. Plutôt que de décrire la limpidité du ciel, le bleuté de la mer, les demi-teintes des ombres dans une forêt de bambous géants et l’incongruité d’une architecture hyperpensée et intégrée dans le sol, il préférait cadrer. Par un cliché, il interrogeait son lecteur sur le pourquoi et le comment. Il donnait un sens à toute création, une direction portée par son angle de vue. Déposer une cucurbitacée sculptée tout au bout d’une digue ou recueillir les sanglots de la pluie et les laisser couler sur le sol par un ovale béant méritait mieux qu’un long discours. Une photographie lui permettait de filer une grosse baffe à son lectorat. S’il tentait de décoiffer, il pouvait se targuer de réussir. Éliot sortit de sa poche un calepin pour relire sa prose. Il séjournait à Naoshima pour évoquer Claude Monet, du moins ses “Nymphéas”, cinq toiles dont un impressionnant diptyque, exposées dans une salle aux murs blancs et à l’éclairage naturel. Seule certitude, la France vue d’ailleurs, lui donnait sacrément le blues. Piètre rédacteur, les citations comblaient la platitude de ses textes de fond et leur donnaient un relief faussement intellectuel. Éliot puisait chez les autres ce dont il manquait cruellement, le génie de l’écriture. Ainsi, il venait de conclure son article par une citation de Houellebecq : « Les fleurs ne sont que des organes sexuels, des vagins bariolés ornant la superficie du monde, livrés à la lubricité des insectes. » Soudain, ce texte lui parut franchement osé parce que pleinement jouissif. Alors, il se censura d’un coup de crayon. Sa rédaction n’aurait d’ailleurs pas apprécié. De plus, il ne savait pas ce que Monet penserait de voir ses nénuphars revisités par un esprit lubrique. Ces plantes aquatiques, aux fleurs solitaires et feuilles arrondies, accueillaient-elles des crapauds sautant de luxure en luxuriance ? Que ces toiles accrochaient pleinement la lumière, de cela Éliot en était certain. Il ratura la citation de Houellebecq, pour la remplacer par une autre de Maurice Denis, un peintre qui écrivit dans Théories : « Se rappeler qu’un tableau – avant d’être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote – est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées. »
Éliot était trop sage, bien trop lisse. Il s’en voulut de se savoir insipide, mais il lui fallait bien gagner sa croûte, au sens littéral. La photographie ne payait pas et pour conserver son travail, il se devait de plaire à tous, en étant politiquement correct. Ses rêves d’adolescent étaient si loin…
À treize ans, Éliot se promenait toujours avec un livre dans la poche de son blouson. L’objet déformait savamment son vêtement. Il ne lisait pas l’ouvrage mais aimait à le savoir là et à faire savoir qu’il était là. Parfois, il tentait une incursion dans l’univers de l’écrivain, parcourant les trois premières pages puis sautant allégrement à la dernière. Souvent, avec la quatrième de couverture et la lecture d’une critique assassine, il faisait illusion en société, en fait lors des repas dominicaux. Stratégie aisée lorsque l’on est né dans une famille pour laquelle l’achat d’un livre reste un événement et le terme “bibliothèque” est synonyme de meuble en teck. Ses oncles et tantes le qualifiaient de jeune intellectuel précoce et promis à un avenir prometteur. Son père le portait littéralement aux nues. Lui ne se considérait pas comme un menteur, uniquement comme un surdoué capable d’embellir la vérité, pour offrir du bonheur aux autres sans se priver de couper une bonne tranche de cette félicité au passage.
À quinze ans, il s’était aventuré entre les pages d’un roman d’Albert Camus, non parce qu’au dos de la couverture, une phrase annonçait « L’un des plus grands romans de notre époque », mais parce qu’aucun texte résumant le récit ne semblait nécessaire. Le titre, La Peste, suffisait à interpeller le lecteur potentiel. La photographie en noir et blanc de l’auteur, plaquée en quatrième de couverture, façonnait le personnage, perdu dans des pensées obscures, yeux mi-clos, cigarette au coin des lèvres. Poussant jusqu’à la cinquantième page, Éliot avait découvert un plaisir surprenant, à lire. En fait, pour l’amour de Juliette, sa voisine de palier, jolie et érudite, il s’était mis à dévorer des livres à la couverture énigmatique et à se pencher sur tout ce qui pouvait intéresser la belle. La jeune fille aimait le cinéma d’auteur, où l’on cause “riche” ou pas du tout, où le silence meuble les intermèdes ponctuant des conversations énigmatiques, subtil cocktail de formulation et reformulation. Éliot souhaitait se retrouver seul dans les salles obscures avec Juliette. À Rennes, leur cinéma de quartier, au bord de l’agonie, financièrement rincé, s’entêtait à programmer du cinéma d’auteur. Dieu que les salles étaient vides ! Dieu que ce vide lui semblait bon, propice à des attouchements et baisers baveux ! À cette époque, il ne portait pas encore son appareil dentaire. Gwidal, plus âgé de six mois, affichait, lui, un sourire teinté d’acier. Pour Éliot, que Juliette l’ai choisi comme petit ami alors qu’elle admirait Gwidal, s’expliquait par ce détail matériel, carrément “repousse-flirt”. Il n’avait jamais osé demander à la demoiselle si son hypothèse tenait la route. Désormais, il était trop tard pour s’en ouvrir à elle.
Éliot embrassa du regard le hall de l’hôtel Mitschu et murmura : « La vie c’est trop con et la jeunesse est tellement pleine de vie… »
Alors qu’il venait de régler sa note d’hôtel, le réceptionniste fit le tour du comptoir en bois pour le rattraper dans le hall. Dans un anglais parfait, il lui dit :
— Monsieur, excusez-moi, j’allais oublier… une carte postale est arrivée ce matin, de France – puis l’homme se courba, inclinant la tête, et dans un murmure, renchérit : Vous avez failli ne jamais la recevoir… par ma grande faute.
Éliot devint blême. Il marmonna en français :
— Indélébile est le propre du tatouage, le vrai. Cette griffure engage, pour le meilleur ou peut-être le pire. Passer à l’acte du motif sur la chair, c’est comme se jeter à l’eau et se dire que, jamais plus, on ne séchera. Toujours mouillé, à vie. Alors, la petite aiguille sur la peau, mieux vaut la regarder à deux fois, avant de remettre au tatoueur le dessin stylisé reprenant les lettres du prénom, celui qui marquera sa chair jusqu’à sa mort…
III
MARTHE
Japon - Gare de Tokyo - Le 15 mai à midi.
Il était une fois un train à grande vitesse, le Shinkansen, celui que Marthe s’apprêtait à prendre. Si elle ne l’avait pas pris, tout aurait été différent.
Au milieu d’une foule pressée, elle se distinguait par la blondeur de ses cheveux coupés court et sa grande taille. Les claquements sonores du passage des roues de sa valise sur une plaque d’acier firent ralentir son pas. Elle songea que tous les quais de gare avaient cela en commun, le départ imminent pour un voyage vers et avec les autres. Lorsqu’elle repensait à tous les trains qui l’avaient accueillie, elle se souvenait de mille aventures. La lenteur du périple de ses premières expériences ferroviaires la rendait nostalgique. Elle regrettait les départs immobiles en voyant par la vitre disparaître des voyageurs assis dans un wagon, placé sur une voie parallèle, qui s’ébranle en douceur. En mémoire, elle gardait les odeurs épicées du Cameroun et la vision de cet homme courant sur la voie de chemin de fer, chutant, se relevant les coudes en sang, réussissant à s’agripper à la passerelle arrière, le sourire aux lèvres. Elle avait à peine vingt ans, c’était son premier séjour à l’étranger, seule. Cette ligne ferroviaire avait été ouverte durant la Première Guerre mondiale pour relier Yaoundé à Douala. Les décennies passant, il restait néanmoins l’encombrement des voies par des buffles indolents et les ponts suspendus prêts à s’effondrer sous le poids de la locomotive. La moiteur, la sueur, les couleurs chatoyantes des tissus enveloppant les peaux donnaient à cet ailleurs un goût de miel. Cette première expédition lui avait fait découvrir et apprécier la solitude qu’elle n’avait cessée de cultiver au fil des années. Cinq ans plus tard, la jeune fille s’était retrouvée en Yougoslavie, sur la ligne reliant Sarajevo à Ploce, quelques mois avant que la guerre ne s’abatte sur le pays. Peu après, les voies avaient été bombardées, le pont de Mostar détruit, les quatre hommes croisés dans ce train avaient probablement sorti les armes pour se battre, pour combattre ceux qui se trouvaient peut-être dans un autre wagon, ce jour-là. Elle était assise en face d’eux sur une banquette inconfortable, genoux serrés, tête baissée. Un moustachu s’était levé d’un bond pour lui attraper le bras, avec fermeté. Tandis qu’elle se débattait, il riait à gorge déployée. Ce rire, longtemps, elle l’avait conservé en elle. Jamais elle ne sut s’il avait voulu lui faire peur ou lui donner une leçon. Réussissant à se sortir de ses griffes, elle avait rejoint un compartiment dédié à la gent féminine, comme il se devait. Par la suite, elle avait appris à se fondre dans la foule, à ne plus transgresser les règles, à dissimuler ses formes sous des vêtements sombres et amples. Parcourir le monde passait par une acceptation de l’anonymat, surtout lorsque l’on est femme, belle et blonde. Maintenant, Marthe avait cinq décennies de vie derrière elle, devant, elle ne pouvait le dire. Sa tenue stricte de femme d’affaires convenait parfaitement à l’objet de son séjour au Japon : le business.
En se retournant sur le quai, elle vit son passé défiler, emporté par tous les trains qui lui avaient permis de prendre place dans le spectacle du quotidien des autres. Elle posa son escarpin droit sur le marchepied et déplora que son futur se retrouvât dépourvu de toute poésie, uniquement inscrit dans les objets haute-technologie que contenait son sac à main. Son agenda électronique rempli de rendez-vous de la plus haute importance, pour le semestre à venir, et sa messagerie saturée ne lui suffisaient plus pour tromper l’ennui. Ce 15 mai, en montant dans ce train à Tokyo, elle se sentit vide de tout, d’avenir et de ce trop-plein de high-tech. Elle avait tant changé… Désormais, elle voyageait en première classe et découvrait ses jambes pour ses séjours-éclairs au Japon. Désormais, elle traînait une valise à roulettes. « Suis-je vieille ? » se demanda-t-elle. « Suis-je aigrie parce que je ne supporte plus les enfants qui courent dans un couloir ? » Elle respira à pleins poumons pour se rassurer, songeant : « Je dois payer le prix fort pour acheter ma tranquillité, j’en ai les moyens. Je veux un compartiment empreint de sérénité et un fauteuil moelleux. Je planifie tout, mon heure d’arrivée et la suite du trajet. Je ne laisse aucune place au hasard. Je déteste les imprévus et les trains qui n’arrivent pas à l’heure. J’apprécie les Japonais pour leur ponctualité. Que les lignes du Shinkansen soient reliées à des sismographes me rassurent. » Et pourtant, l’inconnu qui allait s’asseoir à ses côtés ferait que ce mille et unième voyage resterait à jamais gravé dans la mémoire de Marthe. On peut croire que l’avenir est derrière soi mais il peut être devant, même à cinquante ans…
Entrant dans le wagon, le contrôleur se plia physiquement aux coutumes japonaises, saluant ses hôtes par une révérence discrète. Un homme jeune, de type occidental, se tenait dans son dos, le dépassant d’une tête. Tandis que Marthe se calait confortablement dans son siège, l’inconnu resta de longues minutes, seul dans l’allée. Elle le jugea séduisant, voire attirant. Elle n’était pas de ce genre de femme qui se moque de savoir ce qu’un homme dissimule sous son tee-shirt et osait avouer qu’un corps bien proportionné fait partie de l’arsenal du séducteur tout autant que celui de la séductrice. Elle affirmait que les biceps et la pilosité développée accompagnaient plus souvent qu’il n’y paraissait une tête masculine bien remplie. Son ex-mari, Alexandre, se complaisait à lui rappeler que la blondeur naturelle de sa chevelure et ses courbes parfaites ne faisaient pas d’elle une idiote. Il avançait que les clichés se devaient d’être revus mais non détruits, parce qu’ils permettaient de comprendre les comportements des autres, ceux qui se pelotonnaient dans un conformisme commun fait de phrases toutes faites et de stéréotypes éculés. Elle ne regrettait pas de s’être séparée de lui.
Ce jeune homme, debout dans la travée, n’était pas doté de pectoraux impressionnants. Cependant, il perturba Marthe par la puissance qui se dégageait de tout son être. Levant les bras pour soulever son bagage, son sweat-shirt se releva, dévoilant la courbe de ses reins. Une fraction de seconde, elle ne vit que la peau révélée et en éprouva de la honte. Les femmes, en cela différentes des hommes, sont pudiques, même dans leurs pensées. Une voix masculine annonça en japonais : « Attention à la fermeture des portes », puis le train démarra. L’inconnu la fixait étrangement. Elle eut la désagréable sensation de déjà-vu. Il agissait pareillement à Kato, un acheteur basé à Hiroshima et rencontré lors d’un de ses passages à Paris. En découvrant une assiette douze escargots en céramique, aux Puces de Saint-Ouen, le visage de Kato s’était fermé, marquant une pointe de dégoût. L’attitude du jeune voyageur se voulait similaire, Marthe ne l’apprécia pas. Elle baissa les yeux, gênée. L’homme s’installa sur le siège voisin puis tourna la tête pour capturer l’extérieur et le laisser l’envahir. Il n’était plus là, dans le compartiment, mais derrière cette vitre, flottant au-dessus du paysage urbain. Elle avait totalement disparu de son univers. Trente minutes après le départ, la ville laissa place à la campagne. Alors il se retourna pour lui demander en français :
— Avez-vous déjà tweeté ?
Prise au dépourvu, elle ne réagit pas. Fautive sans vraiment l’être, elle demeura muette. Alors il poursuivit :
— Non ? Jamais ? Tant mieux pour vous. C’est comme la cigarette, mieux vaut ne jamais commencer. Mais peut-être ne savez-vous pas ce dont il s’agit ? Pas précisément, je vois… Si je puis me permettre. Tenez, prenez mon Ipod et découvrez vous-même… Donc, un tweet n’est pas un bonbon enrobé de chocolat mais un petit message de cent quarante caractères maximum envoyé via le Net. Ce “gazouillis” est gratuit, rapide, bougrement énervant pour les abonnés et se doit de faire preuve de pertinence mêlée d’impertinence. Faute de quoi, vos tweets ne seront lus par personne. Madame, ce monde est fort cruel !
Il venait de l’appeler Madame, de dialoguer dans la langue de Molière avec elle, sans qu’elle ouvre la bouche, en suggérant son inculture face aux réseaux sociaux. Les yeux grands ouverts, elle s’était contentée d’avaler la tirade, fort indigeste. Brusquement, elle attrapa le Smartphone et lui rétorqua :
— Dois-je le lécher ? Est-il sucré ? Vos tweets pourraient être…
— Appétissants ?
Troublée, elle lâcha :
— Exactement !
Le jeune homme lui asséna :
— Je savais que vous prendriez ce train. Vous êtes si prévisible, Madame…
— Qui êtes-vous ?
— Plus tard. Nos souvenirs restent à écrire…
IV
D’UN CONTINENT À L’AUTRE
Au large de Groix.
Le portable collé à son oreille, Amélie sautillait sur place. Ses hochements de tête, ponctués de « Oui, bien, trop », signifiaient tout autant l’écoute que l’exaspération. Elle coupa son interlocuteur pour placer enfin « OK. Si la pluie te donne le blues à Londres, eh bien ici, c’est le vent qui me rend dingue ! La houle bringuebale mon esprit, quant à mon corps… La grande roue de la foire du Trône est une sinécure comparée à ce que j’endure depuis quinze minutes. J’ai le cœur au bord des lèvres. Victime d’une tare honteuse, je subis lamentablement un effroyable mal de mer. Il ne manquerait plus qu’il se mette à pleuvoir… Une galère de plus. J’accumule. Tom, je vais devoir te laisser… urgemment… pour aller vomir. »
La jeune femme pressa son téléphone contre sa poitrine, se pencha en avant et n’eut pas le temps de rejoindre le bastingage. Une bile pâteuse, reste d’une chocolatine trop vite enfilée, macula le rose de ses Converse. En passant sa main sur sa bouche, elle lança, dégoûtée :
— Crotte de biquette !
Assis sur une banquette en acier, un gamin à la bouille ronde, enfonça son bonnet marin sur sa tête puis se retourna pour détailler celle qui venait de proférer un juron préhistorique. Personne ne disait plus « Crotte de bique », encore moins « de biquette », même dans la cour de récréation, même lorsque l’on tournait vingt fois la langue dans sa bouche pour ne pas dire « M… ! » comme les grands. L’enfant la dévisagea, longuement, puissamment, pour comprendre qui elle était, d’où elle sortait avec ses excréments de chèvre de Monsieur Seguin sur la langue et ses lunettes de soleil XXL sur le nez. Une star de Stendhal ? Sa mère lui parlait souvent de ce Stendhal. Mieux, cette femme devait être une Anglaise excentrique qui avait appris le français dans des grimoires du Moyen-Âge. Par une grimace, l’enfant conclut son analyse comportementale qu’il confirma par un juron murmuré : « Dégueulasse ! »
Amélie ramena son pouce tout contre son index, à la façon d’un crabe serrant ses pinces avec détermination sur une proie, ensuite elle souleva légèrement sa monture pour la faire remonter sur son front. Elle offrit un clin d’œil au petit, un clignement à peine perceptible, juste pour lui, qui s’évanouirait à jamais dans la mémoire du garnement. Le gosse, décontenancé par l’intérêt porté à sa personne, de plus gêné de se retrouver dans la peau du chenapan trop curieux, lui tira la langue en guise de réponse.
Si dès l’enfance, chaque jour se distingue du précédent par un événement marquant, ce n’est pas toujours par la découverte d’une montgolfière rouge dans un ciel azur ou le goût d’un délicieux hamburger avalé un mercredi pluvieux. Le regard croisé d’une étrange demoiselle vêtue d’un imperméable couleur Malabar peut aussi convenir. Cet être de sexe féminin, singulière de la tête aux pieds, jugée “vieille” par le gamin, ressemblait bizarrement à Audrey, son amoureuse depuis la maternelle. Cette ressemblance le perturba au point qu’il se leva et piqua un sprint sur le pont. Amélie marmonna : « Au moins, il y en a un qui n’a pas le mal de mer sur ce fichu rafiot ! »
Son portable vibra. Elle reconnut le numéro de téléphone de sa mère. Elle laissa l’appareil vibrer jusqu’à épuisement. Tandis qu’elle était agrippée au bordé, ses douleurs à l’estomac redoublèrent d’intensité. Les spasmes succédaient aux nausées.
* * *
Le Shinkansen.
Marthe tentait de joindre sa fille. Pourquoi elle ? Probablement qu’Amélie était la seule personne capable de ne pas prendre des gants avec elle, de la rassurer tout en lui faisant la morale, sans nulle complaisance. Quoi de meilleur qu’entendre la voix familière de sa petite lui lancer : « Maman, qu’est-ce qu’il t’arrive ? Tu te traînes un super-cafard, bien lourd ? Eh bien, lâche prise, largue ton satané boulot et rentre en France par le premier avion ! »
Le cœur battant la chamade, elle aurait voulu lui raconter en deux mots, sa rencontre glaçante avec un diable d’homme, beau comme un dieu grec. Sa fille lui aurait jeté mille conseils contradictoires : « Piste-le et puis non, reste bien tranquillement, assise sur ton siège. C’est qui ce fêlé ? Fais gaffe, les dingues, y en a plein les compartiments. Est-ce qu’il a une tête de grondin ou de carpe aux yeux bridés ? » Mais sa fille ne décrocha pas. Marthe croisa ses jambes puis les décroisa, se leva, se rassit, réfléchit. Un SMS ferait l’affaire. En repensant à l’attitude de l’inconnu, elle ne trouvait pas les mots pour la décrire. Il avait récupéré son sac de voyage et était sorti du wagon bien trop placidement. Marthe frémissait encore rien qu’en se remémorant la réplique théâtrale du jeune homme : « Nos souvenirs restent à écrire… » En utilisant le terme « Nos », il souhaitait la heurter, abandonnant son interlocutrice en proie à un trouble extrême. S’entendre dire : « Je savais que vous prendriez ce train. Vous êtes si prévisible, Madame ! » justifiait complètement l’angoisse qu’elle sentait grandissante.
Elle expira profondément, se rassurant en imaginant que ce malade mental se permettait de terroriser les femmes seules en leur faisant croire qu’elles étaient uniques. S’il l’avait prise pour cible, il ne la connaissait peut-être même pas mais jouait sur le registre de la terreur en lui faisant imaginer le contraire. S’il s’était exprimé dans sa langue, ce devait être par simple déduction : elle tenait dans sa main un magazine de mode français. Calmée, elle baissa les yeux et découvrit sous le siège une carte postale écornée. Immédiatement, Marthe sut qu’elle était une proie. Si le chasseur venait de quitter les lieux, il avait décoché une balle qui l’atteignait en plein cœur, via cette carte. Il n’était plus question de coïncidence. Ses mains se mirent à trembler. Sa vue se troubla. Sa poitrine se trouva comprimée dans un étau. Sur la carte, l’adresse indiquée, « Marthe Jones, le Shinkansen, Japon », la consterna. Était aussi écrit « Qui a tué Gwidal ? » alors les souvenirs la submergèrent.
Marthe ne s’était jamais considérée comme une bonne mère, probablement parce qu’immature à la naissance de son fils. Sa première maternité avait été annoncée à ses parents par le médecin de famille. Rangeant son stéthoscope dans sa mallette en cuir, il leur avait froidement asséné : « Votre fille n’a pas que la varicelle, elle est enceinte. » Marthe venait de fêter ses seize ans et sa mère n’était absolument pas prête à devenir grand-mère. La gifle que l’adolescente reçut de son père avait marqué sa joue pour les cinq mois suivants. Ensuite, elle avait accouché d’un petit garçon, insolite cadeau pour une veille de Noël. Gwidal avait été le prénom qu’elle avait chuchoté au creux de l’oreille de ce surprenant nourrisson. La peau flétrie du prématuré lui avait fortement déplu. Elle s’était demandé si elle venait d’expulser un monstre ou si tous les nouveaux-nés ressemblaient à une pomme de terre oubliée dans un sac de toile. À la sortie de la maternité, sa mère s’était occupée de l’enfant. Marthe avait très vite repris ses cours au lycée en ayant le sentiment d’avoir fait un mauvais rêve. Gwidal n’avait pas de père déclaré et si peu de mère. Il était là dans l’appartement familial, dans sa chambre à la tapisserie bleue, dans un berceau blanc. Par la suite, il fut là dans un parc puis dans une poussette. Le premier mot que le petit avait prononcé fut « Marthe » et non « Maman ».
À vingt ans, elle l’avait totalement abandonné à ses parents et parlait à ses amis de Gwidal, une sorte de petit frère espiègle. Puis elle s’était mise à voyager, n’ayant de cesse d’installer de la distance entre l’enfant et sa propre personne. Parcourant l’Afrique subsaharienne puis l’Europe, elle papillonnait, vivant de petits boulots et de mandats envoyés par son père. Tous les trois mois, elle rentrait en France et défaisait à peine sa valise. Quant à son fils, il avait adopté un langage approprié à la situation. Il appelait sa grand-mère « Mam » et sa mère Marthe. Les parents de la jeune femme étaient entrés dans le jeu de la confusion des générations, vraisemblablement parce qu’ils n’avaient qu’une unique fille, jouant les globe-trotters et que l’arrivée d’un garçon dans leur famille leur offrait une seconde jeunesse. Lorsque, des années plus tard, Marthe avait rencontré celui qui allait devenir le père de sa fille, elle avait omis de lui parler de son fils, tout en ne tarissant pas d’éloges sur Gwidal, un enfant précoce, malheureusement handicapé.
Étrangement, c’est à la mort de Gwidal que Marthe avait pris conscience qu’il avait toujours été son fils et non son frère. Vingt-six années et une tragédie avaient été nécessaires pour lui faire comprendre que rien ne pouvait effacer les remords et surtout pas le temps qui passe. La culpabilité était remontée à la surface, trop tardivement.
Dans ce train, à l’autre bout du monde, la carte postale venait de la faire trébucher sur le chemin de sa vie, d’une adolescence ratée à une existence d’adulte amnésique de son état de génitrice. Marthe composa pour la dixième fois le numéro de sa fille pour la joindre, si loin. Soudainement, elle eut le sentiment d’avoir abandonné sa fille en France pour survivre ailleurs, reproduisant avec Amélie le schéma conçu pour Gwidal.
Terrifiée, Marthe rangea son téléphone avec la carte dans son sac à main. Elle se leva puis disparut. Elle ne descendit pas du Shinkansen à la gare de Nagaoka, comme prévu.
V
JULIETTE
Houat, l’île - France - Le 16 mai en soirée.
Le colosse aux pieds d’argile se tenait devant la porte, les gouttes de pluie léchaient l’arête de son nez. Huit minutes qu’il regardait la pointe de ses bottes en caoutchouc, immobile, incapable de tourner la poignée. Pour se donner la force d’agir, il chuchota : « Pas mort » puis répéta à trois reprises : « Pas mort… » À bout de souffle et de mots, il entra. La porte claqua. Juliette poussa un soupir, à peine perceptible. Assise dans un siège à bascule, les mollets repliés sous ses fesses, elle lisait, voyageait entre les lignes, s’abandonnait à sa lecture. Sans se retourner ni lever le nez de son roman, elle dit :
— Tu as vu l’heure ? Surtout ne me dis pas que Vendredi recherchait Robinson à l’autre bout de l’île…
Les mots retombèrent sur un silence pesant qui s’effaça devant le crépitement du bois dans la cheminée, devant le tintement des gouttes sur le carrelage. L’eau suivait des routes sinueuses formées par les plis du ciré de Victor pour venir mourir sur le sol. La flaque grossissait autour de ses semelles. Tête baissée, il se sentait aspiré par cette mare liquide. Il allait s’y noyer parce qu’il avait peur, si peur ! Comment aurait-il pu exprimer à Juliette l’angoisse qui suintait de ses pores, alors qu’elle ne savait pas, pas encore, ce qu’il venait de vivre dans ses tripes ?
Calmement, la jeune femme marqua la page avec un fil de laine rouge puis referma le livre. Elle déplia son corps, s’étira et se retourna pour regarder son frère. Alors, elle le vit dans sa globalité, transi par le froid, le visage hagard, les lèvres tremblantes, le corps tétanisé. Aussitôt, il sut qu’elle le protégerait pour toujours, comme toujours, et qu’il pouvait se laisser aller en lui avouant l’horreur de sa mésaventure. Il sortit les mains de ses poches, lui présentant ses paumes rougies par le sang. Tendant les bras, il voulait s’excuser de tout ce qui allait suivre, du présent, du futur, du passé inavouable, d’être né ainsi, mauvais. Uniquement, il murmura :
— Pas mort…
Juliette le fixait, le dévorait du regard, cherchant une réponse au-delà des termes terribles qu’il venait de prononcer.
Elle hurla :
— Tu es blessé !