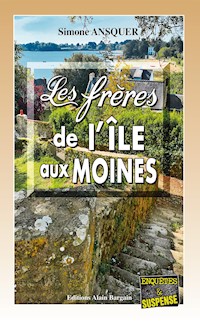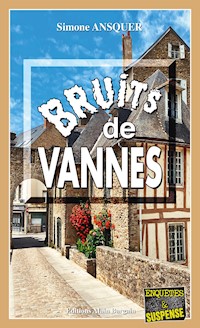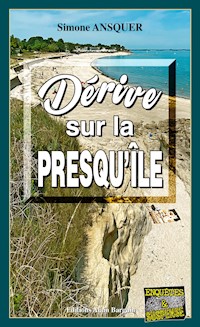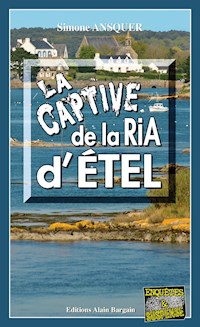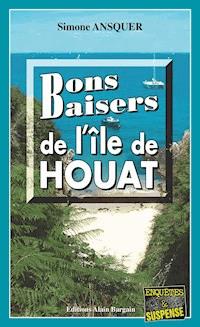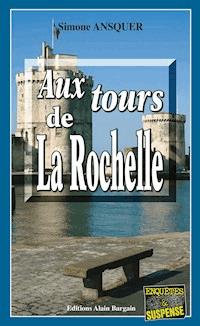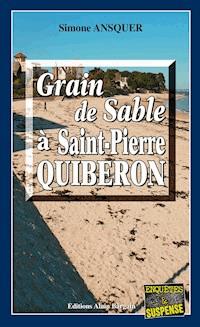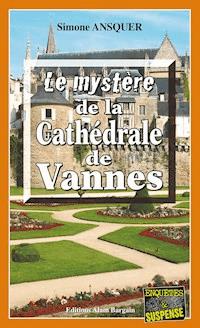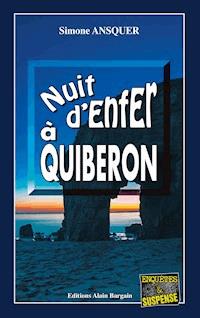
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Une course contre la montre endiablée s’annonce…
Quiberon, 18 heures.
En pénétrant dans le salon de la maison familiale, Salomé n’entendit que la fin du message enregistré sur son répondeur. Une voix masculine déclarait : « D’ici là, n’appelez pas la police. Croyez-moi, c’est préférable pour tous… » Le déclic de fin résonna dans sa tête, la laissant au bord de l’implosion.
Le jeu mortel venait de démarrer. Les règles lui étaient imposées. Pour sauver un homme, elle avait à peine quelques heures pour mettre la main sur une toile de maître dérobée.
L’art, l’amour, l’argent et la mort allaient jalonner sa nuit d’enfer à Quiberon…
Un polar angoissant au cœur d’un Quiberon nocturne et mystérieux
EXTRAIT
Qui étaient-ils ceux qui ralentissaient le pas, voire se plantaient dans l’allée de gravillon et de sable pour lire l’énigmatique épitaphe gravée dans le marbre ?
Qui étaient-ils ceux qui, oubliant, l’espace d’un instant, l’objet de leur visite, jouaient les curieux ? Nulle indécence à jouer puisqu’éveiller la curiosité était une des règles du jeu. Les uns cherchaient en vain sur la plaque tombale, avec discrétion ou sans aucune discrétion, le prénom du défunt. Les autres s’attardaient, méditant sur la mystérieuse phrase.
A PROPOS DE L’AUTEUR
Née en 1960 à La Rochelle où elle a grandi,
Simone Ansquer vit aujourd’hui sur la presqu’île de Quiberon et y cultive ses passions pour les sports nautiques, les voyages, l’histoire et la peinture. Avec ce septième roman, l’auteure tisse les fils d’une intrigue machiavélique.
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -
Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
À mes douze cousines, Guénolé, Cathy, Marie, Sandrine, Valérie, Jessica, Sylvie, Laurence, Virginie, Chantal, Mireille et Joëlle.
PROLOGUE
Qui étaient-ils ceux qui ralentissaient le pas, voire se plantaient dans l’allée de gravillon et de sable pour lire l’énigmatique épitaphe gravée dans le marbre ?
Qui étaient-ils ceux qui, oubliant, l’espace d’un instant, l’objet de leur visite, jouaient les curieux ? Nulle indécence à jouer puisqu’éveiller la curiosité était une des règles du jeu. Les uns cherchaient en vain sur la plaque tombale, avec discrétion ou sans aucune discrétion, le prénom du défunt. Les autres s’attardaient, méditant sur la mystérieuse phrase. Tous reprenaient leur chemin et ne le croisaient jamais, celui qui aurait pu leur révéler le secret, celui qui fleurissait la tombe chaque matin et chuchotait le prénom de l’être qui reposait là, à jamais. Son murmure faisait frémir les pétales, couleur sang.
Était inscrit sur la tombe : « L’important, ce n’est pas comment vous vous prénommez, mais l’histoire associée au choix de votre prénom. » Pourtant, aucun prénom, nul patronyme n’était gravé dans le marbre. Devant l’épitaphe, un imposant bouquet de pivoines rouges, placé dans un vase noir, captait toute l’attention, donnant un relief aux mots. Murmurer quelques paroles. Faire pleuvoir des diamants, des perles, des larmes et des fleurs pour repousser l’oubli d’un être exceptionnel à jamais disparu tragiquement.
Deux pies regardaient la tombe. Lorsqu’elles prirent leur envol pour planer au-dessus du cimetière de Quiberon, celui qui fleurissait cette tombe pleura.
I SALOMÉ
Si Salomé n’était pas née un 22 octobre, bien des années plus tard, jamais elle n’aurait découvert un cadavre gisant nu sur un sol en cèdre rouge du Canada. Il avait suffi d’un calendrier pour qu’une main posée sur son épaule d’adulte ait la précision d’un geste meurtrier.
Si elle ne s’était pas prénommée Salomé, à trente-six ans, elle n’aurait pas vécu une nuit d’enfer à Quiberon. Pourtant, rien ne la prédestinait à se prénommer ainsi. Sa mère ne s’appelait pas Hérodiade, son père n’avait aucune culture religieuse et nulle grand-mère, tante ou aïeule ne portait ce prénom. Alors, pourquoi ses parents avaient-ils choisi de l’appeler Salomé ? Imaginer que son père puisse conserver un souvenir ému de l’interprétation de Rita Hayworth dans la Salomé ou garder en mémoire l’opéra en un acte de Richard Strauss aurait été mal le connaître. Le matin de la naissance de sa première - et à ce jour unique - fille, l’heureux homme avait attrapé le calendrier accroché sur le mur de la cuisine pour dire à haute voix aux cinq garçons qui lui faisaient face : « La sainte du jour est... Salomé. » Comme il avait procédé de pareille façon avec ses autres enfants, la surprise ne fut pas au rendez-vous. Depuis plusieurs semaines, toute la maisonnée scrutait cet almanach des postes. D’abord Paul, l’aîné de la fratrie, le seul sachant donner un sens aux lettres juxtaposées, prenait un malin plaisir à haranguer une maigre foule masculine, juché sur un tabouret de la cuisine. Tel un orateur du Speaker’s Corner à Hyde Park, le garçon délivrait la bonne parole à un jeune public enthousiaste. Jean, Marc et Louis l’écoutaient religieusement déclamer : « Renée, Adeline, Ursula, Salomé ou bien Mélodie. » Albain, le benjamin trépignait, bavait puis répétait : « Salomé ou Mélodie. » Puis, la mère qui mangeait des yeux l’almanach. Elle s’était plongée dans de savants calculs calendaires afin de forcer son corps à lui obéir. Fâcheux aurait été de subir la délivrance la veille du 22 octobre, aussi limitait-elle ses mouvements afin de ne pas accoucher prématurément. À la date du 21 octobre correspondait le prénom d’Ursula, considéré par la future maman comme étant un mauvais présage, puisqu’issu du latin « ursus », signifiant « ours ».
En conséquence, cette femme déterminée avait tenu tête à tout le corps médical en décidant de la date de son accouchement, prétextant vouloir être attendue par une équipe médicale au grand complet et l’obstétricien qui l’avait suivie tout au long de sa grossesse. La véritable raison n’avait pas transpiré. Dans la fratrie, seul Paul n’était pas dupe du stratagème de sa mère.
Quant au père, n’ayant que fort rarement fréquenté les églises, l’histoire de Salomé, la pécheresse lui était inconnue, alors il s’en tenait à son almanach des postes, son « empêcheur de tourner en rond » comme il le dénommait.
Ainsi, la princesse naquit le jour voulu et se prénomma Salomé. L’histoire associée à son prénom aurait pu en rester là, mais la principale intéressée se rebella. C’est le jour de son quatorzième anniversaire que Salomé décida de s’affranchir de l’anecdote du calendrier qui entachait, selon elle, le choix de son prénom. Alors, l’adolescente proposa au monde sa version personnelle. Elle décréta que son père, féru d’astrologie et ce de façon insoupçonnable, avait vu en elle, le petit corps céleste au doux nom de Salomé, évoluant avec grâce au cœur du système solaire et découvert par Max Wolf en 1905. De par sa volonté, elle devint, ce jour-là, un astéroïde perdu sur terre, ce qui lui plut bien plus que de se languir dans la peau de la réincarnation d’une sainte.
Ce dont elle ne se doutait pas c’était que les ailes de la mort planaient déjà au-dessus de sa tête, attendant que la jeune fille devienne enfin une femme pour envelopper son corps avec une volupté morbide.
II BERNARDINO LUINI
Le Louvre - Le 11 mai
C’était l’instant de personne ou peut-être de tous. Hommes, femmes et enfants présents dans la Grande Galerie, emportés par la beauté du lieu, venaient d’arrêter le temps. Salomé les embrassa du regard et sut que l’instant magique qui venait de s’écouler n’était pas le sien mais le leur. Cette particule temporelle, elle n’avait pas pu la partager avec eux ou peut-être pas su. La perte de cette seconde la décomposait intérieurement. Était-elle si différente des autres, à ce point vidée de toute émotion ? Elle se sentait incapable de prendre la moindre décision, hormis celle de se fondre dans cette foule cosmopolite, de se glisser anonymement dans son flot. Si faire semblant de regarder, sans même voir, lui demandait une énergie folle, alors comment aurait-elle pu arrêter le temps ?
Aimait-elle les musées ? Détestait-elle les galeries ? Elle perdait pied, ne supportant plus ce qu’elle était devenue, une femme de trente-six ans qui avait perdu le goût de vivre. Pourrait-elle un jour se relever de l’infamie que Julian venait de lui faire subir ?
Tout était Éverest, signe d’une dépression naissante. Tout. Le nombre de toiles d’exception était si grand qu’il lui paraissait impossible de faire un choix, de s’attarder sur l’une plutôt que l’autre. Avides de culture, les promeneurs évoluaient avec une déconcertante facilité alors qu’elle se déplaçait avec la sensation d’être écrasée sous le poids d’un monde injuste. Pire, sa perception déchirante de l’environnement aggravait son état léthargique. En enfilade, des peintures italiennes évoquaient l’attachement des artistes du XVIe siècle à la religiosité dans ce qu’elle avait de plus sombre. Une foultitude de saints martyrs et de Christ sur la croix s’exposaient à la vue des visiteurs. Si peu de joie de vivre se détachait des murs de la Grande Galerie que Salomé considérait l’ensemble avec dégoût. Pourtant, elle ne déambulait pas seule. Tel un poisson pilote profitant de l’onde créée par la nage de son requin personnel, en l’occurrence Bastien, elle suivait le parcours linéaire tracé par le jeune homme. Lorsque Bastien s’arrêta net devant une des œuvres, elle fit de même sans sourciller, voire même avec la satisfaction de pouvoir s’en remettre à Bastien et au choix qu’il venait de faire. Ce matin-là, l’esprit de Salomé restait clairement hermétique à toute forme d’art et son corps agissait mécaniquement au gré de la progression et des haltes de son compagnon. Elle haïssait la terre entière et cette haine engluait totalement les synapses de son cerveau.
Que Bastien se laisse peu à peu physiquement envahir par une toile de maître, elle n’en avait que faire. Bien plus que regarder la peinture qui lui faisait face, le jeune homme semblait la voir avec une acuité extrême, s’attachant à percer le moindre détail. L’envoûtement dura une éternité. Le temps suspendit son vol et reprit enfin son cours, lorsque sur le ton de la confidence, il chuchota :
— Cette madone te ressemble... énormément.
Levant le nez, Salomé ouvrit grand ses yeux puis grimaça ostensiblement. Elle combattait des démons intérieurs prêts à la dévorer et son ami lui proposait de contempler la toile la plus morbide qui soit ! La scène était particulièrement terrifiante. Une demoiselle au visage d’ange recevait la tête tranchée de saint Jean-Baptiste. Du sang s’écoulait du cou sectionné pour goutter dans une assiette en fer que tenait la jeune femme entre ses mains. Buste en avant et regard tourné à l’opposé, elle ne semblait pas apprécier l’offrande faite par une main masculine, celle d’un inconnu. L’artiste s’était contenté de peindre un avant-bras, laissant au spectateur tout le loisir d’imaginer la face dantesque de l’auguste donateur. Ce dernier empoignait une touffe de longs cheveux pour maintenir, suspendue dans le vide, la tête du décapité aux paupières closes et à la barbe rousse.
Muet, Bastien, doigts glissés dans les poches de son jean et pouces reposant sur les pans de sa chemise, scrutait l’œuvre qui l’aspirait dans un tourbillon mystérieux. Salomé s’écarta de quelques pas et se mit à examiner le jeune homme. Il incarnait la génération geek avec son look d’éternel adolescent et son manque de style qui lui donnait un style, celui de Bastien Guainler. Veste noire nonchalamment ouverte sur une chemise du même ton, jean brut et tennis grises, il se la jouait cool, voire trop cool compte tenu de son âge. À trente ans, les boucles de sa toison brune faisaient craquer les mères et les grands-mères, et il s’en amusait volontiers. Salomé avait un tout autre avis sur le sujet, jugeant ce casque capillaire ridicule.
Cependant, là dans la Grande Galerie, le beau gosse avait la mine grave parce qu’un mystère le préoccupait.
— Encore plus surprenant, la gente dame se prénomme Salomé... La Salomé de Bernardino Luini, dit-il en se retournant puis il renchérit : Tu n’aurais pas des origines italiennes, par hasard ? Peut-être qu’un Milanais a échoué en 1500 sur les côtes bretonnes. Vois ces cheveux d’un blond vénitien, ce nez délicat, ces lèvres fines et ce port princier. Ma petite, tu contemples ton aïeule ou bien ton sosie du Moyen Âge.
Épaules rentrées, Salomé ne lui répondit pas, jouant l’aphasique. Elle adorait et détestait tout à la fois que Bastien la surnomme « La petite », prenant le contre-pied de la réalité, puisqu’elle était de six ans son aînée et le dépassait d’une tête par la taille. Naturellement et dès leur première rencontre, il s’était octroyé le droit de la gratifier du doux sobriquet de « Puce » puis au fil des mois, s’était même permis de l’appeler « Baby », « Lutine », « Lilliputienne » et autres qualificatifs du même acabit. Tel un Indien jivaro, il se complaisait dans le rôle du réducteur de tête de la forêt amazonienne et Salomé acceptait, sans se poser toutefois en victime. Trois ans qu’il agissait ainsi.
Pourtant, avec son mètre quatre-vingts et son corps de libellule, elle ne ressemblait en rien à une puce. Probablement que son comportement justifiait bien plus le choix de ce sobriquet. Instable, elle agissait par sauts successifs, sans vraiment suivre un chemin tout tracé. À force de s’évertuer à s’intéresser à tout sans rien approfondir, elle effleurait les sujets. En perpétuelle quête, elle n’avait de cesse de chercher le déclic qui ferait d’elle une femme d’exception. L’éclectisme de sa garde-robe marquait particulièrement son errance. Dans son dressing, s’accumulaient des tenues de tous les styles, du bobo intello, du branché des beaux quartiers au carrément sexy.
Ce matin-là, elle souhaitait effacer jusqu’à son ombre, disparaître derrière le personnage passepartout qu’elle avait endossé, avec ses cheveux sagement attachés, son chemisier blanc cintré et son jean droit. La période présente se voulait réalité parce que la femme idéale qu’elle s’était évertuée à incarner durant trois années, venait de se prendre une monumentale claque. Son grand amour l’avait quittée une semaine auparavant et ce, un mois avant le mariage. À ses yeux, le grand amour n’existait plus, de même que le mythe de la femme parfaite. En la traînant de force au Louvre, Bastien, son meilleur ami, avait décidé de la bousculer, de la métamorphoser en un coton imbibé de culture, de l’anesthésier par l’art. Pour lui, l’amitié restait une variante dédramatisée de l’amour, moins blessante et plus sécurisante. Mais quand l’ami respire la joie de vivre, alors que soi, on étouffe, lorsque ce compagnon s’extasie sur une œuvre de Bernardino Luini, maîtrise la confection des cocktails à base de mezcal et fait indubitablement craquer la terre entière uniquement en souriant, on se sent trahi. Cet ami est l’ennemi qui vous fait prendre conscience que vous n’êtes qu’une moins que rien, tout juste bonne à jeter aux ordures.
Visage grave, elle daigna lui lancer une parole, la première prononcée en une heure :
— Bernardino Luini, connais pas.
— Moi non plus, lui déclara Bastien.
Enfin, Salomé se dérida et même esquissa un rictus, censé être un sourire. Son ami ne savait pas tout sur tout et il l’avouait avec simplicité, cette faille lui remettait un peu de baume au cœur. Il n’était pas parfait et pouvait même trébucher là devant elle, se prendre les pieds dans un tapis virtuel et la rejoindre, plus bas que terre, là où elle se situait à cet instant précis. Mais il ne semblait pas décider à s’effondrer. Évidemment, aucune flétrissure sociale ne venait entacher sa réputation, contrairement à elle. En observant Bastien qui paraissait décidé à combler ses lacunes en allant à la pêche aux informations relatives à Bernardino Luini, elle déchanta complètement. Intrigué par la ressemblance et déterminé à percer l’énigme, Bastien déclara vouloir se mettre en quête d’une autre toile de l’artiste. Lorsqu’il en dénicha une seconde, Le sommeil de l’Enfant Jésus, il la détailla avec une attention toute particulière, ce qui énerva au plus haut point Salomé. Pour tromper l’ennui et repousser son agacement, elle se mit à compter : huit minutes passées devant chacune des deux peintures, trois allers-retours entre les deux toiles et cinq plissements du front de Bastien. Excédée, en tapotant à plusieurs reprises sur le cadran de sa montre, elle réussit à lui faire comprendre qu’il était grand temps de donner une nouvelle cadence à cette interminable visite. Le parcours éducatif se poursuivit au pas de charge tandis que Bastien restait plongé dans une réflexion muette, indéniablement troublé par le premier tableau de Bernardino Luini. Lorsque Salomé bouscula involontairement une copiste installée face à La Joconde, il ne le remarqua même pas. Salomé omit volontairement de se confondre en excuses mais bien au contraire pressa le pas. Elle étouffait.
Une demi-heure plus tard, à l’air libre, elle reprit son souffle et respira à s’en faire exploser les poumons. Grouillante de touristes, la Cour Napoléon ressemblait à une esplanade curieusement placée face à une termitière géante, la Pyramide du Louvre. Avec décontraction, Bastien évoluait dans cette jungle urbaine. Il sortit son portable de sa poche et une bulle virtuelle l’enveloppa entièrement, voire s’opacifia tout au long de sa recherche sur le Net. Excité, il consultait avec rapidité tout ce qui se rapportait à sa découverte, le sosie d’un autre siècle au doux prénom de Salomé. Les vocables associés au nom le laissèrent perplexe : danse des sept voiles, récit biblique, désir incestueux, péché. Au terme de sa rapide enquête, il réintégra la réalité et déclama avec emphase :
— Salomé, la puce, tu es une femme fatale !
Pour toute réponse, la jeune femme haussa les épaules. Bastien s’emporta :
— OK, tu as perdu ta langue, ton sens de l’humour et tu as pourri mon après-midi. Alors, prends-le comme un compliment et mets-le dans ta poche pour le ressortir quand tu iras mieux. Femme fatale !
— Fatale ? Plutôt une esseulée au bord de la crise de nerfs, lui répondit-elle sèchement.
Avec fermeté, Bastien lui attrapa le bras. La déambulation artistique imposée n’avait en rien calmé la douleur de la jeune femme, voire même l’avait transformée en rage. Pourtant, Bastien n’était pas mécontent de son choix. Passer l’après-midi à la terrasse d’un café aurait été un véritable cauchemar, au moins ils avaient marché et contemplé des chefs-d’œuvre, sans avoir eu l’obligation de parler de Julian. Nonobstant, le moment tant redouté et sciemment repoussé était venu, celui de l’explication. Bastien se devait de crever l’abcès qui infectait le cœur de son amie et de revenir dans le champ de la seule préoccupation qui la tenaillait, l’affaire Julian. Alors, il pesta :
— Un sale con ! Même si cela me pèse de le dire, je le répète, un sale con ! Je te concède que tu as la haine et c’est plus que compréhensible. Mais si tu positivais juste un peu... Tu as quatre semaines de vacances devant toi. Te gâcher la vie ne te servira à rien, uniquement à prouver qu’il a bel et bien gagné !
S’écartant de Bastien, elle se posa face à lui.
— Regarde-moi bien, vois la femme épanouie que je suis rien qu’en imaginant ce à quoi j’ai échappé : un bustier trop serré, des dragées d’amour, du tulle sur le capot de sa BMW, des agapes à n’en plus finir, des cupcakes à la rose...
Dents serrées, elle fulminait. Bastien préféra adopter le ton de la dérision.
— Mieux, le carafon en cristal de la grand-tante Arlette. Quant à votre voyage de noces, le Queensland, les voiles blanches du Sydney Opéra House, là j’aurais applaudi. Bien plus classieux que huit jours aux Seychelles. Désormais, j’ose te l’avouer, je trouvais l’idée des eaux turquoise carrément quelconque !
Elle fit une vilaine moue. Songer aux paysages paradisiaques qu’il lui fallait oublier, la crispait au point d’en déformer ses traits.
— Prévu pour juillet. La fille de l’agence de voyages a été compréhensive, pas comme ce satané traiteur, il a prétexté un délai de rétractation trop court... Fait incroyable, Julian l’a joué grand prince en sortant sa carte bancaire. De toute façon, s’il ne l’avait pas fait, je lui aurais envoyé toutes les factures par la poste, à lui et à sa sauterelle.
Bastien lui tendit une carte postale, la reproduction de la Salomé de Bernardino Luini, achetée à la boutique du Louvre.
— Poste-la-lui en souvenir. Il y verra probablement la vengeance du diable !
— Mais qu’il grille en enfer !
— Oh, oh, juste qu’il y rôtisse un peu...
En trois ans, Salomé avait collectionné les professions, toutes se terminant par le suffixe « trice »: créatrice de sacs branchés, actrice dans un soap, animatrice radio et collaboratrice commerciale. Elle s’apprêtait à choisir un nouvel emploi, celui de "réductrice" de tête. Lèvres pincées, elle asséna à Bastien :
— Petit homme, je ne veux plus ressembler à une madone du Moyen Âge. C’est décidé, je vais changer de style et coller un peu plus à mon époque.
Salomé retira la pince qui retenait ses cheveux blonds sagement attachés. Cet acte signifiait clairement le début d’une rébellion. Pourtant, la révolte ne serait pas si aisée à concrétiser, car si trouver un fiancé passé les trente-cinq ans devenait compliqué, dénicher un coiffeur "al dente" tel des pâtes croquantes à souhait, l’était encore plus. Le seul expert en peignes et ciseaux qui l’avait véritablement charmée officiait à Barcelone, autant dire que leur relation avait été de courte durée. Malicieusement, Salomé glissa ses doigts à plusieurs reprises à la base de sa nuque, soulevant son épaisse chevelure blonde. Agacé, Bastien s’emporta :
— Fais gaffe tout de même ! Toutes les femmes ne ressortent pas d’un salon de coiffure avec le sourire aux lèvres et le moral au beau fixe. Un léger dégradé mais pas la coupe au bol, façon Pucelle d’Orléans. Les hommes aiment les cheveux longs.
Elle haussa les épaules.
— Tous pareils ! Et toi, tu ne penses pas avoir passé l’âge de porter un casque de boucles brunes ?
— Tu ne peux pas t’empêcher de sortir tes griffes ! J’assume, et puis passer ma main dans ma tignasse, eh bien, c’est mon petit bonheur du jour, même s’il y a de l’électricité dans l’air.
III ALEXANDRE MÉRIADEC
Quiberon - Le 26 mai
Depuis un mois, ne pas avoir de descendance le préoccupait. Les semaines passant, l’inquiétude se faisait grandissante. À qui pourrait-il léguer ses biens, lui, le vieil homme solitaire ? Néanmoins, si la solitude lui pesait parfois et s’il l’admettait difficilement, même encore aujourd’hui, Alexandre n’avait jamais rien fait pour tenter de la rompre. Il avouait volontiers ne pas supporter la compagnie des hommes. Devoir faire preuve d’empathie ou donner de son précieux temps aux autres par une écoute faussement attentive le révulsait. Il n’était pas du genre à relancer la conversation d’un « Mais encore ? » S’il ne s’était pas marié, c’était bien pour cela, parce que l’idée même de s’imaginer vivre en couple, ce qui sous-entendait une communication minimale, lui donnait la nausée. Fort heureusement, des trois femmes qui avaient partagé son existence, aucune n’avait supporté son narcissisme et toutes lui avaient claqué la porte au nez, même Claudia, la plus docile, aux seins merveilleusement siliconés. Alexandre s’était contenté de métamorphoser ses échecs amoureux en victoires, adoptant la posture du héros moderne à ses yeux, puisque capable de ne pas céder à la petitesse d’un quotidien usant le vécu à deux. Ne pas se forcer à écouter les babillages d’une femme préoccupée par les tâches domestiques resterait son credo jusqu’à son dernier souffle. Ainsi, aucun fils attentionné, nulle fille aimante n’avait jamais franchi le seuil de son domicile pour s’acquitter d’une visite dominicale même éclair. Son égoïsme justifiait pleinement son état de célibataire endurci. Que ce fils unique, dernier de la lignée des Mériadec, à l’approche de sa soixante-dix-neuvième année, découvre sur le tard que son isolement volontaire puisse être la source d’une méchante contrition n’aurait pas dû le surprendre. Pourtant, ce tourment, sentiment nouveau et désagréable, le heurtait parce qu’il lui renvoyait une réalité terrible, personne ne déplorerait sa perte, hormis lui, et encore, par anticipation. Désormais, il lui fallait regarder la déplorable vérité en face, il n’avait que peu d’amis et considérait son chat comme le meilleur d’entre eux, parce que muet et d’une politesse excessive.
Alexandre, se jugeant comme un être d’exception, avait mis un point d’honneur à choisir un chat à son image. Durant ces quatre dernières décennies, des trois maus égyptiens qui lui avaient tenu compagnie, Osiris avait été et restait le plus prometteur de tous. Ce fidèle compagnon, lui aussi au crépuscule de sa vie, avait, au fil des années, appris à évoluer avec grâce dans l’élégante demeure du vieil homme. Osiris, aux pattes de velours, frôlait, avec grande délicatesse, la sculpture en bronze de Giacometti, un marcheur aux lignes pures. Il appréciait les mets délicats et tout comme son maître, portait beau et cultivait son côté nombriliste. Il arborait fièrement une face en forme de triangle, une musculature développée, une longue queue annelée avec un bout noir et une robe dite « spotted tabby », mouchetée, couleur argent. Sur le front de l’animal, une trace brune en forme de « M » marquait son pelage et accentuait son port altier. Des rayures horizontales partaient du coin externe de chaque œil. Ce maquillage égyptien lui donnait une grâce incontestable. Un trait sombre barrait ses joues de part et d’autre de son museau et une rayure profonde soulignait sa colonne vertébrale. Docile, indépendant, intelligent et racé, le félin appréciait la vie paisible que lui offrait son maître. Leurs égocentrismes à tous deux les rapprochaient et les liaient à la vie, à la mort.
En cette fin d’après-midi, Alexandre, installé confortablement sur son sofa en velours vermillon, une pièce unique d’un créateur italien, brossait délicatement le poil d’Osiris avec un peigne à dents serrées. Lorsque la sonnerie du téléphone retentit, son front se plissa. Surpris tout autant que chagriné, l’homme poursuivit néanmoins son œuvre. Cette occupation s’apparentait à un travail d’orfèvre qui ne supportait aucune faute d’inattention. Le répondeur s’activa.
— Bonjour, je suis Bastien Guainler, nous ne nous connaissons pas encore. J’aurais besoin de vous rencontrer en toute urgence. C’est à propos d’une peinture italienne du XVIIe. Je suis à Quiberon et... à quelques dizaines de mètres de votre domicile.
Alexandre se mit à lustrer le poil du chat avec une peau de chamois, en déployant une énergie qui ne lui était pas coutumière. Osiris marqua sa désapprobation en sortant légèrement ses griffes. Le travail de finition expédié, Alexandre abandonna sèchement son compagnon pour aller vérifier si la porte d’entrée était bien fermée à double tour. Il manipula la chaîne de sécurité puis le verrou et tapota enfin sur le chambranle de sa porte blindée. Dans le quartier, les habitants considéraient Alexandre comme un original acariâtre, doublé d’un méfiant obsessionnel. Un épais mystère entourait le personnage. Certains avançaient qu’il craignait de se faire dérober des louis d’or, d’autres qu’il cachait un secret peu avouable. Ces allégations sans preuve tangible entretenaient néanmoins la rumeur. Des résidants de la rue, un seul, Maurice Velin, avait le privilège d’être convié avec une régularité de métronome chez Alexandre Mériadec. Cet honneur lui conférait le droit de développer sa propre théorie sur le personnage et de pouvoir la délivrer aux curieux de son entourage. Il expliquait le comportement soupçonneux d’Alexandre par la présence dans le salon d’une toile qui devait valoir une petite fortune. Il supposait uniquement que le tableau valait son pesant d’or, n’ayant pas pu identifier l’artiste. Bien qu’ayant été invité à moult reprises dans l’antre d’Alexandre, et ce toujours un jeudi pour prendre un digestif, il n’avait pas pu déchiffrer la signature en bas de la toile, même en effectuant de savantes torsions du buste.
Auprès de la boulangère du centre-ville, Maurice s’épanchait quotidiennement et elle l’écoutait par pure politesse. Il avait bien noté que lorsqu’il évoquait Alexandre Mériadec, elle lui accordait une écoute plus attentive. Aussi en jouait-il. Il aimait qu’elle le considère comme une personne d’importance. En décembre dernier, bombant le torse, il lui avait déclaré alors qu’elle lui tendait une baguette croustillante :
— Mériadec possède une toile... vieille, authentiquement vieille. Un fameux coup de pinceau. Un paysage d’un réalisme touchant avec, au premier plan, un arbre monumental et, assise sur un muret de pierres sèches, une bergère avec un curieux fichu rouge jeté sur les épaules. Le carmin de l’étole capte toute l’attention. La lumière s’insinue entre les branchages, rebondit sur les feuillages, éclaire le sentier sinueux menant à un hameau, tout au loin. On imagine facilement l’artiste face à son chevalet, peignant la scène avec le soleil dans les yeux. Je parierais sur... l’Italie.
La boulangère n’avait pas perçu l’information comme suffisamment pertinente pour devoir la commenter. Peu intéressée par l’art pictural, elle avait étrangement renchéri sur les vacances de sa nièce à Ibiza. A priori, elle ne s’y connaissait pas plus en géographie. Maurice en avait éprouvé de la peine. Son rayon de soleil quotidien s’était soudainement caché derrière une vilaine masse nuageuse. La belle boulangère était idiote. Ce que la charmante femme aux rondeurs appétissantes ne soupçonnait pas, c’est que Maurice avait vu juste.
Au-dessus du sofa, c’était bien une œuvre d’une inestimable valeur qu’Alexandre exposait en toute intimité, celle d’un certain Claude Gellée, dit Le Lorrain, l’un des peintres les plus célèbres du XVIIe siècle avec Poussin. Claude Gellée que rien a priori ne destinait à rentrer dans l’histoire comme un personnage d’exception dans le domaine de la peinture, était né en 1600 à Chamagne, en Lorraine, dans une famille modeste. À quatorze ans, orphelin et désargenté, il avait pris la décision qui allait sceller son destin : se rendre à Rome pour entrer au service d’un célèbre peintre italien. Son talent s’était vite affirmé et n’avait cessé de se confirmer tout au long de sa foisonnante carrière, puisqu’il peignit jusqu’à la fin de sa vie en 1682. C’est en 1645, au sommet de sa gloire, qu’il avait réalisé ce paysage romain. Trois cent quarante ans plus tard, Alexandre avait acheté cette huile sur toile à un lord anglais qui, après des revers de fortune, avait dû s’en séparer en toute discrétion, ne souhaitant pas ébruiter la vente. La peinture, propriété d’une famille anglaise depuis quelques décennies, avait quitté Londres par le ferry dans un bagage à main. Désormais, elle se retrouvait sur le mur du salon d’Alexandre Mériadec. Le seul homme qui avait osé questionner Alexandre sur la provenance du tableau était Maurice. Avec empressement, Alexandre lui avait fourni une réponse confuse : « Acheté aux Puces. Une vieille croûte, comme moi. Une gardienne de troupeau, solitaire, perdue dans la campagne méditerranéenne. Sans valeur aucune. » Puis il avait clôturé son explication embrouillée par « Un autre digestif... un toast au saumon sauvage ? » Cette réplique bafouillée avait aiguisé encore plus la curiosité de Maurice. Elle fleurait le mensonge. Jamais, en dix ans, Alexandre n’avait proposé à Maurice de prendre un second verre.
Tandis qu’Alexandre actionnait le volet roulant de la baie vitrée, une légère sonnerie puis un grésillement provenant de l’interphone le firent tressaillir. Ainsi, le dénommé Guainler n’avait pas menti et se trouvait probablement devant chez lui. Alexandre fit la sourde oreille. Impassible, il retourna s’asseoir sur son sofa.
À l’extérieur, Bastien se tenait effectivement devant le portail plein, l’index collé à la sonnette. Maurice, cheveux blancs et impeccablement mis, avançait à pas lents sur le trottoir, tout en regardant Bastien agir. Arrivé au niveau du jeune homme, Maurice stoppa net sa progression. Droit comme un I, son panier en osier sous le bras, il resta planté dans le dos de Bastien. À le voir, on aurait pu croire que le vieil homme prenait place dans une file d’attente, disposé à accepter sagement que vienne son tour. Bastien ne sourcilla pas et joua l’indifférent. Soudain, Maurice perdit patience et explosa :
— Jeune homme, inutile de maltraiter ainsi ce pauvre bouton ! Si Alexandre Mériadec a décidé de ne pas vous faire entrer, inutile d’insister. Si cela vous chante, vous pouvez rester ici jusqu’à la nuit venue à torturer ce malheureux poussoir. De toute façon, Monsieur Mériadec ne vous ouvrira pas.
Bastien se retourna enfin.
— Vous le connaissez ?
— C’est mon voisin. Et vous ?
— Je n’ai pas encore eu le plaisir de le rencontrer.
— Déjà qu’il laisse très peu de monde passer le seuil de sa villa, alors si c’est pour lui vendre quelque chose, n’y comptez pas trop.
— Vous vous méprenez. Je ne démarche pas. Pourriez-vous tenter de le contacter par son interphone, vous arriverez peut-être à le décider à me faire entrer ? Je suis convaincu qu’il est chez lui.
— Jeune homme, vous me semblez bien sûr de vous. Mais d’ailleurs, en vertu de quoi, j’agirais de la sorte. Vous lui voulez quoi au juste à Monsieur Mériadec ?
— Lui parler d’une toile de maître.
Immédiatement, la mine renfrognée de Maurice se métamorphosa en une mine réjouie. Contre toute attente, il accepta d’obtempérer. Il appuya sur une des touches de l’interphone, s’annonça mais n’eut aucune réponse. Ensuite, il resta figé sur le trottoir, observant à nouveau Bastien qui s’évertuait désormais à frapper sur le lourd portail en bois. L’action semblait vaine. Malgré cela, Maurice ne bougeait pas, contemplant avec insistance les trois queues de poireaux qui dépassaient de son panier en osier. Il acceptait l’attente avec une excitation non feinte. Au bout de trois minutes, il claironna :
— Je vous l’avais bien dit, il ne fait entrer personne. Par contre, moi, je veux bien vous offrir un porto. Ainsi nous pourrons parler de l’œuvre. La peinture italienne...
Bastien ne se fit pas prier, il tenait peut-être enfin une piste. Ce chemin de traverse se présentait sous la forme d’un voisin perspicace.
IV MAURICE VELIN
Quiberon - Le 26 mai en fin d’après-midi
Le jardin de Maurice, bien qu’en mitoyenneté avec celui d’Alexandre, était non seulement bien plus modeste en taille mais aussi nettement plus conventionnel. Il n’y était pas question de massifs taillés en boule, de platelages en bois ou d’une mise en scène d’inspiration feng shui. A contrario, Maurice adorait les géraniums et collectionnait les nains de jardin. Bastien, en empruntant la petite allée goudronnée, rectiligne et bordée d’une pelouse parfaitement entretenue, ne put s’empêcher de remarquer les curieux bonshommes en plâtre. Sept nains goguenards jalonnaient le chemin d’accès à l’habitation, une maison aux murs blancs et aux volets en bois couleur azur. Immédiatement en entrant dans la villa, Bastien sut que le vieil homme vivait seul. Le sweet home de Maurice Velin exhalait la tanière du vieux loup solitaire. Les senteurs d’encaustique masquaient avec peine l’odeur de renfermé. Filtrée par de lourdes tentures chocolat, la lumière du jour dévoilait de fines particules en suspension dans l’air. Dans le salon, la poussière s’accumulait sur les maquettes de voiliers d’antan, les piles de quotidiens, les meubles en acajou. Curieusement, des caisses de déménagement étaient disséminées aux quatre coins de la pièce. Au centre du salon, un tapis persan portait des marques d’usure localisées précisément devant un crapaud en velours bleu. Bastien imagina sans peine quel était l’emplacement préféré du maître des lieux.
Après avoir proposé à Bastien de s’installer dans le living-room, Maurice détendit l’atmosphère en se permettant une remarque personnelle :
— Je suis veuf. Cela ne justifie en rien le désordre, je le dis uniquement pour atténuer votre point de vue sur ma personne.
— Ah. Toutes mes condoléances.
— Merci. Le veuvage, la solitude et le capharnaüm s’installent insidieusement... Donc, le tableau serait bien italien ?
— Oui, il vous en a parlé ?
— À mots couverts. De qui est-il ?
— De Bernardino Luini, évidemment.
— Évidemment, où avais-je la tête. Luini, quel artiste !
Maurice exultait, enfin, il tenait un patronyme, de plus qui embaumait la campagne italienne. Il s’imaginait déjà aller annoncer sa découverte à sa charmante boulangère. Pour qu’elle prête attention à ses dires, il lui faudrait cependant apporter un élément matériel de taille, l’annonce d’une estimation, la proclamation d’un prix astronomique qui la laisserait pantoise. Pour obtenir la précieuse information, il osa affirmer :
— Une petite fortune.
— Il n’est pas question de prix. Une valeur inestimable.
— Oh ! s’enthousiasma Maurice.
— Que vous a-t-il dit exactement, concernant cette œuvre ?
— Peu de chose, fort peu à mon grand regret. Si je peux me permettre un avis personnel, c’est la femme peinte sur la toile qui doit lui plaire.
— Salomé ?
— Incroyable, cette charmante inconnue a un merveilleux prénom que j’affectionne tout particulièrement. D’ailleurs, dans ma famille...
Sentant la digression poindre, Bastien se permit de couper court pour recentrer les propos de son informateur :
— Monsieur, merci de m’accorder un peu de votre temps en me parlant de cette toile. Cela fait deux semaines que je me perds dans les méandres de l’administration et je dois dire que je désespérais d’aboutir. J’ai fouillé les archives de nombreux musées et c’est complètement fortuitement que je suis tombé sur le nom de votre voisin. On peut dire qu’il maîtrise l’art de brouiller les pistes.
Plissant les paupières, Maurice dodelina de la tête. Perplexe, il ne comprenait pas en quoi Alexandre Mériadec, un vieux grincheux se donnant des airs d’aristocrate, maîtrisait un tel art, celui du camouflage. Pourtant, il déclara tout de go :
— J’ai toujours pensé qu’il cachait bien son jeu. Il y a dix ans, une entreprise spécialisée en sécurité a installé chez lui une porte blindée. Je parierais que des alarmes se trouvent dissimulées aux quatre coins de son logis. Les cambrioleurs n’ont qu’à bien se tenir.
Sa remarque formulée, Maurice eut soudainement un horrible doute. N’aurait-il pas laissé entrer le loup dans la bergerie, un voleur chez lui ?
— Vous travaillez peut-être pour une compagnie d’assurances ? questionna-t-il, inquiet.
— Absolument pas. Je suis développeur.
Pour Maurice, l’opacité du terme qualifiant la profession annoncée oscillait entre le concret d’un immeuble en construction et l’abstrait d’un univers en perpétuelle extension. Il ne tenta pas de percer l’énigme et pour ne pas paraître inculte, il décida de rentrer dans le vif du sujet :
— Pourquoi diable, vous intéressez-vous à la toile de mon voisin ?
— Quelle toile ?
— Mais cette Salomé, cette bergère de Bernardino Luini de grande valeur !
Yeux écarquillés, Bastien dévisagea Maurice.
— Quelle bergère ?
— Celle au fichu rouge qui trône dans son salon ! Bastien se mit à rire.
— Il y a méprise. Je ferais mieux de rencontrer personnellement Alexandre Mériadec. Je suis descendu dans un petit hôtel à Port Maria et je compte y rester quelques jours. Pourriez-vous lui évoquer notre rencontre ? Oh, excusez-moi, je grille les étapes, je ne me suis même pas présenté. Mon nom est Guainler, voici ma carte.
Désarçonné, Maurice attrapa la carte de visite et la tritura nerveusement avant de la ranger dans la poche de sa veste. Il n’était pas question pour lui de décliner son identité à ce jeune inconnu. Méfiant, il demanda :
— Et je lui dis quoi au juste ?
— Que je suis passé et que j’ai l’intime conviction qu’il pourrait me fournir de précieuses informations.
— Sur qui ? Pourquoi ?
— Il y a trente ans, Alexandre Mériadec a fait exactement le même cheminement que moi, en effectuant des recherches identiques aux miennes. Je gagnerais un temps précieux en le rencontrant.
— Ah, encore faudrait-il qu’il accepte de délier sa langue.
— Il le fera. Il suffira que je prononce un nom.
— Lequel ?
— Florence H.
Maurice pâlit, puis ses doigts tremblèrent légèrement. Ce qui ne manqua pas d’alerter Bastien, même s’il n’en laissa rien paraître. Un silence glaçant s’ensuivit. Bastien but le verre de porto à petites gorgées, espérant prolonger l’entrevue, mais Maurice ne lui proposa pas un second vin cuit. Sa curiosité, bien que fortement attisée, ne devait pas lui faire oublier qu’il avait laissé un étranger s’introduire chez lui.
V LA CLÉ
Quiberon - Villa d’Alexandre Mériadec
Depuis que son médecin lui avait diagnostiqué cette maladie - Alexandre ne préférait pas prononcer le mot cancer - le vieil homme songeait à la mort, plus précisément à la sienne, celle des autres ne l’intéressait pas. Cette étrangère qui, aux dires du corps médical, viendrait bientôt lui rendre visite, armée de sa faux, le terrifiait. La nuit, il rêvait de l’épitaphe inscrite sur sa tombe, autant dire cauchemardait. Le jour, chaque souffle lui devenait précieux et le quotidien prenait un délicieux goût de miel. Même l’ennui trouvait grâce à ses yeux. Au coucher, il imaginait que, posé sur le guéridon de sa chambre, un sablier du temps le narguait. Dans l’incapacité de le retourner, il se découvrait impuissant face à cette horloge matérialisée sous la forme d’un misérable tas de sable. Cette vision funeste le mettait en rage. Depuis sa plus tendre enfance, il croyait que ses parents s’étaient penchés au-dessus de son berceau pour lui offrir un bon gros sablier, en l’occurrence un patrimoine génétique excellent, désormais, il émettait un doute, voire il en voulait à son défunt père de l’avoir fort certainement dupé. Ce dernier lui avait toujours soutenu qu’un Mériadec ne décédait que passé les quatre-vingt-dix ans et avait même confirmé ses dires en tirant sa révérence à l’approche de sa quatre-vingt-quinzième année d’existence terrestre.
Naturellement, Alexandre se considérait bien trop jeune pour quitter le monde des vivants, même si les autres ne le voyaient pas de cet œil. Deux mois auparavant, il était sorti de ses gonds, fait peu coutumier. Alors que contraint depuis quelques semaines de suivre une thérapie, il s’était vu propulsé dans un monde inconnu, celui d’un hôpital aseptisé, face à un agent hospitalier qui avait osé lui déclarer tout de go : « Soixante-dix-huit ans, c’est un bien bel âge pour mourir », il s’était emporté. Au gaillard, il avait rétorqué : « Vous n’avez rien compris à la vie, c’est un combat de chaque instant. On peut fêter ses quatre-vingts printemps et penser à l’avenir, tout comme souffler quarante misérables bougies sur son gâteau d’anniversaire et se sentir terriblement vieux. Monsieur, le poids des ans plaque votre blouse bleue sur votre peau de vieillard cynique et vous n’en avez même pas conscience ! » Si l’homme vêtu d’une cotonnade azur avait haussé les épaules, c’était bien pour lui signifier que, quoi qu’il en dît, le combat était perdu d’avance. Les médecins donnaient au mieux une année à ce patient récalcitrant et si ce dernier ne voulait pas voir la vérité en face, il pouvait s’en remettre à Dieu pour obtenir un sursis de quelques semaines. Dans le monde des blouses bleues, soixante-dix-huit ans était et resterait un bel âge pour passer de vie à trépas.
À la suite de cette mésaventure, Alexandre avait annulé son suivi médical, prétextant qu’il souhaitait prendre son avenir en main, expliquant à son cancérologue et à sa cohorte de subalternes que l’urgent se situait ailleurs, hors des murs immaculés d’une institution stupide. À son grand étonnement, les docteurs acceptèrent ce choix et ne le dissuadèrent même pas de changer de point de vue. Les hommes vêtus de blouses blanches appartenaient au monde des hommes drapés dans des blouses bleues.
Libéré du dictat médical, Alexandre s’était décidé à entamer un travail d’écriture pour soigner son mal par les mots. Il entrevoyait un avenir parce qu’il s’était fixé un but, celui de mener un projet qui passait notamment par l’écriture. Pour lui, il n’était pas question de se lancer dans la rédaction de ses mémoires mais uniquement dans celle d’une lettre et de notes annexes. Le soir précédent, empli de désespoir et de lucidité, il avait écrit le début de cette lettre : « Moi, Alexandre Mériadec, sain d’esprit, je lègue tous mes biens à... » mais il avait manqué cruellement d’inspiration pour terminer le texte. Coucher sur le papier le nom d’une personne physique s’était avéré si délicat qu’il avait laissé ses mots en suspens. En cette fin d’après-midi, il se sentait déterminé à poursuivre le douloureux exercice. Assis à sa table de travail, son stylo au bec de plume en or bien en main, il griffonna « Osiris ». Certains farfelus faisaient des dons à leur chat et Alexandre se sentait très proche de ces hurluberlus. Mais comme il savait pertinemment que la loi française interdisait de léguer son patrimoine à un chien, un serin ou un tigre du Bengale, il se morfondait du manque de compréhension des législateurs. Quant à faire bénéficier une association protectrice des animaux d’un legs, uniquement pour rester dans la légalité, il en détestait l’idée. Il aimait Osiris et n’en n’avait rien à faire de nourrir des millions de chats de gouttière abandonnés par leurs maîtres. Il crayonna « Maurice » sans grande conviction mais avec une arrière-pensée en tête. Et s’il laissait tous ses biens à son voisin qui, en contrepartie, prendrait soin de son mau égyptien ?
Il fit un rapide calcul. Maurice avait soixante-dix-neuf ans et son chat onze, soit approximativement le même âge avec le décompte de sept ans pour un chat équivalent à une année de vie pour un être humain. Sur la feuille placée sur son dessous de main en cuir, Alexandre se tenait prêt à mettre noir sur blanc toutes ses conditions : son voisin devrait non seulement laisser Osiris résider dans sa villa avec une jouissance pleine et entière des lieux mais encore passer le voir trois fois par jour et le sortir chaque jeudi. La femme de ménage entretiendrait quotidiennement et avec soin la résidence de son chat et recevrait un dû pour accomplir cette tâche, le jardinier se retrouverait gratifié de pareille façon sans aucun service demandé en retour.
L’éventualité d’un legs à Maurice lui trottait déjà dans la tête, de façon inconsciente. Sans avoir formulé précisément cette arrière-pensée, Alexandre s’était déjà avisé de questionner négligemment Maurice sur son état de santé, lors de leur rendez-vous hebdomadaire du jeudi précédent. Il l’avait joué finement pour ne pas éveiller les soupçons de sa relation de voisinage déjà méfiante. L’affaire de la toile du Lorrain lui restait en mémoire. Bien que Maurice se soit uniquement plaint d’une douleur lancinante au niveau de la hanche provoquée par des rhumatismes, autant dire peu de chose, Alexandre imagina rajouter une clause à son testament. Dans le cas où Maurice viendrait à décéder prématurément, sa fille pourrait prendre la suite, en lieu et place de son père. Étant entendu que les fils de Maurice Velin ne valaient rien, il ne pouvait en être autrement. Alexandre les considérait comme des bons à rien qui vivotaient, se contentant de petits boulots qu’ils nommaient pompeusement « les affaires ». Maurice Velin s’épanchait parfois sur les prétendument florissantes affaires de ses garçons et Alexandre trouvait cet épanchement agaçant. Depuis le décès de leur mère, ces hommes visitaient une fois l’an leur père. Ils débarquaient en formation serrée, tels des fantassins, et ce pour la Toussaint. Alexandre les soupçonnait tous les cinq de profiter des largesses de Maurice. S’acquitter du devoir de fleurissement de la tombe maternelle leur valait de recevoir un chèque de remerciement. Alexandre jugeait leur comportement méprisable et se félicitait de ne pas avoir de descendance masculine.
Comme la fille de Maurice agissait différemment, avec sincérité et sans arrière-pensée vénale, elle trouvait grâce à ses yeux et elle lui faisait presque regretter de ne pas avoir de fille à ses côtés. Ainsi, le choix de Salomé comme personne de confiance en lieu et place de son père, était un juste retour des choses pour cette enfant qu’il avait côtoyée de sa naissance jusqu’à ses treize ans. Alors que la jeune fille était âgée d’une douzaine d’années, Salomé l’avait surpris en lui assénant qu’il était son ami d’enfance. Bien que le qualificatif « d’enfance » avait semblé inapproprié à Alexandre, voire grotesque compte tenu de leur différence d’âge, la fillette n’avait pas voulu en démordre. Il l’avait fait sauter sur ses genoux de nombreuses fois, du vivant de madame Velin mère, et cette proximité avait dû la convaincre qu’ils avaient été amis, un jour, lorsqu’elle était enfant. Cette amitié avait pris fin avec le début de l’adolescence de la demoiselle. Alexandre Mériadec avait conservé en lui cette surprenante réplique : « Monsieur, vous resterez mon ami d’enfance, même quand je serai grande. » Alexandre se doutait bien qu’en grandissant, l’enfant avait complètement oublié cette promesse grandiloquente. Petite, elle parlait à tort et à travers. Sortait de sa bouche un flot continu de paroles, sans aucun intérêt selon Alexandre. Il ne se souvenait plus de la dernière fois où il l’avait fait sauter sur ses genoux. Probablement dès qu’il avait cessé d’apprécier sa présence dans la même pièce que lui. Parfois, il songeait encore à Salomé parce qu’elle avait été à l’origine d’une partie de sa fortune, sans même le soupçonner. Trois ou quatre fois l’an, il croisait la demoiselle sur le marché, le samedi matin à Quiberon, ou dans le quartier lorsqu’elle rendait visite à son père. Élancée, bien trop grande au goût d’Alexandre, elle était néanmoins jolie et semblait être une personne de confiance. Elle le saluait toujours courtoisement, lui adressait quelques paroles banales, des mots d’usage sur la météo changeante. Désormais, seules des politesses convenues sortaient de sa bouche d’adulte. N’était-il pas venu le temps de lui avouer le lien qui les unissait ?
Brusquement, il déchira la feuille de rage. Le choix de Maurice Velin n’avait aucun sens, il le savait, il se voilait la face, il délirait, il s’écartait de son but. Laisser sa fortune à son chat ou encore à un vieux bougre d’un an son aîné, quelle absurdité ! Sa maladie lui faisait-elle perdre la raison ? De plus, il s’interrogeait : qu’est-ce que ce Bastien Guainler pouvait bien lui vouloir ? Ce chenapan venait forcément remuer la boue bien sèche. Cet épineux problème troublait ses plans, car depuis quelques semaines, il réfléchissait à une stratégie pour mener à bien un ultime projet, dans un temps fort limité. La dernière étape consistait à trouver le fameux nom, le patronyme de l’heureux héritier de son énorme fortune et à noter ce nom sur son feuillet, mais ce n’était qu’un palier nécessaire, certes difficile à franchir.
Au fond de lui, il aspirait à une chose : l’amour. Il souhaitait se faire aimer, ne serait-ce que d’une seule personne. Donner de l’amour et en recevoir en retour lui apparaissaient comme la seule porte de sortie honorable. Mais trouver l’élu capable de verser une larme en apprenant la disparition du pire égoïste qui soit, Alexandre Mériadec, ne serait pas chose aisée, surtout en l’espace de quelques mois. Le seul être vivant qui partageait son intimité se révélait être incapable de s’apitoyer sur le sort d’un vieil homme malade. Un chat ne pleurait pas. Son chat ne pleurait pas, en cela, il n’était pas d’exception. S’il miaulait ou cherchait la caresse, ce n’était pas pour déclarer un quelconque amour. Il récompensait uniquement son maître de sa générosité par des signes d’affection. Le terme d’animal de compagnie lui convenait parfaitement. Osiris jouait son rôle à merveille et honorait de sa présence discrète les lieux. Concernant les êtres humains côtoyés par Alexandre tout au long de sa vie, le problème restait délicat. Amantes d’hier et relations professionnelles d’avant-hier ne frappaient jamais à sa porte. Seul Maurice lui rendait la visite hebdomadaire. Mais Alexandre ne lui portait aucun intérêt véritable, hormis celui de se rendre disponible le jeudi soir pour déguster un verre de porto. Et pourtant si Alexandre n’agissait pas avec promptitude, l’œuvre d’une vie pouvait se retrouver remise entre les mains d’un quidam ou, pire, de l’État. Il lui fallait réagir au plus vite. Il s’énerva. Il s’en voulait de sa dernière folie, exposer la toile de Gellée dans son salon. Rien qu’à l’idée d’imaginer quiconque pénétrer dans sa chambre à coucher, des frissons lui parcouraient le dos.
Il rabattit le col châle de sa robe de chambre en cachemire anthracite et resserra la ceinture en satin. Il était uniquement vêtu d’une tenue d’intérieur griffée et réalisée à la main par un drapier bruxellois. Chez lui, il aimait évoluer avec cet unique vêtement à même sa peau nue, confectionné dans une matière noble. En société, il appréciait de parader dans un costume impeccable en provenance d’Angleterre, même si les occasions de paraître se faisaient de plus en plus rares. Il affectionnait les matières raffinées : laine peignée, soie, mohair, vigogne. Ce luxe lui manquerait, cette vie lui manquerait. Il ne voulait pas mourir, pas comme cela, pas en laissant l’œuvre de toute une vie, orpheline. Ses doigts glissèrent le long de la grosse chaîne en or qu’il portait à son cou. Son index effleura la clé qu’il avait conservée depuis trois décennies. Ce geste le rassura puis le dopa brusquement. Promptement, oubliant son arthrose, il se dirigea vers le sofa. Debout, les pieds enfoncés dangereusement dans le moelleux des coussins, il tenta de décrocher la toile du mur. Il devait agir au plus vite, le temps lui était compté. La maladie le grignotait de l’intérieur et repoussait violemment le sable dans le sablier. Il allait se faire aimer et offrir son précieux héritage à un être d’exception.
À minuit, Alexandre posa enfin un nom sur le feuillet. Il relut à haute voix :
— « Moi, Alexandre Mériadec, sain d’esprit, je lègue à Salomé Velin, la clé que je porte à mon cou et qui ne m’a pas quitté depuis trente ans, ainsi que tous les biens qui se trouvent derrière la porte que seule cette clé peut ouvrir. »