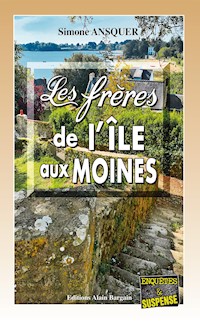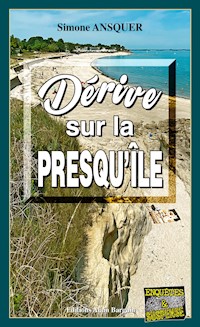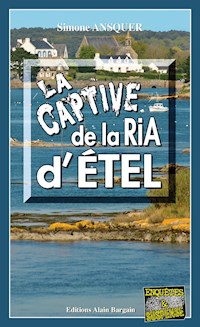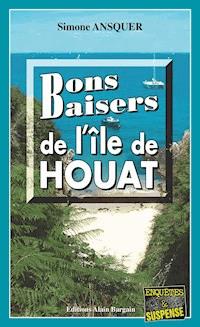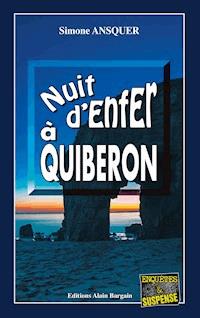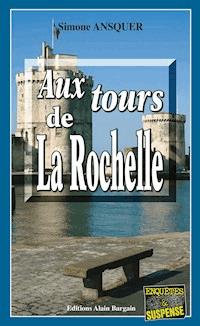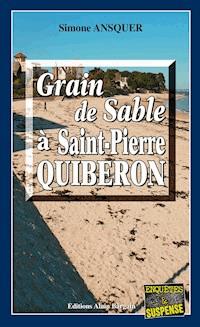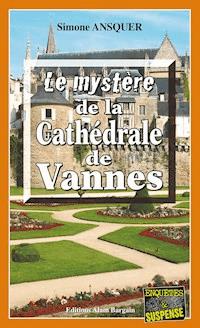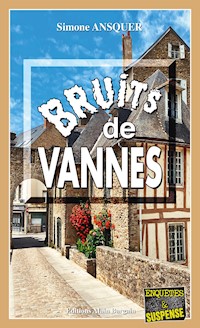
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Quelqu'un tourne autour d'Audrey, elle le sent, quelqu'un lui veut du mal... Mais pourquoi ?
Au cœur de Vannes, les bruits courent dans la ville mais aussi dans la maison d’Audrey Doubriac. Dans six jours, ils livreront leurs secrets, l’ultime soupir de la victime et le nom de l’assassin. Depuis son emménagement dans sa maison bourgeoise, Audrey a le sentiment d’être épiée. Le malaise grandit avec la réception d’un étrange colis. Grincement du parquet, murmures et sombres confidences familiales. Qui l’espionne ? Qui la persécute et pourquoi ? Seul Alberto, son ami horloger, comprend son désarroi. Leur enquête les mène au-delà du Vieux Vannes, à Arradon et à Conleau. Car tôt ou tard, tout comme le passé, le cadavre refait surface.
Entre meurtre et espionnage, il n'y a pas de repos dans le onzième roman de Simone Ansquer !
À PROPOS DE L'AUTEURE
Née à La Rochelle en 1960 où elle a grandi,
Simone Ansquer vit aujourd’hui sur la presqu’île de Quiberon et y cultive ses passions pour les sports nautiques, l’histoire et la peinture. Avec ce onzième roman, l’auteure vous invite à méditer sur une citation de Sophocle : « Tout est bruit pour qui a peur. »
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Remerciements à Carl et à Fred.
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
Je ne me souviens de rien ou de si peu. Ni saveur ni odeur pour qualifier ce cauchemar éveillé. Vision d’apocalypse, incontestablement. Le jaune était partout, une couleur maudite. J’aurais pu ou dû mourir mais j’ai survécu. Moi, la séductrice, la pétillante rousse, je me suis réveillée défigurée. J’ai tenté d’oublier le drame et de me reconstruire. Rage de la combattante que je suis. Mais il a suffi qu’un coursier sonne à ma porte pour que toute mon existence bascule de nouveau. Déjà damnée pour le restant de mes jours, étais-je condamnée à souffrir, voire à mourir à l’instant même où j’ai reçu le colis ? Je pensais que rien de pire ne pouvait m’arriver parce que le pire marquait déjà mon visage. Je me trompais. En ouvrant ce colis, ce que je ne savais pas, c’est que je m’apprêtais à côtoyer la mort pour la seconde fois.
Voici l’histoire d’un crime.
Voici l’histoire des six jours de l’existence d’une femme éperdument accrochée à la vie.
Voici mon histoire, celle d’Audrey Doubriac.
I LE COLIS
Centre-ville de Vannes. Lundi
« Vous sera-t-il plus facile d’être un monstre qu’une sainte ? » était inscrit au recto de la carte au liseré jaune qui accompagnait le colis. Au verso une signature énigmatique, trois lettres calligraphiées avec application par un inconnu. “Qui” signait son envoi par ce “Qui”, en conservant sciemment l’anonymat.
Après avoir déballé de leur papier de soie six bols, Audrey les scruta avec circonspection. Intriguée de recevoir cet étrange colis de bon matin par une société de livraison express, a priori sans erreur d’adresse et arrivé au bon destinataire. Elle l’était d’autant plus qu’elle n’avait jamais passé ce type de commande. Perturbée par la découverte du message joint, elle le lisait, le relisait et le relut de nouveau parce que chaque mot pesé, choisi par le rédacteur, heurtait sa conscience. Ce messager s’en prenait à elle en lui posant une question étrange aux multiples interprétations possibles. Êtes-vous une sainte ou bien un monstre ? Dans un avenir proche, vous vous interrogerez sur votre facilité à être plutôt l’un que l’autre. Quand le ferez-vous et pourquoi ? Dans quelles circonstances aurez-vous à le faire ? Sainte, elle ne l’avait jamais été et monstre, elle l’était déjà.
Quant aux bols, les aligner sur la table du salon avait été son idée première, ce qu’elle avait fait par obligation puisque, dans toute la maison, c’était le seul meuble non encombré par des cartons. Assise sur un tabouret en bois brut, face à ce petit train grotesque composé de six curieux wagons en porcelaine, elle réfléchissait. D’objets quelconques, ils devinrent brusquement sournois, semblant même la narguer les uns après les autres. Liseré bleu, oreilles décollées, arborant fièrement le style « bol breton ». Bien qu’a priori identique à son compagnon de route, chaque contenant assumait crânement sa différence, par la présence d’un prénom spécifique peint à la main sur l’extérieur.
Markus, Lilas, Sophie, Claude, Ester et Eliott s’invitaient à sa table sans y avoir été conviés. Ils étaient pourtant là et c’était bien elle qui les y avait placés. Elle s’interrogeait sur leur présence sur sa table alors qu’une dizaine de minutes auparavant ils attendaient, bien sagement emballés, dans un colis adressé à son nom, accompagné d’un mot glaçant. Si c’était un canular, il était de fort mauvais goût. De cette mauvaise plaisanterie, elle se serait bien passée en ce matin de printemps. Elle tentait de reconstruire sa vie, de rassembler les miettes, de picorer un peu de bonheur dans un quotidien sans saveur. Ses efforts risquaient de partir en fumée, avec cette étincelle. Le château de cartes de sa nouvelle vie restait instable. Une simple brise, le moindre tracas pouvait mettre à terre l’édifice.
Irritée mais décidée à trouver le messager pervers, Audrey attrapa son smartphone et envoya un SMS identique à trois de ses proches : « Kfé chez moi ? J’ai bien reçu les bols ! » Une sorte de bouteille à la mer lancée à la va-vite, histoire de retirer de la liste des suspects ses trois meilleurs amis, voire de les démasquer et même d’en rire par la suite. Songeant subitement que ces trois personnes de confiance étaient âgées approximativement de quarante, soixante et quatre-vingts ans, ce fait la contraria. Elle glissait sur une pente qui n’avait rien de douce. À Paris, elle avait côtoyé tant d’individus, pratiquement tous de sa génération, celle des quadras. Amis envieux et ennemis impitoyables, elle s’était empressée de les oublier. Il y avait bien les inclassables, qu’elle continuait à fréquenter en pointillé, comme sa demi-sœur et son conjoint qui ne l’avaient jamais jugée, ou du moins pas en public. Quant aux couples qu’elle s’était sentie obligée de recevoir pour satisfaire son ex-compagnon, ils ne donnaient plus aucun signe de vie. Depuis son accident et sa séparation, elle avait fait le grand ménage autour d’elle, tout autant par la force des choses que par une volonté farouche de s’isoler.
Soudain, ce colis la ramena à la réalité ; elle songea que si c’était un cadeau d’anniversaire, il arrivait avec une semaine d’avance. Dans sept jours, elle allait fêter ses quarante ans, de surcroît dans les cartons de déménagement ; des dizaines de tasses colorées et dépareillées attendaient d’être déballées. Objets a priori inutiles lui rappelant qu’ayant emménagé à Vannes, il y a de cela deux mois, elle tardait à défaire les cartons. Était-elle monstrueuse de ne pas avoir pendu la crémaillère de son home, ou encore de ne pas avoir expédié de carton d’invitation à ses relations parisiennes pour une soirée d’anniversaire qu’elle ne comptait pas organiser ? Étaient-ce ses voisins qui lui envoyaient un appel du pied, ou plutôt du palais pour qu’elle les convie à fêter son emménagement ?
La surprise passée, Audrey enroula une grosse écharpe beige autour de son cou et la ramena sur le bas de son visage ; ensuite, elle sortit de chez elle. Le centre-ville de Vannes s’éveillait en douceur. Les premiers clients s’attablaient à la terrasse du petit café en bas de sa rue, un commerçant levait son rideau de fer, une vendeuse nettoyait la vitrine de son magasin. Des Vannetais commençaient leur journée de travail alors qu’Audrey jouait la curieuse, s’employant à débusquer sur l’une des boîtes aux lettres de ses voisins un des prénoms inscrits sur un bol. Mais elle ne trouva pas de Markus ni d’Ester, pas plus que de Sophie, dans son voisinage. À neuf heures, elle monta dans sa Triumph vintage garée sur une place de parking privé. Disposer d’un espace de stationnement était un luxe à Vannes, ville touristique, patrimoniale et au centre piétonnier. À l’abri du monde dans l’habitacle de son bijou, une décapotable vert olive avec intérieur cuir, elle s’appliqua à oublier ce paquet. L’oublier ou tout au moins le considérer comme un mystère qui se dévoilerait innocemment dans les jours à venir l’apaisa. Elle se trompait lourdement.
II LE SEPTIÈME BOL
Centre-ville de Vannes. Mardi
De bon matin, un livreur sonna à sa porte et lui présenta un colis de petite taille. Figée face à ce jeune homme en livrée, Audrey le dévisagea avec une insistance telle que le malheureux s’excusa, sans qu’elle comprenne pourquoi et de quoi il s’excusait. Ce travail de livraison à domicile comportait des risques que le coursier assumait avec difficulté. Tout en haut de l’échelle des risques encourus, il avait positionné notamment celui de tomber sur une femme “toute en une”, la cinglée, insomniaque, dépressive, suicidaire, excitée, colérique, de surcroît divorcée et vêtue d’une simple nuisette. Il préférait lorsqu’un homme lui ouvrait la porte. Les femmes le terrifiaient, les célibataires tout particulièrement. Mademoiselle Audrey Doubriac faisait-elle partie de la catégorie des pitbulls, avec une face d’ange et un caractère agressif dès que quiconque s’aventurait sur son territoire ? Enfin, face d’ange, uniquement pour le côté droit de son visage, parce que la partie gauche était probablement mâchée et couturée puisque masquée par un important pansement. Accident ou combat de boxe, il supputait que quelle qu’en soit la cause, cette difformité devait bien lui pourrir la vie et la rendre carrément agressive. Désormais, elle le foudroyait du regard, le dévorait de ses yeux d’un bleu profond, prête à le mordre, lèvre supérieure relevée, se tenant de trois quarts avec son pansement bien en vue. Du haut de sa vingtaine d’années, il se tenait face à elle avec un aplomb vacillant, disposé à lui lancer son précieux paquet, façon ballon de rugby, quitte à le voir atterrir sur le sol. Faute professionnelle ? Et alors ? Il n’escomptait pas faire carrière dans la livraison express ! Il hésita puis bredouilla quelques mots, accomplit dignement sa mission et se retira sur la pointe de ses baskets.
La porte claqua et, enfin seule, Audrey resta un court instant debout, le paquet entre les mains, à ne savoir qu’en faire : le déballer, le jeter à terre, l’aplatir et sentir sous ses pieds la faïence se briser en mille morceaux. C’était une évidence, le colis contenait un bol, voire deux. Encore fallait-il en avoir le cœur net.
À ses SMS du jour précédent, ses trois proches avaient répondu, l’un par un « Kfé, why not ? », l’autre par un « À quelle heure ? » et le dernier par un « Pas le temps aujourd’hui. » Indéniablement, ils n’étaient pas les offreurs de bols n’ayant percuté sur le message qu’à propos de l’invitation à prendre un café. C’était décidé, si le paquet contenait un affreux bol, elle allait prendre son carnet d’adresses et passer des coups de fil laconiques à ses amis d’hier et à tous les membres de sa famille pour tirer cette histoire au clair. Elle ne se sentait pas disposée à poster une photo de ses merveilleux bols sur les réseaux sociaux, en attendant que le sacrément tordu, ami de ses amis, lui réponde que c’était un odieux canular.
Trois minutes plus tard, le septième bol retrouvait ses congénères sur la table de son salon. Il marquait sa différence par l’absence de prénom peint sur sa face extérieure tout en affichant fièrement son lien de parenté avec les six autres, son caractère breton. Audrey ne s’appesantit ni sur cette similitude ni sur cette différence ; elle arracha son pansement, sortit de chez elle en courant pour héler le livreur avant qu’il ne s’enfuie. Le moteur de la camionnette, garée sur le trottoir, ronronnait déjà. Le jeune homme eut un réflexe de recul en la voyant apparaître à sa vitre. Elle tambourinait tout en marmonnant : « Où est la carte ? » Il baissa légèrement la vitre et lui répondit qu’il ne voyait pas ce qu’elle lui voulait, que de carte, il n’en existait pas. Il s’en doutait, cette Audrey Doubriac était une timbrée. Les quadras célibataires étaient toutes des cinglées, un a priori sans réel fondement qui se confirmait néanmoins.
La camionnette s’éloigna et Audrey tira avec rage sur les manches de son pull. Elle s’en voulut, le jeune livreur avait l’air totalement terrifié en la voyant débouler à visage découvert, cheveux en bataille, nu-pieds et simplement vêtue d’un pull bien trop grand pour elle qui couvrait à peine le haut de ses cuisses. Elle se mit à rire, le jeune homme l’avait prise pour une dégénérée, une obsédée prête à persécuter un gamin sous le prétexte fallacieux d’obtenir une carte de visite. Pas de carte, pas de petit mot, juste un bol enveloppé dans un papier de soie, un septième. L’affaire se corsait. Dans son for intérieur, Audrey voulait se persuader que ce n’était qu’un innocent colis mais son comportement déplacé lui faisait comprendre que c’était bien plus qu’un bol qu’elle venait de recevoir. Quelqu’un cherchait à lui pourrir la vie avec des cadeaux absurdes qui la mettaient sacrément mal à l’aise.
III LES PRÉNOMS
Centre-ville de Vannes. Mercredi
Audrey se leva à l’aube et attendit le messager. Aucun livreur ne sonna à sa porte. C’est avec un sentiment mitigé, de soulagement mêlé d’irritation, qu’elle se mit au travail devant son écran. Après une lecture rapide de ses mails professionnels, elle s’attela à rédiger un mémo et en oublia même l’heure. À dix heures précises, elle s’affola et cliqua sur un lien pour accéder à une visioconférence prévue de longue date. D’un état d’urgence, elle passa à une douce somnolence peu coutumière. Sur l’écran, les résultats économiques délivrés par l’un de ses interlocuteurs l’absorbaient mollement, tandis que son esprit vagabondait. Le diaporama disparut. Soudainement prise au dépourvu, elle sourit à ses trois partenaires par écran interposé. Il faisait nuit à New York, les cernes de Jones trahissaient son manque de sommeil et il ne perçut même pas ce sourire discret. Quant à Sasuke, il ne se permettait jamais de faire une quelconque remarque sur l’attitude de ses collaborateurs étrangers, il surfait virtuellement sur les fuseaux horaires et aussi sur les états d’âme des êtres humains. Insolite personnage, son kimono enfilé de travers ne révélait en rien l’heure qu’il pouvait être à Tokyo. Kimono du matin ou du soir pour un vêtement porté à ce qu’imaginait Audrey de nuit comme de jour, façon pyjama, tenue d’intérieur ou même de ville. Seul Malouin lui demanda pourquoi elle souriait ainsi, était-ce la dépréciation des valeurs qui la mettaient en joie ? Ironique remarque de ce Parisien toujours tiré à quatre épingles installé dans son bureau, au dixième étage d’une tour à La Défense.
Toute digression personnelle lors d’une visioconférence chronométrée n’était pas dans les convenances mais Audrey se permit de déroger à la règle. Elle sourit de nouveau, tourna légèrement son écran pour que ses trois collaborateurs puissent apprécier à leur juste valeur les sept bols exposés sur la table de son salon. Cela n’avait pas de sens mais c’est pourtant ce qu’elle venait de faire, sans rien en attendre en retour. Malouin pinça les lèvres. Jones colla son nez sur l’écran ; peut-être escomptait-il mieux voir ce qu’il se passait en France, dans ce coin reculé de Bretagne, bourgade qu’il prononçait à la volée « Vans » ? Sasuke s’insurgea avec son tact habituel : « Ainsi, nos valeurs se déprécient et l’information ne m’était pas parvenue. » Malouin le rassura et la visioconférence se poursuivit de façon très professionnelle. Avant de quitter l’écran, Sasuke se permit de faire un léger signe de tête à l’intention d’Audrey, la remerciant par ce signe de sa délicate attention pour le bol qu’il venait de recevoir en express, de l’exotisme à l’état pur quoique trop grand pour contenir du saké. Audrey n’eut pas le loisir de lui répondre, la communication s’interrompit.
Vers treize heures, Audrey reçut une photo transmise par Sasuke. Le Tokyoïte tenait fièrement son bol breton au liseré bleu entre ses mains délicates. Il ne portait pas de kimono, ni lui ni sa ravissante épouse assise à ses côtés. Audrey zooma sur le cliché et découvrit avec horreur le prénom de Markus inscrit sur ce bol maléfique.
Dans l’après-midi, ce fut Jones qui la gratifia d’une photographie de sa personne avec, trônant devant l’écran de son ordinateur, un bol breton partiellement masqué par son mug fétiche, personnalisé avec le logo des Yankees. Il se permit de joindre à son envoi un « Thank you ». Elle ne reçut rien de Malouin. Toute cette affaire prenait une tournure très singulière, voire internationale, professionnelle et machiavélique. Sa soirée en fut perturbée. Elle ne cessait de penser à ces bols maléfiques et au fait que de l’autre côté du monde, deux de ses confrères imaginaient qu’elle les leur avait offerts. Quelqu’un se faisait passer pour elle, offrant des cadeaux douteux à ses relations de travail. “Qui” en était l’auteur. Désormais, elle en avait la certitude, il lui était inutile d’alerter son réseau familial. Son cercle d’intimes ne se serait jamais attaqué à son réseau professionnel.
Elle ne put trouver le sommeil que tard dans la nuit. Elle n’avait eu de cesse de se retourner dans son lit, songeant à ces hallucinants bols, analysant que le mystère allait crescendo et que si elle n’agissait pas très vite cela irait de mal en pis. Elle avait grandement raison de le croire.
IV ALBERTO
Centre-ville de Vannes. Jeudi
Pour que ce petit jeu cesse, il lui fallait trouver qui en était l’initiateur. Pour le moment, il n’y avait pas mort d’homme mais la persévérance et l’application prises pour la rendre dingue la terrifiaient. “Qui” lui avait expédié six bols, plutôt sept, avait usurpé son identité en transmettant deux autres bols dans des contrées lointaines sous son nom. Quant à la carte avec le message, désormais elle lui glaçait le sang. Clairement, Audrey ne se jugeait pas sainte et allait très vite devenir un monstre d’ingéniosité pour pourchasser son persécuteur. Il lui était impossible d’alerter la police, compte tenu des indices bien trop minces et sans preuve que ce “Qui” lui ait causé un quelconque tort en lui offrant de la vaisselle pour fêter son emménagement. Il y avait bien la carte avec le premier colis, mais la question existentielle notée au verso n’était pas une menace de mort.
En ouvrant sa boîte mail, elle eut la désagréable surprise de découvrir un message importun, un courriel indésirable, un spam, un envoi en nombre – quoique le nombre puisse se réduire à un, en l’occurrence à elle seule –, un calamiteux courriel transmis par la société “Qui”. Le texte disait « Quand ils viendront à vous, vous devrez choisir, sacrifier l’un d’eux pour que les autres ne se brisent pas en mille morceaux. » Le choc la laissa abasourdie face à son écran, et une douloureuse migraine s’enclencha. À la moindre menace extérieure, ses hormones du stress affolaient son cerveau. Elle se rappela avoir lu dans un magazine féminin, post-Covid, que des applications miracles pouvaient l’aider à surmonter les tensions nerveuses. Si durant ces deux derniers mois, elle avait géré la pression quoique avec peine, jusqu’alors elle ne s’était sentie ni prête à télécharger des applications salvatrices sur son portable ni disposée à faire du yoga. Pourtant face à ce mail, elle ressentit l’impérieux besoin de tester la position du lotus. Elle glissa sur le sol, s’assit sur le tapis en laine, mains jointes et jambes croisées. Rester zen et demander de l’aide. À dix heures, elle contacta Alberto. À son SMS du lundi, il lui avait répondu « A quelle heure ? » La réponse « Aujourd’hui, 13 h 30 » arrivait tardivement mais, avec son ami de toujours, elle s’autorisait à ne pas prendre de gants. Le café serait le prétexte, elle avait besoin d’échanger et qu’un regard extérieur soit posé sur toute cette histoire.
Alberto était l’homme de la situation. Alberto, le roi des mécanismes complexes, l’as de l’horlogerie saurait l’écouter. Sa profession d’horloger faisait de lui un être à part, un résistant à la vie qui court trop vite. Avec des clés, il remontait non seulement les horloges mais aussi le temps. Coup double. À bientôt quarante-trois ans, il en paraissait dix de moins. Il avait été et resterait toujours le beau gosse. Un beau gosse se doit d’être une pointe tatoué, légèrement barbu et soucieux de la planète. Comme il cochait toutes les cases avec la bonne dose, du léger sans excès, il se classait dans la catégorie des séducteurs. Abandonné récemment par l’être qui avait partagé son existence ces dix dernières années, Alberto était libre comme l’air, tout comme Audrey. De surcroît, il avait une qualité fort appréciable, il résidait à cinq minutes de chez elle à Saint-Patern. Il était l’ami fidèle qu’elle prénommait Alberto depuis vingt-cinq ans et qui en réalité à l’état civil était connu sous le prénom d’Albert.
Des clients, trop crédules, pensaient que le patronyme de “Lhorloger” matchait parfaitement avec sa profession. Albert Lhorloger, comme il s’était nommé sur ses cartes de visite, s’appelait en réalité Albert Ferry. Audrey Doubriac et Albert Ferry avaient fréquenté les bancs du même collège puis du même lycée. Ensuite, leurs chemins s’étaient séparés. Elle avait choisi d’intégrer une école de stylisme à Paris et lui de se consacrer à un métier manuel qui l’avait même conduit à quitter à regret sa douce Bretagne pour les montagnes suisses. Il aimait dire avoir été apprenti chez le plus grand horloger de la planète, maître Jarvis. Audrey s’en amusait et l’imaginait entouré de coucous suisses, une véritable volière pleine d’oiseaux empaillés sortant tous à midi tapant de leurs nids pour réclamer la béquée. Les clichés perduraient au-delà des décennies et Audrey les faisait siens. Maître Jarvis savait allier modernité et tradition mais Albert n’osait s’insurger sur ce côté carte postale désuète, en fait cela lui importait peu ce que croyait Audrey. Plutôt, cela lui importait et même l’arrangeait. Ce pan de son passé donnait un côté aventurier à sa personnalité, faisant de lui un pantouflard breton travesti par magie en séducteur des montagnes d’une époque révolue.
V LES INVESTISSEUSES
Si l’avis d’Alberto serait d’un grand secours pour Audrey, ceux de deux femmes de confiance, sa grand-mère et sa tante, le seraient tout autant. Restait à planifier les deux autres rendez-vous. Après le déjeuner, Alberto sonnerait à sa porte et il lui fallait d’ici là passer quelques coups de fil à plusieurs de ses collaborateurs.
Audrey était à la tête d’une plateforme digitale de vêtements d’occasion. Sa vocation, elle la devait à deux femmes, sa grand-mère et l’une de ses tantes. La plus âgée avait été brocanteuse et la plus jeune une écologiste d’avant-garde. L’antigaspi était dans les gènes d’Audrey. C’est assez naturellement qu’elle s’était lancée dix ans auparavant en ouvrant un site de vente en ligne de vêtements de seconde main. Un marché balbutiant à l’époque qui lui avait valu quelques déconvenues. Clamer être précurseur parce que ayant pressenti qu’il tenait la bonne idée ne suffisait pas pour réussir. Encore lui avait-il fallu lever des fonds pour commencer son activité. Avec ses maigres économies en poche et sa petite expérience de chef de produit pour une grande marque de lingerie française, elle s’était néanmoins attaquée à ce marché de la seconde main. Lever des fonds via le Net avait été une idée désastreuse. Alors que cela semblait être si simple pour d’autres, elle n’avait réussi qu’à amasser quelques milliers d’euros. Les banquiers n’avaient pas plus cru en elle que ces braves internautes avides d’un retour sur investissement rapide et à peu de frais. Elle avait dû tout reprendre de zéro. Tandis qu’elle se décourageait, voire s’usait à vouloir vendre son concept à des inconnus et ce sans résultat, Audrey avait utilisé la bonne vieille recette du réseau des proches qui croient en vous ; cela s’était avéré salvateur. Son entourage familial l’avait aidée à entrer dans la cour des grands. Sa grand-mère s’était délestée d’une assurance-vie et sa tante avait hypothéqué sa résidence principale. À la même époque, tous les hommes de son entourage l’encourageaient mollement, peu disposés à investir dans le commerce du chiffon usé, comme l’avait qualifié son oncle, un agent de maîtrise, syndicaliste de la première heure qui parlait volontiers du patronat suceur de sang et dénigrait ouvertement l’esprit entrepreneurial. Cet oncle ne lui adressait plus la parole depuis qu’Audrey se retrouvait à la tête d’une entreprise avec près de cent salariés. Probablement considérait-il qu’elle était passée à l’ennemi ? Sa demi-sœur, Hélène, et son charmant époux avaient salué son audace mais tardivement et sans avoir daigné mettre la main à la poche au moment opportun.
En devenant chef d’entreprise, Audrey avait fait le tri dans sa garde-robe et dans son carnet d’adresses.
C’est dans une cuisine, devant trois bols bretons contenant des cafés au lait fumants que sa véritable aventure de femme d’affaires avait pris un tournant décisif. Dix ans déjà. Sucrer de nouveau son breuvage et finir la cafetière, tout en expliquant les règles de son futur business : rendre la transaction entre l’acheteuse et la vendeuse simple, faire de l’une comme de l’autre des actrices à part entière en leur permettant de mettre en ligne les clichés des manteaux et des robes à céder ou à acheter. Sa grand-mère lui avait dit « la brocante, la récup, une bonne idée qui fera toujours recette ». Sa tante Élisabeth, fervente adepte du recyclage, lui avait assuré son soutien en sortant son chéquier et en lui promettant la semaine suivante de tout mettre en œuvre pour lui trouver les fonds nécessaires au démarrage de cette friperie sur le Net. Élisabeth avait une garde-robe exceptionnelle et peu conventionnelle et fut même l’une des premières à photographier avec soin quelques robes de soirée qu’elle désirait voir porter par une autre. Assurance-vie, petites économies, hypothèques possibles et même bijoux de famille, tout fut mis sur la table de la cuisine. Deux ans plus tard, ses investisseuses n’avaient pas eu à le regretter, elles n’avaient pas cherché des dividendes ou une quelconque rentabilité en agissant ainsi mais avaient offert de l’amour à l’état pur. Élisabeth et Martine avaient cru en Audrey. Par amour, elles auraient accepté de s’être trompées, mais cela n’avait pas été le cas.
Dans cette cuisine, chez sa grand-mère, dix ans auparavant, sur les trois bols étaient inscrits leurs prénoms respectifs : Élisabeth, Martine et Audrey. Ces bols, Audrey les avait récupérés dans le placard de la cuisine de sa mamie lorsque celle-ci avait vendu sa maison devenue bien trop grande pour elle pour acheter un bel appartement tout confort à Conleau avec vue sur le golfe du Morbihan. Si la vieille dame avait su réinvestir les subsides liés à la vente de sa résidence principale, elle n’aurait néanmoins pas pu se payer un tel appartement sans cet investissement providentiel dans une affaire de chiffons usés comme l’avait qualifié son fils. Quant à Élisabeth, elle louait chaque année à la belle saison un superbe voilier avec skipper pour naviguer avec ses amis sur la côte Atlantique. Sa confortable retraite ne lui aurait pas permis un tel luxe mais son investissement providentiel le lui permettait désormais.
À treize heures, Audrey se délesta de son costume de chef d’entreprise et se décida à terminer la planification de ses rendez-vous personnels. Le harcèlement psychologique dont elle se considérait victime méritait un temps de la réflexion. Elle avait un urgent besoin de raconter ce qu’elle subissait à des personnes de confiance. Comme trois avis extérieurs valaient mieux qu’un et qu’elle allait commencer par celui d’Alberto, le rendez-vous étant fixé à treize heures trente, il lui restait à contacter sa tante Élisabeth et sa grand-mère.
Élisabeth avait répondu à son invitation en la gratifiant d’un « Kfé, why not ? », une résurgence d’un long séjour au Canada. Elle aimait non seulement la langue de Molière mais aussi celle de Shakespeare. Ce « pourquoi pas ? » exprimait un accord en demi-teinte. Probablement qu’Élisabeth avait prévu un tout autre emploi du temps lundi dernier, mais comme nous étions jeudi, Audrey lui répondit « Café, aujourd’hui 14 h 30, salon de thé habituel, rue du Mené ? » La réponse arriva en express, un simple « OK. » Quant à sa grand-mère, qui se laissait facilement déborder et qui, à l’invitation du début de semaine à prendre un café, s’était permis de lui lancer « Pas le temps aujourd’hui », à la vavite et quelque peu ingrat, elle s’était empressée – enfin deux jours plus tard – de préciser : « Audrey. C’était impossible lundi. Jeudi 17 heures, café chez toi. Pas utile que j’apporte des bols… » Audrey ne lui avait pas encore confirmé, aussi elle le fit, tout en grignotant une barre de céréales.
Les voir tous ensemble n’aurait fait que créer des étincelles. Demander de l’aide à trois fortes personnalités peu enclines à accepter les remarques de quiconque n’aurait pas été productif. L’appui se concevait mais avec un planning clair sans que ces esprits bouillonnants aient à se croiser. À treize heures trente précises, Alberto apparut sur le pas de sa porte.
VI MARKUS
Odeur nauséabonde de renfermé ou, pire, de rat crevé. Albert renifla l’air ambiant de l’appartement en s’abstenant de tout commentaire. Qu’Audrey ne sente rien n’avait rien d’exceptionnel puisqu’elle avait perdu l’odorat. Bien que le café soit excellent, le prendre assis sur un tabouret en teck brut, avec le nez irrité, et ce au milieu d’un amoncellement de cartons de déménagement désolait Albert. Il aurait espéré être accueilli plus chaleureusement, dans un sweet home fleurant la violette et moins encombré. Deux mois qu’Audrey était redevenue Vannetaise et elle n’arrivait pas à défaire ses valises. Était-ce le signe d’un nouveau départ avorté ? Repoussait-elle son installation dans l’espoir que son ex-époux la supplie de rentrer à Paris ? Dépité, Albert regardait le mur du salon orné de curieuses décorations ; il lui fallait positiver, voire encourager son amie à prendre ses marques.
— Tu commences ton emménagement tout en douceur, belle hauteur sous plafond que tu exploites avec singularité, accrocher sur ton mur ces trois couvercles de pouf à plumes, un bon début.
Amusée, Audrey se permit de rectifier.
— Ce ne sont pas des poufs mais des Juju Hats, des coiffes camerounaises artisanales. Des chapeaux traditionnels que j’ai détournés de leur fonction originelle.
— Excuse mon inculture. Donc de l’ethnique branché, pour être en accord avec le reste de ta décoration intérieure. Enfin j’imagine, un style bohème que tu vas peaufiner d’ici peu.
— Plutôt le gros bazar que je cultive. Enfin il y a ces coiffes bamilékées, elles donnent le ton et la couleur à ma future déco.
— Gaies sans vraiment l’être réellement. Du noir, de l’écru et du blanc.
— Elles sont parfois bien plus colorées. Des chefs de tribu, voire les membres de sociétés secrètes, les portent lors de cérémonies, notamment funéraires.
— Volumineux et pesants couvre-chefs pour une utilisation mystérieuse. Pas trop mon style, pas plus que…
Albert laissa en suspens sa phrase ; il s’abstint de dire : pas plus que ces bols bretons sur ta table.
Audrey se leva sur la pointe des pieds, elle décrocha du mur une des coiffes et la positionna sur sa tête, non sans difficulté. Ensuite, elle regarda Albert droit dans les yeux.
— À ton avis, est-ce plus facile d’être un monstre qu’un saint ?
Ahuri, Albert passa sa main sur sa barbe naissante, geste qui l’apaisait. Ces légers frottements de doigts sur son menton pour sentir sa pilosité allaient lui permettre de s’exprimer plus calmement. Il aurait pu éclater d’un rire nerveux mais sentait bien que ce n’était pas ce qu’Audrey espérait de lui.
— Surprenants, ta question et ton accoutrement. Tu vas bien en ce moment ?
Comme Audrey semblait décidée à attendre qu’il réponde à sa question, sans vouloir lui donner plus d’explications et sans souhaiter répondre à sa propre interrogation, il se prêta au jeu.
— A priori, plus simple d’être un saint.
— Illustre ta position.
— Disons que c’est plutôt facile d’entrer en sainteté éphémère en filant son manteau à un SDF qui crève de froid et grelotte sous un porche en bas de chez soi.
La tête d’Audrey, emportée par le poids de la coiffe, tanguait tantôt à droite, tantôt à gauche. Elle rétablit l’équilibre et lança.
— Oui, mais imagine que le gars s’empresse de prendre la poudre d’escampette en constatant que tu as laissé ton portefeuille dans la poche de ton pardessus !
— Je me mettrais en rogne.
— C’est comme la peine de mort, on est bien évidemment contre mais lorsque celui qui va échapper à la chaise électrique s’avère être le diable en personne qui a tué un de tes proches, cela change la donne.
Albert pressentait que son amie broyait du noir. Il avait le sentiment confus qu’Audrey s’évertuait gauchement à lui faire passer un sombre message, de façon sacrément subliminale. Elle n’avait pas défait ses cartons, uniquement accroché ses curieuses coiffes de cérémonie funéraire sur un mur, mieux positionné l’une d’elles sur sa tête et désormais l’entraînait sur un terrain glissant avec ses allusions à un monstre. Elle avait un problème et passait par des circonvolutions verbales pour l’exprimer. Pourquoi n’allait-elle pas droit au but, en lui avouant qu’elle était au plus bas parce que ce monstre, son ancien compagnon de route, venait de reprendre contact avec elle ?
— OK, je vois où tu veux en venir, aisé d’être un saint lorsque l’on n’a pas un monstre en face de soi. Mieux vaut éviter tout contact avec un diable d’homme.
— Mais quand c’est un inconnu ? Comment savoir s’il n’est pas déjà à rôder autour de toi, à t’épier, à te scruter avec un téléobjectif de la maison d’en face, sans même que tu sois au courant, à fouiller tes poubelles pour retrouver des lettres déchirées et à les reconstituer avec perversion.
— Sordide ! Je ne vois pas bien où tu veux en venir ? C’est Shepard qui a renoué le contact ? Il fouille tes poubelles ?
— Non, pas lui.
— Qui, alors ?
— Quelqu’un. Et toi, tu te considères plutôt du côté des saints ?
— Pas spécialement mais je ne suis carrément pas du genre voyeur à mater une nana avec des jumelles. Tu es sûre d’aller bien ?
— Moyennement.
— Version verre à moitié vide ou verre à moitié plein ?
— Disons bol à moitié vide.
— Bon, cesse de tourner autour du pot. Qu’est-ce qu’il t’arrive ? C’est quoi, cette histoire de mec qui t’épie ?
— Eh bien, en ce moment, quelqu’un s’en prend à moi. J’ai reçu par la poste un mot avec le texte suivant : « Vous sera-t-il plus facile d’être un monstre qu’une sainte ? »
— Glauque mais maintenant je comprends mieux ta question.
Albert se détendit ; enfin, Audrey en venait au fait. Elle était inquiète et s’interrogeait sur la signification d’un courrier énigmatique reçu récemment. Ce n’était pas si grave et bien moins alarmant que ce qu’il avait pu imaginer.
— C’est tout ?
— Non, ce mot accompagnait les six bols alignés sur la table devant toi.
— Markus, Lilas, Sophie, Claude, Ester et Eliott. Des amis ? questionna Albert.
— Non, des inconnus.
— Ce mot et cette vaisselle, qui te les a envoyés ?
— Je te l’ai déjà dit, un détraqué qui n’a pas laissé son nom. Il m’a aussi fait parvenir un mail via une adresse bidon, dixit : « Quand ils viendront à vous, vous devrez choisir, sacrifier l’un d’eux pour que les autres ne se brisent pas en mille morceaux. »
— Clairement, un message de bien mauvais goût. Ma cocotte, tu es victime d’un persécuteur. J’imagine le profil de ton gars. Homme, de la génération de ceux qui offrent des bols, donc âgé de plus de cinquante ans. Attaché à la Bretagne et aux traditions.
— Profil cohérent. Mais il me veut quoi, au juste ? Que je sacrifie un de ses bols en l’explosant de rage. En plus, je ne connais aucun Markus, alors…
— Étrange car moi oui, maître Markus Jarvis.
— Jarvis, ton horloger suisse ?
Inquiet, Albert attrapa le bol sur lequel était inscrit le prénom de Markus. Alors qu’il l’étudiait, il s’exclama.
— C’est du délire, regarde au fond du bol !
Audrey découvrit alors une scène qu’elle n’avait même pas pris le temps de décrypter. En costume traditionnel, un Breton avec son chapeau rond tendait une clé à une charmante Bretonne à coiffe en dentelle.
— C’est une bonne vieille clé pour remonter une horloge ! s’époumona Albert.
Audrey réfléchissait à haute voix.
— Quand ils viendront à vous ? Où est Markus Jarvis à cet instant précis ?
— En route pour venir me voir, c’est la première fois qu’il me rendra visite. Ta petite histoire commence à me glacer le sang.
— Ton Markus Jarvis, c’est certainement un type bien, avec une moralité irréprochable.
— Le genre de gars qui, sans hésiter, courrait pour me rattraper et me rendre mon portefeuille.
— Tu es le lien entre Markus et moi.
— Effectivement, désormais ce n’est plus ton affaire mais la nôtre.
Audrey ne lui avait pas tout révélé, il y avait pire encore. Sasuke et Jones. Elle lui raconta tout dans les moindres détails puis se tut.
Albert venait de se resservir pour la troisième fois un café. Il posa sa tasse vide sur la table et s’exprima enfin.
— C’est quoi, ce délire ?
— Je ne sais pas. Mais depuis quatre jours, cela me prend complètement la tête. L’intention de me nuire est bien là.
— Pensé, prémédité et orchestré. Peu rassurant. Prévenir la police, y as-tu songé ?
— Pour leur dire quoi ? Qu’un petit malin s’amuse à me faire peur, rien de concret à ce jour.
— Oui mais cela m’a tout l’air de n’être qu’un début.
— Des petits mots loin d’être doux et des colis curieux pour le moment.
— Tout de même, usurpation d’identité, ce n’est pas rien. Se faire passer pour toi auprès de deux de tes confrères résidant à l’étranger. Sacrément tordu. En plus, ce malade a l’air de bien connaître ta vie intime.
— Si tu penses à Shepard, il ne jouerait pas avec moi de cette façon. Tu ne l’as jamais apprécié et moi-même je le hais pour ce qu’il m’a fait subir mais ce n’est pas un tordu. D’ailleurs il a tourné la page, tout comme moi, enfin moi par la force des choses. Sans ce SMS, je n’aurais jamais su qu’il me trompait. Bon, passons, Shepard est un con mais pas un détraqué. Quant à mon problème du jour qui devient le nôtre maintenant, nous avons en plus ton horloger suisse qui entre dans la danse. Sacrifier un bol, ce n’est pas très rassurant comme idée ?
Étourdi par ce flot de paroles, Albert se leva d’un bond.
— Audrey, enlève ce ridicule chapeau de ta tête, il me fait flipper ! Markus arrive par le train de dix-huit heures à la gare de Vannes. Je vais veiller sur lui durant son séjour. De ton côté, s’il y a du nouveau, tu me téléphones. Peut-être que toute cette histoire va en rester là.
— Peut-être ? Albert, prends grand soin de Markus Jarvis.
— N’en doute pas. On reste en contact. En attendant, appelle un dératiseur, ton appart sent le rat crevé !
Perturbé, Albert sortit, sans même prêter attention aux cartons éparpillés dans la pièce.
VII ÉLISABETH
Vannes, rue du Mené
La rue était commerçante et animée. C’est dans un salon de thé à l’ambiance feutrée qu’Audrey avait fixé rendez-vous à sa tante. Audrey, consciente d’avoir perdu du temps avec Albert en le gratifiant d’explications confuses, préféra entrer dans le vif du sujet avec Élisabeth et ce sans même lui laisser le temps de retirer son manteau. Un rapide bonjour lancé et elle lui demanda :
— Aurais-tu dans tes relations proches, un Markus, un Claude, un Eliott, une Ester, une Sophie ou même une Lilas ?
Élisabeth devint blême. Tout en hélant la serveuse, elle asséna avec rage à Audrey :
— Alors tu enquêtes sur ma vie privée, maintenant ?
— Pas du tout. Excuse-moi, tu n’as pas à te sentir agressée, j’ai juste été un peu trop directe en te questionnant sur des personnes que tu ne connais même pas. Je vais tout t’expliquer.
— C’est mieux ainsi. Je nous commande deux cafés.
Audrey allait devoir s’y prendre autrement pour aborder sa délicate situation, totalement ubuesque. Sa tante avait l’air à cran et toute la lucidité d’Élisabeth était requise pour aborder un épineux casse-tête moral.
— Tante Lisbeth, je ne sais par où commencer. J’ai besoin d’un éclairage neuf sur un cas d’école qui me tourmente en ce moment. De la philo, une introspection sur l’âme humaine. Si je te dis, vous serait-il plus facile d’être un monstre qu’un saint ? Cela t’évoque quoi ?
— Question encore plus étonnante que la première mais tout aussi sournoise. Comment es-tu au courant ?
— De quoi ?
— De rien, absolument de rien, s’empressa de répondre Élisabeth.
Nerveuse, elle tapota du bout des doigts sur la table. Ses ongles longs, recouverts d’un vernis violet aux reflets irisés, provoquaient un cliquetis qui s’amplifia puis soudain cessa.
— Je fais fausse route. Les tourments de l’âme humaine, tu disais… Audrey, tu vas bien ? Je te sens crispée, voire franchement perturbée.
Élisabeth avait l’art d’irriter sa nièce, Audrey s’emporta.
— Qu’est-ce que vous avez tous à me demander si je vais bien ? Oui, je vais bien, enfin presque.
— Calme-toi. Prendre la mouche ainsi sans raison, ce n’est pas dans tes habitudes. Revenons à la philosophie, je t’écoute. Problème sentimental ou bien professionnel ?
— Je suis très calme, c’est toi qui es sur les nerfs, suspicieuse en entendant de banals prénoms ! Moi, je vais super bien !
La serveuse déposa deux tasses de café sur la table et s’éclipsa rapidement. Ambiance orageuse. Audrey but son café d’un trait et s’empressa d’annoncer :
— En fait pas du tout, pas bien du tout. Je ne sais pas comment m’y prendre pour t’expliquer que j’ai effectivement un grave problème qui m’est tombé dessus, comme cela sans que j’aie rien demandé à personne.
— Très bien, reprenons notre conversation sereinement. Quelle était ta seconde question sociologique ?
— Vous serait-il plus facile d’être un monstre qu’un saint ?
Élisabeth se mit à réfléchir. A priori, il convenait de peser sa réponse car sa nièce, au bord de l’implosion, attachait une importance excessive à cette demande. De surcroît, elle voulait qu’Audrey oublie au plus vite le prénom de Lilas.
— Audrey, puis-je avancer sans te heurter que cela m’évoque la religion, la morale, un cas de conscience et même un conte tel que Le Petit Poucet. Enfin oui, les parents de cet enfant se comportaient-ils comme des monstres en abandonnant leur progéniture dans la forêt parce qu’ils étaient incapables de le nourrir ? Choix douloureux.
— Un sacrifice, tu es sur la bonne voie.
— Je ne vois pas du tout où tu veux en venir, mais si je suis sur la bonne voie, je m’en satisferai…
De son sac, Audrey sortit son smartphone et montra à sa tante les clichés des bols pris sous toutes les coutures. Elle les fit défiler. Troublée, Élisabeth perdait pied, elle tournait la cuillère dans sa tasse vide tout en regardant les photographies s’afficher.
— C’est bien, tes premiers achats pour ton emménagement font très couleur locale. Bonne petite Bretonne que tu veux redevenir. Quoique, la faïence quimpéroise est plus prisée par les touristes que par les locaux. Enfin, si tu veux faire une soirée crêpe et cidre pour pendre ta crémaillère, une bonne chose. Du breton made in quartier Montparnasse, là où il y a tant de crêperies, enfin… Une excellente idée d’inviter ta grand-mère. Et moi, je ne vois pas de bol à mon nom, à moins que je ne fasse erreur ? Est-ce que je fais erreur ?
— Comment cela, ma grand-mère ?
— J’avais cru en découvrant le prénom de Lilas.
— Mamie se prénomme Martine et non Lilas.
— Certes, mais Lilas est son second prénom.
Audrey, consciente que ce ne pouvait être un pur hasard, s’empressa de montrer le cliché du fond du bol sur lequel était inscrit le prénom de Lilas. En découvrant une Bretonne lâchant la main d’un petit Breton pour prendre celle d’un gaillard barbu, tout aussi costumé que le premier, Élisabeth eut un mouvement de recul.
— Attention fort peu délicate, je ne te conseille pas de sortir ce bol à ta petite sauterie. Parce qu’un secret de famille que tu aurais mis au jour et que tu servirais au fond d’un bol à ta grand-mère aurait un effet déplorable sur l’ambiance ! Qui t’en a parlé ?
— De quoi ?
— Du premier époux de ma mère.
— Mamie avait déjà été mariée avant de connaître grand-père ?
— Bon, cela suffit ! Ces histoires de bol, de Petit Poucet et de Grand Méchant Loup ne m’amusent plus. D’ailleurs, oublie ce que je viens de te dire. J’ai eu tort, je m’en veux de ne pas avoir su tenir ma langue.
Élisabeth héla la serveuse pour régler la note, reboutonna énergiquement son manteau parme et sortit du salon de thé sans même un au revoir, laissant Audrey totalement désarçonnée.
VIII MARTINE
Centre-ville de Vannes
Le seuil de l’appartement à peine franchi, la grand-mère paternelle d’Audrey se permit de faire le tour du propriétaire tout en faisant mine de chercher son chemin au milieu d’un dédale de cartons. Tel le Minotaure, elle déambulait dans un labyrinthe, cherchant non pas une issue mais une assise confortable. Charpentée et de petite taille, plantée dans ses bottines, la vieille dame progressait en commentant à voix basse le capharnaüm environnant. Lorsqu’elle trouva enfin dans le salon un fauteuil à sa convenance, elle le désencombra et s’assit. Elle replia ses mains tout contre son petit sac en crocodile. Elle semblait vouloir protéger la peau du défunt reptile d’une attaque de lémuriens embusqués derrière l’unique et imposante plante verte de la pièce. Bien que contrariée par le désordre, elle préféra positiver.
— Je ne dirais pas que ton agencement soit coquet, enfin il y a une once de verdure, que dis-je, une jungle !