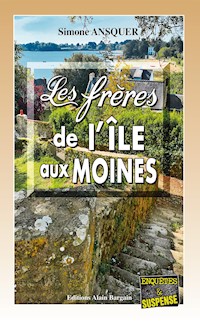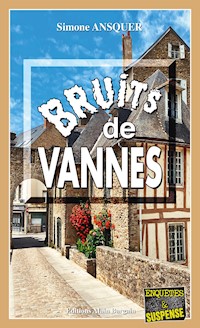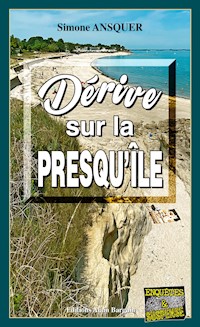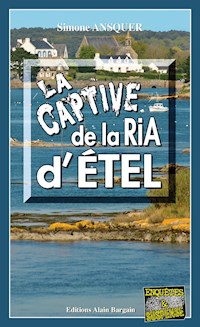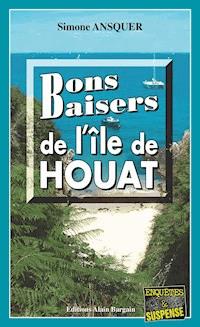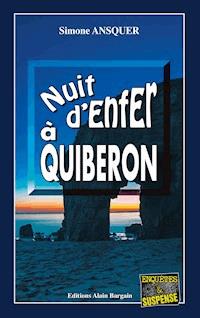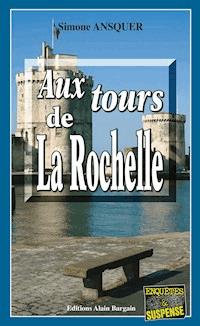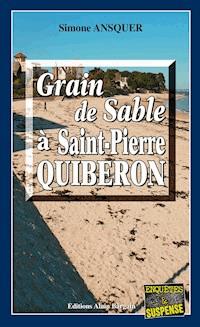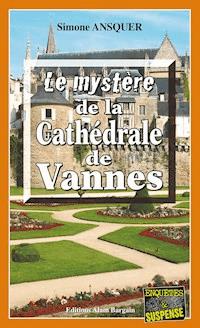Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Franck voyage beaucoup et mène une double vie. Ingénieur à Lorient, tueur à gages à Baltimore. Lorsque son père, un promoteur immobilier fortuné, est assassiné, son existence bascule. La police française risque de fourrer son nez dans ses activités secrètes. En deux jours, il devra trouver le criminel et aussi affronter la famille qui l’a rejeté. Tous de potentiels coupables, sœur, frère, belle-mère et même Morgane, cette attirante demi-sœur par alliance. Et si quelqu’un voulait l’atteindre lui ? Revolver dans son holster sous sa veste, il va mener une enquête à haut risque entre la cité de la Voile et Larmor-Plage.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Née à La Rochelle en 1960 où elle a grandi,
Simone Ansquer vit aujourd’hui sur la presqu’île de Quiberon et y cultive ses passions pour les sports nautiques, l’histoire et la peinture. Avec ce treizième roman, l’auteure vous invite à méditer sur le crime parfait. Ne pouvoir établir aucun lien entre la victime et l’assassin, l’adage du tueur à gages.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
REMERCIEMENTS À mes grands-parents, Jeanne et Joseph Lofficial, qui ont dû quitter Lorient en 1943, sous les bombardements.
PROLOGUE
Deux hommes étaient attablés dans un restaurant de San José au Costa Rica.
— Tu connais l’histoire des cobras de Delhi ? demanda Zeller à Franck.
— Non.
— Eh bien, des mecs paient pour tuer les cobras en surnombre. Alors, des rusés élèvent des cobras pour avoir les primes, au final encore plus de reptiles à Delhi.
— Tu veux éradiquer les cobras ?
— Non, je veux me faire du fric. Faut savoir tirer sa révérence avant que les serpents venimeux n’envahissent la ville.
IFRANCK
Dix ans plus tard, Baltimore
Dans l’étroite ruelle plongée dans une semi-obscurité, pas âme qui vive. D’âme, Franck n’en avait pas et le mort, si tant est que ce pourri de Sullivan n’en ait jamais eu une, n’en avait désormais plus. Bien que la porte en acier à l’arrière du restaurant soit fermée, des vapeurs de friture flottaient dans l’air et masquaient les odeurs environnantes. Exhalaison d’un corps encore chaud, imperceptible remugle d’un lieu quasi clos, légère émanation d’un tabac brun. Sens en éveil, Franck baissa les yeux puis écrasa du talon le mégot au bout incandescent tombé à terre. La dernière cigarette du condamné, celle de Sullivan.
Tirer une balle et après… Accomplir le rituel. Ramasser la douille puis, délicatement, effleurer l’acier. La précision du geste s’acquiert avec l’expérience, le savoir-faire se peaufine avec la pratique, mais seule la superstition rassure. Prendre le temps de caresser du bout de l’index le silencieux, calmement le retirer de son pistolet, soulever le pan de sa veste puis ranger l’arme dans son holster. Sous le bras droit, en dessous de l’aisselle, une discrétion parfaite. Franck est gaucher.
Indéniablement, ce n’était pas la première fois que Franck exécutait cet enchaînement de gestes et sans doute pas la dernière. À moins que la faucheuse ne le frappe avant, il agirait de la même façon pour son prochain contrat. Il jouirait avant et après, une montée d’adrénaline précédant et suivant le passage à l’acte. Pendant l’action, le temps suspendrait son vol.
Un calme absolu, une plongée en apnée dans le monde du silence. Son job requérait une excellente maîtrise de soi. Sang-froid du maître face au sang encore chaud de la victime. Laisser la mort s’introduire vite en déshumanisant la vie ôtée à l’autre. Agir proprement, en infligeant une mort rapide. L’agonie, quelle saleté ! Une erreur de jeunesse, sa première victime avait souffert. Écart de quelques millimètres. Pitoyable ! Depuis, Franck avait atteint le sommet de son art. Une unique balle et la précision d’un grand chirurgien. Là encore, il venait d’opérer sans scalpel, de tuer sans scrupule. Une opération à cœur fermé, une de plus. Une exécution tarifée, la vingtième. Un travail calibré au millimètre près, là aussi.
Douze heures plus tard, Franck déposait son passeport sur le comptoir d’embarquement d’une compagnie aérienne. Progresser dans la file. Rien à déclarer. Seule trace de son crime qu’il emportait avec lui, son holster vide dans un bagage qui rejoindrait bientôt la soute. Avoir un physique passe-partout, c’était là un atout non négligeable dans son job. Il franchissait toujours la douane sans encombre parce qu’il cultivait l’art du “médian”. Taille et corpulence dans la moyenne. Rien de remarquable. Yeux noisette et cheveux châtains, teint très légèrement hâlé. Pour le douanier américain, il fleurait bon l’Européen type. Un Madrilène, un Viennois, un Parisien, un Milanais, bref un Européen quelconque qui bien évidemment parlait sa langue avec un accent british trop prononcé. Seule certitude pour ce douanier, ce voyageur n’était pas londonien. L’officier des douanes prêta peu de cas à cet homme quelconque à la démarche lente et à l’humilité agréable face à l’autorité conférée par l’uniforme. Un Français, un mangeur d’escargots ? Un ingénieur commercial selon le passeport que le passager tenait innocemment dans sa main droite. Apparences trompeuses.
Ce 26 juin, il pleuvait sur le tarmac. Les pistes étaient détrempées. La présence de Franck Gaillard à l’aéroport international Thurgood Marshall de Baltimore-Washington signifiait la fin du voyage d’affaires de l’ingénieur. La commercialisation de composants électroniques, un métier qui le faisait voyager outre-Atlantique. Une excellente couverture qu’il avait considérée de nombreuses années être tel un plaid bien chaud couvrant tout son corps en hiver. Et il y a trois ans, un jour de mars, une satanée crise sanitaire mondiale avait failli mettre à bas son business, effilochant sa douce couverture. Ce jour-là n’avait rien d’exceptionnel, la planète ronronnait, tel un chat au repos. En bruit de fond, des rumeurs à Wuhan, des cris à peine audibles, des pleurs étouffés et des messages vindicatifs de politiciens prolifiques en tweets. Le locataire de la Maison-Blanche venait de poster son énième tweet de la journée. Le républicain Donald Trump s’en prenait une fois de plus à ses opposants. Franck s’apprêtait à quitter le sol américain et à laisser Baltimore, un bastion du Parti démocrate, pour s’envoler vers la France. Fin des repérages pour une opération prévue le mois suivant. Du bon boulot. Le soir même, Sullivan décidait de faire décoller son jet privé, direction Orlando. Un départ précipité vers la Floride, comme s’il pressentait ce qui allait se produire les jours suivants, que le gouverneur de Floride déciderait le confinement de l’État, que le Mexique et les États-Unis fermeraient leurs frontières. Sullivan avait vu juste, tout avait basculé en un claquement de doigts, une panique planétaire qui avait fait bouger les lignes économiques, politiques et sanitaires. Maudit coronavirus. Trois années perdues. Franck avait dû tout reprendre à zéro et enfin pu réenclencher son contrat, il y avait trois mois. Parce que Sullivan était revenu sur ses pas. Le Maryland lui manquait, tout comme son juteux business. De retour à Baltimore, il avait repris ses bonnes vieilles habitudes. Aller dîner au Blue Sky le dernier dimanche soir du mois avec sa conjointe, commander un excellent cru, se lever de table avant le dessert, indiquer d’un mouvement sec de la main à ses gardes du corps de ne pas bouger, s’éclipser discrètement aux toilettes pour au final se précipiter dans la ruelle à l’arrière du restaurant afin d’aller tirer nerveusement sur sa cigarette. Une fenêtre de tir de deux minutes. Son épouse ne supportait pas qu’il fume. Si Sullivan faisait marcher son petit monde, y compris celui de ses porte-flingues, son épouse, une main de fer dans un gant de velours, a priori le faisait marcher droit. Ce dont il ne se doutait pas, c’est que mentir à sa charmante femme provoquerait, un soir, sa mort.
Un contrat mené à son terme, celui de Sullivan, avec un retard de trois années. Bientôt, Franck pourrait souffler. Une escale à Atlanta et ensuite une dizaine d’heures de vol sur un long-courrier avec une arrivée prévue à Roissy-Charles-de-Gaulle le lendemain tôt dans la matinée. Paris puis un train pour Lorient. Un expresso serré à la terrasse d’un café français, sur le port de Lorient, l’attendait là-bas. Assis dans la salle d’embarquement, il consulta son agenda crypté. Il grimaça en voyant s’afficher « Enterrement ».
IIELLE
Au-dessus de l’Atlantique
Rêver et oublier son rêve. Chercher dès le lever les reliefs d’un doux songe ou encore les débris du pire cauchemar. Plisser les paupières, presser ses neurones pour en extirper ne serait-ce qu’un infime souvenir, une misérable goutte sans saveur ou un délicieux nectar, Franck le faisait souvent. Vaines tentatives. Rien. Jamais il ne se souvenait de quoi que ce soit après une nuit de repos. Pourtant, il rêvait bien comme tout un chacun et cauchemardait probablement. Expiation inconsciente et oubli réel ? Songes peuplés de cadavres qui revenaient de parmi les morts et le hantaient dans son sommeil tout en restant profondément enfouis dans son subconscient ? Impossible à envisager. Un monstre dans tous ses états, éveillé tout autant qu’endormi, c’était ce qu’il était. Atteint d’une forme de conscience et d’inconscience. Après l’escale à Atlanta, Franck avait embarqué pour un vol transatlantique et s’était assoupi. Erreur. Son voisin, un passager nerveux, lui avait lancé au réveil :
— Vous avez dormi comme un bienheureux. Je vous envie, moi je n’ai pas pu fermer l’œil, les turbulences et la trouille. Horreur de prendre l’avion… Au fait, vous avez parlé d’elle en dormant.
Franck s’était senti obligé d’enfreindre la règle qu’il s’était fixée, celle du “no contact”. Alors, il avait demandé à son voisin :
— Qui est « elle » ?
Son informateur haussa légèrement les épaules.
— Son prénom ? Vous parliez « d’elle » uniquement. J’ai une faim de loup, je compense mon manque de sommeil en me jetant sur la nourriture. L’hôtesse arrive avec les plateaux-repas. Moi, c’est Désiré, et vous ?
Mentir et s’en satisfaire.
— Moi aussi, je me prénomme Désiré, dit sèchement Franck en se levant de son siège, laissant la main tendue de son voisin en suspension dans l’air à près de quarante mille pieds au-dessus de la terre ferme.
Grotesque. Cinq secondes d’immobilité, une éternité et la main trouva curieusement le chemin de l’arrière du crâne, direction non préméditée, massage impromptu de la nuque pour ne pas perdre la face. Geste habilement improvisé, preuve néanmoins du désappointement du véritable Désiré. Mais il aurait été inconcevable pour Franck d’attraper cette poigne, de la serrer et ainsi d’accepter de se lier avec cet inconnu. D’ailleurs, cette rencontre fleurait le mauvais présage. Avait-il failli et réellement parlé dans son sommeil ?
Sa réflexion n’alla pas plus avant. Debout dans l’allée, il toisa le misérable resté assis. Embarrassé, son compagnon de voyage renifla, se contorsionna et sortit de sa poche un mouchoir rayé, bleu, blanc et rouge. Il se moucha bruyamment. Franck le dévisageait. Était-ce immoral de maculer de morve un carré de coton aux allures de drapeau français ? Franck jugea cette action irrévérencieuse et antipatriotique, alors qu’elle ne causait pourtant aucun tort à quiconque. Un non-sens puisque lui-même venait d’accomplir une faute lourdement immorale avec victime la soirée précédente. Si nul sentiment de culpabilité ne l’habitait, une fibre patriotique l’animait bel et bien. Dans le cercle excessivement fermé des tueurs à gages internationaux, on le surnommait le “Marquis français”. Le passager qu’il toisait n’était qu’un gueux du petit peuple auquel la nationalité française aurait dû être retirée ou, mieux, auquel la vie aurait dû être ôtée sur le champ. Désiré Champion, tout penaud, fit une boule de son mouchoir tricolore, emprisonnant ainsi la morve en son sein puis la déposa sur la tablette qu’il venait de déplier. Franck eut un haut-le-cœur. Cet être insignifiant, dénué d’amour pour sa patrie et malpropre, espérait son plateau-repas, salivant déjà sur le poulet curry tout en malaxant le lobe de son oreille droite.
Non seulement le curry tachait, mais plus encore Franck en gardait un très mauvais souvenir. Dix-neuf ans déjà. La paume large comme un battoir s’était abattue sur sa nuque. Celle du “Grand Paulo”. La respiration coupée, bouche ouverte, tête maintenue dans le plat de poulet au curry, Franck s’était vu mort. L’étreinte s’était relâchée avec la même fulgurance et la même brutalité que ne l’avait été l’attaque. Son visage bleui par l’asphyxie et maculé de sauce jaunâtre avait instantanément déclenché des rires gras, des cris gutturaux et des levers d’index. Tout le réfectoire de la prison de Ploemeur n’avait d’yeux que pour lui, le nouveau venu, le blanc-bec, le bizuth. Brusquement, Franck enfonça avec force son poing au creux de l’estomac du Grand Paulo, juste en dessous du sternum. Touchant le plexus solaire de son agresseur, un point vital, il lui bloqua instantanément la respiration. Pupilles dilatées, son regard les impressionna tous. Il semblait dénué d’émotions, restant parfaitement immobile alors que son offenseur suffoquait. En une fraction de seconde, la cible des quolibets montra son véritable visage, il était un caïd en puissance. Pour la première fois de sa vie, il s’était senti craint. Depuis, le curry déclenchait en lui une horreur viscérale, une colère rentrée et une curieuse sensation de toute-puissance.
Rien ne prédestinait Franck, diplômé d’une école d’architecture et fils de bonne famille, à devenir tueur à gages. Il avait suffi d’un déplorable accident et d’un passage par la case prison pour que son avenir bascule. Une année d’enfermement. Trois cent soixante-cinq jours pour en arriver à une assimilation parfaite des règles codifiées du milieu carcéral. Il en était ressorti libre avec le sentiment d’avoir été respecté par ses gardiens, accepté par les autres codétenus et même apprécié du Grand Paulo. En partageant sa cellule avec Paul Rollec, dit le Grand Paulo – un gaillard qui arborait de surprenants tatouages sur ses biceps et qui l’avait pris sous son aile –, il avait été repéré comme le gars ayant un fort potentiel pour intégrer le milieu du petit banditisme local dès sa liberté recouvrée. Une absence totale d’émotions. Une virginité peu commune de son casier judiciaire, du moins jusque-là. Blanche était la feuille sur laquelle son avenir professionnel s’apprêtait à s’écrire. La perspective d’une brillante carrière d’architecte s’était dissoute dans les limbes d’un pénitencier, les espoirs de son père s’étaient envolés. Son père n’avait été ni alcoolique ni violent. Sévère uniquement. Un excellent promoteur immobilier qui n’avait jamais ménagé sa peine. Il avait toujours couru sans jamais perdre de vue son objectif, le profit. Étudier simultanément la faisabilité de plusieurs projets, lever des fonds, raser, construire, répondre à la réglementation, suivre les chantiers et commercialiser en lots, il avait excellé en tout. Le décès de son épouse aurait pu perturber son plan de carrière, mais cela n’avait pas été le cas. Cet élégant veuf s’était raccroché à sa vie professionnelle avec la hargne du naufragé agrippé à une bouée. Son unique planche de salut pour ne pas sombrer, c’était « le développement de mon activité immobilière », disait-il. Pourtant, ce maudit veuvage l’avait contraint de prendre en main l’éducation de ses trois enfants. Il leur avait concédé ce qu’il avait pu, un peu de temps de-ci de-là, beaucoup d’argent par-ci par-là, et s’était vu bien mal récompensé. Au Monopoly de la vie, il était devenu un heureux propriétaire foncier alors que son fils avait pioché la carte fatidique « Allez à la case prison. » Aussi ce fut naturellement que ce passage en milieu carcéral avait marqué un point final aux relations père-fils. Aucun pardon, aucune explication. Tout juste une visite expéditive avant que son fils ne soit incarcéré. Pas d’échanges, uniquement une injonction : « Je te coupe les vivres, je ne veux plus jamais te revoir. »
Une légère turbulence et le verre de whisky posé sur la tablette de son voisin s’agita. Ce voyage était une plaie. Franck plissa les paupières, une réflexion ou, mieux, un diagnostic médical. Surpoids, mauvais cholestérol et cirrhose latente. Il estimait le contenu de l’estomac de Désiré, mélange de chair de poulet badigeonné au curry et baignant dans un alcool fort. Sur le bord du mouchoir des traces jaunes. Ce type avait dû gagner à la loterie, seule explication plausible pour attester un billet en classe affaires. De combien était la probabilité que ce type qui avait pris place dans le même avion que lui à Atlanta prenne place dans le même train que lui à destination de Lorient ? Chance quasi nulle ou malchance énorme. Et pourtant, il semblait que l’impossible allait se produire. À côté du verre de whisky, un feuillet arraché. Reste d’un calepin et liste manuscrite avec non seulement les horaires d’un vol Baltimore-Paris via Atlanta, mais encore ceux d’un TGV Roissy-Lorient. Ce franchouillard, ce rondouillard allait lui coller à la peau, tel un poisson-pilote.
Dix-neuf années qu’il n’avait pas revu son père, près de trois semaines que sa sœur lui avait appris la mort de celui-ci, par un laconique SMS avec la photo d’un article de presse joint. Surréaliste fairepart de décès que cette une d’un quotidien breton. À l’affiche, l’assassinat du promoteur, Michel Gaillard. Franck s’était abstenu d’une réponse du genre : « J’irai cracher sur sa tombe. » Sa sœur n’avait aucun humour. Il s’était contenté de : « Je serai présent pour la mise en bière. »
Franck relut l’accroche de l’article : « Lorient sous le choc. À soixante-neuf ans, le promoteur lorientais Michel Gaillard s’apprêtait enfin à lâcher les rênes de sa florissante entreprise à sa fille. Homme intègre et respecté, jamais aucune vilaine affaire n’avait entaché son business. Alors pourquoi l’assassiner ? Un mode opératoire qui fait froid dans le dos et laisse perplexe la police. Fil d’une enquête passionnante et glaçante… à suivre. »
Il sourit. Le journaliste avait vu juste, en employant l’adverbe “enfin” marquant ainsi la fin d’une longue attente. Enfin, sa sœur allait s’asseoir derrière le bureau tant convoité, celui de leur père.
IIILE LOUP SOLITAIRE
Le 27 juin au petit matin – Aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle
Face au tapis roulant encore à l’arrêt, Franck attendait son bagage. En habitué des longs-courriers, il savait que de la soute au tapis, le périple de sa valise pouvait s’avérer long. Arrivé le premier dans le hall, il appréciait le calme avant la tempête. Bientôt, le tapis s’ébranlerait dans un bruit de cliquetis et arriveraient en masse les autres voyageurs. Dans quelques minutes, ils seraient là avec leurs incivilités et leurs cris, de joie parfois, d’énervement souvent, voire de désespoir. Franck détestait ce qui allait immuablement suivre. Toutes ces gesticulations et bousculades pour attraper au vol les valises rebelles qui se jouaient de leurs propriétaires, s’éloignant crânement d’eux, emportées dans la ronde du carrousel.
Le tueur à gages était un loup solitaire qui exécrait les meutes. Contraint de patienter, il lui fallait se protéger des futures agressions en créant une bulle salvatrice. En une fraction de seconde, cette attente obligée prit la forme d’un examen de conscience. Yeux fixes, il ne regardait pas le tapis, mais à l’intérieur de lui-même. Plongé en pleine introspection, il sut qui il était à cet instant précis. Il était l’homme aux multiples visages qui incarnait le mal. Mais comment en était-il arrivé là ?
Aussi loin que remontaient ses souvenirs, Franck n’avait jamais été une énigme pour Franck. Puisque tout était écrit, voire inscrit dans ses gènes. Dès son plus jeune âge, il avait analysé puis assumé la singularité de son comportement. S’il personnifiait le mal aujourd’hui, c’est parce que faire le mal lui avait toujours procuré une formidable jouissance. Comment avouer un délice réprimé par toute société civilisée, du moins en temps de paix ? Son unique choix, la dissimulation de ses penchants pervers. Seule sa mère avait mis à jour la véritable personnalité de son fils et lui avait dit : « J’aurais souhaité que tu ne viennes jamais au monde. » Mais sept mois après ce terrible aveu, la mort avait fauché, trop jeune, cette mère éclairée. Ce décès avait provoqué en lui une douleur mesurée. Affliction modérée et soulagement considérable. Par la suite, plus rien ni personne ne lui avait fait obstacle.
Prendre plaisir en arrachant les ailes d’une mouche encore en vie est peu avouable. Enfant, Franck pratiquait de tels actes en secret. Conscient du côté répréhensible de ses agissements, il se considérait néanmoins en droit de les commettre, puisque se jugeant être un prédateur extrêmement bien positionné dans la chaîne alimentaire. Inavouable tout autant l’était de mâchouiller les dizaines d’ailes de mouches après avoir accompli un véritable massacre. Un jour, sa sœur l’avait surpris en pleine dégustation. Yeux ronds d’une fillette de cinq ans et salive gluante d’un garçonnet de sept. Une déplorable confrontation. Par la suite, il avait appris à bien mieux dissimuler sa passion dévorante pour les ailes de mouche. À tout juste douze ans et peu après le décès de sa mère, il s’était essayé à des jeux tout aussi pervers sur des animaux de compagnie. Puis il avait jeté son dévolu sur des enfants de son entourage. Sa sœur n’en avait jamais rien su ni n’en avait fait les frais. Le préado excellait dans la maltraitance animale et humaine. Toujours sur des mâles. Une forme de superstition, s’en prendre à des chiens et pas à des chiennes, harceler des gamins et pas des gamines. D’ailleurs, Franck, devenu adulte et tueur à gages, perpétuait ce principe. Son credo, accepter des contrats pour assassiner uniquement des hommes.
À vingt et un ans, après le passage par la case prison, Franck était passé à la vitesse supérieure. Il s’était découvert une passion pour le tir à balles réelles sur cible en mouvement. Appuyer sur la détente et prendre du plaisir. Ces premiers tirs s’étaient révélés prometteurs, au-delà de ses espérances. Certains exerçaient leurs talents lors de tirs aux pigeons, lui exprimait son penchant en tirant sur des goélands avec une arme fournie par Paulo, une carabine 22LR. Cartouches .22 Long Rifle dans la poche, antique Winchester sous le bras, il se rendait très tôt le matin sur la plage à l’abri des regards, près de Fort-Bloqué à Ploemeur. Les goélands argentés étaient abattus en plein vol.
Comme Franck avait de réelles prédispositions pour faire carrière dans le banditisme, c’est tout naturellement que Paulo lui avait mis le pied à l’étrier en lui confiant une mission à haut risque qui se résumait en quatre mots : « Tu flingues le gars. » Le fort en gueule tenait son poulain. Du moins, le croyait-il. Après avoir bel et bien flingué le gars et empoché une belle somme du commanditaire, Franck avait remis à Paulo une enveloppe pleine de billets pour le remercier de cette mise en relation ainsi que de son apprentissage. Enveloppe contenant aussi quatre mots d’adieu « Loup solitaire, je suis. » Laconique missive. Franck était avare en mots. L’apprenti quittait le maître qui n’en était pas réellement un. Paulo n’avait jamais tué quiconque. Là n’était pas leur seule différence. Paulo résidait dans un deux-pièces miteux et s’en contentait alors que Franck appréciait le luxe et les appartements de standing. Il avait été à bonne école avec un père promoteur immobilier. Si le meurtre commandité s’avérait être un bon business, il avait dû par la suite se professionnaliser pour ne plus jamais voir son client agoniser. Voler de ses propres ailes et trouver seul ses prochaines cibles.
L’introspection prit fin soudainement, le tapis roulant venait de se mettre en marche. Franck vit apparaître un énorme sac kaki de baroudeur. Alors que le brouhaha de la foule l’agressait, il songea qu’il aurait pu être un mercenaire à la solde d’un dictateur. Que s’il était né en période de guerre, il se serait engagé dans l’armée, aurait pris les armes et tué de façon licite. Dans l’aéroport, autour de lui, la foule était désormais compacte. À ses côtés, une petite meute de loups chassait en groupe, sautant sur des valises, crocs sortis. Un mâle dominant bouscula la meute, se considérant dans son bon droit. Sac militaire en main, il allait sortir vainqueur de cette zone de guerre et pouvoir affronter en tête le passage en douane. Mais Franck le contraignit à faire demi-tour pour s’excuser en lui empoignant le bras. Une prise véloce et maîtrisée. Un regard froid et imperturbable. Une main de fer. Le malotru demeura un long moment pantois, tentant d’analyser ce qui venait de se produire. Franck se détourna de lui sans un mot. D’un geste rapide, il attrapa la poignée de sa valise. Soudain, un bruit désagréable l’irrita. Franck avait face à lui le dénommé Désiré qui se mouchait bruyamment. Dépenaillé, Désiré Champion se rua sur le tapis roulant tentant de saisir une énorme valise en skaï marron, écrasant au passage le pied d’une Américaine. Pitoyable bonhomme ! Il était temps pour Franck de quitter cet aéroport et de se séparer définitivement de son poisson-pilote.
IVÉMILE DURAND
Gare de l’aéroport Charles-de-Gaulle
En s’installant dans le wagon, Franck fut satisfait de constater que son poisson-pilote n’était ni dans son dos, ni assis à sa droite. Néanmoins, Désiré Champion ne sévissait pas très loin de lui. Confortablement installé trois rangées devant lui, le bougre dégustait un croque-monsieur à la béchamel en guise de breakfast tout en conversant avec son voisin. Une bouchée, une parole. Un sursaut de panique, un dépôt de morve dans son mouchoir. Il se mouchait pour conjurer le mauvais sort. A priori, il exécrait le train à grande vitesse tout autant que l’avion et adorait la nourriture en sauce.
Franck n’avait acheté ni viennoiserie ni panier-repas à la gare et n’escomptait pas se rendre à la voiture-restaurant. Il était perturbé. Le décès de son père modifiait considérablement ses plans. Pas de SAS de décontamination envisageable. À l’issue d’une mission, Franck s’enfermait habituellement dans sa maison de maître dont il n’était pas propriétaire, du moins officiellement. Il faisait ce qu’il nommait son RETEX, son précieux retour sur expérience. Essentiel de poser les valises et de faire un bilan. L’engagement contractuel avec son commanditaire lui imposait de ne pas sauter une seule clause du contrat. Respect de la chronologie de toutes les étapes. Préparation, repérage, action et bilan. Habituellement, la mission accomplie, seul chez lui, il consultait les médias, les réseaux sociaux et le darknet. Il n’acceptait le solde du paiement qu’après avoir eu la certitude que l’enquête en cours ne permettrait pas de remonter jusqu’à lui et bien sûr jamais jusqu’à son donneur d’ordres. Le paiement s’opérait en trois fois, avant, juste après et bien plus tard. Un compte numéroté dans un paradis fiscal. Sur le sol français, Franck avait ouvert un compte dans une banque des plus communes. Un compte courant, un plan épargne logement, une seule carte bancaire, un crédit pour l’achat de sa petite maison du bord de mer. Ce monsieur Tout-le-monde prenait parfois rendez-vous avec Richard, son banquier, qui le considérait comme un client raisonnablement endetté et désireux de faire des placements en bon père de famille. Une relation de confiance s’était instaurée entre eux, dix années de fidélité. Si Richard avait su !
Située à Lorient, la maison dans lequel logeait Franck appartenait à un certain Émile Durand. Belle demeure de trois étages et divisée en plusieurs logements. Franck résidait officiellement au rez-de-chaussée dans un deux-pièces, le seul appartement mis en location. Une partie de ce rez-de-chaussée et la totalité du premier étage étaient inoccupées puisqu’en travaux depuis des années. Monsieur Durand occupait tout le dernier étage composé d’un unique appartement avec une belle vue sur la nouvelle ville. Jamais Franck Gaillard n’avait croisé Émile Durand dans l’escalier principal, ni même dans l’escalier de service ou dans l’ascenseur. D’ailleurs, comment en aurait-il pu en être autrement puisque Franck Gaillard et Émile Durand étaient le même homme ? Dans son quartier, seul Franck Gaillard était connu des commerçants, voire apprécié et considéré comme un homme sympathique voyageant beaucoup pour ses affaires, un ingénieur hautement qualifié puisqu’appelé sur des chantiers à l’étranger. A contrario, Émile Durand était plus du genre à se faire livrer de petits plats très onéreux lorsqu’il résidait sur Lorient. Les livreurs des plus grandes tables du pays de Lorient connaissaient l’adresse, mais ces coursiers ne connaissaient pas monsieur Durand. Les plats des chefs cuisiniers de restaurants étoilés étaient déposés dans le local technique de l’habitation. Ainsi, toutes sortes de légendes urbaines avaient très vite couru sur le compte de monsieur Durand. Peu après l’acquisition de cette vaste maison, des travaux de rénovation avaient été entrepris sans que l’heureux propriétaire ne daigne suivre l’avancement du chantier. Ensuite, il y avait eu l’emménagement réalisé par des déménageurs peu bavards, et un jour quelqu’un avait cru apercevoir monsieur Durand et l’avait qualifié d’aristocrate en rupture de bans, de rentier acariâtre. Mais qui l’avait vu ? Qui l’avait qualifié de telles façons ? Peu importait, le mystère s’était uniquement épaissi et même le nouveau locataire du rez-de-chaussée, un certain Franck Gaillard, n’avait pu délivrer d’éléments probants sur le profil de son propriétaire. Fort heureusement, il y avait eu l’affaire du fauteuil roulant livré au domicile du propriétaire des lieux. Elle avait fait grand bruit dans le voisinage et enfin mit un point final à toutes les allégations. Ainsi, monsieur Durand était handicapé, ce qui expliquait tout. La boulangère et la poissonnière s’étaient fait fort de construire un profil à cet étrange personnage. Au fil des années, tous les voisins l’avaient savamment peaufiné. Monsieur Durand, issu d’une famille argentée, avait été victime d’un accident de voiture à Monaco. Son passé était flamboyant, flambeur au casino, adepte des sports extrêmes, athlète émérite, grand navigateur. Son présent était moins fameux, cures thermales en Suisse, suivi hospitalier à la Salpêtrière, béquilles et fauteuil roulant pour soulager le poids de ses jambes atrophiées. Ainsi, ce grand malade s’octroyait parfois quelques jours de répit sur Lorient, et ce, entre deux consultations de pontes de la médecine parisienne. L’ombre aperçue derrière un store, c’était lui, ce reclus qui admirait les lumières de la ville la nuit venue. Songeait-il à son passé glorieux de grand navigateur solitaire ?
Franck n’avait pas eu besoin de créer une fausse identité à ce monsieur Durand. Les hommes et les femmes de son quartier l’avaient fait pour lui. Même les commerçants des halles de Merville avaient eu leurs mots à dire sur ce mystérieux Durand. Comme témoin privilégié, puisque résidant au rez-de-chaussée, Franck était parfois sollicité pour alimenter la rumeur. Il surfait sur le qu’en-dira-t-on, sans tomber dans le commérage. Que dire ? Qu’il payait son loyer par virement et rubis sur l’ongle à monsieur Durand, son discret propriétaire qu’il croisait deux fois l’an lorsque celui-ci sortait de l’ascenseur. Oui, son propriétaire boitillait et s’aidait d’une canne pour marcher. Oui, son propriétaire voyageait aussi souvent que lui, mais les trajets devaient être bien plus compliqués pour lui, compte tenu de son handicap. La boulangère interpréta les dires et s’empressa de répéter que seul monsieur Franck Gaillard prenait l’avion, car monsieur Émile Durand se déplaçait en voiture avec chauffeur. Ensuite, la poissonnière se permit de préciser qu’elle avait bien aperçu une berline noire avec chauffeur portant casquette. Le volailler, de bon matin en installant son étal aux halles, l’avait lui aussi vue.
Lorsque le train ralentit à l’approche de la gare de Rennes, Franck regarda par la vitre. Au milieu des nuages, la silhouette d’Émile Durand flottait, aérienne, irréelle, et allait prendre sa correspondance, un Rennes-Lorient pour rentrer enfin chez lui.
VLES MÈRES
Lorient
Debout, dos à la porte de descente du train, Champion tanguait. Il tentait de débloquer la poignée rétractable visiblement coincée de son imposante valise, et ce, tout en discutant avec un passager. Monologue bien plus que dialogue. Débit rapide compte tenu de l’arrivée imminente du TGV en gare de Lorient. Il poursuivait son récit qu’il n’avait a priori pas pu achever durant le trajet, celui de l’histoire de sa nouvelle vie. Combien son divorce l’avait marqué et comment il avait récemment décidé de quitter Rennes pour venir emménager sur Lorient. Ses meilleurs amis vivaient à l’Île-aux-Moines, une sorte de rapprochement physique. Il avait longuement hésité entre Lorient et Vannes pour finalement choisir de s’installer près du stade du Moustoir à Lorient. Ses affaires, une tante adorable, une cousine surprenante et surtout un lien sentimental indéfectible avec cette ville. Sa mère, une femme merveilleuse, paix à son âme, était enterrée à Lorient, au cimetière de Carnel. À quelques mètres de lui, Franck attendait l’arrêt définitif du train. Il entendait Champion, mais ne l’écoutait pas vraiment. D’ailleurs, dans cet espace réduit, Champion ne s’adressait pas à lui, mais à celui qui était son nouveau confident, son voisin durant le trajet Rennes-Lorient.
Le train s’immobilisa, la porte s’ouvrit et il descendit de la rame sans cesser de parler à son nouvel ami. Franck, témoin privilégié de la scène, écoutait ce bonhomme au ventre rebondi, s’épancher et pleurer sa défunte mère. Il parlait du marbre de la pierre tombale et du bouquet de fleurs qu’il déposait chaque dimanche dans un vase en céramique. Mais qu’il avait dû faire une entorse à ses habitudes. Il allait de ce pas, prendre un taxi, direction le cimetière. Pas une minute à perdre, acheter des fleurs fraîches et jeter les fleurs artificielles qu’il avait pris soin de déposer dans le vase, compte tenu de sa longue absence. Sur le quai, son confident se permit de lui donner un conseil plein de sagesse, celui de passer par son domicile pour y déposer sa valise en skaï encombrante, avant de visiter la tombe de l’auguste madame Champion mère. Désiré massa son front et sortit son portable de sa poche. Il avait une meilleure idée.
Une fois dans la galerie qui surplombait les voies, Franck fit une halte, préférant laisser de la distance entre lui et ce passager. Il eut une remontée de bile aigre. Les seules fois où il s’était recueilli sur la tombe de sa mère, c’était lorsque son père l’y avait contraint. Il y avait si longtemps. À dire vrai, si elle n’avait pas eu la fibre maternelle le concernant, lui-même n’avait jamais ressenti un quelconque amour pour elle, cette femme qui avait compris si vite et lu en lui comme à livre ouvert alors qu’il était si jeune.
Enfant, Franck avait beau être un habile dissimulateur, sa mère l’avait démasqué très tôt et au fil des années, ses doutes n’avaient fait que se confirmer. Son aîné était un monstre. Un après-midi, alors qu’ils étaient seuls dans la cuisine, elle avait avoué à son fils de onze ans : « J’aurais préféré ne pas te mettre au monde. » Franck avait empoigné un couteau de cuisine puis pointé la lame en direction du ventre de sa mère. Ce qu’il ne savait pas encore, c’est qu’elle portait déjà en elle celui qui allait devenir son frère. Elle s’était vue morte, il l’avait vue morte, mais il ne l’avait pas tuée. La semaine suivante, il avait songé à ce qu’il aurait pu inventer si le drame avait eu lieu. Un crime sans préméditation, inenvisageable ! Plutôt un matricide qu’il aurait habilement maquillé en meurtre crapuleux commis par un voleur qui se serait introduit dans la maisonnée en l’absence de son père. Essuyer le manche du couteau, il s’était vu de nombreuses fois le faire. L’hypothétique image de sa mère baignant dans son sang, agonisant sur le sol carrelé de la cuisine familiale ne constituait pas une source d’horreur. Il s’était même imaginé endossant le rôle de la victime, celui du pauvre enfant traumatisé à vie, non par ce qu’il avait fait, mais par ce qu’il avait vu. Voilà, cela aurait été si simple de tous les duper, père, sœur, proches et même enquêteurs. La presse aurait annoncé un « quasi double meurtre », étant donné que sa douce maman était enceinte.
Ce qu’elle lui avait dit l’avait fait réfléchir et portait encore à réflexion des décennies plus tard. Pause achevée, il se mit à tracter sa valise à roulettes tout en méditant sur ce qu’elle lui avait asséné autrefois. Exprimer sa préférence de ne pas l’avoir mis au monde impliquait qu’elle aurait pu avoir un tout autre choix. Mais au moment de sa conception, elle avait préféré autre chose, absolument pas d’avorter, mais bien de donner naissance à l’enfant de l’amour. Ainsi, dans cette cuisine, elle avait affirmé que la vie de son aîné n’était pas digne d’être vécue. Peut-être qu’elle se trompait ? Qu’il retrouverait un jour le bon chemin, celui de la rédemption ? Même si à bien y réfléchir, elle avait vu juste puisque le potentiel hautement maléfique de sa progéniture s’était confirmé par la suite lorsque madame Gaillard n’avait plus été de ce monde. D’ailleurs, de son vivant elle n’avait pu évoquer avec quiconque le caractère glaçant de son garçon. L’épisode du couteau était resté secret. La mère ayant provoqué l’enfant enclin à faire le mal. Aussi tous deux avaient senti peser sur leurs épaules une forme de culpabilité. Par la suite, la mère avait fait en sorte de ne jamais se retrouver seule dans une pièce avec son enfant. Cette femme s’était probablement consolée en repensant au moment de joie extatique que lui avait procuré la venue au monde de sa fille. Un sentiment de bonheur extrême bien que passager lorsqu’elle avait tenu pour la première fois sa petite dans ses bras à la maternité. L’accouchement compliqué de son troisième enfant avait entraîné sa perte. Jamais elle n’eut le loisir de tenir entre ses bras son petit dernier, celui que Franck avait voulu assassiner. Elle avait laissé un cadeau à ce nouveau-né, son prénom qu’elle avait choisi avec amour en espérant que son Florian soit radicalement différent de son aîné.
En empruntant l’escalator, Franck s’agrippa à la poignée de sa valise. Florian serait à l’enterrement de leur père. Le beau Florian, l’enfant que sa mère n’avait jamais dorloté. Celui que Michel Gaillard avait porté aux nues. Franck baissa les yeux et vit, en contrebas, Champion trottinant dans le hall de la gare. Puis subitement ce dernier se retourna et lui lança crânement :
— Vous voulez savoir qui elle est ? Eh bien, votre cocotte a des poils aux pattes !
Aussitôt Franck comprit de qui ou plutôt de quoi il avait rêvé durant le vol au-dessus de l’Atlantique.
Champion n’était pas peu fier de sa réplique. Il venait de clouer le bec à ce gougnafier qui s’était accroché à ses basques d’aéroports internationaux en gares ferroviaires. Il consulta sa montre, il était un peu plus de 13 h 15. Sa cousine n’allait pas tarder à venir passer le prendre à proximité de la gare d’échange de L’Orientis-Lorient.
VILORETTE DUSSOT
Lorient, jardin de l’Hôtel-Gabriel
En ce tout début d’après-midi, le jardin à la française invitait à la mélancolie romantique. La haute grille en fer forgé passée, l’allée de gravier permettait d’accéder à un écrin de verdure ombragé. C’est ici que Michel avait osé prendre la main de Lorette pour la première fois. À l’instant précis où leurs doigts s’étaient entrecroisés, ils avaient su que l’amour faisait fi du temps qui passait trop vite. Peu leur importait d’être un couple de vieux tourtereaux, ils voulaient se comporter tels d’insouciants adolescents. Ce moment de grâce, Lorette ne pouvait l’oublier. Quatorze ans déjà.
Assise sur un banc minéral sans dossier, elle se mit à pleurer, dos courbé. Poids des ans et de la douleur. Brusquement, elle vit un gouffre s’ouvrir sous ses pieds. Un gouffre de solitude tout autant que d’incertitudes. Larmes de colère, de rage, de souffrance. Après quatorze merveilleuses années de bonheur, Lorette Dussot venait de perdre l’être aimé. Une incommensurable perte. Une chute aussi vertigineuse que celle qui l’avait entraînée à tomber amoureuse de Michel Gaillard, et ce, à l’aube de la soixantaine. Une première chute inespérée et une seconde qu’elle considérait lui être bientôt fatale. À son âge, elle ne pourrait s’en remettre. Elle aurait dû vieillir puis mourir à ses côtés. Elle l’avait attendu si longtemps.
Plus jeune, n’avait-elle été qu’une éponge imbibée d’amour attendant qu’un homme la presse ? Étourdissante décennie qui s’achevait. Durant près de soixante années, elle s’était contentée d’effleurer la vie. Ces quatorze dernières années, elle l’avait croquée. Une prise de conscience tardive de ce que recouvrait un véritable amour. Parce qu’en moins de huit jours, Lorette ne l’avait pas aimé lui, mais le monde alentour, au-delà des frontières, au-delà des barrières, au-delà des qu’en-dira-t-on… L’amour avait pulvérisé toutes ses certitudes. Lorette s’était éprise de Michel Gaillard, le père de Franck, à cinquante-six ans. Un samedi matin, cet homme distingué avait passé la porte de sa mercerie pour acheter une première paire de lacets et, le mardi suivant, il était revenu pour en acheter une seconde. Un délicieux prétexte. Avant cette rencontre improbable, jamais Lorette Dussot n’avait osé associer l’amour à une sexualité comblée. En effet, son défunt époux, un tendre compagnon de route et un bon père, avait été un piètre amant. A contrario de Michel. Une révélation que cette découverte de son corps vieillissant soudain prompte à lui offrir une seconde jeunesse. Désormais, un vide sidéral. Elle n’était plus qu’une éponge gorgée de larmes.
Mains jointes, elle ne priait pas, elle malaxait son mouchoir humide. Rageusement. À quarante-cinq ans, elle avait porté le deuil d’un mari plus âgé et bien trop lisse. À soixante-dix, elle pleurait la perte prématurée d’un séduisant amant de son âge. Seul réconfort dans son existence qui s’effritait, sa fille qui saurait la soutenir et tenterait de lui redonner le sourire.