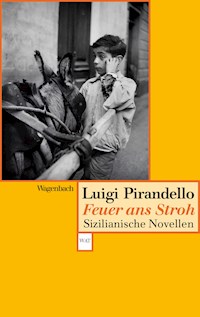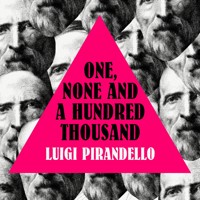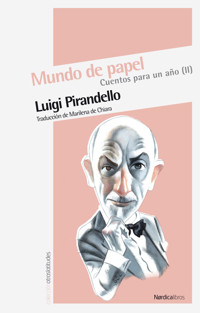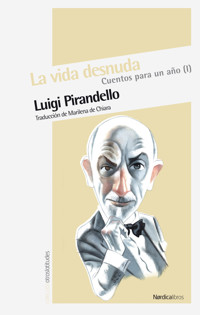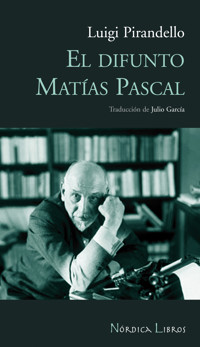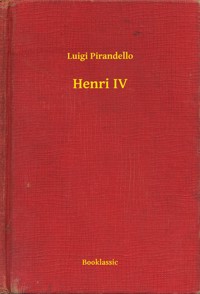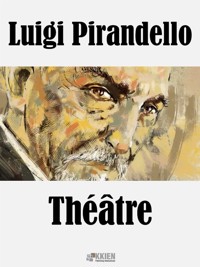Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
«À chacun sa vérité» est une comédie tirée d'une nouvelle, «Mme Frola et M. Ponza, son gendre». Dans la petite ville où M. Ponza vient d'être nommé secrétaire de préfecture, on s'interroge et on cherche à savoir qui dit la vérité: Mme Frola, qui prétend que sa fille, disparue depuis quatre ans, est bien l'actuelle épouse de M. Ponza? ce dernier, qui affirme que Mme Frola est folle de croire cela? qui est donc Mme Ponza? Chacun sa vérité, chacun sa folie...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 98
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Chacun sa vérité
Chacun sa véritéDISTRIBUTIONACTE PREMIERACTE DEUXIÈMEACTE TROISIÈMEPage de copyrightChacun sa vérité
Luigi Pirandello
DISTRIBUTION
LAMBERT LAUDISI
M. Charles Dullin.
M
me
FROLA
M
me
Marcelle Dullin.
M. PONZA, son gendre
M. Corney.
M
me
PONZA
M
me
Blazy.
M. AGAZZI, secrétaire général de la préfecture
M. Herminger ;
M
me
AMÉLIE AGAZZI, sa femme, sœur de Lambert Laudisi
M
me
Ève Longuet.
DINA, leur fille
M
me
Orane Demazis.
M
me
SIRELLI
M
me
Lucienne Morand.
M. SIRELLI
M. Michel Duran.
LE PRÉFET
M. Spanelly.
Le commissaire CENTURI
M. G. Vital.
M
me
CINI
M. Lucien Arnaud.
M
me
NENNI
M. Nicolesco.
UN DOMESTIQUE
M. Gridoux.
MESSIEURS ET DAMES
Baranger, Darnault, etc.
De nos jours, dans un chef-lieu de département.
Représentée pour la première fois en français à Paris au Théâtre de l’Atelier, le 23 octobre 1924.
ACTE PREMIER
Un salon chez les Agazzi. Porte au fond donnant sur le vestibule ; portes à droite et à gauche.
Au lever du rideau, Laudisi se promène avec animation à travers le salon. Svelte, élégant sans recherche, quarante ans environ, il revêt un pyjama violet à parements et brandebourgs noirs. Esprit aigu, il s’irrite facilement, mais ne tarde pas à rire et à laisser les gens parler et agir à leur guise ; le spectacle de la sottise humaine le divertit.
LAUDISI. – Alors, il est allé se plaindre au préfet ?
AMÉLIE, quarante-cinq ans environ, cheveux gris, montre une certaine importance à cause du rang de son mari, mais tout en laissant entendre que s’il ne dépendait que d’elle, elle montrerait plus de laisser-aller et se comporterait en bien des occasions tout autrement. – Mais voyons, Lambert, c’est un de ses subordonnés !
LAUDISI. – Son subordonné à la préfecture, mais pas chez lui.
DINA, dix-neuf ans, l’air de tout comprendre mieux que sa mère et même que son père, mais cet air de supériorité est atténué par la vivacité et la grâce de la jeunesse. – Mais pardon ! Il est venu loger sa belle-mère à côté de nous, sur le même palier !
LAUDISI. – Est-ce qu’il n’en avait pas le droit ? Il y avait un appartement libre, il l’a loué pour sa belle-mère. Prétendez-vous par hasard que la belle-mère était obligée de venir faire une visite (chargeantet détachant les syllabes) à la femme et à la fille d’un supérieur de son gendre ?
AMÉLIE. – Il n’est pas question d’obligation. C’est nous qui sommes allées les premières, Dina et moi, voir cette personne, et nous n’avons pas été reçues. Comprends-tu ?
LAUDISI. – Mais que diable ton mari est-il allé faire chez le préfet ? Prétend-il imposer d’autorité un geste de courtoisie ?
AMÉLIE. – Une juste réparation ! On ne laisse pas ainsi deux femmes devant une porte.
LAUDISI. – Tout cela est abusif, c’est de la pure tyrannie ! Les gens n’ont-ils donc plus le droit de rester chez eux si cela leur fait plaisir ?
AMÉLIE. – C’est toi qui ne veux pas tenir compte que nous avons voulu nous montrer aimables les premières envers une étrangère !
DINA. – Allons, tonton, calme-toi ! Nous avouons. Nous reconnaissons que, dans notre politesse, il entrait un peu de curiosité. Mais enfin, c’était bien naturel !
LAUDISI. – Naturel, parce que vous n’avez rien d’autre à faire !
DINA. – Mais non, tonton, écoute. Tu es là, tu ne fais pas attention à ce que font les autres autour de toi. Très bien. J’arrive. Et alors, sur ce guéridon, là devant toi, je place avec le plus grand sérieux – ou plutôt non, avec la tête du monsieur en question, une tête patibulaire, – je place sur ce guéridon,… heu… supposons… les savates de la cuisinière.
LAUDISI. – Les savates de la cuisinière n’ont rien à voir là-dedans.
DINA. – Tu vois, hein ? Tu t’étonnes ! Tu considères ça comme une extravagance, et tu m’en demandes tout de suite la raison.
LAUDISI. – Petite peste ! Ah ! tu es une fine mouche, toi… mais tu as affaire à ton oncle, tu sais ? Tu es venue poser sur ce guéridon les savates de la cuisinière, pourquoi ? Pour provoquer ma curiosité ; tu l’as fait exprès, et, dès lors, tu ne peux me reprocher de te demander : « Mais pourquoi, ma chérie, as-tu posé là les savates de la cuisinière ? » Prouve-moi que ce M. Ponza, ce rustre, ce polisson, comme l’appelle ton père, est venu loger exprès sa belle-mère sur le même palier que vous !
DINA. – Il ne l’a pas fait exprès, je te l’accorde ! Mais tu ne peux nier que ce monsieur vit d’une façon si étrange qu’il provoque tout naturellement la curiosité de la ville entière. Écoute : il arrive, il loue un petit appartement au dernier étage de cette grande bâtisse lugubre, là-bas au fond du faubourg… Tu la connais ? Je veux dire, y es-tu déjà entré ?
LAUDISI. – Tu es peut-être allée y voir, toi ?
DINA. – Mais oui, tonton ! avec maman. Et nous n’avons pas été les seules, tu sais ? Tout le monde est allé la visiter. Il y a une grande cour toute sombre, – on dirait un puits, – et tout en haut une balustrade de fer, qui court le long de la corniche du dernier étage, avec de petits paniers qui pendent au bout de ficelles.
LAUDISI. – Et après ?
DINA, avec étonnement et indignation. – Après… Il a séquestré sa femme au dernier étage !
AMÉLIE. – Et sa belle-mère vit ici, à côté de nous !
LAUDISI. – En tout cas, la belle-mère a un joli petit appartement, au centre même de la ville !
AMÉLIE. – Merci pour l’appartement ! Il l’oblige à vivre séparée de sa fille !
LAUDISI. – Mais qui vous l’a dit ? Et si c’était elle, la belle-mère, qui le désirait pour avoir plus de liberté ?
DINA. – Non, non ! tonton ! On sait que c’est lui !
AMÉLIE. – Pardon ! On comprend parfaitement qu’une fille, en se mariant, abandonne la maison de sa mère et aille vivre avec son mari, au besoin dans une autre ville. Mais qu’une pauvre mère, ne pouvant se résigner à vivre loin de son enfant, la suive et que, dans la ville où elle est étrangère, elle se voie contrainte à en vivre séparée, eh bien, tu admettras qu’une chose pareille ne se comprend plus facilement !
LAUDISI. – C’est que vous avez des imaginations de tortues ! Il doit y avoir, ou par sa faute ou par la faute de son gendre, une telle incompatibilité d’humeur que, naturellement…
DINA, l’interrompant, étonnée. – Comment tonton ? Incompatibilité d’humeur entre une mère et une fille ?
LAUDISI. – Qui te parle d’une mère et d’une fille ?
AMÉLIE. – Mais oui ! Entre la belle-mère et le gendre, il n’y a rien, ils ne se quittent pour ainsi dire pas !
DINA. – Parfaitement ! La belle-mère et le gendre ! C’est ce qui stupéfie tout le monde.
AMÉLIE. – Il vient ici tous les soirs que Dieu fait tenir compagnie à sa belle-mère.
DINA. – Et même pendant la journée… Une ou deux fois par jour.
LAUDISI. – Est-ce que, par hasard, vous supposeriez qu’il y a quelque chose entre la belle-mère et le gendre ?
DINA. – Tu plaisantes ! Si tu la voyais ! C’est une pauvre petite vieille.
AMÉLIE. – Mais il ne lui amène jamais sa fille !… Jamais, au grand jamais, il n’amène sa femme voir sa mère !
LAUDISI. – Cette pauvre femme doit être malade… elle ne doit pas pouvoir sortir de chez elle…
DINA. – Mais non, la mère va là-bas…
AMÉLIE. – Elle y va, oui, mais pour voir sa fille de loin. On sait de source certaine qu’il est interdit à cette malheureuse de monter jusqu’à l’appartement de sa fille !
DINA. – Elle ne peut lui parler que d’en bas, du fond de la cour !
AMÉLIE. – Du fond de la cour, entends-tu !
DINA. – À sa fille, qui se penche à son balcon, comme du haut du ciel ! Cette pauvre vieille entre dans la cour ; elle tire sur la ficelle du petit panier ; là-haut, une clochette sonne ; la fille se met au balcon, et sa mère lui parle du fond de ce puits, la tête en l’air… comme cela ! Tu imagines !
On frappe à la porte ; entre le domestique.
LE DOMESTIQUE. – Madame ?
AMÉLIE. – Qu’est-ce que c’est ?
LE DOMESTIQUE. – Monsieur et madame Sirelli avec une autre dame.
AMÉLIE. – Faites entrer.
Le domestique s’incline et sort.
AMÉLIE, à Mme Sirelli qui entre. – Chère madame !
MADAME SIRELLI, plutôt grasse, rougeaude, encore jeune, agréable, habillée avec une élégance recherchée de provinciale, toute brûlante d’une curiosité mal contenue, rude envers son mari. – Je me suis permis de vous amener ma bonne amie, madame Cini, qui avait le plus grand désir de faire votre connaissance.
AMÉLIE. – Très heureuse, madame… Asseyez-vous donc, je vous prie. (Elle fait les présentations.) Ma fille, Dina… Mon frère, Lambert Laudisi.
SIRELLI, chauve, quarante ans environ, gras, mais avec des prétentions à l’élégance. Il salue. – Madame, mademoiselle.
Il serre la main de Laudisi.
MADAME SIRELLI. – Ah ! chère madame, nous venons chez vous comme à une source. Nous sommes de pauvres créatures assoiffées de renseignements.
AMÉLIE. – Mais de renseignements sur quoi, chère madame ?
MADAME SIRELLI. – Mais sur le nouveau conseiller de préfecture. En ville, on ne parle que de ça !
MADAME CINI, vieille, ridicule et mal attifée. Elle dissimule la malignité et l’envie qui la dévorent sous des airs d’ingénuité. – Nous brûlons de curiosité…
AMÉLIE. – Mais, madame, nous ne savons rien de plus que les autres, je vous assure !
SIRELLI, à sa femme. – Je te l’avais dit ! Ils n’en savent pas plus que nous, ils en savent peut-être moins que moi ! La raison pour laquelle cette pauvre femme ne peut monter voir sa fille dans son appartement, par exemple, la connaissez-vous ?
AMÉLIE. – J’étais précisément en train d’en causer avec mon frère.
LAUDISI. – Vous me faites tous l’effet d’être devenus fous !
DINA. – C’est parce que son gendre le lui défend.
MADAME CINI. – Explication insuffisante, mademoiselle !
MADAME SIRELLI. – Absolument insuffisante ! Il y a autre chose !
SIRELLI. – Une information toute fraîche, confirmée à l’instant même : il l’enferme à clé !
AMÉLIE. – Sa belle-mère ?
SIRELLI. – Non, madame, sa femme !
MADAME SIRELLI. – Sa femme, sa femme !
MADAME CINI. – À clé !
DINA. – Tu entends, tonton ? Toi qui voulais l’excuser…
SIRELLI, stupéfait. – Comment, tu voulais excuser cet homme ?
LAUDISI. – Mais je ne voulais pas l’excuser du tout ! Je dis que votre curiosité (j’en demande pardon à ces dames) est insupportable, ne fût-ce qu’à cause de son inutilité.
SIRELLI. – Comment cela ?
LAUDISI. – Inutile, mon cher, inutile !
MADAME CINI. – Inutile qu’on veuille se renseigner ?
LAUDISI. – Se renseigner ? Mais que pouvons-nous savoir réellement des autres ? Ce qu’ils sont… comment ils sont… ce qu’ils font… pourquoi ils le font…
MADAME SIRELLI. – Et pourquoi pas ?… En s’informant.
LAUDISI. – Mais s’il y a quelqu’un qui, dans ces conditions, devrait être informé, c’est vous-même, chère madame, avec un mari comme le vôtre, qui est toujours au courant de tout !
SIRELLI, cherchant à l’interrompre. – Permets, permets…
MADAME SIRELLI. – Ah non, mon cher, écoute, c’est la vérité. (Se tournant vers Mme Amélie.) La vérité, chère madame : avec mon mari qui se vante toujours d’être au courant de tout, je ne réussis jamais à savoir quoi que ce soit.
SIRELLI. – Naturellement ! Elle ne se contente jamais de ce que je lui raconte. Elle se figure toujours que les choses sont autrement que je le dis. Elle prétend qu’elles ne peuvent être comme je les lui rapporte. Elle va même plus loin : elle suppose que c’est le contraire qui est vrai !
MADAME SIRELLI. – Mais bien sûr, tu me racontes des histoires à dormir debout…
LAUDISI, riant aux éclats. – Ah ! ah ! ah !… Vous permettez, madame ? C’est moi qui vais répondre à votre mari. Comment veux-tu, mon cher, que ta femme se satisfasse de ce que tu lui dis, si, comme il est naturel, tu lui montres les choses telles qu’elles t’apparaissent ?
MADAME SIRELLI. – Comme il est radicalement impossible qu’elles soient !
LAUDISI. – Ah non, madame, souffrez que je vous contredise ! Ici c’est vous qui avez tort. Pour votre mari, soyez-en certaine, les choses sont bien telles qu’il vous les dit.
SIRELLI. – Mais je les donne pour ce qu’elles sont en réalité ! Ni plus, ni moins…
MADAME SIRELLI. – Jamais de la vie ! Tu nous racontes des histoires de brigands !
SIRELLI. – C’est toi qui te trompes et non pas moi.
LAUDISI. – Mais non, mais non ! Aucun de vous deux ne se trompe ! Vous permettez ? Je vais vous le démontrer. (Il se lève et se campe au milieu du salon.) Je commence… Vous me voyez bien tous les deux, n’est-ce pas ? Vous me voyez ?
SIRELLI. – Naturellement, nous te voyons.
LAUDISI. – Non, non, ne répondez pas si vite ! Approche-toi, approche-toi !
SIRELLI, qui le regarde en souriant, perplexe, un peu déconcerté, hésitant à se prêter à une plaisanterie qu’il ne comprend pas. – Pourquoi ?
MADAME SIRELLI, avec irritation. – Mais vas-y donc !
LAUDISI, à Sirelli qui s’approche de lui avec hésitation. – Tu me vois ? Regarde-moi encore mieux. Touche-moi.
MADAME SIRELLI, à son mari qui hésite à toucher Laudisi. – Mais touche-le donc !
LAUDISI, à Sirelli qui lève une main et lui effleure l’épaule. – Bravo, très bien. Tu es maintenant aussi sûr de me toucher que de me voir, n’est-ce pas ?
SIRELLI. – Heu…
LAUDISI. – Voyons, tu ne peux pas douter de toi ! Retourne à ta place.
MADAME SIRELLI, à son mari, qui reste tout balourd devant Laudisi. – Mais reviens donc à ta place !
LAUDISI, à Mme Sirelli, lorsque son mari est revenu à sa place. – Maintenant, voudriez-vous approcher à votre tour, chère madame ? (Se reprenant aussitôt.) Non, non, c’est moi qui irai jusqu’à vous. (Il s’approche d’elle, ploie un genou.). Vous me voyez, n’est-ce pas ? Levez cette jolie petite main, touchez-moi. (Mme Sirelli pose sa main droite sur son épaule, il s’incline pour la lui baiser.) Oh ! la gentille petite main !
SIRELLI. – Hé là ! hé là !