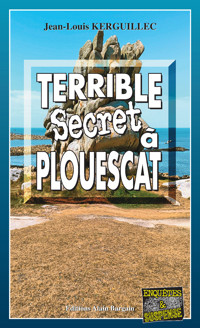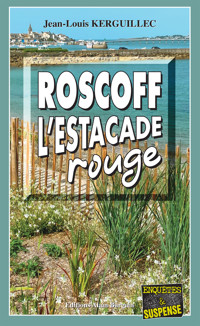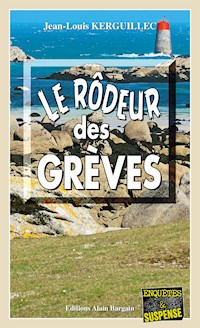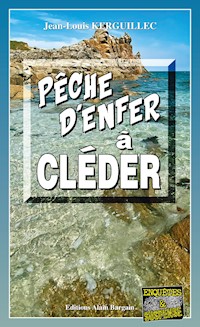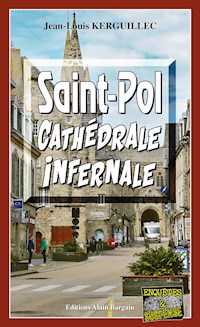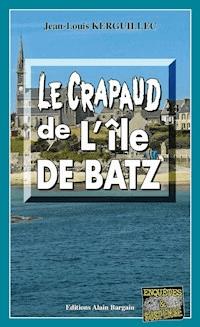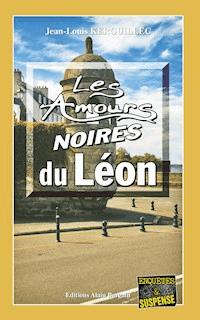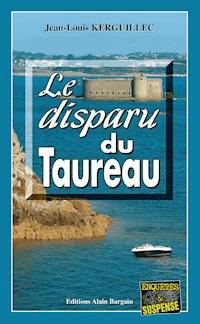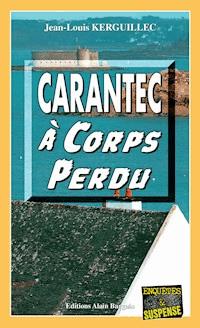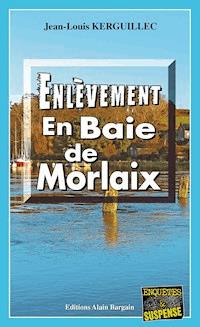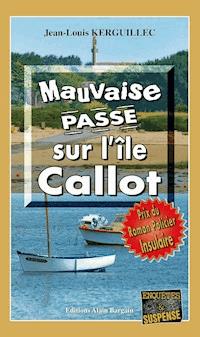Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Les enquêtes du commandant Le Fur
- Sprache: Französisch
CARANTEC. Un jeune fêtard sort au petit matin d’un établissement de nuit à Carantec et se fait sauvagement agresser par plusieurs individus qui le rouent de coups et le laissent pour mort. Le commandant Guillaume Le Fur et son groupe vont se lancer dans une difficile recherche des coupables. Une laborieuse enquête criminelle de proximité où ils iront de surprise en surprise et dont le dénouement inattendu va les déconcerter.
Une nouvelle investigation du commandant Le Fur qui jette ici un regard lucide et quelque peu désabusé sur l’état et l’évolution de notre société.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean-Louis Kerguillec, né à Kervaliou dans les dunes de Cléder, sur la côte léonarde dont il connaît jusqu’au moindre recoin, a exercé sa carrière de professeur de lettres classiques au lycée Tristan-Corbière à Morlaix. Il fait partie du collectif d’auteurs, “L’assassin habite dans le 29”, organisateur de Salons du livre policier et signe ici son onzième roman aux Éditions Alain Bargain.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
« Quand je pense à tous les livresqu’il me reste encore à lire,j’ai la certitude d’être encore heureux. »
Journal de Jules Renard
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
PROLOGUE
Carantec. Samedi 2 juillet 2022.
Il était trois heures du matin. Gaëtan Briant laissa se refermer, puis claquer dans son dos, la porte du “Rendez-vous des sportifs”, cabaret de Carantec où il avait passé la soirée et la plus grande partie de la nuit. Il traversa la rue et s’avança vers le parking où il avait garé sa voiture, la démarche mal assurée. Il se rendait bien compte qu’il avait trop bu et que son équilibre était incertain. Le ciel, à l’est, du côté de Penalan, commençait à blanchir au-dessus des grands pins de la pointe avec, déjà, des filaments et des stries roses et jaunes mêlées. Un vent d’est aigrelet remontait du Kelenn avec la rumeur de la mer, charriant des odeurs de sel et de goémons en décomposition. De longues écharpes de brume montaient de la plage et venaient se déchirer dans les jours du clocher de l’église. Le froid le surprit, il frissonna et referma les pans de son veston dont il remonta le col. Il avait passé plusieurs heures au Rendez-vous des sportifs à boire, un verre poussant l’autre, une quantité de whisky et un mélange d’alcools divers ; à pérorer au comptoir puis de table en table ; à refaire le monde avec l’un, l’une ou l’autre ; à draguer et à se laisser draguer par des créatures tout autant alcoolisées et qui ne se souviendraient même plus de lui le lendemain matin, à l’heure du Doliprane et du café bien serré. La tête lui tournait. L’échec qu’il venait de subir pour la première fois dans sa vie d’homme, le bouleversait, le retournait complètement, lui soulevait le cœur et lui donnait envie de vomir. Il était convaincu qu’il ne s’en remettrait jamais, il avait envie d’aller se jeter du quai du port dans la mer, de foncer dans un mur au volant de sa voiture ou de se pendre à une poutre de son garage. Il avait l’impression qu’il ne saurait plus regarder une femme en face, encore moins soutenir son regard. Trop de cigarettes aussi, fumées à la sauvette sur le trottoir, devant le bar, entre deux verres, au coude à coude avec des grappes de personnes qu’il ne connaissait pas, juste réunis dans les courants d’air autour de leur besoin de fumer. La veille, en fin d’après-midi, il avait téléphoné à sa femme vers seize heures : il allait prendre un verre au Rendez-vous des sportifs après son travail, juste un verre, un seul, pas deux, vite fait, il ne resterait pas traîner et il ne rentrerait pas trop tard chez eux à Locquénolé. Elle pouvait même l’attendre pour dîner. Il arriverait à l’heure. Promis. En même temps, il était convaincu que Carole, sa femme, ne le croirait pas plus que toutes les autres fois. Mais ce n’était pas le plus important, il allait pouvoir faire ce qu’il voulait de sa soirée.
Gaëtan Briant passa par le parking du “Comptoir de la mer”, butta contre un rebord de trottoir, partit en avant, se rattrapa de justesse, et parvint à la petite place où il se souvenait encore d’avoir garé son véhicule la veille. Sa voiture, sa chère voiture, il ne pouvait pas l’avoir oubliée. Elle était là face à lui, bien rangée auprès du distributeur de billets de la Caisse d’épargne, une masse sombre, imposante et arrondie. Comme un gros scarabée. Le dernier modèle de Mercedes. Au volant de cette berline allemande dont il était si fier et qu’il avait payée une petite fortune, qui lui donnait un sentiment de toute-puissance, il devenait un autre homme. Il dominait la route, il dominait le paysage, il était au-dessus de tout le monde. Il était le plus riche, il était le plus fort. Le roi du monde. Tout le reste lui paraissait dérisoire. Il chercha la clé dans la poche de son pantalon et actionna l’ouverture de la porte. Il en reconnut le choc sourd, familier et rassurant.
Brusquement, un homme cagoulé surgit devant la voiture et se dressa devant lui. Il devait se trouver tapi entre la voiture et le mur de la Caisse d’épargne. Gaëtan Briant comprit aussitôt et se mit en garde. Il avait suivi des cours de boxe française et de karaté des années auparavant, à la salle Aurégan à Morlaix. Il avait même pris part à quelques combats officiels. Il recula pour s’adosser au canon récupéré par des plongeurs dans la baie. Il chercha des yeux un objet quelconque pour se défendre. Il n’y avait rien autour de lui. Il recula encore vers l’entrée du futur musée maritime en travaux, encombrée de parpaings et de gravats. Il reçut alors un coup violent à l’arrière de la tête et tomba à genoux, après un coup de pied dans la tempe il s’effondra sur le côté, la bouche sur le bitume. Alors ses agresseurs, au moins deux, peut-être trois ou même davantage – il ne saurait malheureusement jamais combien ils étaient – s’acharnèrent sur lui à coups de pied et de battes de base-ball. Il y eut des chocs sourds, des bruits mous et des craquements d’os broyés. Ensuite les raclements d’un corps qu’on traînait au sol, des ahanements et des jurons étouffés. Un coffre de voiture claqua. Un bruit lourd et mat. La voiture démarra et prit la direction de Morlaix par la corniche de Locquénolé et par Saint-François.
Une épaisse flaque de sang demeura au sol. Au petit matin, les responsables de la voirie de la ville ne s’en inquiétèrent pas outre mesure. C’était, pour eux, une des routines de certains matins d’été. Chaque week-end, ils avaient l’habitude des rixes entre bandes rivales alcoolisées ou sous l’emprise de stupéfiants. Comme à peu près partout. Rien de bien grave. Des nez cassés qui pissaient le sang et des arcades sourcilières éclatées, après tout rien de bien grave. Juste un peu de sang sur la voie publique. La prochaine averse effacerait tout. Il suffisait de quelques seaux d’eau poussés au balai par le caniveau jusqu’à une bouche d’égout. Les courants d’air de la rue Albert-Louppe et les premiers rayons du soleil feraient le reste. Il ne resterait aucune trace de cet événement quand Yvon, le bouquiniste familier des lieux, déplierait ses tréteaux et déballerait ses cartons de livres. À cet endroit même, le jour du marché hebdomadaire.
I
Morlaix. Dimanche 3 juillet 2022, 8 heures
J’avais repris le travail après quelques jours de vacances. Des vacances toutes relatives et bien encombrées par une enquête qui m’était tombée dessus au milieu de mes congés alors que je m’y attendais le moins. Je séjournais à Brignogan-Plages à “l’hôtel du Port”, où j’avais pris pension, quand une vieille dame m’avait abordé pour me faire part de ses problèmes et me demander de lui venir en aide*. Évidemment, je n’avais pas eu le cœur de lui dire non. D’autant que cette vieille dame avait été étranglée le soir même. Nous avions arrêté le coupable après quelques jours d’enquête, un peu par hasard. Puis j’avais repris mes habitudes au commissariat de Morlaix. Mon supérieur, le commissaire André Lagarde était en congé de maladie, il se remettait difficilement du Covid. On parlait maintenant d’un Covid long. Étant le plus âgé et le plus gradé, j’assurais l’intérim. Je l’avais déjà fait en d’autres circonstances. J’héritais donc d’un surcroît de responsabilités, de travail de bureau que je n’aimais pas, et surtout d’une quantité de paperasses. Je courais sans cesse après le temps. Certains jours, je me faisais l’effet d’un hamster pédalant pour l’éternité dans le petit tourniquet de sa cage, je n’avais plus un moment à moi. J’avançais en âge, je fatiguais plus facilement, la retraite n’était plus qu’à quelques mois et mon métier de commandant de police judiciaire me prenait déjà beaucoup trop d’énergie.
S’y ajoutaient, depuis quelques années, mes activités d’écrivain qui me donnaient aussi beaucoup de travail, surtout à l’occasion de la sortie annuelle de chacun de mes livres. En effet, j’écrivais de petits romans policiers, librement inspirés de certaines de mes enquêtes ou de celles de mes collègues ; d’autres étaient parfaitement imaginaires. Je m’amusais bien, d’abord à écrire puis à rencontrer mes lecteurs pour leur présenter mes romans. Ainsi, je multipliais les séances de dédicaces dans les grands magasins et dans les librairies. Je participais, sur mes congés, à de nombreux Salons du livre dans toute la Bretagne, parfois même au-delà. Tout mon temps libre et toutes mes vacances y passaient. Je négligeais mon jardin qui s’était progressivement transformé en forêt vierge, je regardais mon bateau de loin, avec une certaine nostalgie, juste pour m’assurer qu’il était encore là et qu’il n’avait pas rompu son amarre. J’avais encore des travaux à terminer sur ma maison de Roscoff, mais ils attendraient des jours meilleurs, des jours où je me sentirais plus disponible. En fait, je n’arrêtais jamais. Le travail, encore le travail et quelques promenades le long de la mer avec mon chien Horace, mon yorkshire terrier, déjà âgé de dix ans. J’avais l’impression de gâcher ma vie à force de trop vouloir en faire, d’être partout en même temps et de m’obliger à être disponible pour tout le monde.
Ce dimanche 3 juillet, je participais au Salon du livre policier de Morlaix, dont j’étais d’ailleurs l’un des organisateurs. Il se tenait sur la place des Otages entre le parvis de la mairie et le kiosque à musique. L’endroit idéal pour une telle manifestation. Le centre historique dominé par la masse majestueuse du viaduc. La veille, les services de la mairie avaient disposé des barrières pour réserver le stationnement aux auteurs, mais des automobilistes n’en avaient évidemment pas tenu compte et les avaient déplacées. Ainsi, quelques voitures gênaient le travail de l’équipe des employés municipaux venus tôt le matin installer les barnums, ménager à l’intérieur un sens de circulation et délimiter avec de la rubalise le périmètre de la manifestation. Des voitures étaient garées sur la place en dépit des barrières et des pancartes de la mairie qui interdisaient le stationnement.
Une haute voiture noire, une berline allemande imposante et luxueuse, garée en épi sur la voie, obstruait l’entrée du parking et empêchait le passage du camion des services municipaux. Je sentais confusément que cette voiture n’appartenait pas au monde des jeunes fêtards inconscients qui laissaient parfois leurs véhicules stationnés n’importe comment au retour de leur tournée des bars du samedi soir – souvent parce qu’ils n’étaient pas en état de les retrouver et ne se souvenaient même pas de l’endroit où ils les avaient laissés. Elle était fermée à clé, et on ne pouvait pas la déplacer. Il fallut, pour libérer l’entrée du parking, faire appel à une entreprise de remorquage. Je ne pris pas garde à l’enlèvement de cette voiture, les yeux et l’esprit ailleurs, entièrement absorbé par le tirage au sort de la place attribuée à chaque auteur sur le Salon. Nous étions une trentaine, tous des connaissances, des fréquentations ou des ami(e)s. Autrices et auteurs bretons de romans à connotation policière – parfois incertaine et lointaine.
* Le rôdeur des Grèves, même collection.
II
Lundi 4 juillet
Quand j’arrivai à mon bureau le lendemain lundi, bien avant huit heures selon mon habitude, le brigadier Célestin Kergroc’hen, “Tintin” ou encore “Rintintin” pour ses collègues du commissariat – et tous ses amis, hélas trop nombreux dans les cafés de Morlaix –, qui tenait la permanence à l’accueil ce matin-là, referma sèchement le Télégramme dont il épluchait les dernières pages, sans doute les pronostics des courses de chevaux de la journée, se leva, contourna difficilement son comptoir et vint vers moi au bas de l’escalier menant à mon bureau.
— Bonjour, Guillaume. Je n’ai pas pu te joindre hier soir, tu as dû rentrer tard de ton enquête. Et je n’ai pas voulu te déranger chez toi, à Roscoff. Je sais que tu n’aimes pas trop. D’ailleurs, j’ai pensé que l’affaire pouvait attendre. Hier, une femme est venue pour te voir. Elle est déjà venue plusieurs fois, deux ou trois fois au moins, mais elle t’a manqué à chaque fois et pas moyen de lui faire dire pourquoi elle venait ainsi. Elle insistait, voulait absolument te parler, à toi et rien qu’à toi. Elle ne voulait pas être reçue par quelqu’un d’autre de ton équipe. Pourtant, Joana et Monique étaient là-haut dans leurs bureaux. Mais vraiment rien à faire. Fermée, sourde à mes explications et complètement butée. Agressive et pas commode, en plus. Un vrai frelon asiatique.
— Quel genre de femme ?
— Je ne l’avais jamais vue auparavant. Une femme du genre que je n’aime pas trop. Bien habillée, plutôt belle femme, le sachant très bien et désireuse de le montrer. La petite bourge friquée, qui se la pète et regarde tout le monde de haut. Tu vas encore me dire, Guillaume, que décidément je n’aime pas les femmes et que je ne manque pas une occasion de les dénigrer. C’est d’ailleurs un peu vrai, je le reconnais, depuis que ma garce de femme m’a quitté pour un crétin probablement deux fois pire que moi, prenant, comme on dit, un cheval aveugle pour remplacer un cheval borgne.
Je l’arrêtai aussitôt, la paume de la main en avant. Je connaissais assez bien cette histoire qu’il racontait en boucle dans les cafés de la ville, et avec parfois de nouveaux rebondissements qui avaient amusé le commissariat le temps d’un été quelques années auparavant. D’ailleurs, ce n’était pas tout à fait la vérité. Célestin avait sa manière à lui de présenter les choses. À son avantage, évidemment. Et il ne manquait jamais une occasion de rappeler ses tourments conjugaux. Madeleine, sa femme, avait déserté le domicile conjugal parce que Célestin dilapidait son salaire en jouant aux courses et faisait tous les soirs, après le travail, le circuit de ses cafés préférés puis rentrait à la maison, dans un état d’ébriété plus ou moins avancé ; il recommençait le même circuit le lendemain et ainsi tous les jours de la semaine et de l’année. De plus, on le disait autoritaire, voire même tyrannique avec ses proches. Ses enfants, un garçon et une fille, avaient quitté la maison depuis longtemps et ne revenaient que de loin en loin, le moins possible. Madeleine, une sainte femme pourtant disait-on, avait supporté cette situation des années durant, puis un soir, quand Célestin est rentré de sa virée habituelle, il avait trouvé la maison complètement vide et le ménage fait. Plus personne, plus aucun meuble, plus un bibelot, plus un pot de fleurs aux fenêtres, plus un grain de poussière, plus rien. Des pièces vides, creuses et sonores. Même leur vieux matou Bisousig avec son panier, le poisson rouge Tibulle dans son bocal, et Caroline la tortue du jardin avaient déménagé sans laisser d’adresse. Il ne les revit jamais. Pour autant, Célestin ne changea rien à sa façon de vivre. Il s’était contenté d’élargir et de rallonger sa tournée des cafés du soir en y ajoutant quelques stations supplémentaires.
— Ta visiteuse est du genre petite pétasse bourgeoise friquée que je n’aime pas du tout.
Célestin ne donnait jamais trop dans la nuance. Pour lui, la société se divisait en deux catégories bien distinctes et tout à fait imperméables entre elles, la bourgeoisie et le peuple. On appartenait à l’un ou à l’autre de ces deux mondes, sans passerelle possible. Naturellement, il revendiquait haut et fort son appartenance au peuple et, pour toutes choses, se référait obstinément aux positions extrêmes de son syndicat.
— Oui, mais encore…
— La quarantaine sûrement, peut-être un peu plus, peut-être moins, ce n’est pas facile à évaluer, car elle me semble trop bien apprêtée et pomponnée. Et en même temps habillée comme une petite fille. Une petite bourge qui te fait comprendre que vous n’êtes pas du même monde, hautaine et sûre d’elle-même, bien fringuée, blonde décolorée, le genre poupée Barbie de collection, qui puait à un kilomètre à la ronde un parfum de luxe dont elle avait dû largement s’arroser, maquillée comme une artiste de cirque, un pot de peinture sur deux pattes. Et qui me fixait derrière mon bureau, me soupesait, m’évaluait, me toisait d’un regard plein de mépris, tout juste comme une crotte de chien sur un trottoir. Elle paraissait me faire l’honneur d’être là, face à moi et de m’adresser la parole. Elle restait à bonne distance comme si je sentais mauvais, ou avais attrapé la gale et capable de la lui refiler. Du genre qui vous fait comprendre que vous n’êtes pas du même monde qu’elle, souffre de venir jusqu’à vous mais ne peut malheureusement pas faire autrement. Elle semble vous faire l’aumône de vous adresser la parole. Le genre cul pincé, le menton en avant et arrogant, sûre d’elle-même et de son fric. En fait, une gonzesse insupportable. J’avais vraiment envie de la jeter sur le trottoir avec perte et fracas et de lui botter les fesses, d’imprimer la semelle de ma chaussure sur sa petite robe blanche qui avait dû coûter à son mari ou à l’un de ses amants, au moins trois mois de mon salaire, peut-être beaucoup plus.
— Abrège un peu ton feuilleton, Célestin, tu me fatigues, tu me fais perdre mon temps. Dis-moi tout de suite ce que me voulait cette femme !
— Rien de précis. Elle m’a affirmé qu’elle te connaissait, ou plutôt que sa mère te connaissait depuis le lycée.
— Depuis le lycée ! Ce n’était pas hier et ça commence à dater ! C’était vers la moitié du siècle dernier.
— Elle a dit que sa mère parlait souvent de toi avec elle, qu’elle lui avait montré ta photo dans le journal, que vous aviez été dans la même classe et qu’elle avait même des photos de classe où vous étiez ensemble, presque à vous toucher.
— Je ne vois pas de qui il peut s’agir, c’est tellement loin et tellement vague. Et des camarades de classe, j’en ai quand même fréquenté quelques-uns, et aussi quelques-unes !
Le brigadier Célestin Kergroc’hen balança son menton d’un côté, puis de l’autre, plissa la bouche et réprima un sourire étrange et entendu. Il avait dû entendre parler de mes années de jeunesse, notoirement assez agitées. Sans doute des rumeurs sans fondement véritable…
— Je lui ai répondu que beaucoup de gens te connaissaient à Morlaix et dans toute sa région que tu n’avais pas beaucoup quittée. Ou t’avaient côtoyé à une époque ou à une autre. Et donc que tu étais connu comme le loup blanc, mais que, pour autant, tu n’étais pas à la disposition de tout le monde. Qu’à présent tu étais en mission, une enquête à l’extérieur, que je ne savais pas où, que je n’avais aucune idée de l’heure à laquelle tu allais rentrer. Que je n’étais pas au courant de tes enquêtes avec ton groupe. Et que si même je le savais, je n’avais pas à le lui dire. Elle m’a dit qu’elle reviendrait. Renfrognée et désagréable, elle grognait, marmonnait tout bas, et est sortie du bureau en tortillant des fesses, roulant des hanches en faisant claquer ses talons rouges. Il lui fallait montrer sa contrariété et son mépris. Une vraie punaise de lit, une tête à claques.
— Et elle est revenue ?
— Effectivement, elle était encore à la porte du commissariat ce matin. Je me suis demandé si elle n’avait pas passé la nuit à t’attendre dans sa voiture sur le parking de la place des Halles, juste là en bas. J’ai pensé qu’elle était venue avec son sac de couchage et sa trousse de maquillage. Elle était furieuse de ne pas te trouver encore une fois et elle me l’a bien fait savoir. Je lui ai dit qu’elle n’avait pas de chance, que tu étais passé au commissariat tôt ce matin, en coup de vent comme souvent, puis reparti à l’extérieur avec une partie de ton équipe. Sans doute pour les besoins d’une affaire ou d’une intervention urgente et que je n’en savais pas davantage.
Elle me regardait, un pli méprisant au coin de la bouche. Ni bonjour, ni au revoir, à peine un regard. Elle ne me voyait pas. J’étais transparent pour elle, elle regardait au-delà de moi, comme si je n’existais pas. Une vraie vipère. « – Vous avez sans doute oublié de dire à ce Guillaume Le Fur que je voulais le voir, en personne, lui seul et personne d’autre ? – Le connaissez-vous personnellement, Madame ? Et qui dois-je lui annoncer ? – Non, il ne me connaît pas encore et je ne l’ai jamais rencontré. Mais je veux le voir tout de suite, et lui tout seul. On vous paye pour quoi dans la police ? Quand même pas pour lire le journal, bien au chaud et au calme dans votre bureau, à cocher vos tickets de tiercé et attendre l’heure de l’apéro, le seul moment de la journée où vous vous remuez vraiment un peu ? C’est quand même l’argent de nos impôts ! Tous les mêmes, les fonctionnaires. Trop bien payés pour ce qu’ils font. Il faudrait en supprimer plus de la moitié et ne garder que ceux qui servent vraiment à quelque chose ! Il n’en resterait pas beaucoup. Assez quand même, voire encore trop. » Elle s’emportait, mais je l’ai laissée s’énerver. Finalement, elle m’amusait un peu. Les fonctionnaires, encore les fonctionnaires… On les met à toutes les sauces. Ils sont coupables de tout. Toujours la même rengaine de café du commerce. Je ne réponds jamais à ce type de propos depuis des années. On me balance la même chose depuis quarante ans ! Là-dessus, je suis blindé. En partant, ta visiteuse a claqué la porte d’entrée et est partie sans se retourner. Le hall puait son parfum. Une véritable infection. J’ai dû aérer.
***
Le lendemain, vers neuf heures, j’étais dans mon bureau devant une épaisse pile de dossiers en attente. Mon équipe était partie enquêter sur un cambriolage après notre petite réunion du matin. Je mettais la dernière main à un rapport sur une affaire de violences conjugales. Encore une, mais pas la plus édifiante. Une femme avait frappé son mari à coups de balai et l’avait sérieusement amoché parce qu’il avait oublié de mettre le poulet à cuire au four. Son mari lui avait jeté ce poulet à la figure, première manche d’une bagarre générale. Les époux s’étaient retrouvés aux urgences de l’hôpital et y avaient passé la nuit. La violence ordinaire en somme, quotidienne et familière, celle-là même dont j’étais saturé. Célestin Kergroc’hen m’appela à ce moment de l’accueil.
— Guillaume, elle est encore là, solide au poste et toujours aussi désagréable, tu sais, la pétasse blonde d’hier matin, celle qui cherche absolument à te parler. Et à toi seul. Elle s’incruste. Un vrai brinnig* à un rocher. Je me demande ce qu’elle peut vouloir de toi. Peut-être que du bien, après tout. Une amoureuse transie, brûlante, le feu partout, dans le besoin absolu, et qui ne peut plus attendre ? Encore une que tu négliges ou que tu as déjà oubliée. Une de plus que tu nous avais cachée. Elle est dans le hall d’entrée et exige de te voir d’urgence. Fais quelque chose, j’ai peur, je crois que ma dernière heure est arrivée. Au secours, Guillaume ! J’ai peur ! Si tu voyais ses yeux ! Des bazookas. Elle va m’étriper ou m’arracher les yeux.
— Tu en as vu d’autres, Célestin, et elle n’est pas la première femme qui te menace et à laquelle tu échappes. Tu survivras, car personne ne peut rien contre toi. Tu es immortel et inoxydable. Tu es un roc, du granit breton dans la tempête. Ah oui ! c’est vrai, je l’avais déjà oubliée celle-là, la pétasse blonde, comme tu dis. Fais-la monter dans mon bureau. Je l’attends de pied ferme.
— Bon courage à toi, Guillaume, mais sois prudent. Garde ton arme de service à portée de main, une balle engagée dans le canon, prêt à te défendre. Si tu te sens réellement en danger, appelle-moi. N’hésite surtout pas, je me précipiterai à ton secours le plus vite possible. Je vais même mettre en alerte un groupe d’intervention de la police.
Je l’entendis éclater d’un rire tonitruant. En même temps, des talons claquaient déjà sur les marches de l’escalier menant à mon bureau.
* Brinnig en breton. Bernique, patelle.
III
Une grande femme très élégante se présenta à ma porte, blonde, mince et plutôt gironde, comme dirait mon collègue Didier. Je reconnus le modèle courant de jeunes femmes qui ne s’occupent jamais d’autre chose que d’elles-mêmes et de leur apparence physique et sociale. Le modèle des magazines féminins à la mode, fait pour plaire à une certaine catégorie d’hommes, dont, heureusement, je n’avais jamais fait partie. Elle était court vêtue d’une robe d’été blanche à petites bretelles qui lui laissait les épaules largement découvertes et qui offrait à voir ses jambes fines et bien bronzées. Elle portait des sandales blanches dont je remarquai avec étonnement les talons rouges et élevés, qu’elle avait dû payer une petite fortune. Elle devait passer ses journées dans les salons de coiffure et d’esthétique et y laisser beaucoup d’argent. De l’argent qu’elle n’avait nul besoin de compter. Elle occupait, sans doute, le reste de ses journées dans une salle de sport chère et à la mode, ou sur le golf de Carantec à pérorer et à se laisser draguer au club-house plutôt qu’à marcher sur le green. Rien ou pas grand-chose au-delà de l’image à renvoyer et à sauvegarder par tous les moyens. Elle devait avoir des actions dans la maison Chanel et se faire livrer son parfum par bonbonnes de vingt litres. Elle me dévisagea, m’évalua presque avec effronterie. Puis elle parut rassurée. Je crus comprendre, qu’à première vue, je lui faisais bonne impression et que je n’étais pas tellement différent de ce qu’elle avait dû imaginer. Un petit sourire d’aise plissa le coin de sa bouche. Je lui désignai une chaise et l’invitai à s’asseoir, mais elle resta debout face à moi raide et déterminée. Nous fîmes les présentations.
— Commandant de police judiciaire Guillaume Le Fur. Actuellement, par nécessité et par intérim seulement, je suis à la tête du commissariat de Morlaix.
— Carole Briant-Pellen. Je suis déjà venue à trois ou quatre reprises et vous n’étiez pas là. C’est quand même quelque chose ! Je tenais à vous rencontrer, vous en personne et nul autre. Mais à chaque fois, rien à faire pour vous trouver ! Je me suis fait envoyer promener toutes les fois où je suis venue. Un ours, un chien de garde, un vrai pitbull, un monstre, votre collègue, le flic de l’accueil. Il n’est pas sympa du tout et n’a pas trop l’air d’aimer les femmes. Il avait une drôle de façon de me regarder. Encore un vieux satyre. J’ai insisté pourtant, mais il ne voulait rien entendre. On ne devrait plus jamais, en France et à notre époque, avoir affaire à un fonctionnaire aussi mal embouché.
Je la sentais déjà combative, bien allumée et prête à en découdre. Un vrai coq de combat dressé sur ses talons rouges. Une femme habituée à dominer les autres en jouant de son mauvais caractère. Ce matin, elle avait du venin à déverser. Mais, je m’efforçai de demeurer calme. Je l’avais déjà jugée. Il me fallait peu de temps. J’avais déjà pris mes marques et aussitôt installé des distances. Tout un savoir-faire, toute une habitude, un vrai métier en somme…
— Effectivement, madame Briant. J’ai appris que vous étiez venue à plusieurs reprises et que vous exigiez de me rencontrer à la minute. Je le sais par le brigadier Célestin Kergroc’hen qui vous a reçue à l’accueil et me l’a fidèlement rapporté. Il m’a dit que vous aviez l’air contrariée de ne pas me trouver et que vous étiez même passablement énervée, voire plutôt désagréable. À la limite même de l’outrage à fonctionnaire. Je vous rappelle quand même, madame Briant, que mon collègue de l’accueil n’a fait que son travail et qu’il n’a pas à subir vos impatiences et vos mauvaises humeurs. C’est un excellent fonctionnaire de police, un agent expérimenté, compétent et dévoué.
— Mais, à chaque fois, vous n’étiez pas là…