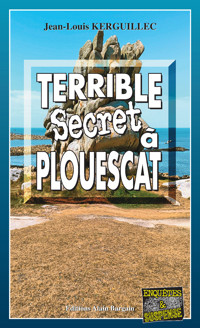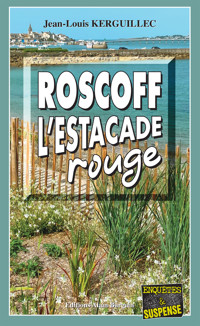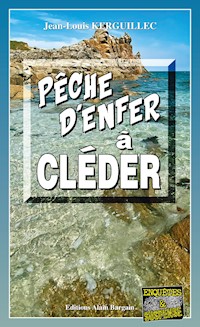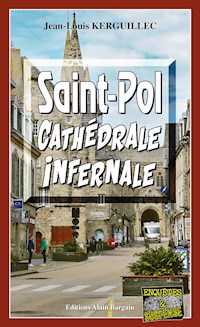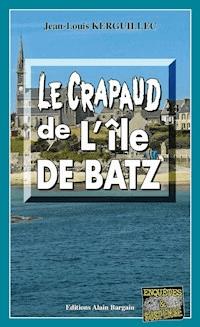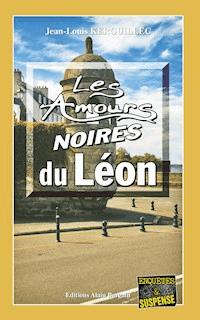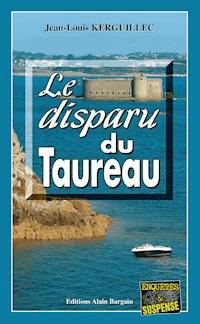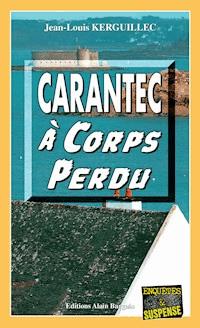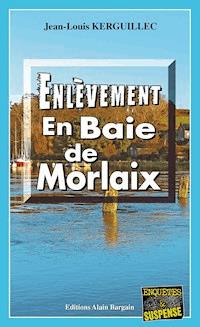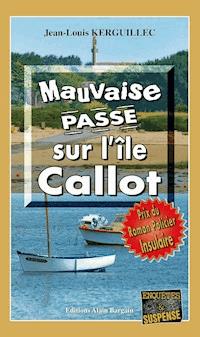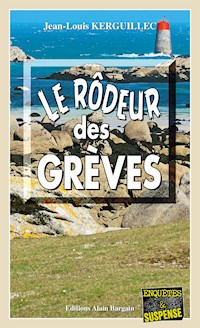
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Les enquêtes du commandant Le Fur
- Sprache: Französisch
Une rencontre inatendue avec une inconnue étrange plonge notre héros dans une enquête fascinante...
BRIGNOGAN-PLAGES. En vacances, au restaurant de l’Hôtel du Port, je décortiquais une langoustine que j’allais plonger dans le petit monticule de mayonnaise, quand cette femme est parvenue, chancelante, jusqu’à ma table. Je ne l’avais jamais vue auparavant. Capucine L’Hostis, après m’avoir raconté sa vie et les menaces qui pesaient sur elle, m’a demandé une aide que je n’étais pas en droit de lui fournir. Pourtant, ce personnage étrange et fascinant nous a entraînés, mon équipe et moi, dans une enquête criminelle difficile et compliquée, jalonnée de chemins de traverse et de rebondissements, sur la côte magnifique du Pays pagan.
Découvrez la dixième enquête du commandant Le Fur !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean-Louis Kerguillec, né à Kervaliou dans les dunes de Cléder, sur la côte léonarde dont il connaît le moindre recoin, a exercé sa carrière de professeur de lettres classiques au lycée Tristan-Corbière à Morlaix. Il fait partie du collectif d’auteurs, “L’assassin habite dans le 29”, organisateur de salons du livre policier et signe ici son dixième roman aux Éditions Alain Bargain.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
« Racontez n importe quelle histoire à quelqu’un. Si vous ne l’arrangez pas, on la trouvera incroyable, artificielle. Arrangez-la, et elle sera plus vraie que nature. »
Les mémoires de Maigret – Georges Simenon
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
AVERTISSEMENT DE L’AUTEUR
Le rôdeur des Grèves, dixième roman de l’auteur, nous dévoile l’enquête particulièrement compliquée du commandant de police Guillaume Le Fur et de ses quatre équipiers. Vous allez suivre la traque d’un criminel sur les côtes du pays Pagan, de Brignogan à Plouguerneau. Pour mieux vous faire comprendre la personnalité de l’assassin, personnage retors et pervers, assassin de vieilles femmes, j’ai intégré quelques fragments de son journal intime où il proclame sa haine envers ses victimes, décrit ses crimes dans un luxe de détails cruels et souvent insoutenables.
PROLOGUE
17 août 2020
Pour mes vacances d’été 2020, j’avais renoncé à la Grèce et aux îles de la mer Égée, à l’île de Paros plus précisément, où je me rendais depuis maintenant une dizaine d’années. En raison d’abord de la pandémie du Coronavirus, un virus venu de Chine, qui avait tout arrêté, tout compliqué depuis plusieurs mois et rendait tout voyage incertain et problématique voire dangereux. Tout paraissait brouillé, brumeux et incertain, surtout les voyages par avion. Nous étions submergés d’avis contradictoires et parfois tout à fait opposés. Je ne me voyais pas rester bloqué en quarantaine à Athènes, au Pirée, ou sur je ne sais quelle île, et assigné à une résidence plus ou moins surveillée et forcément mal vécue. Je ne savais pas à quels contrôles et à quels tests j’allais devoir faire face. J’avais aussi, je dois le dire, des raisons personnelles et intimes de ne plus vouloir m’y rendre. Comme une sorte de rejet violent et définitif. Je ne voulais plus trop fréquenter les îles grecques, surtout les grandes Cyclades que j’avais pourtant tant aimées. J’étais partagé entre l’envie de voir mes amis que j’y avais nombreux et la crainte de leur apporter le virus. Je ne voulais pas m’encombrer de mon chien Horace et surtout lui faire subir des conditions de voyage aussi confuses et incertaines. Pour toutes ces raisons, il était préférable que je reste en France mais en réalité, je n’avais guère le choix. J’avais d’abord pensé me rendre en Baie de Somme que je connaissais mal et qui m’attirait depuis longtemps ou alors en Alsace que je n’avais jamais vraiment visitée. En outre, je ne voulais pas imposer à mon petit chien de trop longs trajets en voiture, d’autant que la météo annonçait un important épisode de fortes chaleurs. Au bout du compte, je choisis la facilité et la prudence et pris la décision de ne pas quitter la Bretagne.
Je privilégiai finalement la proximité pour revisiter la côte nord du Finistère. Je voulais revoir la région des Abers, l’Aber Wrac’h, l’Aber Benoît, Landeda, Lanildut en suivant la côte au plus près, de Kerlouan au Conquet. Toute une bande côtière dont je n’avais plus de souvenirs très précis. Je décidai de m’installer à Brignogan, d’en faire ma base et le point de départ de mes excursions, et je pris pour quinze jours une pension complète à l’Hôtel du Port qui acceptait les chiens. J’y installai mon bagage et, aussitôt, je m’y sentis bien, j’avais la mer et les bateaux devant ma fenêtre et l’envie de me promener le long des grèves. Je ne pouvais pas rêver mieux !
I
Vendredi 21 août 2020. 20 heures
J’étais au restaurant de l’hôtel devant la grande baie vitrée et face à la mer. J’avais sous les yeux le port de Pontusval, ses bateaux au mouillage tirant doucement sur leurs chaînes, et la longue courbe de la plage, à cette heure désertée par ses derniers baigneurs. Je décortiquais, une à une, délicatement et du bout des doigts des langoustines en commençant, comme on le fait toujours par les plus grosses. Celles qui sont exposées en majesté sur le dessus de l’assiette, recouvrent et cachent les autres, souvent plus petites et parfois moins fraîches. « Buisson de langoustines dressées en demoiselles », proposait fort poétiquement le menu du jour. Une cuillère tenait, plantée bien droit, dans un bol de mayonnaise. Horace dormait à mes côtés, recroquevillé sur une chaise et ronronnait tout doucement. Il était épuisé. Il avait tant couru et poursuivi en vain mouettes, goélands et petits bécasseaux sur les grèves que nous avions parcourues toute la journée. Pour avoir le droit d’être là, sur une chaise à toucher la mienne, il avait l’autorisation et la bénédiction exceptionnelles de Jean-Hervé, le patron du restaurant, qui, chose étrange, avait fait sa conquête en dépit de ses méfiances et de son mauvais caractère. Mais je n’étais pas dupe. L’odeur de bonne chère de ses mains et des basques de son tablier devaient y être pour quelque chose. Horace avait vite trouvé le chemin de la cuisine, se faufilait sous la porte battante dès que j’avais la tête tournée et en revenait, se pourléchant les babines, les moustaches grasses, le regard ailleurs, et affichant une attitude faussement détachée et indifférente. Il semblait heureux de pouvoir enfin me jouer quelque tour. Il s’amusait et jouissait d’une liberté toute nouvelle, d’un tout nouveau terrain de jeu, et vivait sa vie de petit chien heureux. Je fermais les yeux et je laissais faire, mais j’avais très vite négocié des limites, des interdits et des garde-fous que le personnel de la cuisine s’était engagé à respecter. Juste un petit lipig, admettait en souriant le chef cuisinier, à peine une miette, une “toute petite douceur”, et rien de plus. Surtout rien de plus. J’avais été ferme et intransigeant, à l’excès même, car je ne voulais pas que mon petit chien revienne de nos vacances ayant doublé voire triplé de volume.
La grande salle du restaurant était pratiquement vide. Les tables étaient séparées de plusieurs mètres, et protégées par des paravents en plexiglas. Les clients se faisaient rares et extrêmement prudents, évitaient de se parler et se tenaient à l’écart les uns des autres comme des poissons d’aquarium. Ainsi, nous n’étions qu’une dizaine de dîneurs éparpillés dans la salle. De l’autre côté de l’allée, face à moi, un couple attendait son dessert. La femme tripotait son téléphone, silencieuse et recueillie, absorbée par son petit écran dans une sorte de contemplation extatique. Son mari regardait autour de lui et paraissait s’ennuyer. Je prenais mon temps. J’avais un livre devant moi. Afin de pouvoir lire à table ou ailleurs et en toutes circonstances, j’avais toujours un livre à portée de main ou fourré dans une poche. Dans ma voiture aussi. Il me fallait cette présence rassurante d’un livre à tout moment de la journée et de la nuit. Une fâcheuse habitude sans doute, mais dont je ne pouvais me passer. À chacun son addiction, j’avais la mienne, et il en est sans doute de pires. J’avais acheté ou emprunté, je ne sais plus, à Yvon, un ami bouquiniste, un ouvrage déjà ancien, Goémoniers des îles – Histoires et naufrages* qui racontait la vie rude des goémoniers de Landeda et de Plouguerneau qui allaient passer la saison de printemps et d’été dans les petites îles de l’archipel de Molène. Kemenez, Beniguet, Trielen… Et dont le retour se faisait au milieu des tempêtes d’automne. J’étais parvenu à un endroit du livre particulièrement dramatique. Quatre bateaux avaient appareillé du Conquet, faisaient route sur Plouguerneau poursuivis et très vite rattrapés par une soudaine et violente tempête. Le dernier du convoi, le René était en très mauvaise situation, déjà en perdition. Les déferlantes battaient son tableau arrière. « Submergés, Hervé et Saïk, avec l’énergie du désespoir, se cramponnent comme ils peuvent, à la barre, au bordé, au banc. » J’étais impatient de connaître la suite et je m’inquiétais pour ce bateau et pour le sort de ces deux marins, un père et un fils. Je brûlais d’envie d’ouvrir mon livre mais hésitais un peu à cause du regard de mes voisins. J’hésitais aussi entre mon livre et une nouvelle langoustine. La “demoiselle” se dressait sur le sommet de l’assiette, la pointe des pinces piquées dans la coque, la tête relevée, la poitrine offerte, provocante et impudique, comme la figure de proue des grands voiliers d’autrefois. Finalement, je me laissai séduire par la demoiselle et je lui tendis la main. Les marins de Plouguerneau allaient lutter sans moi contre la tempête. J’avais hâte de les retrouver et de partager leur chemin de croix. Mais je savais déjà que j’allais arriver trop tard et que je ne pourrais rien pour eux.
Je m’apprêtais donc à plonger la chair de ma langoustine dans le monticule de mayonnaise au bord de mon assiette quand, levant la tête, je suspendis mon geste. Une femme traversait la salle en diagonale et venait vers moi, un verre de vin rosé en équilibre précaire dans la main. Elle avait la démarche mal assurée, hésitante et chaloupée. Longue, grande mais voûtée, elle avançait par à-coups, gardant les yeux fixés sur son verre, de crainte de le renverser. J’étais frappé par son extrême maigreur. Soudain, elle fit une brusque embardée. J’eus peur pour son verre et pour le plancher de la salle et pour elle aussi évidemment. Mais elle réussit à se rattraper et à parvenir jusqu’à ma table.
Elle s’était détachée d’un petit groupe d’hommes et de femmes, qui se tenaient côté bar, menant grand tapage, certains debout au comptoir, d’autres assis autour de tables et de chaises en désordre. Ils ne portaient pas de masque quand ils se déplaçaient ou le portaient n’importe comment, à la main, ou à la pointe du menton, et ne se souciaient guère de garder entre eux la distance recommandée par nos autorités sanitaires. Je les avais observés un moment, de loin et distraitement. Des hommes surtout, de tous âges, tous veufs et célibataires sans doute, ou mal mariés, trompant leur solitude, et guère pressés de rentrer à la maison. Les uns levaient haut leur verre et parlaient fort de politique ou de football, d’autres, silencieux et immobiles, contemplaient le fond de leur verre comme s’ils voulaient y lire l’avenir. D’autres encore, recueillis et tête basse, regardaient redescendre lentement la marée dans l’écume grise de leur verre de bière. J’avais entendu la veille au soir le patron protester, dire qu’il en avait assez de faire la police, qu’il ne voulait pas, par leur faute, courir le risque d’un contrôle inopiné de la Gendarmerie et donc d’une fermeture administrative de plusieurs semaines. Il menaçait de tous les mettre à la porte, de leur servir à boire dehors, sur le muretin de pierres grises, face à la mer, dans les courants d’air, la pluie et les gaz d’échappement des voitures. Ou même de fermer définitivement son bar. Mais, de toute évidence, ses clients s’en moquaient et le laissaient dire. Jean-Hervé grognait souvent mais se montrait compréhensif et tolérant. Dès qu’il tournait le dos, et repartait vers sa cuisine ou servir des clients en terrasse, ils se déplaçaient sans masque dans la salle, lui faisaient par-derrière des grimaces, lui adressaient des doigts d’honneur. Il leur criait en claquant son torchon par-dessus son épaule.
— Vous serez bien contents quand nous serons à nouveau entièrement confinés et quand mon bar et mon restaurant seront à nouveau fermés. Vous irez boire, là, en face, c’est gratuit mais un peu salé. Vous ne serez pas obligés de payer ou de me faire marquer sur l’ardoise ni de porter un masque et encore moins de faire un peu attention aux autres.
Jean-Hervé leur montrait la mer d’un mouvement tournant du bras et se retirait dans sa cuisine en haussant désespérément les épaules.
L’élégance et la recherche vestimentaire ne semblaient pas être la principale préoccupation de mon invitée de ce soir. Elle portait un tee-shirt blanc constellé de taches sur une poitrine écroulée et à l’abandon, un pantalon de survêtement d’un gris douteux et pelucheux qui tire-bouchonnait sur ses chevilles et faisait de lourdes poches sur ses genoux. Elle avait aux pieds des espadrilles éculées, à l’arrière écrasé et crasseux, qui, quelque jour lointain, sans doute, avaient dû être bleues. Ses pieds étaient gris de poussière. Elle avait un visage étroit et osseux et sur les traits un air de lassitude désespérée. Elle dégageait surtout une impression désolante de laisser-aller et d’usure précoce. Un large espace, entre ses cuisses trop maigres, où passait la lumière, lui faisait une impressionnante rivière parisienne.
— Je peux ?
Je hochai la tête, avançai le menton, étonné et indécis, un peu contrarié malgré tout. J’étais venu là, en vacances, pour être seul et tranquille. Pour enfin ne dépendre de rien ni de personne, oublier un peu mon travail, mes chers collègues et le téléphone. Pour me promener avec Horace, marcher, me baigner peut-être et lire au soleil. Mais, en même temps, j’étais curieux, bienveillant par nature, ouvert et attentif aux autres. Sans doute un peu trop. Mon invitée attira à elle une chaise et y posa prudemment la pointe des fesses en serrant les genoux.
— J’espère que je ne vous dérange pas ?
Elle allongea une jambe sous ma table, et tira un masque chirurgical tout fripé et pas très net de la poche de son pantalon.
— Voulez-vous que je le porte ?
— Ce n’est pas nécessaire. Vous êtes maintenant assise, vous êtes donc en règle. Et puis…
Je haussai les épaules avec un soupir désabusé. Je croyais modérément à l’efficacité absolue des masques. Tant de gens, autour de moi, oubliaient de les porter ou les portaient n’importe comment, souvent des chiffons froissés qui traînaient au fond de leurs poches ou sur le siège de leur voiture, qu’ils ne prenaient pas la peine d’ajuster et qu’ils portaient parfois à l’envers. Et ils les mettaient juste pour paraître en règle, pour échapper aux contrôles et faire comme tout le monde. Moi le premier d’ailleurs, même si je me conformais d’assez bonne grâce aux injonctions des autorités sanitaires. De toute façon, le virus de la Covid était partout et nulle part, et beaucoup des précautions prises me semblaient désormais inutiles et dérisoires. J’avais compris tout de suite que les ennuis me rattrapaient au beau milieu de mes vacances, et je me laissais gagner et envahir par un mauvais pressentiment. Mon invitée se présenta. Elle avait un débit de parole rapide et haché, signe d’une violente émotion et en même temps d’une intense lassitude. J’abandonnai ma langoustine sur le bord de mon assiette. Je regardai ma visiteuse en face, lui souris et la laissai parler. Elle paraissait en avoir un besoin urgent et je devais lui apparaître comme l’interlocuteur inespéré, l’homme providentiel, le sauveur tombé du ciel ou, mieux, miraculeusement apporté par la marée. Comme un de ces saints des premiers temps, tout juste débarqué d’Irlande ou du pays de Galles dans un vaisseau en pierre et venu porter l’Évangile en petite Bretagne. J’étais l’aubaine de sa soirée, sa chance enfin, la perle rare qu’il ne fallait pas rater et dont il fallait profiter sans attendre. Je ne fis rien pour arrêter le torrent. J’étais ainsi fait, j’aimais écouter les gens parler et se raconter, comme si, à chaque fois, je feuilletais un nouveau roman. J’allais amèrement le regretter, je le savais déjà, mais, déjà, il était trop tard.
— Je suis désolée de venir vous importuner au beau milieu de votre repas. Vos langoustines sont belles et me semblent délicieuses. Je m’appelle Marguerite l’Hostis. C’est mon nom de femme mariée. Je l’ai gardé à la mort de mon mari par paresse de le changer et d’engager les démarches nécessaires. Trop de paperasses à remplir. Pourtant, je n’aimais pas mon mari et encore moins son nom de famille. Je suis née Marguerite Cornec, « qui a des cornes, de grandes cornes », en breton, ce qui n’est pas un nom facile à porter. Surtout avec le mari irresponsable et volage que j’ai dû supporter pendant trop d’années. Et j’en ai porté des cornes, vous pouvez me croire. Je lui en ai aussi fait porter et au moins autant. Peut-être même plus. Mon prénom, Marguerite, un peu vieillot et passé de mode, a été imposé à mes parents par une vieille tante du côté paternel, Péroline Cornec, que je n’ai vue que trois ou quatre fois quand j’étais enfant et qui sentait les boules à mites, la pisse de chat et le tabac à priser. Je m’en souviens encore car mes parents me forçaient à l’embrasser quand ils lui rendaient visite à Lannilis, certains dimanches après-midi, autour d’un café-chicorée et d’une tarte aux pommes mal cuite, et j’en ai encore, plus de soixante ans après, des frissons dans tout le corps et les poils des bras qui se hérissent. Ses joues piquaient car elle ne pensait pas toujours à se raser. Une vieille fille, vraie et authentique, contrôleuse des impôts à Morlaix pendant toute sa carrière, depuis longtemps retraitée, au caractère aigri et insupportable, qui faisait payer ses frustrations à tout son entourage. Elle nourrissait tous les chats de son quartier et en possédait, pour sa part, une bonne douzaine qui, vivant entre eux, se reproduisaient allègrement. Marguerite était le prénom de sa propre mère et elle voulait absolument que moi, la petite dernière de la tribu, je perpétue la tradition familiale. Mes parents avaient dû céder pour éviter un esclandre, un de plus dans la famille. Mes parents et mes tantes paternelles, en effet, se disputaient depuis toujours pour des peccadilles, une succession infinie de vieilles chicanes familiales, de bouderies, de réconciliations larmoyantes et de bonnes résolutions, spectaculaires mais jamais tenues. Enfant, je n’aimais pas mon prénom, mes camarades de classe se moquaient de moi, disaient que le prénom Marguerite faisait vieux, que c’était un prénom de mémé. Alors, je me suis fait appeler, au cours de mes années d’enfance et d’adolescence et un peu au hasard, par tous les noms de fleurs possibles. Parce que j’aimais les fleurs. Camélia, Capucine, Pâquerette, Zinnia, Mimosa, Dahlia, Primevère, Jonquille et même Renoncule qui faisait pouffer de rire les garçons. D’autres encore, peut-être, que j’ai pu oublier. Toutes les fleurs donc, sauf les marguerites. Je sais, c’est bête, mais c’étaient là des jeux de gamines, des amusements tout à fait innocents et inoffensifs. On a quand même fini par s’arrêter sur Capucine, je ne sais d’ailleurs trop pourquoi, et c’est ainsi qu’on m’appelle depuis mes seize ans, donc depuis bientôt soixante ans. On ne m’a plus appelée autrement. Vous devez trouver tout cela ridicule et sans grand intérêt.
Je n’avais aucune raison particulière de contrarier cette femme pour un motif aussi futile et guère d’opinion personnelle sur un pareil sujet. Chacun vit sous le prénom qu’il a choisi et personne n’est obligé de conserver son prénom de naissance, sauf évidemment sur ses documents officiels. Je ne m’engageai donc pas trop et j’y allai de ma petite lâcheté bien prudente.
— Pas vraiment. Je trouve votre prénom poétique, frais et coloré. Printanier, pour tout dire. En outre, c’est plutôt original.
Ainsi mise en confiance, la prénommée Capucine se mit à me raconter sa vie, en commençant, évidemment, par ses soucis de santé et je me demandais où elle voulait en venir. Mais, j’avais pris le parti de la laisser parler. Elle avait sous les yeux des cernes mauves et blanchâtres, couleurs de fleurs vénéneuses, qui me rappelaient les pétales de digitale. Des rides du fumeur, profondes et verticales lui fendaient la lèvre supérieure et me faisaient penser au rebord crénelé des plats à tarte. Les doigts de sa main droite étaient jaunes de nicotine. Elle m’expliquait souffrir d’un genou depuis des mois, marcher avec difficulté et être en attente d’une prothèse. Son opération avait été programmée à l’hôpital de la Cavale Blanche à Brest puis repoussée à une date ultérieure en raison de l’épidémie de Coronavirus qui menaçait toujours de submerger les services de réanimation.
Elle devait avoir une hygiène de vie déplorable, tabac et alcool, sa main tremblait sur le bord de la table, et semblait animée d’une vie indépendante qu’elle s’efforçait en vain de maîtriser.
Elle devait avoir l’habitude de raconter ses malheurs aux personnes de rencontre, une disposition sans doute apprise au comptoir des cafés qu’elle fréquentait au quotidien. J’attendais patiemment la suite.
Je la regardais déjà comme un personnage à part, presque comme un personnage de roman. Une rencontre originale. Mais elle avait sûrement une raison précise de venir me voir. Elle finit quand même par en arriver au fait.
— Quelqu’un vient frapper à ma porte d’entrée toutes les nuits…
— Comment ça, toutes les nuits ?
— Oui, toutes les nuits, enfin presque, au moins quatre ou cinq fois par semaine.
— Vers quelle heure ?
— Je ne regarde pas toujours mon réveil, je n’allume même pas ma lampe de chevet, mais c’est toujours à peu près à la même heure, vers 4 ou 5 heures. Plutôt un peu après 4 heures. Je le sais, car il vient toujours avant le livreur du Télégramme qu’il doit vouloir éviter et qui, lui, passe régulièrement à 4 heures et demie, sauf le dimanche où il passe plus tard. Parfois aussi, il secoue la porte et y donne des coups de pied. Il finira un jour par me la démolir. Je m’enfouis sous ma couette, je me bouche les oreilles, je me recroqueville, je serre longtemps les dents et j’attends qu’il se décourage et s’en aille enfin, ce qu’il finit par faire à la longue. Et ainsi tous les jours.
— Un homme ?
— Je pense…
— Vous en êtes sûre ?
— J’ai pensé à un homme.
— Pourquoi un homme ? Comment pouvez-vous en être sûre ? Et pourquoi pas à une femme ?
Capucine haussa les épaules.
— Comme ça. Et je ne peux pas vous dire pourquoi. Sans doute parce que je n’aime plus trop les hommes et que je ne leur fais plus confiance. Je les ai connus et fréquentés de trop près pendant tellement longtemps. Sans doute aussi parce qu’il tape très fort sur ma porte et qu’il me fait peur. Une femme ne frapperait pas ainsi. Pas si fort en tout cas. Je crois même qu’il cogne avec un bâton ou un morceau de bois. Avec ses poings et ses pieds aussi, parfois, et toute la maison résonne de ses coups. J’ai parfois l’impression que ma porte va exploser. Il y a des marques de chaussures sur le bas de ma porte, et des taches de boue et de sable. Surtout de sable. Il doit marcher sur les plages, avant de venir chez moi. Et surtout parce que je vois mal une femme se lever la nuit, toutes les nuits, pour aller déranger les gens dans leur sommeil. Pour moi, pas de doute, c’est sûrement un homme car il n’y a que les hommes capables de courir la nuit pour faire des choses pareilles. Les femmes sont plus intelligentes et ont moins de temps à perdre à de pareilles bêtises. Elles ont davantage le respect de la vie des autres. Car il faut quand même être un peu fêlé pour venir tous les matins perturber le sommeil de quelqu’un. C’est donc, j’en suis persuadée, un truc d’homme, d’un individu pas très clair, un peu dérangé certainement.
— Cet homme vient vraiment tous les jours ?
Capucine parut réfléchir et secouait la tête d’un côté à l’autre.
— Oui presque. Sauf quand il pleut beaucoup ou qu’il y a une tempête, ce qui arrive parfois l’hiver, ici au bord de la mer. Nous avons souvent des coups de vent d’ouest assez violents. Je crois qu’il n’aime ni la pluie ni le vent. Il est très possible aussi que les jours de grosse pluie et de grand vent, je ne l’entende pas frapper. Comme il a quand même pu m’arriver, quoique rarement, de dormir profondément à cette heure-là. Il ne prend jamais de vacances ni de week-end. Il n’a pas tenu compte du confinement ce printemps et est venu quand même. Sans doute ne craignait-il pas les contrôles des gendarmes de Lesneven et de Plouguerneau qui passaient et repassaient dans les rues de la commune à longueur de journée et de nuit.
— Depuis combien de temps vient-il ainsi frapper à votre porte toutes les nuits ?
— Depuis plus de deux ans. Deux ans et demi. Presque trois ans.
— Trois ans ! Ah ! quand même…
— Il a commencé à venir après ma première opération du genou. C’était en novembre 2017 pour la première prothèse, celle du genou droit, car je dois également me faire opérer de l’autre genou, presque trois ans après. Toutes les opérations ont été ajournées à cause de la pandémie de la Covid et je n’ai aucune nouvelle d’un futur rendez-vous possible. J’attends, je prends mon mal en patience, je ronge mon frein depuis des mois et je souffre terriblement. J’ai mal jour et nuit, mais je souffre surtout d’attendre et de n’avoir aucune nouvelle. La secrétaire du chirurgien m’envoie promener quand j’essaie de me renseigner. On peut la comprendre car je l’appelle un peu trop souvent, presque tous les jours. Je suis sortie de l’hôpital le 19 du mois de novembre 2017 et, je m’en souviens bien car je ne dormais pas, j’avais trop mal au genou. J’avais pris un nouveau cachet et je me suis un peu assoupie. Cette nuit-là, il est venu frapper à ma porte pour la première fois. Il était 4 heures du matin. Je ne pouvais pas me lever pour aller voir qui était là. De toute façon, je n’attendais personne à une heure pareille. Et, depuis cette date, il n’a jamais vraiment arrêté. Il importune peut-être d’autres femmes. Il faudrait demander aux gendarmes de Lesneven s’ils ont reçu d’autres plaintes.
— Vous n’avez pas de soupçons, comme une petite idée, même vague et imprécise, de son identité ?
— Aucune, en tout cas pas vraiment. Vous pensez bien que j’ai cherché à savoir qui il pouvait être et je me suis livrée à quantité d’hypothèses et à toutes sortes de vérifications discrètes. Pas toutes discrètes d’ailleurs. J’ai hésité entre différentes personnes, je m’embrouillais, j’ai eu des doutes, presque des certitudes aussi parfois, j’ai même cru trouver à plusieurs reprises, mais finalement non, je ne sais pas qui il est. J’ai échoué dans toutes mes recherches et j’ai même renoncé à chercher. Je finissais par regarder tous les hommes de travers dans les bourgs de Brignogan, de Kerlouan et de Plounéour-Trez et même au-delà. Je soupçonnais plusieurs personnes en même temps, et finalement tout le monde. Je devenais complètement paranoïaque. Je voyais sans cesse des complots autour de moi et je me croyais persécutée. J’aurais sans doute mieux fait d’aller consulter un psychiatre, mais je n’en ai pas eu le courage. Je ne voulais parler de moi à quiconque, pas même à un médecin. C’était devenu infernal. J’étais désagréable avec tout le monde et je ne supportais personne, pas même moi. J’avais continuellement des envies de meurtre ou de suicide. Je n’ai jamais été une sainte, loin de là, et j’ai accepté trop facilement la consolation et la béquille de quelques verres de boissons plus ou moins alcoolisées. Et de plus en plus alcoolisées. Puis de beaucoup de verres, de plus en plus nombreux au fil des jours et des semaines. Chacun fabrique, supporte et gère sa solitude comme il peut. Seule presque toujours à la maison et parfois avec d’autres solitaires dans les cafés du bourg, ou comme ici à l’Hôtel du Port. Presque tous les soirs. Des amis et des connaissances, guère plus vaillants que moi et, pour la plupart, perdus et se débattant dans les mêmes problèmes et les mêmes dérives. Je prends beaucoup de médicaments aussi, surtout des somnifères et des anxiolytiques, en désordre, de manière fantaisiste, et même n’importe comment. Parfois pas du tout. Parfois aussi, je rattrape mon retard et j’avale tout d’un coup. Ce qu’il ne faut jamais faire, je ne le sais que trop bien, mon médecin me l’a tellement répété. Je consomme aussi trop de café pour espérer faire surface le matin et faire un peu illusion, trop de tabac, au moins deux paquets de cigarettes par jour, parfois davantage.
Elle m’interrogeait d’un regard douloureux. Capucine L’Hostis se racontait bien, trop bien sans doute, avec un talent évident de vieille comédienne, et aussi de vieille rouée. Je la laissais dire et faire. Je savais déjà ce qu’elle voulait, mais je ne pouvais pas répondre d’avance à sa question. J’attendais. Ses cheveux en désordre et emmêlés lui tombaient sur le front et avaient la couleur roussâtre de la paille desséchée avec des reflets d’herbes folles grillées par le soleil. Je suis obligé de reconnaître, ce qui me gêne un peu, qu’elle sentait mauvais. L’odeur rance des aisselles oubliées et celle de transpiration des vêtements trop longtemps portés, mêlées à la puanteur du tabac froid m’indisposaient. Je me contentais de la relancer par de courtes et rapides questions, puis je laissais déferler la vague et j’écoutais dévaler le torrent.
— Vous vivez seule ?
— Oui. Je suis veuve depuis bientôt vingt ans. Un vrai bonheur. Mon mari Yvan s’est noyé au cours d’une partie de pêche au large de Kerlouan en septembre 2000. Le 11 septembre précisément. Il m’arrive quand même de faire l’effort de me souvenir de cette date. C’est tout ce que je peux encore faire pour lui. C’était un dimanche et un jour de grande marée. Comme toujours, il était seul sur son bateau, il n’emmenait jamais de passagers, pas même ses meilleurs amis. Il ne voulait pas dévoiler ses coins de pêche, ses repères et ses alignements, ses “bases”, comme on dit ici sur la côte du pays Pagan, et qui sont des secrets mieux gardés que les secrets de famille les mieux enterrés. Il a dû tomber à la mer en relevant ses casiers à homards. On a retrouvé son bateau fracassé dans les rochers devant Ménéham. Vide. On n’a jamais retrouvé son corps et les recherches ont été arrêtées au bout de trois jours. Trois jours pour moi interminables, j’ai compté les heures, je les ai regardées s’égrainer l’une après l’autre, lentes et mortelles, car je ne voulais pas qu’on le retrouve, mort et encore moins vivant. Disparu, il me convenait bien, il me plaisait enfin un peu, je commençais à l’aimer. Disparu pour de bon, disparu à tout jamais. J’aime ce mot, disparu, car conforme à mes espérances les plus secrètes. Je n’en ai jamais fait mystère. Ensuite, j’ai dû rapidement me faire une raison, organiser un deuil de façade et ma vie d’après. Ce ne fut pas trop difficile quand même, je le reconnais, car, je n’avais jamais vraiment aimé mon mari et il ne m’a pas beaucoup manqué. Pas un seul jour, encore moins une seule nuit. Il n’était qu’une longue et fastidieuse habitude, un hasard malheureux qui s’était installé dans ma vie pour une trop longue durée. Une erreur de jeunesse. Comme tant d’autres, je m’étais mariée parce qu’il fallait en passer par-là, pour faire plaisir à mes parents, pour faire comme les cousines, les copines, les voisines et comme tout le monde. Pour paraître normale, en somme. Pour la robe, la fête, les carillons de l’église, les invités et les cadeaux, le repas au Castel Regis, le plateau de fruits de mer et l’omelette norvégienne. Pour le feu d’artifice tiré sur la plage à minuit. Pour le voyage de noces, en Corse évidemment, offert par des amis de mes parents. Pour aussi mettre la main sur un homme, un homme à moi seule, et avoir enfin le droit de l’avoir dans mon lit, de le garder et d’en profiter, car à l’époque on ne faisait pas ce qu’on voulait dans ce domaine. Il fallait d’abord passer devant monsieur le maire et, ensuite, obligatoirement, devant monsieur le curé, donc se marier ou aller brûler en Enfer. L’enfer me poursuivait déjà depuis mes années de jeunesse un peu désordonnées. Il faut dire que je l’avais si souvent nargué. Enfin veuve, j’ai vécu comme je l’entendais, sans jamais tenir compte de l’avis ou de l’opinion des uns ou des autres. Je n’ai écouté que mon désir de liberté et mon bon plaisir. Comme, finalement, j’aurais toujours aimé vivre. Je n’avais plus de comptes à rendre à personne et en aucune façon. Je cessais de faire semblant et redevenais libre après vingt ans de bagne conjugal et j’en ai bien profité. Disons, pour faire court que je me suis bien rattrapée. À Brignogan, les mauvaises langues, qui sont nombreuses, comme partout ailleurs, m’appelaient la veuve joyeuse. Ce qui me mettait doublement en joie. J’étais veuve en effet et terriblement heureuse de l’être. Je ne m’en cachais pas, bien au contraire. J’exultais. Je n’avais plus aucun frein ni aucune limite, je ne me privais de rien ni de personne. Je prenais avec gourmandise tout ce qui venait à moi, j’étais heureuse et gaie, je provoquais et je narguais à longueur de journée les crétins et les jaloux qui me critiquaient et qui pourtant mouraient d’envie de vivre à ma manière. Et, pour beaucoup d’entre eux, de venir partager mon lit. Faveur et privilège, que, malgré tout, je n’accordais pas à tout le monde. Just a happy few.
Un sourire coquin illuminait son visage ridé et lui faisait quantité de plis serrés au coin des yeux, au souvenir des plaisirs et des bonheurs qu’elle s’était donné. J’essayai de lui rendre un sourire naïf et complice, puis, je la ramenai à notre propos.
— Vous n’avez pas, chez vous, un chien pour vous garder ?
Capucine jeta un regard en coin à Horace qui, de sa chaise, ne la quittait pas des yeux et épiait tous ses gestes. Elle réprima l’ébauche d’un nouveau sourire. Je suivais aisément le fil de sa pensée. Elle jaugeait sûrement les capacités de dissuasion de mon propre chien de garde.
— Non, je n’ai pas de chien et je ne veux plus en avoir. C’est trop de tracas et de responsabilités, j’ai déjà assez de mal à m’occuper de moi-même et bien souvent, je n’y arrive plus vraiment. Alors, Je ne veux plus être responsable d’un être vivant quelconque. Pas même d’un serin dans sa cage, d’un chaton, d’une souris blanche, ou d’un cochon d’Inde, pas même d’une petite peluche comme votre propre chien. Je pourrais oublier ses vaccins, le laisser mourir de soif, ou lui donner n’importe quoi à manger et donc l’empoisonner. Ou oublier de le sortir pour ses petits besoins. À force de boire, j’oublie, certains jours, de me faire à manger, et même de manger, alors, vous comprenez, le pauvre chien…
— Je comprends.
— Nous avions un épagneul breton autrefois, car mon mari était chasseur. Oui, pêcheur et chasseur, les deux passe-temps, les deux passions chez le même homme et double peine pour moi, sa femme ! Il n’était presque jamais là, surtout le week-end, toujours par monts et par vaux. Sur la mer durant tout l’été et à travers champs l’hiver. Les restaurants avec ses amis chasseurs, les casse-croûtes champêtres bien arrosés, les soirées agréablement fréquentées par de petites femmes, dont il empestait le parfum en m’embrassant le soir, au retour tardif des boîtes de nuit à la mode. Il dépensait sans compter un argent fou. Je n’avais pas mon mot à dire. C’était son argent, après tout, ou plutôt l’argent de ses parents. Je ne savais même pas où il était, la plupart du temps, encore moins avec qui. Et je ne cherchais plus à le savoir. Je m’en fichais complètement. Mais il fallait pouvoir supporter de rester seule, cloîtrée à la maison tous les dimanches, pendant que monsieur se donnait du bon temps.
— Vous me parliez de votre chien.
— Ce chien est mort de sa belle mort depuis très longtemps. Il avait seize ou dix-sept ans, peut-être même dix-huit. Nous vivions ensemble depuis tant d’années. Il s’appelait Zac. Un drôle de nom, choisi par l’éleveur et que mon mari n’avait pas voulu changer parce qu’il était court, sec, cassant, et qu’il claquait comme un ordre. C’était, d’ailleurs, un chien de chasse qui n’aimait pas du tout aller à la chasse. En réalité, il aimait tout dans sa vie de chien, sauf aller à la chasse. Mon mari l’avait payé une petite fortune dans un élevage renommé du côté de Callac, qu’il appelait la capitale mondiale des épagneuls bretons. Zac n’aimait que sa gamelle et son confort douillet. Il préférait le canapé du salon et son panier au coin de la cheminée à la campagne mouillée, aux labours gras et collants, aux taillis et aux ronciers dans lesquels, d’ailleurs, il refusait obstinément de pénétrer. Au désespoir et à la grande fureur de mon mari. Je ne pouvais pas donner tort à ce brave chien ! Je l’encourageais, le plus discrètement possible, à ne pas renoncer à son confort et je l’aidais à se cacher à l’étage de la maison, sous un lit, ou dans la haie au fond du jardin pendant que mon mari se déguisait en guérillero du dimanche et décrochait un de ses fusils du râtelier sur le manteau de la cheminée. J’ai toujours eu la chasse et les chasseurs en horreur absolue. C’était là, d’ailleurs, un motif constant de conflit avec mon mari. Enfin, un motif parmi bien d’autres, pas le plus grave, rassurez-vous. Je ne comprendrai jamais quel plaisir ces gens-là peuvent trouver à battre la campagne par tous les temps, un fusil sur le bras, à traquer et à essayer de tuer des animaux plus ou moins sauvages.
Je n’avais rien, a priori, contre la chasse ni contre les chasseurs. Ce monde-là m’était tout à fait inconnu et, pour tout dire, plutôt indifférent. Je n’en connaissais rien ou si peu. C’était, pour moi, une occupation de plein air comme une autre. Ni plus ni moins. Comme certains jouent au golf en traînant leur petit chariot sur une pelouse bien rase et bien verte et que d’autres courent après un ballon de football le dimanche après-midi. Ou que d’autres encore font rouler des boules bretonnes sous un préau communal. J’affichais donc, sur le sujet, une certaine neutralité bienveillante et un peu jésuite.
— Mais tous les chasseurs vous diront qu’ils promènent leur chien, qu’ils étudient et admirent sa quête du gibier et surtout qu’ils protègent la nature. Ils prétendent, à tort, ou à raison que, s’ils n’étaient pas là, les sangliers qui se reproduisent bien trop vite et prolifèrent dans nos campagnes bondiraient par-dessus les haies de nos potagers, viendraient se goinfrer sur nos plates-bandes de radis et ravager du groin nos planches de salades et que les renards entreraient effrontément dans nos cuisines, se serviraient dans nos placards et plongeraient leur fin museau dans nos assiettes.
Capucine souriait. Son regard se portait dans le vague, par-dessus mon épaule, très loin derrière moi, sur je ne sais quelle ligne d’horizon, sur quels souvenirs ou rêves qui n’appartenaient qu’à elle seule.