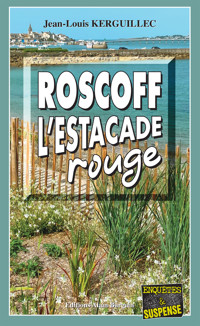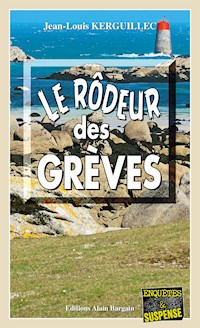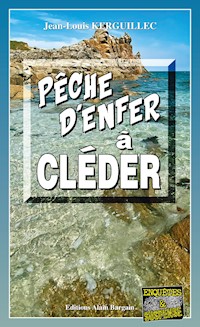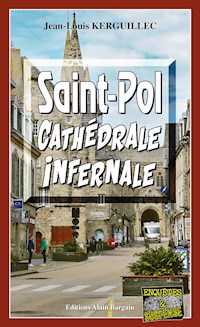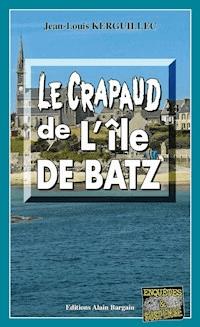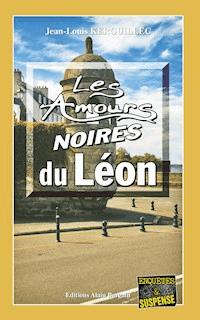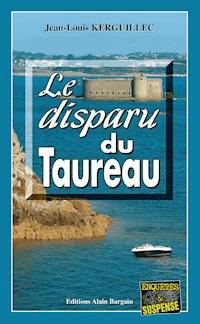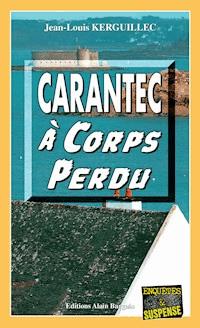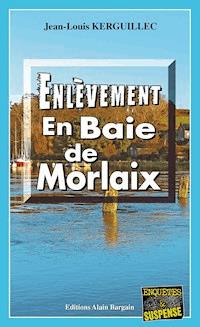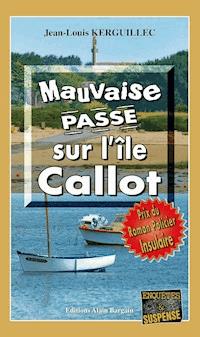Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Les enquêtes du commandant Le Fur
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Les vacances à la mer du commandant Le Fur risquent d'être de courte durée...
Le commandant Guillaume Le Fur passe quelques jours de vacances à Plougastel-Daoulas, parcourant la campagne et les bords de mer pour repérer et choisir les lieux où il situera l’action de son prochain roman policier. À la fête des Fraises, la manifestation annuelle, il est approché par une vieille dame qui lui demande avec insistance d’enquêter sur les circonstances qu’elle juge plus que suspectes, voire criminelles, d’un accident de la route dont a été victime son neveu bien-aimé. Guillaume se laisse évidemment convaincre et entraîner dans une enquête compliquée dans le cercle très restreint des proches et de la famille de la victime. Un étrange imbroglio dont, finalement, il trouvera la solution un peu par hasard.
Plongez-vous dans le 6e tome des enquêtes surprenantes du commandant et écrivain Guillaume Le Fur, confronté à un étrange imbroglio : accident de la route ou meurtre ?
EXTRAIT
Ils étaient deux, ce samedi midi là, dans cette ancienne écurie qui faisait office de vestiaire, de réfectoire et de toilettes, un espace bas de plafond et sombre. Ils finissaient enfin leur semaine de travail. Six jours pleins, du matin au soir, à genoux à même la terre, à cueillir des fraises et des tomates. C’étaient un homme et une femme plutôt âgés, Rodolphe et Georgette. Rodolphe Kervella répondait au sobriquet de Rodolphe Nez Rouge. Comme le neuvième renne du père Noël.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Éditions Bargain, le succès du polar breton. -
Ouest France
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean-Louis Kerguillec, né à Kervaliou dans les dunes de Cléder, au plus près de la côte léonarde dont il connaît le moindre recoin, a exercé une longue carrière de professeur de lettres classiques au lycée Tristan-Corbière à Morlaix. Désormais retraité, il cultive son jardin, pratique la pêche en mer, la course à pied et se passionne pour la peinture et toutes les littératures. Il vit et écrit à Taulé.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
« Et ma vie pour tes yeuxlentement s’empoisonne… »Guillaume Apollinaire – Les Colchiques
« Laisse-moi t’emmenerJe vais aux champs de fraisesRien n’est réelEt il n’y a pas de soucis à se faireChamps de fraises pour toujours »
Les Beatles – Strawberry Fields Forever
« Écrire un roman, c’est prendre quelquesanimaux humains, les mettre ensembleavec toutes leurs passions, observer, attendre,et voir ce qui va en sortir… »
Georges Simenon
PROLOGUE
Plougastel-Daoulas. Samedi 15 avril 2017 – Peu avant minuit
Cette petite route sinueuse et raboteuse, bordée d’arbres bas et de taillis ras, de talus couverts de hautes fougères et de ronciers, dans la campagne de la presqu’île de Plougastel, quelque part entre le bourg et la pointe de l’Armorique, Adrian Kersiroux, au volant de sa voiture, un vieux modèle 205 Peugeot, la connaissait parfaitement et mieux que quiconque probablement. Depuis sa plus tendre enfance, en effet, il l’avait si souvent parcourue, à pied d’abord en cherchant des noisettes et en cueillant des mûres, puis sur sa bicyclette aux côtés de son père, sur son vélo demi-course ensuite, sur son scooter rouge et pétaradant, et enfin en voiture, son permis obtenu, depuis tout juste quelques années. Un trajet dont il connaissait le moindre détail, le moindre cahot, le moindre nid-de-poule, chaque virage, chaque arbre. Il aurait pu y circuler les yeux bandés. La nuit d’avril paraissait douce.
Mais Adrian Kersiroux avait, cette nuit-là, beaucoup de difficultés à conduire, comme s’il roulait dans un brouillard épais ou derrière un pare-brise embué ou même recouvert d’une pellicule de givre. Ou encore avec des lunettes de soleil ou bien des lunettes sales. Comme s’il avait perdu sa route et ne savait pas où il allait. Les paupières lourdes et tombantes, il avait l’impression qu’il lui arrivait quelque chose d’anormal. Plus rien ne répondait à sa volonté, tout lui échappait, il était un autre, tout à fait différent. Il était ailleurs, il ne se reconnaissait pas. Quelqu’un, pensait-il confusément, lui avait sûrement fait une mauvaise farce. Qui et quelle farce ? Une drôle de blague quand même ! Qui avait pu le mettre dans un état pareil ? On a dû me faire boire ou manger quelque chose de bizarre. On m’a peut-être empoisonné, se disait-il. Qui m’a fait ce coup-là ? se répétait-il en s’efforçant de conserver à sa voiture une trajectoire normale. Sa tête tournait, son regard se brouillait. Il se sentait envahi d’impressions confuses, de sensations nouvelles et incompréhensibles, d’images vagues et étranges. Il vit sa tante Solange sortir le poulet du four de sa cuisine, en prenant mille précautions, reculant, fesses en arrière, un coin de torchon à chaque main pour ne pas se brûler. Il vit son oncle Fernand crier sur ses employés, pousser Georgette vers le tas de paille, puis dans une sorte d’arc de lumière majestueux, un arc-en-ciel, Katell, sa nouvelle amie, lui apparut, sortant nue de sa douche, longue, hiératique et provocante, avec ses jambes interminables, ses petits seins ronds haut perchés, ceux des madones des tableaux de la Renaissance italienne comme ceux de Botticelli, La Naissance de Vénus. Et, plus bas, le minuscule triangle roux qui le fascinait tant depuis des semaines. Sa tête tournait et lui faisait mal, de plus en plus violemment. Ce n’était plus supportable.
Adrian maintenant s’affolait, tout se troublait devant ses yeux. Il ne reconnaissait pas la route, il n’était jamais passé par là, il ne savait plus où il était. Il était perdu, complètement désemparé. Il se disait qu’il ferait mieux d’arrêter et de ranger la voiture au bord de la route, de prendre un peu de repos, mais en même temps, il continuait à rouler, sans trop savoir pourquoi. Il n’était plus maître de ses décisions. Il ne contrôlait plus rien, sa tête bourdonnait, il avait un goût de cendre dans la bouche. C’était une succession d’images rapides, floues et fugaces, un tourbillon, une tourmente d’images. Une sorte de résumé accéléré des choses et des situations de sa vie. Ensuite se fit un vide brutal, un trou noir, une absence, puis plus rien. Rien. Rien du tout. Les ténèbres absolues. La voiture mordit sur l’herbe grasse du bas-côté, chassa de l’arrière, fit une embardée, franchit le fossé d’un bond, passa comme par miracle entre deux gros châtaigniers, troua dans sa descente un bouquet de noisetiers, dégringola dans la douve, cassa net un jeune peuplier sur son passage, piqua du capot avant sur l’herbe de la prairie, une dizaine de mètres en contrebas, rebondit, se renversa, puis s’immobilisa sur le toit, tout au bord du ruisseau, les roues tournant encore, éclatées et boueuses, puis s’arrêtant lentement l’une après l’autre. Le silence se fit, le vide total. Pas âme qui vive, pas même un aboiement de chien. L’accident ne pouvait avoir de témoin. Il n’y avait personne sur cette petite route de la campagne de Plougastel à cette heure de la nuit, entre deux villages isolés, inconnus, perdus et noyés dans l’obscurité. Le gazole du réservoir glissa sous la voiture, rampa lentement parmi les hautes herbes, et s’insinua dans le ruisseau.
Le lendemain matin, des traces sur l’herbe, des ornières profondes et boueuses sur l’accotement, qui passaient entre deux vieux arbres et qui plongeaient dans le ravin attirèrent l’attention d’un cyclotouriste du dimanche et plutôt matinal qui était descendu de sa machine pour satisfaire une envie pressante. Se penchant et poussant la tête en avant, il vit, entre les arbres, une voiture, les roues en l’air, parmi les joncs, en contrebas dans la prairie. Lui parvenait en même temps une forte odeur de gazole. Fébrilement, il fouilla dans son coupe-vent jaune fluo, chercha son téléphone, et se souvint alors qu’il l’avait encore oublié à la maison, puis, à grands signes et moulinets des bras, arrêta des voitures de passage, sans doute des gens du voisinage qui se rendaient en famille à la première messe du dimanche. Un gamin, s’accrochant aux touffes d’herbe, dévala dans la prairie en se laissant glisser sur les fesses, parvint à la voiture, s’accroupit et regarda à l’intérieur. Il cria qu’il voyait quelqu’un qui ne bougeait pas, qui dormait ou qui devait être mort. On s’affola, on s’agita en tous sens, on manipula fébrilement des téléphones et l’on parvint enfin à appeler les pompiers et la gendarmerie de Plougastel.
Adrian Kersiroux était resté prisonnier de sa voiture durant toute la nuit. On le sortit difficilement en découpant les tôles une à une et les pompiers le conduisirent inanimé et en état d’hypothermie à l’hôpital de la Cavale Blanche à Brest. Le diagnostic médical tomba rapidement. Il avait la colonne vertébrale brisée au niveau d’une vertèbre lombaire et la moelle épinière cisaillée. Les médecins le plongèrent aussitôt en état de coma artificiel. Adrian ne marcherait plus jamais, il était désormais paraplégique…
Et moi qui écris, qui, évidemment, organise tout et par avance, qui connaît déjà tout du personnage et de son destin, je sais ce qu’Adrian Kersiroux ne pouvait nullement savoir, que s’il s’en sortait et demeurait en vie, la plupart de ses projets étaient définitivement ruinés, avortés ou mort-nés, qu’il allait passer le reste de son temps coincé dans un fauteuil roulant, inséparable de lui, et, pour l’essentiel des choses de la vie, dépendre de la bonne volonté des autres et devoir supporter à longueur d’existence leur sollicitude empressée et, à son approche, leur regard apitoyé, fuyant et oblique.
I
Samedi 15 avril 2017 – 12 heures précises
La ferme de Fernand Kersiroux, sur les hauteurs de Keralliou était une lourde et longue bâtisse en pierres apparentes jointoyées de ciment gris, avec une avancée à la mode des fermes du Nord-Finistère, et de petites fenêtres protégées par des barreaux. Elle était couverte de grosses ardoises des monts d’Arrée. Tout autour, en désordre, des bâtiments anciens, d’époques différentes, dépareillés et en mauvais état et un vaste hangar couvert de tôles rouillées. De hautes herbes partout, des machines à l’abandon, des allées broussailleuses. L’ensemble donnait une impression sinon d’abandon du moins de défaut d’entretien régulier. Une demi-douzaine de tunnels recouverts de plastique descendaient en rangs parallèles vers la mer. On y cultivait quantité de variétés de fraises et de tomates. Comme dans la plupart des exploitations agricoles de Plougastel.
Ils étaient deux, ce samedi midi là, dans cette ancienne écurie qui faisait office de vestiaire, de réfectoire et de toilettes, un espace bas de plafond et sombre. Ils finissaient enfin leur semaine de travail. Six jours pleins, du matin au soir, à genoux à même la terre, à cueillir des fraises et des tomates. C’étaient un homme et une femme plutôt âgés, Rodolphe et Georgette. Rodolphe Kervella répondait au sobriquet de Rodolphe Nez Rouge. Comme le neuvième renne du père Noël. Celui qui n’est pas attelé au traîneau, qui fait office de phare et éclaire la route. Ce nez, il l’avait bien rouge en effet, large, étalé, grêlé, creusé de cratères et constellé de petites bosses rougeâtres. Comme un paysage lunaire, une grosse truffe rouge. Il portait un collier de barbe blanche, une barbiche en tresse arrêtée par un élastique rouge, une chevelure enchevêtrée et sale avec des reflets jaunâtres qui lui couvrait les oreilles et descendait sur sa nuque burinée. Il s’apparentait à une sorte de père Noël décati, chaloupant, perclus d’arthrose et pas très assuré sur ses jambes. Il partit, on ne sait pourquoi, d’un rire gras qui découvrit toutes ses dents, avec des espaces vides et des chicots ébréchés, la plupart de travers, jaunis et goudronnés par une existence vouée au tabac brun et au vin de très médiocre qualité. Georgette, sa collègue de travail, devait être bien plus jeune, mais faisait nettement plus que son âge. Alourdie et pataude, elle traînait les pieds dans de lourdes chaussures de randonnée, déformées et avachies. Un pantalon de coton gris godaillait sur ses genoux. Courbée en avant, elle jetait des regards apeurés de tous côtés et paraissait douloureuse et diminuée. Elle avait le visage étroit et gris, le menton pointu et de petits yeux noirs enfoncés dans leur orbite. Elle gardait l’allure soumise d’une malheureuse, d’une perpétuelle victime. Comme toujours abandonnée et désemparée. Chacun de ses gestes semblait compliqué et maladroit. On avait envie de lui prendre la main et de l’aider. Georgette changeait de pantalon dans un coin en s’efforçant de se cacher derrière un tas de cagettes, puis rangeait ses affaires avec des gestes mal assurés et inquiets. Elle plia son vêtement, une sorte de bas de survêtement de gros coton gris, déformé et terreux, et le tassa au fond de son sac en poussant fort le bras. Puis elle se posta sur le seuil de la porte, et semblait attendre, inquiète, et, bras ballants, regardant la petite route empierrée qui remontait jusqu’à la ferme et au-delà, bien plus loin vers le nord, le trafic routier à l’entrée du pont de l’Iroise.
— Adrian est allé livrer les fraises et les tomates cerise à la coopérative Kuzh-Heol à Kerhuon. Le voilà qui revient, je vois le fourgon qui tourne là-haut au rond-point. Il a fait vite pour livrer la cueillette de ce matin.
Quand, quelques secondes plus tard, un grand fourgon blanc apparut à l’entrée de la cour et dévala le chemin gravillonné dans un fracas de mitraille, un étrange sourire s’épanouit doucement, puis illumina le visage gris et douloureux de la vieille demoiselle. Rodolphe racla gras sa gorge, cracha par terre, écrasa du pied le glaviot dans la poussière et répliqua en haussant les épaules.
— Tu le sais bien, Georgette, Adrian ne reste jamais traîner, comme s’il avait sans arrêt le feu quelque part, il ne fait jamais la moindre pause, je ne suis même pas sûr qu’il trouve le temps d’aller au lit, il court tout le temps, toujours à fond les marmitons, surtout le samedi matin. Il doit absolument être prêt à midi pile. Pas une seconde de plus, pas une de moins. Toujours pressé. Tata m’attend ! Comme s’il allait rater le dernier train…
— Tous les samedis, toute l’année, invariablement, sa tante l’attend pour déjeuner. Il n’a pas le droit d’être en retard. Pas une seule minute. Elle lui ferait une scène abominable.
— Tante Solange de Keralliou ! Tata tarte à la fraise chantilly ! Tata Solange, c’est sûr, ne rigole pas, attention les yeux ! La vieille pharmacienne a du caractère, et même très mauvais caractère. Il vaut mieux ne pas s’y frotter. C’est leur traditionnel poulet-frites du samedi midi. Un véritable rituel. Impossible de rater ça ! C’est pire que la grand-messe du dimanche matin à l’église Saint-Pierre de Plougastel. Il faut absolument être là à l’heure. C’est sacré, immuable, arrêté pour toujours, éternel, et à ne manquer sous aucun prétexte. Et ensuite, son repas à peine avalé, salut Tata, c’était super bon, merci beaucoup, merci pour tout et à samedi prochain… Adrian ira, à toute vitesse, rejoindre sa blonde qui l’attend à Brest. Je crois qu’elle ne travaille pas le samedi après-midi. Ni même le matin, mais je ne suis plus très sûr, ça dépend des semaines et des lubies de son patron. Ils doivent se taper une sacrée sieste cochonne ! Il n’a pas beaucoup de temps à perdre. Il court, il court en tous sens. C’est Adrien le Lapin1, comme le surnomment ses copains de Plougastel. Ses copains des clubs de football et d’escalade. Et il en a beaucoup. Trop parfois. Adrian n’a que des amis et depuis toujours. C’est surprenant et tout à fait magique. Il a toujours une cour autour de lui, garçons et filles. Il en est couvert. C’est chaud, rapide et organisé un lapin ! Tac, tac, vite fait. Une autre m’espère déjà ailleurs, elle m’attend, j’arrive et je suis partout. Tout juste un peu en retard… Sa devise pourrait être, je sème à tout vent, une vraie fleur de pissenlit à la fin du printemps. Je me demande comment il tient le coup, surtout à ce rythme. C’est de son âge, c’est sûr, mais quelle santé !
Et Rodolphe riait tout seul du portrait qu’il dressait de son camarade de travail et jeune ami. Avec une petite nuance d’envie. Il en était certainement jaloux. Georgette baissait la tête, renfrognée et hostile. De toute évidence, certains sujets ne lui plaisaient guère. Elle marmotta quelque chose d’indistinct, une sorte de protestation inaudible. Elle eut alors un sourire triste qui lui froissa le visage et lui donna l’allure désemparée de celle que personne n’avait jamais attendue et que personne ne regarderait ni n’accueillerait jamais. Elle avait aussi un regard fixe, où passa tout à coup un éclair farouche. Rodolphe ne le vit pas et pour cause, le dos tourné et tête baissée, il se servait un verre de vin. Il pouvait se le permettre en toute tranquillité. Son patron, Fernand Kersiroux, ce matin-là, n’était pas dans les parages.
Adrian bondit de son siège, claqua la portière d’un revers du bras et, sans se retourner, poussa la porte du hangar et traversa la cour en courant, agitant et faisant tourner au bout des doigts les clés du fourgon. De fines gouttelettes de transpiration perlaient sur son front, sur sa lèvre supérieure, et, sur les tempes, descendaient de ses cheveux longs et blonds, décolorés par le sel et l’air marin. Il avait de grandes auréoles sous les bras et sa chemisette mouillée collait à son dos. C’était un grand jeune homme blond, nerveux et musclé, bronzé et d’une activité débordante. Il passait l’essentiel de son temps sur la mer. C’était un tourbillon, un raz-de-marée. Il entra dans l’écurie en coup de vent.
Il prit une bouteille d’eau dans son placard, en arracha le bouchon avec les dents, et but, au goulot, une très longue rasade, insista, rejetant la tête en arrière, jusqu’à ce que le plastique de la bouteille se mette à craquer et à se déformer dans sa main. L’eau qui dévalait dans sa gorge était tiède, avait un goût bizarre qui, sur le coup, lui parut étrange, un goût de terre brûlée, ou de poussière chaude. Un goût âcre qui lui était inconnu. Un léger goût d’encre plutôt. Comme celui de ses doigts à l’école quand il était enfant et que son stylo à encre fuyait et maculait son index. Sans doute à cause du plastique et de la chaleur, de ce temps orageux sûrement, se dit-il. Mais Adrian avait tellement soif, faisait tout tellement vite, était tellement pressé qu’il n’y prêta pas davantage attention. Rodolphe avait, chaque samedi, avant son départ, l’habitude de le taquiner. Et pas toujours avec finesse. Dans ces moments-là, Georgette détournait les yeux, regardait ailleurs, baissait la tête et faisait mine de s’absorber de nouveau dans le rangement de ses petites affaires.
— Ne reviens pas trop crevé lundi matin, garde, malgré tout, un peu de forces pour attaquer la semaine prochaine. Ne les laisse pas toutes entre les bras de ta blonde, et quand je dis les bras, évidemment…
Adrian souriait, haussait les épaules et ne répondait pas, il n’avait que trop l’habitude des plaisanteries et des provocations de Rodolphe. Rarement de très bon goût d’ailleurs, presque toujours sous le niveau de la ceinture et plutôt lourdingues à la longue. Mais il avait beaucoup de tendresse et de reconnaissance pour son vieux collègue de travail.
— Pas de souci, Rodolphe ! Ne t’inquiète pas trop pour moi, je suis un grand garçon, je suis encore capable de gérer mes efforts. Je n’ai pas besoin d’ange gardien.
— Avec le soleil que la météo nous promet pour les jours à venir, la Gariguette va donner à plein, on va cueillir les premières Ciflorette et les Délice2 ne vont pas tarder à se pointer. On va avoir un sacré boulot et nous n’aurons pas beaucoup de temps à perdre. De plus, on nous promet de grosses chaleurs pour la semaine prochaine. Avec cette température, tout arrive en avance cette année. Alors, tâche d’être en forme. Encore une fois, fais attention à toi, ne te laisse pas dévorer tout cru et tout entier par ta belle blonde. C’est un crocodile femelle, celle-là, une triple rangée de dents, une vraie sangsue, une mante religieuse. Trouve le temps de dormir un peu et ne reste pas trop longtemps coincé dans l’étau. Bon week-end quand même et à huit heures lundi ! Tâche surtout d’arriver à l’heure, ton oncle Fernand, tu l’as bien compris, est d’humeur massacrante ces derniers temps et ne supporte plus rien. C’est pire que d’habitude, tout le met hors de lui. Une de ses putes attitrées a dû lui faire des misères. Ou alors il est à la recherche d’une nouvelle, et il ne trouve pas ce qu’il voudrait sur le marché. De toute façon, c’est un sauvage, un chien enragé. Il faudrait pouvoir l’étouffer entre deux matelas ou le faire piquer par un vétérinaire. De toute façon, tous les lundis, il arrive bien après toi de sa virée du week-end à Brest. S’il pouvait ne plus revenir…
Adrian Kersiroux leva les deux bras simultanément, les jetant derrière ses épaules, en un grand geste d’indifférence et d’insouciance heureuse, repoussa du pied et claqua sans même la regarder la porte de son placard, jeta son sac sur son épaule et partit en courant vers sa vieille Peugeot rouge et lépreuse, dont la couleur s’en allait par plaques. Un garçon sportif et une nature heureuse, l’image même de la jeunesse et du bonheur. Rodolphe, fixant ses affaires sur le porte-bagages de son scooter, se racla la gorge, gloussa et, à l’adresse de Georgette, y alla de son petit commentaire, d’une voix de rogomme, grasseyante et éraillée.
— Depuis qu’il fréquente sa blonde brestoise, Adrian a, comme nos fraises Gariguette, le pédoncule toujours dressé.
Et il ajouta, partant d’un rire gras qui dégénéra en une toux rauque, inextinguible, presque à l’étouffer qui le cassa en deux et le plia vers le sol. On eût dit qu’il allait décrocher ses poumons. Il parvint néanmoins à éructer.
— Et sa copine blonde, la collerette toujours relevée.
Il était ainsi, Rodolphe, ce samedi midi là, à la fin de sa semaine de travail, un poète, un chantre, un troubadour des champs de fraises… Il paraissait tellement content de lui, sifflotait et fredonnait d’une voix rauque et grasse, une célèbre chanson des Beatles, une chanson des années de sa jeunesse certainement, les années soixante du siècle dernier, Strawberry Fields Forever : champs de fraises pour toujours. Peut-être par dérision, lui qui avait passé sa vie à genoux dans ces mêmes champs, et par tous les temps. Georgette se détourna vivement, soupirant fort et haussant les épaules. Une grimace plissa et déforma son visage prématurément ridé. La vieille demoiselle refusait d’entendre pareilles choses. Elle s’en protégeait à longueur de journée et à longueur d’année, seule femme parmi ces hommes toujours énervés par la chaleur qui ruisselait sous le plastique brûlant des tunnels. Toujours des propos à double entente, intolérables pour elle, et parfois des esquisses de gestes qu’elle ne tolérait pas. Rodolphe continuait à rire tout seul, satisfait de sa dernière saillie et amusé de la gêne de sa collègue de travail. Il ne pouvait pas savoir qu’elle retenait les larmes qui lui montaient aux yeux et qu’elle serrait fort son mouchoir tout au fond de la poche de son tablier. À s’enfoncer les ongles dans les paumes et s’en blanchir certainement les phalanges de ses doigts crevassés et abîmés par le continuel travail de la terre.
Rodolphe aimait pourtant bien Georgette, que leur patron Fernand Kersiroux brimait et exploitait depuis tant d’années, soumettait aux mêmes mauvais traitements et aux mêmes humiliations que lui. Et davantage encore, puisque face à telle brute épaisse, elle avait la malchance supplémentaire d’être femme. Une femme vulnérable et sans défense aucune, incapable de se plaindre à quiconque et dont il usait et abusait à sa guise depuis des années. Brutalement, fréquemment, parfois plusieurs fois par jour, et sans la moindre nuance de respect ou d’intérêt, mais tous faisaient mine de l’ignorer. D’aucuns s’en amusaient et considéraient, sans toutefois le dire ouvertement, qu’il exerçait ainsi comme une sorte de droit naturel. Un certain droit des seigneurs d’antan. En somme, une situation tout à fait normale et ordinaire, pour la plupart des gens. Sauf pour Adrian que cette situation révoltait. Il aurait bien voulu aider sa collègue de travail. En vain, car Georgette ne se défendait pas, n’avait sans doute jamais songé à se défendre, ne protestait pas, n’avait jamais élevé la voix, ne se rebellait pas et paraissait tout à fait résignée à son triste sort. Depuis longtemps, depuis le premier jour, depuis la toute première fois sans doute. Et probablement jusqu’à sa retraite qu’elle n’osait même pas envisager. Elle ne voulait surtout pas perdre son travail, car elle savait pertinemment qu’elle aurait beaucoup de mal à en trouver un nouveau. Et même qu’elle n’en trouverait pas. Jamais. Elle ne savait rien faire d’autre que travailler aux champs. Question d’âge aussi évidemment. Tout juste bonne pour la réforme, à l’instar des vieilles bêtes qui ont trop donné et dont personne ne veut plus. Quant au reste donc, les assauts incessants de Fernand Kersiroux par exemple, elle faisait avec, comme on dit couramment, parce qu’elle ne pouvait pas faire autrement. C’était une corvée supplémentaire, une de plus, gratuite, pas mise au compte des heures supplémentaires, rien de plus, rien de moins. Juste une chose à faire et à supporter parmi tant d’autres, toutes différentes et toutes plus ou moins agréables, dans la continuité des jours, des saisons et des années… Comme dédoubler les plants de fraises, supprimer les stolons, dresser nettoyer une pile de cagettes, encore une, déplacer le conteneur à ordures et le rouler au bord de la route ou alors gratter les mauvaises herbes et les mousses dans les allées. Les travaux et les jours. Georgette ne se reposait jamais, ne posait jamais de questions superflues, donc inutiles, elle n’en avait pas le temps, encore moins les moyens. Comment résister à l’emprise et à la violence d’un personnage comme Fernand Kersiroux, son patron depuis tant d’années ? Depuis ses douze ans, personne ne l’avait protégée, ni même ménagée. Orpheline pauvre, elle n’avait pas longtemps fréquenté l’école, petite boniche, elle avait été bringuebalée de place en place, de ferme en ferme, au gré des travaux et au hasard des différents patrons. Elle acceptait donc son sort, résignée à tout et pour toujours. Et le pire était encore possible, et comment faire autrement ? Elle subissait tout depuis sa plus tendre enfance. Dans sa pauvre tête mal remplie, le monde était ainsi fait, impossible de le changer, elle n’avait nullement les moyens de réfléchir à une situation différente, bonne ou mauvaise. Surtout pas meilleure, elle ne pouvait pas l’envisager.
1 Adrien le Lapin : personnage de livres illustrés pour enfants d’Antoon Krings.
2 Gariguette, Ciflorette, Délice : différentes variétés, parmi quantité d’autres, de fraises cultivées à Plougastel.
II
Plougastel. Port de Keralliou.
Samedi 15 avril 2017 – 12 heures 30
Comme tous les samedis midi, donc, Adrian Kersiroux avait déjeuné à Keralliou, tout près de la mer, chez sa tante Solange Kersiroux, l’ancienne pharmacienne. Il aimait bien sa tante qui l’avait élevé, mais ne se sentait pas à l’aise dans sa maison. Il s’y sentait en permanence oppressé. Une lourde villa néobretonne sombre, remplie de meubles bretons anciens, vaisselier garni d’assiettes en faïence de Quimper, lit clos du pays bigouden transformé en bibliothèque, armoire Louis XIII, sombre et trapue. Il apportait à sa tante son linge à laver, ses chemises à repasser et lui confiait de menus travaux de couture. Un bouton arraché, une fermeture éclair coincée ou déraillée, un ourlet de pantalon en détresse. En descendant de voiture dans la cour de sa tante, et en posant le pied au sol, il avait failli tomber en avant. Ses jambes se dérobaient sous lui, ne le tenaient plus, comme s’il avait couru plusieurs kilomètres. Comme quand il revenait de ses longues séances de course à pied. Presque comme après un semi-marathon. Ou après un match de football, l’hiver, sur un terrain lourd et boueux. Il avait des vertiges, mal à la tête et au ventre.
Avec sa tante, ils abordèrent leurs sujets de conversation habituels. Les menus événements et les rumeurs de la commune de Plougastel, les travaux de la semaine à la ferme, le cours des fraises et des tomates, le travail à faire dans les serres. Très vite, ils parlèrent de Fernand, son oncle, à qui Adrian s’opposait violemment à longueur de temps.
— Tu as parlé à Fernand de la visite du promoteur immobilier et de ton désir de vendre tes deux terrains de Keralliou qui l’intéressent ? Comment s’appelle-t-il donc ce bandit en costume anthracite et chemise blanche qui vient te relancer régulièrement, parfois plusieurs fois par semaine ?
Adrian s’énervait, agitait les bras et haussait les épaules.
— Je ne sais plus, je n’ai pas retenu son nom, je m’en fiche d’ailleurs, c’est sans importance, je ne connais que le nom de l’agence, Recouvrance Immobilier, et surtout le prénom de la secrétaire, Corinne, que j’ai eue au téléphone à différentes reprises, et qui ne doit pas être vilaine du tout, si je me fie au timbre de sa jolie voix, une petite musique agréablement flûtée qui me donne envie de la rencontrer. Elle a le ramage très agréable, mais je préférerais lui caresser le plumage et mieux encore, le pelage.
La vieille Solange secouait la tête, prenait une mine faussement scandalisée, levait les bras au ciel, feignait de s’inquiéter du tempérament bouillant de son neveu, mais en réalité, en était secrètement flattée et s’en amusait. Elle en était même fière. Un vrai mâle dans la famille… Avec lui, la descendance serait assurée et le nom de Kersiroux ne se perdrait pas, car il ne fallait pas compter sur son abruti de frère. Elle faisait juste semblant de s’alarmer des propos de son neveu, simplement pour la forme, par jeu, avec une absolue mauvaise foi. De son côté, le jeune homme aimait provoquer la vieille célibataire. Une sorte de petite comédie qu’ils se jouaient tous les samedis. À huis clos absolu…
— Tu es incorrigible, Adrian ! Tu ne penses décidément qu’à ça !
— À quoi d’autre veux-tu que je pense, Tantine ? Je vais à l’essentiel. C’est quand même le meilleur morceau de la vie. Tu vois quelque chose de plus agréable et de plus important ? Moi pas, pas du tout. Cette agence immobilière se trouve tout en bas de la rue de Siam, à droite, juste avant le pont de Recouvrance.
— Je connais, je vois bien où elle est située. Une devanture bleue et deux grandes vitrines remplies de photos en couleur. D’un côté les maisons et les appartements à vendre, de l’autre les biens à louer. Et que dit ton cher oncle de ton intention de vendre une partie de tes terrains ?
— Je lui en ai touché deux mots, juste en passant, histoire de le mettre au courant, mais je n’aurais sans doute pas dû, car il s’est mis à s’énerver aussitôt et à brailler pire qu’un âne. Il dit que si quelqu’un de cette agence, ou d’une autre, venait à se retrouver dans la cour de la ferme, il prendrait son fusil de chasse. Avec des balles pour sanglier, et personne ne court plus vite qu’une balle pour sanglier, a-t-il ajouté en ricanant et en roulant les épaules.
— Je le crois, il en est tout à fait capable, il est capable de tout, surtout du pire. Rien ne peut l’arrêter. Il est fou, je crois. Ou c’est tout comme…
— C’est sûr. J’ai cru qu’il allait me tuer sur place, m’écraser et m’enfoncer en terre. Un vrai sauvage, un véritable forcené ! Il m’en veut à mort. Fernand ne me lâche pas sur la question de mes terrains ! Il a toujours la même rengaine, son éternelle et intarissable litanie. À l’entendre, je suis la honte de la famille, je vais brader le patrimoine familial à des bourgeois de la ville de Brest, des médecins ou des avocats pourris et bouffis d’argent, je me moque du travail et des sacrifices des anciens qui ont sué sang et eau pour acquérir et défricher ces terres et ensuite les conserver et les transmettre à leurs enfants. Depuis des générations… Je serais, d’après lui, le premier et le seul de la famille à me permettre une chose pareille. À l’entendre, je n’ai aucune morale, absolument rien dans la tête, je ne suis pas un Kersiroux, en tout cas pas un vrai. Pour lui, je suis nul sur toute la ligne.
— Je sais tout cela. Il est venu à plusieurs reprises me radoter la même chose et me demander de te faire la leçon et, si possible, de t’amener à changer d’avis. Je ne l’ai pas écouté et, un jour, je l’ai mis à la porte de chez moi. J’en avais plus qu’assez de toutes ses magouilles. Depuis, il m’adresse tout juste la parole. À peine bonjour, bonsoir. Bon débarras. Je ne perds pas grand-chose.
— Il proclame dans tous les bistrots de Plougastel et d’ailleurs que je ne suis qu’un petit étudiant qui rêve de la ville et de ses mirages, un minable, une nullité… Une graine de petit fonctionnaire, sans doute de petit prof ou de petit moniteur de sport merdique qui ne pensera qu’à ses petits avantages, et qui, évidemment, sera toujours fauché, toujours en vacances, quand, du moins, il ne sera pas en grève. Le refrain habituel. Toujours les mêmes clichés. Je suis pour mon oncle Fernand un renégat, celui qui renie et trahit les siens, tourne le dos aux valeurs de ses parents et à ses origines.
— Il est bien placé pour parler des valeurs de la famille, Fernand, lui qui n’a jamais eu le moindre respect pour ses parents et leur a fait tous les mauvais coups possibles, lui qui insultait père et mère à longueur de temps et les menaçait ! Ils avaient peur de lui. Je peux même dire qu’il les a fait mourir de chagrin.
— N’empêche que pour mon oncle, je suis en quelque sorte un dégénéré. Un bâtard, un tocard. Un bon à rien. C’est ce qu’il dit partout où il passe. Ce sont d’ailleurs les mots qu’il emploie, et d’autres pires encore. Il dit que mes nouvelles fréquentations le montrent bien, et que tout le monde s’en rend compte. Je crée le scandale, je suis la honte de la famille. Il ne supporte pas la présence de mon amie Katell, il n’a pas de mots assez méchants pour en parler. Une poule de luxe, dit-il, une pétasse que j’ai pêchée on ne sait où, beaucoup trop bien pour moi, parfumée et pomponnée, un vrai pot de peinture, une bêcheuse de la ville qui ne daigne pas dire bonjour aux paysans, ou de si loin, qui les regarde à peine, et qui se pince le nez quand elle vient me chercher dans la cour de la ferme en retroussant ses jupes pour franchir les flaques d’eau et en prenant garde de salir ses belles chaussures à talons pointus. Une créature d’un monde autre que le nôtre. Une petite poufiasse blonde, une paillasse pour bourgeois fortunés. Ce sont ses mots. Il n’a que des termes dégueulasses pour en parler, jamais une parole propre. Chez lui, c’est d’ailleurs valable pour tout le monde et surtout pour les femmes.
— Il a toujours été ainsi, y compris avec les femmes de la famille, moi, ses cousines et même sa mère.
— Un jour, il y a environ trois semaines, il a chassé Katell de la cour de la ferme, où elle était venue m’attendre, presque à coups de caillou, comme un chien galeux, et lui a interdit de revenir. Si tu savais comme il lui a parlé ! Elle doit désormais m’attendre plus haut, au bout du chemin, vers la route de Brest, sur le parking. Certains jours parfois, quand il sait qu’elle m’attend, il ruse, il triche, il me trouve un travail à finir, tout juste avant de partir, une dernière corvée, un outil à ranger ou à aller chercher, pour m’obliger à partir en retard, invente des prétextes tordus pour me garder quelques minutes encore, sans doute pour la faire patienter, m’attendre le plus longtemps possible et sûrement la faire enrager. Il m’a tout l’air d’en tirer un plaisir intense. Il prend son pied comme il peut, cet abruti. Il croit sans doute que je ne me rends pas compte de son jeu imbécile.
— Et ça doit bien l’amuser, cet idiot.