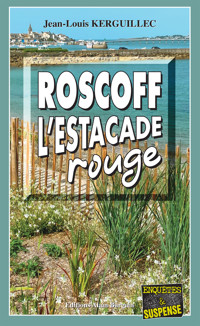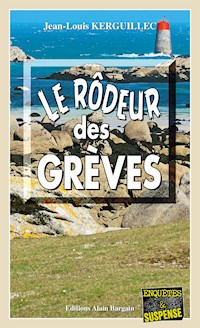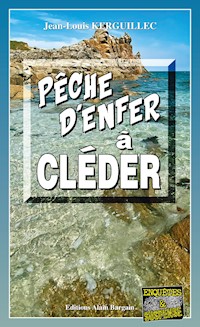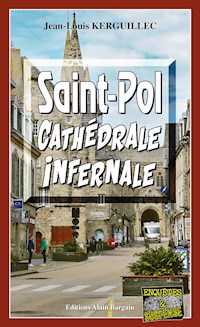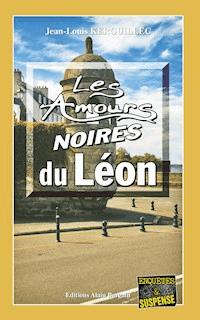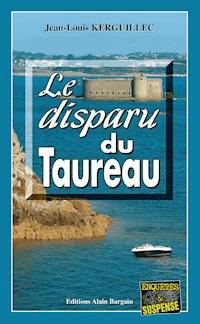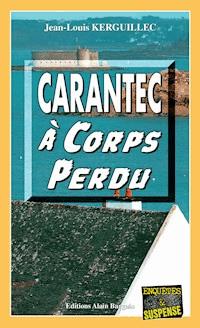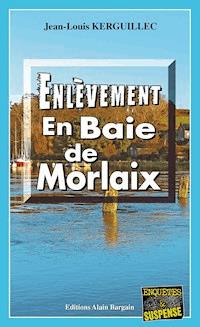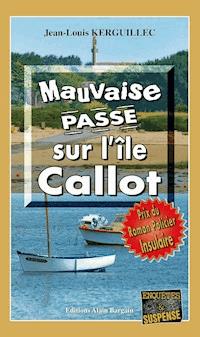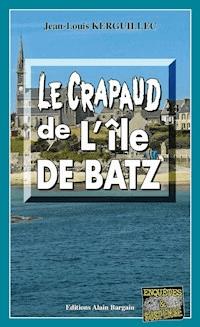
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Les enquêtes du commandant Le Fur
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Un dangereux criminel s'en prend à des joggeuses sur les chemins de randonnée et en des endroits isolés : il a déjà fait trois victimes...
Avec deux nouveaux équipiers et la jeune lieutenante, Joana Mélion, qui déborde de talent et d’énergie, le commandant de police Guillaume Le Fur doit, une fois encore, faire face à une enquête particulièrement difficile et complexe. Démasquer et mettre hors d’état de nuire un dangereux criminel qui s’attaque à des joggeuses sur les chemins de randonnée et en des endroits isolés. Déjà trois crimes à son actif. Un pervers insaisissable qui signe ses forfaits de manière étonnante et barbare. À l’île de Batz d’abord,
puis en différents points de la côte léonarde, une longue traque sans merci et une enquête fertile en rebondissements.
Retrouvez le commandant de police Guillaume Le Fur dans le 7e tome de ses enquêtes, avec une longue traque sans merci, passant par l'île de Batz et différents points de la côte léonarde. Parviendra-t-il à mettre hors d'état de nuire ce pervers insaisissable et barbare ?
EXTRAIT
— Ce sont des crimes qui choquent l’opinion. On l’a bien vu tout récemment avec ce fait divers dont nous avons déjà parlé.
Notre affaire de l’île de Batz faisait néanmoins grand bruit dans les journaux et à la télévision et on la rapprochait d’une affaire similaire qui avait tenu l’opinion en haleine durant plusieurs semaines au début de l’été. Une coïncidence fortuite et malheureuse pour nous.
— Une joggeuse avait été enlevée, puis son corps retrouvé brûlé dans une forêt de l’est de la France. L’enquête, après quelques semaines de recherches, a finalement révélé que le mari était le coupable. Au cours d’une dispute dans la chambre conjugale, il avait étranglé sa femme qui, l’injuriait, l’humiliait, l’accusait d’être à peu près nul au lit.
Le capitaine Didier prit le risque d’une remarque à sa manière.
— On peut quand même le comprendre… À force d’être humilié par sa femme, il a pété un plomb, il est passé à l’acte et lui a tordu le cou. Sa femme est quand même un peu responsable de ce qui lui est arrivé. C’est trop facile de balancer des saloperies à son mari. Elle l’a bien cherché. Peut-être n’a-t-elle eu que ce qu’elle méritait.
Personne ne réagit pas et Joana resta impassible. Ce qui devait beaucoup lui coûter. Elle devait bouillir intérieurement et serrer les dents. Mais elle continua comme si elle n’avait rien entendu.
— Il l’avait revêtue de sa tenue de jogging, puis transportée dans le coffre de sa voiture et brûlée en forêt. Puis il avait alerté ses proches et la police sur la disparition de sa femme et joué devant les micros et les caméras, la comédie du mari inconsolable et éperdu de douleur. Jusqu’à la nausée. Et avec un certain succès. Tout le monde l’a cru et l’a pris en pitié pendant trois mois. Jusqu’à la révélation de la vérité. Il avait participé à une marche blanche comme la nôtre en hommage à sa femme. Il marchait au premier rang soutenu par sa belle-famille et répondait en pleurnichant aux questions des journalistes.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean-Louis Kerguillec, né à Kervaliou dans les dunes de Cléder, au plus près de la côte léonarde dont il connaît le moindre recoin, a exercé une longue carrière de professeur de lettres classiques au lycée Tristan Corbière à Morlaix. Il fait partie du collectif
d’auteurs, “L’assassin habite dans le 29”, organisateur de salons du livre policier et signe ici son septième roman aux Éditions Alain Bargain. Il vit actuellement et écrit à Taulé.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Adresse e-mail de l’auteur : [email protected]
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
À toute l’équipe des éditions Alain Bargain. Alain, Carl, Caroline, Frédéric, Haude, Morgane.
À tous mes amis du collectif d’auteurs “L’assassin habite dans le 29” organisateur de salons du livre policier.
À Raoul Kerguiduff par qui m’est venue l’idée toute première de ce roman.
« Un chant dans une nuit sans air…
La lune plaque en métal clair
Les découpures du vert sombre…
… Un chant ; comme un écho, tout vif
Enterré, là, sous le massif…
– Ça se tait : Viens, c’est là, dans l’ombre…
– Un crapaud ! – Pourquoi cette peur,
Près de moi, ton soldat fidèle !
Vois-le, poète tondu, sans aile,
Rossignol de la boue… – Horreur ! –
… Il chante. – Horreur !! – Horreur pourquoi ?
Vois-tu pas son œil de lumière…
Non : il s’en va, froid sous sa pierre.
…………………………………
Bonsoir – ce crapaud-là c’est moi.
(Ce soir, 20 juillet) »
Le Crapaud – Les Amours Jaunes – Tristan Corbière
« La réalité dépasse la fiction,
car la fiction doit contenir la vraisemblance,
mais non pas de la réalité. »
Mark Twain
PROLOGUE
Roscoff. Quai d’Auxerre – Lundi 26 juin 2017
Été comme hiver, en toute saison, depuis ma toute première enfance, et sans jamais varier, je me suis levé de très bonne heure. Je n’ai jamais eu besoin de réveille-matin ni de sonnerie ou d’appel d’aucune sorte. Mes origines paysannes probablement. Dès que les tout premiers rais de lumière des matins d’été s’infiltrent à travers mes persiennes, se projettent sur le mur face à mon lit ou dansent dans les rainures du lambris de mon plafond, je guette le chant du premier merle quelque part dans la haie de lauriers palme de mon jardin. Ce chant d’une pureté extraordinaire brise le silence qui accompagne le lever du jour. Le musicien égrène une infinie variété de notes chaudes douces et flûtées que tous les merles du voisinage reprennent à leur tour avec d’interminables variations. Il doit être 5 heures. Nul besoin de vérifier. C’est pour moi le signal. Je saute au bas de mon lit.
Ainsi, ce lundi matin-là, comme tous les matins, je parcourais Roscoff en compagnie de mon petit chien. J’ai toujours rêvé d’être peintre pour fixer sur une toile de pareils moments. J’aurais aimé savoir dessiner, mais je n’ai jamais su tenir un crayon. Encore moins un pinceau. Il ne me restait que les mots et leurs images. Et comment en effet rendre pareil spectacle autrement qu’avec les mots de la peinture. Le ciel au-delà de l’îlot de Ty Saozon était une aquarelle aux dégradés de jaune safran, de bleus différents, marine, indigo et turquoise, et toute une palette de gris délavés et mêlés, sans oublier les dégradés de rose. Une boule rouge surgissait sous l’horizon comme si un feu qui couvait s’était progressivement réveillé, ranimé par la brise du matin. J’avais si souvent observé et tenté vainement, au gré des saisons, de mettre des mots sur ce miracle quotidien. Il était 7 heures. Je revenais d’une longue promenade qui m’avait conduit vers l’Aber et le camping de Santec, par la grève au ras de l’eau, sautant par-dessus les ruisseaux, barbotant dans les flaques laissées par la marée et imprimant nos empreintes dans le sable mouillé. Horace, yorkshire terrier, mon petit compagnon, courait en tous sens, relevait, déposait, et semblait méditer ses petits messages.
Je me préparais ensuite à rejoindre mon bureau au commissariat de Morlaix. Mes dernières années de commandant de police judiciaire. Encore probablement quatre ou cinq années d’enquêtes et de paperasses et je pourrai enfin me consacrer librement à ma passion de plus en plus dévorante, l’écriture. Je dirigeais depuis une dizaine d’années une équipe bien rodée avec laquelle j’avais connu des succès éclatants, reconnus et salués, mais aussi, je suis bien obligé de l’admettre, quelques échecs cuisants. Il y avait eu bien des changements dans cette équipe, des départs et des arrivées et j’avais quantité de choses à réorganiser. La période était plutôt morne, des affaires banales et répétitives et des tonnes de paperasses. La rédaction de rapports enterrés d’avance et noyés dans la masse des précédents. Nous n’avions pas grand-chose de passionnant à nous mettre sous la dent ou la souris de l’ordinateur. Une sorte de routine quotidienne. Sans compter que l’atmosphère au commissariat était devenue tout à fait exécrable. Nous étions bousculés et perturbés par les travaux de rénovation des locaux du commissariat que nous réclamions depuis des années. Nous étions cernés par des échafaudages et continuellement assourdis par des coups de marteau. Quant à notre patronne, la commissaire Évelyne Lemétayer, de plus en plus revêche et punaise, aigrie et mécontente de sa vie personnelle, elle nous empoisonnait systématiquement l’existence par son humeur détestable et ses récriminations continuelles. Tous les personnels, sans la moindre exception dans le commissariat, souhaitaient qu’elle disparaisse. Qu’elle aille au diable, le plus vite et le plus loin possible ! Mais elle ne semblait pas disposée à partir. Et il nous fallait la supporter, encore et toujours. Alors, comme elle, et bien obligés, nous attendions et nous espérions je ne sais quel message d’en haut.
Le port de Roscoff était au plein de la grande marée. Les bateaux dominaient le quai de leurs structures colorées. La barge “François André” était à quai. Les tracteurs déchargeaient des remorques de légumes. Des palettes de parpaings et de madriers à destination des entreprises de bâtiment travaillant sur l’île de Batz, attendaient sur le parking, ainsi que des marchandises diverses pour le ravitaillement des commerçants de l’île. Un camion blanc et vert attendait son tour pour embarquer auprès d’une demi-douzaine de fourgons. Il était rempli d’une quantité de croix de cimetière, serrées les unes contre les autres. Ce cimetière itinérant, rangé sur le plateau d’un camion avait quelque chose de saugrenu et de surréaliste. Robert, les cheveux dressés et en bataille, le visage souriant et jovial, fumait sa cigarette, appuyé à la portière, suivant distraitement les manœuvres et le ballet des tracteurs. Il attendait son tour, qu’on lui fasse signe de faire monter son camion sur la barge. Je le connaissais depuis longtemps, il avait même effectué quelques travaux de consolidation sur la tombe de mes parents quelques années auparavant. Je le saluai et engageai la conversation. J’avais tout mon temps. Il m’expliqua qu’il allait installer un cimetière sur la dune au nord de l’île de Batz. Un cimetière de cinéma. Un cimetière pour de faux, comme disent les enfants. C’était en réalité un élément essentiel du décor d’un film qu’on allait tourner les jours suivants à l’île de Batz et dont le titre devait être Le cimetière dans la dune.
— Je crois que c’est une histoire de crime. C’est en tout cas ce que j’ai cru comprendre. Une histoire de petite fille qu’on va déterrer dans un vieux cimetière abandonné au bord de la mer, une enquête sur une affaire de meurtre déjà ancienne, qui ressurgit après une recherche d’ADN, comme on en fait aujourd’hui. On peut trouver des criminels et résoudre des affaires des années après. Dans le film, on reprend donc une enquête. Le cimetière en question, regarde, il est là dans mon camion. Je leur livre toutes les croix. Les décorateurs vont le compléter et l’aménager sur la dune. Il y a aussi une femme que l’on va retrouver assassinée. Et une policière qui découvre que d’une certaine manière, et malgré elle, elle est personnellement mêlée à l’histoire de ce crime. Quelque chose comme ça… En vrac. C’est assez embrouillé… Il y a une quantité de rebondissements. Je ne sais plus comment et dans quel ordre. Je n’en sais pas plus… Je m’en fiche d’ailleurs. Donc, pour résumer, des morts, des enterrés, des déterrés, et une enquête de police. Ils me raconteront l’histoire et me donneront des détails quand je serai sur place.
— Elle n’est pas vraiment gaie ton histoire. Il y a mieux et plus joyeux pour entamer une belle journée de soleil comme celle-ci. Encore un film policier. Comme si nous n’avions pas assez de crimes dans la réalité, il faut encore que les cinéastes et les romanciers passent leur temps à en imaginer de nouveaux et sans doute pires encore que les vrais… C’est étonnant cette mode et même assez incompréhensible. Surtout que nos concitoyens, qui ne sont pas à une contradiction près, passent le reste de leur temps à dire tout le mal possible de la police, de leur police, puis, dès le lendemain, manifestent et défilent en braillant qu’il n’y a pas assez de policiers et que les malheureux citoyens ne sont pas suffisamment protégés contre les malfaisants. Allez comprendre. C’est une certaine France.
— Le film doit passer à la télévision l’année prochaine. Au printemps, mais je ne sais plus sur quelle chaîne. La deux, je crois, mais je ne suis pas sûr. Les acteurs sont bien connus. C’est, du moins ce qu’on m’a dit. Il y a même une actrice autrefois célèbre, mais qui n’est plus de première jeunesse. Et, paraît-il, moche et ridée. Un vieux pruneau. Exigeante et capricieuse qui plus est ! Une vraie chèvre. J’ai déjà avalé son nom, mais ça me reviendra. C’est l’âge, j’oublie tout… Une cinquantaine de personnes en tout travaillent sur ce film.
— Ah, quand même…
— Ils vont tourner à la maison du corsaire sur la côte ouest, au moulin Rehaussa et dans l’ancien abri du canot de sauvetage. On peut dire qu’ils ont choisi les plus beaux endroits de l’île. C’est toute une sacrée organisation. Ils auront un traiteur à leur disposition pendant toute la semaine. Un camion rempli à bloc de nourriture et de boissons va faire la navette depuis Nantes avec toute une brigade de serveurs, de serveuses et de cuisiniers, et un vaste et imposant barnum, les frigos, le mobilier, tables et chaises, la vaisselle et toute la batterie de cuisine. Ils m’ont d’avance invité à manger. Je vais y aller, j’aurais bien tort de refuser. Ce n’est pas tous les jours fête dans mon métier. On m’invite bien plus souvent à partager des goûters d’enterrement dès que j’ai descendu les cercueils et refermé les caveaux.
Robert paraissait heureux et tout émoustillé par sa journée de vacances inespérées. Je hochai la tête et fis une moue d’approbation.
— Certainement, ça te change d’un enterrement presque tous les jours. Tu as bien raison d’aller profiter de l’air du large.
— Ils vont rester une semaine, peut-être bien plus, si la météo s’en mêle. Or, on prévoit de la pluie pour les jours qui viennent. Ils ont même annoncé un bon coup de vent. Leur programme a toutes les chances d’être perturbé. Et donc le mien également. Je ne sais pas s’ils pourront tourner car ils arrêtent tout dès qu’il se met à pleuvoir. Je ferai ce qu’ils me diront, après tout, c’est eux qui payent et ils payent plutôt bien. Moi, je ne verrai pas beaucoup les acteurs. J’ai surtout affaire aux décorateurs. Mais pas très longtemps car ils passent d’un chantier de décoration à un autre, ne prennent ni la peine ni le temps de démonter et de débarrasser leur décor Ils laissent tout en plan. Ils payent sans discuter pour qu’on débarrasse tout, ils n’ont pas de temps à perdre. Dès le lendemain, ils sont déjà passés à autre chose, ils sont ailleurs, ils construisent d’autres décors, parfois d’autres mondes.
— C’est passionnant.
— J’ai déjà, il y a trois ans, installé mon cimetière tout au sommet Mont Saint-Michel de Brasparts dans les Monts d’Arrée, tout autour de la petite chapelle. Un joli cimetière typique de campagne. C’était aussi pour un film, encore une histoire de crime, de sorcières, de fantômes et de revenants dans les landes et les tourbières sur les bords du lac de Brennilis. Les gens qui s’en approchaient et le visitaient croyaient que ce cimetière était là depuis toujours. Ils prenaient quantité de photos et se faisaient photographier assis ou même allongés sur les tombes. Certains même allaient jusqu’à gratter les monuments de leurs ongles pour vérifier s’ils étaient vrais ou faux.
— Finalement, tu emmènes ton cimetière prendre le bon air marin sur l’île de Batz.
— C’est un peu ça, Guillaume ! Les décorateurs du film construisent des tombes avec du bois, du contreplaqué et du polystyrène expansé, tout juste des coffres qu’ils renversent et fixent sur le sable et l’herbe de la dune. Ou de simples bastaings peints de couleur sombre, coupés à la bonne taille et à la même épaisseur, qui imitent à la perfection l’ardoise des lames des tombes d’autrefois. Ils les peignent, leur donnent une allure ancienne, celle du vieux granit de différents grains et de différentes couleurs, ou celles du marbre poli ou de l’ardoise. Des tombes de toutes les époques et de tous styles. Avec des lichens jaunes ou gris, des mousses et de petits végétaux, ils créent un cimetière plus vrai que nature. Il faut vraiment être tout près et toucher pour se rendre compte qu’il s’agit d’un simple décor. On croit que c’est vrai, et que c’est là depuis toujours. Ce sont de véritables magiciens, ils sont capables de créer n’importe quelle illusion. Aussitôt le tournage terminé, je vais devoir tout débarrasser et rendre à l’endroit son aspect d’origine. Le jour même et sans attendre, car il y a le semi-marathon de l’île le dimanche suivant. C’est une course pédestre annuelle qui a toujours lieu le premier dimanche du mois de juillet. Le parcours fait tout le tour de l’île et le cimetière ne doit pas gêner le passage des coureurs et des spectateurs car il coupe le chemin de randonnée sur la dune. Tout doit donc être enlevé, aplani, nettoyé, rendu à l’aspect naturel, au sable, à l’herbe et aux petites fleurs des dunes. Sous peine de pénalités de retard. C’est écrit noir sur blanc dans le contrat. Je récupérerai quelques planches, pour des copains qui en ont besoin pour bricoler et je balancerai tout le reste dans la déchetterie de Taulé en rentrant chez moi. Puis je rangerai mon petit cimetière bien au sec et au chaud, sous mon hangar, jusqu’à la prochaine fois. Peut-être pour un autre film. Je l’espère en tout cas. Quelque part, ailleurs, je ne sais où et je ne sais quand… J’attendrai les propositions. Je ne me fais pas trop de souci.
— Cela doit te changer de tes chantiers habituels. C’est en quelque sorte des vacances pour toi. Tu en as de la chance.
— C’est vrai, ça me fait des vacances. J’adore venir à l’île de Batz. À un quart d’heure du continent, j’ai l’impression d’être complètement dépaysé. Comme si j’étais parti au bout du monde dans quelque île paradisiaque. Je respire l’air marin, je prends le bateau, je me promène au bord de la mer, j’aime tout. J’attends tranquillement que les choses se passent. Cela me change des cimetières de ville où je travaille à longueur d’année. Je vais regarder travailler les gens du cinéma pendant quelques jours. Ils m’inviteront sûrement à leur table. Avec ces gens-là, habituellement on mange bien, on boit sec, on rit et c’est plutôt agréable. Chez eux, c’est toujours un peu la fête. Ils ne sont là que pour quelques jours. Ensuite, ils sont ailleurs et on ne les revoit jamais. Il faudra quand même que je fasse attention à ne pas tomber sur les flics en rentrant à la maison. Oh pardon ! Je…
— Pas d’inquiétude, Robert. Moi aussi il m’arrive parfois de faire attention aux flics, comme tu dis, en rentrant chez moi à Roscoff après une soirée chez des amis…
— Je creuse, j’enterre et je déterre, depuis mes quatorze ans. Je fabrique, j’installe, j’ouvre et je referme des caveaux. Les nouveaux et les anciens. Mes clients, je leur change de boîte, je leur rétrécis leur logement. Je les range et les installe au calme et au chaud pour l’éternité. En somme je passe mon temps à jouer aux osselets.
Je comprenais son humour macabre, une réaction de défense assez naturelle face à un métier ingrat et difficile. Il parlait familièrement de la mort. Comme une évidence. La mort apprivoisée, paisible et naturelle. Banale aussi, une simple formalité de l’existence, un passage obligé familier et ordinaire. Comme une collègue de boulot en quelque sorte. Un travail comme un autre. Il conclut ainsi, levant le bras d’un geste d’insouciance. On lui faisait signe que son tour était venu de faire monter son camion sur la barge et on le pressait de faire au plus vite.
— C’est comme toi avec tes criminels et tes délinquants de toutes sortes, moi, c’est la mort qui est mon métier. Bon, on m’appelle. Je dois y aller. Salut Guillaume. À bientôt.
Cette formule, quoique banale en elle-même, m’avait fortement impressionné ce matin-là. Un choc venu de loin, comme une résonance profonde et lointaine.
C’était, en effet, à une lettre près, le titre d’un livre que j’avais lu tellement d’années auparavant. La mort est mon métier. J’étais encore lycéen, en classe de seconde, je crois. Ou de première. Je ne sais plus exactement. Peu importe. Je n’ai pas oublié le nom de l’auteur. Robert Merle. Justement comme l’oiseau que j’écoute tous les matins siffler dans la haie de mon jardin.
Mais rien à voir. C’était une histoire sinistre de camp de concentration, le fonctionnement du camp d’extermination d’Auschwitz, je crois. Je me souviens de passages particulièrement insupportables, comme cette description d’un bûcher où l’on brûlait des cadavres, et la façon dont on rangeait les corps entre des couches de fagots, en millefeuille, et toute la méthode mise en œuvre pour recueillir la graisse qui dégouttait des corps calcinés afin d’en faire du savon pour la toilette de la femme et des filles chéries du directeur du camp.
Je conservais encore, et tant d’années après, une quarantaine d’années au moins, le souvenir d’une lecture pour moi insoutenable. J’étais jeune alors, sensible et impressionnable. J’avais dû le rester d’une certaine manière pour retrouver, vive et intacte, une pareille émotion.
Je n’avais évidemment pas trop envie de penser à la mort par une aussi belle matinée de printemps tiède et face à ce premier soleil qui allumait des éclats dorés sur les vieux murs de la petite cité minérale. Mais elle était passée par là, la dame à la faux et à la face camarde, elle s’était invitée et insinuée dans cette belle matinée pourtant riche de toutes les promesses. La magie du soleil levant avait disparu, comme si les couleurs du ciel s’étaient brusquement ternies. La mort, comme une ombre rampante, s’était insinuée dans cette matinée. Brusquement je me suis senti étrangement mal à l’aise. Ce n’était plus l’entame normale d’une belle journée d’été.
J’allais devoir me ressouvenir longtemps de ce matin-là, de cette conversation avec Robert sur le vieux port de Roscoff. Et davantage encore, de ce cimetière itinérant et un peu étrange, montant sur un bateau, traversant la mer…
Je saluai Robert d’un geste de la main. J’avais confusément l’impression qu’il ne s’agissait pas d’un lundi matin tout à fait comme les autres. Je ne savais pas encore que cette conversation familière sur le port de Roscoff allait être en relation directe avec l’enquête sans doute la plus difficile et la plus terrible de ma carrière qui s’acheminait, bon gré mal gré, vers son achèvement. C’est pourtant ainsi que, ce matin-là, tout avait commencé. Il me semblait maintenant que le ciel avait des nuances de différents gris. La magie des couleurs me semblait avoir disparu.
Ma baguette de pain s’amollissait, pliait sous mon bras, et Horace s’impatientait au bout de sa laisse rouge. Il me fallait bouger. Je rentrai chez moi en longeant le vieux port, puis le quai d’Auxerre, regardant la mer et les bateaux et sans trop me presser. Aucun enthousiasme de ma part ce lundi-là, contrairement à mes habitudes. J’étais en proie à je ne sais quel étrange pressentiment. Je n’avais aucune envie de prendre ce lundi matin-là, la route pour Morlaix, je ne sais encore trop pourquoi. L’installation de ce cimetière dans les dunes de l’île de Batz, étrangement, ne me disait rien qui vaille et me semblait une ombre menaçante, comme un ver dans un fruit. Aujourd’hui, écrivant ces lignes, à peine quelques mois plus tard, je m’explique beaucoup mieux mon angoissante prémonition.
I
Vers 22 heures – Samedi 1er juillet 2017
L’île de Batz au soir d’une belle journée d’été. La lumière déclinait vers l’ouest, derrière le phare. Une douce chaleur émanait encore des murs de vieilles pierres chauffées à blanc toute la journée. La marée était haute et les vagues battaient doucement la plage de Pors Kernoc. Quelques voiles s’attardaient encore dans le chenal et glissaient lentement vers l’entrée de la baie de Morlaix poussées par une petite brise d’ouest. Les derniers passagers avaient depuis longtemps embarqué pour Roscoff. Les loueurs de vélos avaient rangé leurs machines bien en lignes sur le quai. Les badauds marchaient le long des quais, mangeaient une glace en regardant la mer ou promenaient leur chien. Les terrasses des restaurants et des cafés étaient prises d’assaut. L’air sentait le goémon qui séchait sur les laisses, la barbe à papa et les crèmes solaires. L’été battait son plein, immobile et brûlant.
Une jeune joggeuse, Cécile Demeurant, venue courir le marathon annuel de l’île, avait loué un gîte rural pour le week-end avec deux amies intimes, Florence Kerfissiec et Claire Lefrançois. L’une, éducatrice spécialisée dans un établissement pour handicapés mentaux, l’autre vendeuse dans une parfumerie dans la galerie marchande d’un grand magasin de Morlaix. Le gîte était une petite maison basse abritée des vents dominants dans un repli de terrain et cernée par des champs cultivés, au village de Mechou Bras. Cécile, passionnée de course à pied, devait, le lendemain, participer au semi-marathon de l’île, pour la quatrième année consécutive et avait l’ambition d’améliorer sa performance des années précédentes. Ses deux amies qui n’étaient pas particulièrement sportives se contenteraient de participer à la course des dix kilomètres. Elles n’avaient pas d’autre ambition que de finir la course et de s’amuser. Toutes trois se retrouvaient en fin de semaine pour aller au cinéma et pour courir le dimanche quand une compétition était programmée. Les deux amies de Cécile, qui n’étaient pas vraiment motivées et avaient à peine l’entraînement suffisant pour une pareille distance, voulaient juste finir la course sans se soucier du chronomètre et surtout passer un bon séjour dans l’île. Cécile voulait aller courir ce soir-là, éliminer le stress qui l’envahissait la veille de chaque compétition, aller trottiner un peu au bord de la mer et au grand air au lieu de tourner en rond dans leur location. La veille des courses, elle ne tenait pas en place. Ce n’était pas le soir pour sortir, aller au café prendre un verre avec ses amies et faire un peu la fête. Elle l’aurait payé le lendemain en faisant le tour de l’île en courant…
À l’angle des rues du bourg et aux passages étroits et difficiles, des bottes de paille et des barrières métalliques attendaient qu’on les installe le long de la route. Le balisage de la course était déjà en place. Les tables étaient prêtes aux postes de ravitaillement et aux différentes buvettes qui jalonnaient le parcours, avec leurs monticules de packs de bouteilles d’eau en plastique entassés les uns sur les autres.
C’était une heure trop tardive pour aller courir. Ses amies l’avaient d’abord moquée, puis disputée, mise en garde, et avaient finalement essayé de l’en dissuader. Mais elle ne s’était pas laissé fléchir. Plusieurs personnes disséminées dans différents endroits de l’île affirmeront l’avoir vue ce soir-là, et leurs témoignages nous permettront de reconstituer approximativement l’itinéraire qu’elle avait emprunté. Des consommateurs à la terrasse du “Bar du Port” profitaient des derniers rayons du soleil. Juste en face, de l’autre côté de la rue, assis à califourchon sur le mur qui domine la plage, trois couples qui prenaient l’apéritif, tandis que leurs enfants jouaient sur le sable en contrebas, déclareront aux enquêteurs avoir vu passer ce soir-là une jeune femme en débardeur rose, qui courait. Ils avaient même interrompu leur conversation pour l’accompagner des yeux. Elle portait une tenue vestimentaire légère et colorée et avait l’allure d’une belle femme sportive et attirante. Ils s’étaient livrés à des commentaires flatteurs sur son passage. « Une belle femme, aux longs cheveux bruns qui flottaient sur ses épaules, portant un short noir et rouge et un débardeur fuchsia, élancée, souple et à la foulée longue et aérienne. » Un peu plus loin, une femme âgée qui remontait la rue au niveau du pignon de l’école décoré d’une fresque naïve et allait prendre en face un escalier inégal entre deux murs de pierre la vit prendre, à droite, la rue de Créac’h Bian qui monte vers la butte du sémaphore. La joggeuse lui avait fait, au passage, un petit signe de la main auquel la vieille dame, surprise et gênée, n’avait pas eu le temps ni la présence d’esprit de répondre. « Une grande femme, jeune, jolie, avec un vêtement couleur fraise écrasée et de longues jambes bronzées. Elle paraissait bien gentille, bien aimable quand même pour dire bonjour en passant à une vieille dame comme moi. Elle a tourné à droite et est montée vers le sémaphore. C’est quand même malheureux ce qui lui est arrivé ! » ajoutera-t-elle, quand nous irions recueillir son témoignage quelques jours plus tard. Bien trop tard évidemment.
Dans la montée de la rue de Créac’h Bras, sous le sémaphore, Cécile se fit dépasser par un scooter bleu attelé à une carriole, conduit par une femme qui venait chercher une bouteille de gaz pour finir de cuire sa soupe du soir. Cette femme se souviendra d’avoir croisé la joggeuse et en donnera aussi une description assez précise. Cécile passa devant la supérette Sept à Sept où l’épicière se souviendra aussi de l’avoir vue passer. Elle finissait son ménage et ses rangements, rentrait ses présentoirs de légumes, sortait la caisse en bois pour le livreur de journaux du lendemain et sa poubelle de l’autre côté de la rue. Juste avant de tourner la manivelle de son rideau métallique Elle échangeait quelques mots avec Paolic Kerfriden, un vieux client qui sortait de l’épicerie, venu en urgence, tout juste avant la fermeture, chercher une plaquette de beurre qu’il avait oublié d’acheter en faisant ses courses, le matin même… « Un joli brin de fille, une belle foulée, on aurait dit une gazelle », dira-t-il quand on l’interrogera quelques jours plus tard, mais son témoignage demeurera plutôt vague. L’épicière dira que, sur le coup, elle s’était fait la réflexion que « ce n’était pas une heure pour aller courir le long des petits chemins de l’île. Qu’est-ce qu’elle allait faire, cette belle fille, sur les dunes à la tombée de la nuit ? Elle était bien imprudente, et il ne fallait pas s’étonner s’il arrivait malheur à certaines filles… » Elle précisera plus tard aux enquêteurs s’être quelque peu étonnée qu’une jeune femme en tenue de sport légère, s’aventure seule à la tombée de la nuit sur ces chemins déserts du bord de mer. Un agriculteur, un peu plus loin, dans la descente qui mène au village de Goalès, reculait son tracteur dans son hangar et sa remorque remplie de cageots de pommes de terre qu’il livrerait le lendemain à la cale de l’île aux Moutons. Il avait rappelé, à grands cris, son chien, Dicky, un vieux caniche jadis noir, désormais tout gris et pelé, qui gaspillait ses dernières forces à courir après la joggeuse sur une centaine de mètres, le ventre traînant au sol, aboyant d’une voix rauque et mourante, et s’efforçant de lui accrocher un mollet. Près de la mare, un peu plus loin, Cécile dérangea une troupe de canards qui prenaient le dernier soleil sur la berge, au bord de la route, et qui retournèrent pesamment à l’eau, protestant et claquant des ailes. Une vieille femme qui fermait son poulailler pour la nuit et évaluait son tas de bois, de crainte des voleurs, avait vu passer la joggeuse en rose puis, le long d’un chemin de terre qui descendait vers la mer, un homme qui marchait lentement habillé d’un manteau noir. Une silhouette qui lui était inconnue. Elle dira plus tard, bien trop tard, elle aussi, quand nous irions l’interroger en refaisant le trajet parcouru par la joggeuse ce soir-là et en interrogeant patiemment les riverains, un à un. « Il n’était pas d’ici. Je ne l’avais jamais vu, j’en suis certaine. Il avait dû prendre un petit chemin, un raccourci pour couper à travers champs. Je me suis, bien sûr, demandé ce qu’il allait faire par-là, à une heure pareille et habillé d’un vêtement d’hiver. Un long manteau noir, trop épais et trop long pour la saison. Pourtant il faisait chaud et lourd ce soir-là, l’orage menaçait et grondait déjà sur la mer. Avec une dégaine pareille, c’était sûrement un touriste. Ce n’était pas quelqu’un d’ici, je ne l’avais jamais vu. Dans l’île, personne ne s’habille comme ça en plein été. J’ai d’abord pensé à un curé en balade. Quelqu’un venu du continent, sans doute arrivé là pour la course à pied du lendemain dimanche. Ce n’était pas un îlien, ça, j’en suis certaine, car je l’aurais certainement reconnu. Je connais tout le monde sur l’île de Batz. Mais malgré tout, cet homme en noir, que je n’avais jamais vu auparavant, avait l’air de bien connaître les petits chemins de l’île et de savoir où il allait. Comme s’il était chez lui. C’est bizarre. Tout de même, quand j’y repense aujourd’hui, il m’avait tout l’air d’un drôle de paroissien. »
Arrivée au sommet de la dune, le long d’un enclos pour chevaux, Cécile Demeurant reçut au visage le souffle de la brise marine et la fraîcheur du soir. Elle longea une haie de troènes qui bourdonnait encore d’insectes malgré l’heure tardive. Elle pensa à une haie de lilas en fleurs. Les lilas, couleur des vieilles dames et parfum des vieilles garde-robes. Elle pensa à sa grand-mère, aux lilas mauves dans son jardin, à l’odeur de lavande de son oreiller et à l’odeur des crêpes dans sa cuisine, dont elle se régalait quand elle s’arrêtait pour lui rendre visite en revenant de l’école communale. Un parfum de nostalgie et des souvenirs mélancoliques l’accompagnèrent quelque temps au long de la dune. La mer roulait sur le sable et se cognait aux rochers. Un homme, dont elle ne voyait que le dos marchait devant elle. Il portait un long vêtement noir, le genre kabig breton, trop long, avec une capuche qui lui recouvrait la tête. Ce qui étonna Cécile, compte tenu de la température du soir. Quelle raison pouvait-il avoir de se couvrir, de se protéger et à la limite de se cacher ainsi ? Il avait une démarche lourde, hésitante, avançait voûté, les yeux au sol, comme tassé sur lui-même, et dodelinant de la tête. Il semblait absorbé et perdu dans ses pensées roulant des épaules et des hanches, avançant les jambes l’une après l’autre, de manière saccadée, comme un gros batracien pesamment en chemin vers sa mare originelle. Un vieux, pensa Cécile. « Que fait-il là à cette heure-ci ? » Cécile le compara aussi, mentalement, à un gros insecte noir, un bousier par exemple, un scarabée ou un pince-oreilles, à une bête rampante comme une salamandre ou même à un crapaud. Tous des animaux noirs et terreux. Elle détestait ces animaux, elle avait pour eux une véritable répulsion sans doute irraisonnée et qui remontait à son enfance. Une répulsion que lui avait transmise sa grand-mère. Le jardin de mamie Marie-Catherine, débordant de fleurs. Elle pensa aussi à un vieux curé qui marchait ainsi en lisant son bréviaire et qu’elle croisait parfois dans un square où, dans son quartier de Brest, elle allait courir à la nuit tombante. Au passage, en le dépassant sur l’étroit sentier, Cécile lui lança un bonsoir rauque et essoufflé. Elle n’obtint pas de réponse mais peut-être un vague grognement. Elle n’en était même pas sûre. Elle était déjà à distance. Elle évita de se retourner, pourtant elle en brûlait d’envie, mais elle se retint le plus possible avant de jeter un coup d’œil par-dessus son épaule. Elle aurait bien aimé voir le visage de ce personnage. Pour se donner une contenance, elle fredonnait une chanson du groupe Indochine, « la vie est belle »