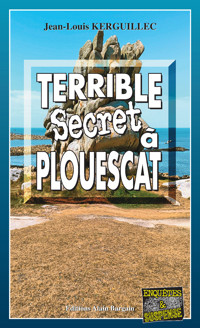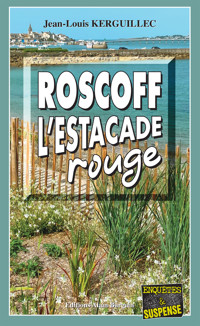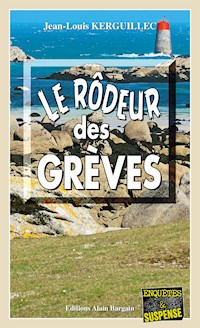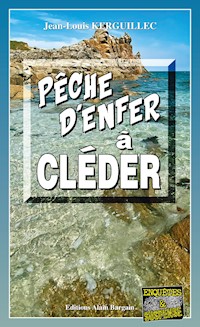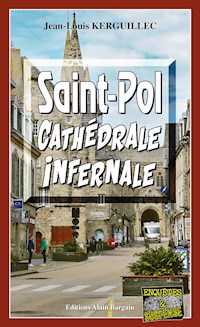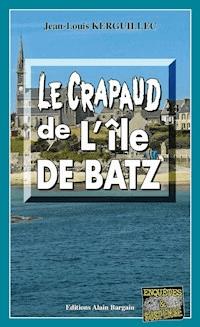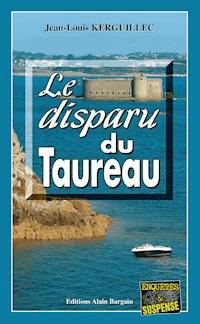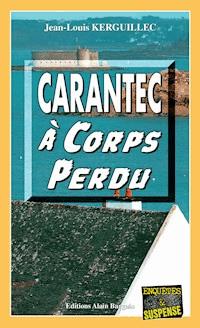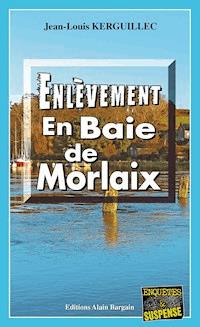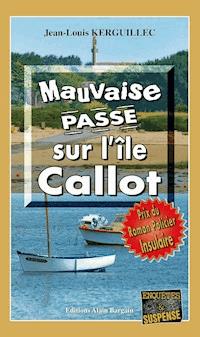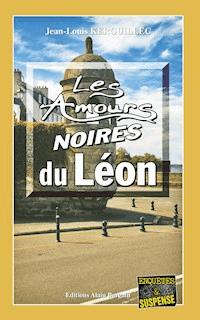
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Les enquêtes du commandant Le Fur
- Sprache: Französisch
Adieu vacances et écriture, les macchabés n'attendent pas !
Roscoff. Le commandant de police Guillaume Le Fur avait décidé de prendre enfin un mois de vacances, dans la petite cité de tous ses rêves, de promener son petit chien et de consacrer son temps à l’écriture d’un roman à la fois policier et historique, dont Tristan Corbière, son poète préféré, serait le personnage principal. Pourquoi a-t-il fallu que l’on trouve un cadavre dans le sauna de la salle de sport qu’il fréquentait depuis seulement deux jours ?
Le voilà donc avec une enquête sur les bras, au beau milieu de ses vacances, et l’écriture de son roman compromise. Une étonnante affaire qu’il va devoir résoudre avec l’aide de sa fidèle équipe…
Plongez-vous dans le tome 4 des enquêtes du commandant Le Fur, avec une histoire qui vous tiendra en haleine jusqu'à sa chute finale !
EXTRAIT
Roscoff. Quartier de la gare. Lundi 11 août 2014.
Jour de la saint Laurent.
L’orage, ce lundi-là, avait grondé dès le matin, un orage de mer qui avait tourné et roulé dans les deux baies de Morlaix et de la Penzé toute cette journée, sur la mer et au-delà des îles. C’était la tempête de chaque été, la tourmente de la saint Laurent qui survient habituellement vers la mi-août, tant redoutée des marins et des pêcheurs. Le ciel était noir ou gris profond, continuellement parcouru et griffé d’éclairs.
Du quai de Roscoff, on ne voyait plus ni l’îlot de Ty Saozon ni le phare de l’île de Batz, encore moins les bâtiments bas du centre médical de Perharidy derrière son bouquet de grands pins maritimes. Toute la côte était sombre sous un ciel de suie et l’atmosphère était lourde et oppressante.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Éditions Bargain, le succès du polar breton -
Ouest France
À PROPOS DE L’AUTEUR
Jean-Louis Kerguillec né à Kervaliou dans les dunes de Cléder, au plus près de la côte léonarde dont il connaît le moindre recoin, a exercé une longue carrière de professeur de lettres classiques au lycée Tristan Corbière à Morlaix.
Désormais retraité, il cultive son jardin, pratique la pêche en mer, la course à pied et se passionne pour la peinture et toutes les littératures. Il vit et écrit à Taulé.
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -
Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
Le blog de l’auteur : [email protected]
A tous mes chers Anciensdu lycée TRISTAN CORBIÈRE à Morlaix.Condisciples et professeurs,puis collègues et élèves.(1957-2007)
PROLOGUE
Roscoff. Quartier de la gare. Lundi 11 août 2014. Jour de la saint Laurent.
L’orage, ce lundi-là, avait grondé dès le matin, un orage de mer qui avait tourné et roulé dans les deux baies de Morlaix et de la Penzé toute cette journée, sur la mer et au-delà des îles. C’était la tempête de chaque été, la tourmente de la saint Laurent qui survient habituellement vers la mi-août, tant redoutée des marins et des pêcheurs. Le ciel était noir ou gris profond, continuellement parcouru et griffé d’éclairs. Du quai de Roscoff, on ne voyait plus ni l’îlot de Ty Saozon ni le phare de l’île de Batz, encore moins les bâtiments bas du centre médical de Perharidy derrière son bouquet de grands pins maritimes. Toute la côte était sombre sous un ciel de suie et l’atmosphère était lourde et oppressante. Enfin, vers dix-huit heures, le tonnerre et la pluie avaient brusquement éclaté, une pluie lourde et violente, accompagnée d’un coup de vent soudain, qui transforma en quelques minutes les rues du centre de Roscoff en véritables torrents. Les gouttières débordaient, rejetaient leur trop-plein sur la rue, les bouches d’égout ne pouvaient plus absorber les flots qui dévalaient vers le port des ruelles en pente du quartier, les lourdes plaques en fonte des bouches d’égout se soulevaient et laissaient échapper à gros bouillons une eau boueuse et nauséabonde. Le déluge dura jusqu’à la nuit sans le moindre répit. Les derniers passants se hâtaient vers leurs abris.
*
Un homme avançait d’un pas pressé et nerveux, sur le trottoir étroit de la rue Brizeux, courbé en deux sous l’averse et la tête prise dans la capuche d’un anorak gris foncé. Il entra dans “Rosko sport et santé”, un grand hangar aménagé en salle de sport. La pluie tambourinait violemment sur la toiture et faisait sur les tôles un vacarme assourdissant. Il semblait connaître parfaitement les lieux et allait droit devant lui, sans la moindre hésitation. Il passa dans le couloir entre la salle de cours et la salle de musculation, évita les vestiaires et les douches et parvint à la porte du sauna, jeta un coup d’œil rapide à droite et à gauche et la tira vers lui. Une lourde et violente bouffée de chaleur lui embrasa le visage. L’homme qu’il était venu tuer était là, devant lui, en petit slip noir et trop étroit, allongé sur le banc de bois, les genoux repliés vers son gros ventre qui s’écroulait de chaque côté, et la tête recouverte d’une grande serviette éponge. L’homme à l’anorak noir sortit de sa poche un objet long et pointu, peut-être un tournevis très fin, dont il empoigna le manche et qu’il planta d’un coup sec dans la poitrine du dormeur. Il retira l’objet d’un autre coup sec, en appuyant l’autre main entre les seins de sa victime, puis fit disparaître son arme dans la poche de son pantalon de treillis.
L’homme allongé sur le banc n’avait pas bougé. Du coin d’un mouchoir en papier, le tueur tamponna la petite goutte de sang qui perlait sur la poitrine de sa victime, tourna les talons, poussa la porte avec précaution et avança la tête. Le couloir était libre. Il connaissait la direction de la sortie de secours qu’il gagna au pas de charge. Parvenu à l’extérieur, baissant la tête sous la violence de la pluie et du vent, il se mit à courir sous l’averse qui redoublait, tenant sa capuche de la main gauche et le coude relevé.
Il courait maintenant le plus vite qu’il pouvait, courbé et aveuglé par les trombes d’eau. À l’angle de la rue Brizeux, en descente et transformée en torrent, il dérapa sur une plaque d’égout et bouscula contre le mur d’en face une vieille femme qui revenait du centre-ville et se hâtait sous l’averse. Pliée en deux, elle luttait contre la bourrasque, le cabas sous le bras et poussait son parapluie devant elle comme un bouclier. Elle se souviendrait longtemps de cet individu grand et lourd, qui l’avait heurtée et avait poursuivi son chemin sans même prendre la peine de s’excuser mais qui, d’une main ferme, l’avait retenue par le poignet et empêchée de tomber à la renverse. Son genou avait néanmoins violemment heurté le mur. Elle avait juste eu le temps d’entrevoir son visage, malgré la tête baissée sous la capuche. La vieille femme se redressa difficilement, se frotta la jambe en grimaçant, puis continua son chemin, boitant bas, agrippée des deux mains à son parapluie que l’averse transperçait déjà, et rentra chez elle, un peu plus loin, rue des Trois frères Daridon, pestant contre le temps qu’il faisait et contre le monde entier, et prenant bien garde d’éviter les flaques d’eau les plus importantes et de trop mouiller ses chaussures.
I
J’avais enfin décidé de prendre un mois de vacances et, pour la première fois depuis bien longtemps, un mois tout entier. Je pensais l’avoir bien mérité, après un certain nombre d’enquêtes difficiles et une très longue période où je n’avais pris aucune journée de repos ni même quitté le travail, souvent de jour comme de nuit. J’avais ainsi quantité de journées de congé en retard. Depuis plusieurs mois, en effet, mon précédent supérieur, le commissaire Claude Lamoulot, ayant été nommé à Montluçon, je dirigeais le commissariat de la place des Halles à Morlaix, sans l’avoir vraiment demandé. Je comblais un vide momentané et j’assurais une manière d’intérim en attendant l’arrivée du nouveau titulaire du poste.
*
On nous avait annoncé, quelques semaines auparavant, l’arrivée d’une femme à la tête de la police de Morlaix, et elle débarquait en effet. C’était le commissaire Yveline Lemétayer, jusque-là en poste en Guyane Française. Nous ne nous attendions pas nécessairement à recevoir une reine de beauté ni une gravure de mode, mais tous les collègues espéraient, après avoir supporté ce cafard de Lamoulot pendant une dizaine d’années, l’arrivée d’une personne plus agréable à tout point de vue. Plus agréable à regarder, certes, et surtout plus facile à vivre et à supporter. Notre surprise fut de taille. En effet, la nouvelle venue était une haute et forte femme, brune d’apparence, le cheveu coupé très court, hommasse et d’allure autoritaire qui poussait loin devant elle, en se dandinant d’une jambe sur l’autre, une impressionnante poitrine. Une sorte d’éléphant en uniforme. Elle arrivait, déjà accompagnée d’une solide réputation de tyran et de peau de vache. Grâce au téléphone et aux réseaux sociaux, les nouvelles et les réputations sont vite connues et circulent rapidement. Mon collègue, Arsène Le Treut, toujours au fait de tous les ragots, nous avait déjà avertis qu’elle était homosexuelle et qu’elle partageait sa vie avec une Brésilienne, une jeune et jolie métisse qu’elle avait ramenée dans ses bagages et à qui, toujours selon la rumeur relayée par Arsène, elle avait offert, à peine étaient-elles arrivées à Morlaix, une petite boutique de lingerie féminine dans la basse ville, du côté de la rue Carnot. Je laissais dire et venir, mais j’allais devoir, juste pour la forme, assister dans quelques jours, à la petite cérémonie de réception officielle d’intronisation de la nouvelle venue. J’aurais tout le temps, plus tard, de me faire une idée personnelle sur ma nouvelle patronne. Je n’allais plus être là pendant un mois. Je verrais tout cela début septembre, et c’était encore loin, fort heureusement. J’étais enfin et totalement en vacances et je ne voulais plus rien entendre. Je n’avais que trop donné et il fallait que j’arrête un moment. J’étais à bout de souffle et j’avais enfin le droit d’être sourd. Il me fallait couper les ponts, tous les ponts, au moins jusqu’à nouvel ordre. J’aurais même aimé être Robinson Crusoë abandonné de tous sur son île perdue, à des milliers de milles marins de toute nation prétendue civilisée.
*
J’étais donc totalement en vacances, mais je n’aimais pas voyager, encore moins quitter la Bretagne dont la vie culturelle et la beauté des paysages me suffisaient amplement. Je n’avais aucune envie d’aller regarder ailleurs, et mettre ma valise dans le coffre de ma voiture ou admettre l’idée de monter dans un train ou un avion m’étaient, depuis toujours, d’une répugnance absolue. J’avais l’impression de perdre mon temps et, accessoirement, mon argent, d’aller de plein gré au-devant de toutes sortes de difficultés, de me mettre à courir et à affronter des inconvénients et des dangers inutiles, sans contrepartie véritable. C’était comme m’élancer dans une expédition hasardeuse, presque partir pour une guerre dont je ne voyais pas les raisons. Je n’avais pourtant pas peur de grand-chose dans la vie, j’avais affronté tant de dangers et de difficultés, et je n’avais aucune espèce de prévention contre un pays étranger ni aucune région du monde, encore moins contre une population quelconque, mais, en même temps, aucun voyage ne m’attirait vraiment. Sans doute à tort, m’avait-on toujours répété, et je m’étais disputé avec tant de proches à ce sujet au cours des années, mais j’étais ainsi fait, et il était sans doute trop tard pour espérer me transformer. Là encore, j’allais à contre-courant des opinions et des modes généralement admises. Le soleil, toujours le soleil, l’éternel et banal argument ! Et la beauté des paysages, le dépaysement obligatoire, les photos pour les amis, les rencontres à espérer et les souvenirs pour les vieux jours ! Tout ce fatras d’arguments éculés que je considérais comme des foutaises sans intérêt dues au battage publicitaire des agences de voyages et au caractère désespérément moutonnier de mes contemporains. En réalité, il me faut bien l’avouer, j’étais incurablement breton et casanier et trouvais que j’avais tout sur place, ma langue, ma culture, mes paysages familiers et toujours renouvelés, et je n’avais aucune envie d’aller me promener ailleurs. J’avais encore tant de choses à découvrir, non loin de chez moi et, pour ainsi dire, à ma porte. Il y avait seulement la Grèce, je dois le reconnaître, que je n’arrivais pas à oublier et à mettre entre parenthèses, et qui était, avec la Bretagne de mon enfance, le socle dur de ma culture personnelle, littéraire et philosophique. C’était finalement le seul pays que j’avais envie de voir et de revoir. Particulièrement certaines îles de la mer Égée, les Cyclades, comme Paros, Naxos et quelques autres. Je rêvais des petites maisons blanches et bleues, des bateaux de toutes couleurs bercés par un reste de houle dans les petits ports d’eau turquoise, devant des terrasses fleuries où les pêcheurs démaillent les poissons ou ravaudent leurs filets. Les bateaux glissent lentement devant les yeux, petites taches de couleur mouvantes, et le soleil pétille sur la mer. J’étais donc, moi aussi, sur ce sujet même du voyage, en proie à mes propres contradictions.
*
J’avais, par conséquent, et depuis longtemps, projeté de passer ce mois de vacances, à tout juste une vingtaine de kilomètres de chez moi, à Roscoff, cette petite ville côtière que j’aimais particulièrement. Ce n’était pas vraiment original, encore moins aventureux. J’avais toujours, et depuis l’enfance, considéré ce petit port léonard comme un paradis absolu et une pure merveille. Un lien passionnel et inexpliqué m’avait toujours attaché à cette petite cité qui était comme le concentré de tout ce que j’aimais, l’histoire maritime, l’activité nautique, la mer dans tous ses états et les vieilles pierres lourdes d’histoire. Il y avait juste en face l’île de Batz, un véritable bijou, dont je ne m’étais jamais lassé de faire le tour. J’aimais aussi ce ciel gris ou bleu, toujours changeant au fil des jours et même des heures. J’étais dans le passionnel et l’inexplicable. Pourtant mesuré dans la plupart des domaines, j’étais à propos de Roscoff d’un chauvinisme à toute épreuve. J’aurais aimé y passer ma vie, mais, précisément, la vie en avait décidé autrement. J’aimais l’histoire de cette petite cité pittoresque et laborieuse, accrochée à son rocher, toujours en mouvement, vivante et en lutte, comme si elle avait hérité des combats ancestraux de ses habitants qui naviguaient sus à l’Anglais ! Ces Anglais qu’ils avaient tant combattus au fil des siècles sur terre et sur mer, Roscoff les recevait maintenant en invités et en touristes et leur faisait traverser la Manche et l’Atlantique sur les ferries de la Brittany. Étrange retournement de l’Histoire.
*
Je voulais donc me reposer, prendre enfin le temps de regarder autour de moi et de flâner au long des grèves avec mon petit chien, et surtout mettre en œuvre un petit projet littéraire que je caressais depuis trop longtemps et que j’avais, faute de temps et de disponibilité, toujours remis à plus tard. La vie va si vite, et j’étais tellement accaparé par mon travail. Je voulais écrire un roman à la fois policier et historique qui se situerait dans la cité corsaire vers 1870, à l’époque où le poète Tristan Corbière y séjournait. J’avais imaginé d’en faire le personnage principal de mon livre. Il avait vécu à Roscoff une dizaine d’années et son unique recueil de poèmes Les Amours Jaunes que j’avais découvert lors de mes classes de lycée, précisément au lycée qui porte son nom, était depuis toujours l’un de mes livres de chevet, un recueil de poèmes controversé, mais considéré comme original et novateur dans la littérature française. J’en connaissais chaque poème par cœur et j’étais capable d’une approche critique et précise de chacun d’entre eux. Je ne voulais certes pas faire œuvre d’historien de la littérature, je ne disposais pas de la documentation suffisante, je n’en avais nullement l’envie, encore moins les compétences. Je voulais tout simplement écrire une fiction, une sorte de petit roman policier imaginé et brodé à partir de la vie du poète à Roscoff, aux alentours de ces années 1870-1872.
J’étais un lecteur fidèle et assidu d’une collection de romans policiers régionaux et historiques, dont l’action se passait dans le milieu des artistes, particulièrement des peintres de l’école de Pont-Aven, et j’avais décidé de m’en inspirer quelque peu. J’en avais récemment lu un qui brodait une histoire policière à partir d’un événement réel de la vie du peintre Paul Gauguin, une bagarre d’après-boire entre l’artiste et des pêcheurs de Concarneau1, un soir de goguette, au cours de laquelle il avait eu il avait eu une jambe brisée. J’avais trouvé l’idée excellente et je m’étais donc mis en tête de construire une pareille intrigue policière à partie de la vie du poète Tristan Corbière, peintre également à ses heures, quoique moins connu dans ce domaine. Il peignait, en effet, de féroces caricatures, souvent de lui-même d’ailleurs, comme éternellement fasciné par sa propre laideur. De vastes zones d’ombre dans sa biographie, d’énormes lacunes, surtout sur les années où il habitait Roscoff, vers 1870, m’autorisaient ce type de projet quelque peu fantaisiste. Ses biographes les plus récents supposent que sa famille, des notables de la haute bourgeoisie de Morlaix, a, à son décès, par crainte de je ne sais quel scandale, détruit tous ses documents personnels et surtout sa correspondance, particulièrement une correspondance amoureuse dont on peut supposer l’existence. Seulement supposer... On en revenait toujours à la même absence de documents et les chercheurs s’étaient longtemps arraché les cheveux, torturé l’imagination, avaient dû se contenter de maigres informations, les avaient cousues ensemble et, pour combler les grosses lacunes, avaient tissé ensemble des suppositions de toutes sortes. Une sorte de légende ! Il fallait donc tout reconstituer, l’imagination devait souvent corriger ou compenser le manque de documents objectifs et l’ensemble tenait donc déjà du roman. Je me proposais donc d’imaginer une affaire de meurtre qui se serait passée à Roscoff en 1872, aurait été négligée par ses biographes et dans laquelle le poète aurait été soupçonné un moment. Je projetais donc ce petit jeu littéraire destiné à meubler mon temps et à occuper mon mois de vacances. J’avais toute liberté et toute latitude et je pensais que ce projet de roman allait me distraire des enquêtes policières bien réelles que je vivais à longueur de temps, et des rapports que je rédigeais jour après jour, inlassablement, depuis une bonne trentaine d’années. Mais il fallait être un peu fou, me disaient certains de mes proches que j’avais mis dans la confidence de mon projet, avoir du temps à perdre ou, plus simplement, être passionné d’écriture. J’étais sûrement un peu tout cela à la fois. J’avais même arrêté le titre de mon roman, avant même d’en avoir écrit la moindre ligne. Il s’intitulerait Les Amours Noires, référence évidente aux Amours Jaunes de Corbière. J’étais satisfait du titre, il me restait maintenant à écrire le livre, au moins déjà la première ligne, ce qui était évidemment beaucoup plus compliqué.
*
J’avais rencontré Valérie Kermaïdic au cours de l’une mes enquêtes précédentes2. Elle tenait un petit bar, “Le Refuge”, sur la place de la cathédrale à Saint-Pol-de-Léon. Je m’y étais rendu à plusieurs reprises pour les besoins de cette enquête et, par étapes et glissements progressifs, nous avions fini par laisser venir à nous, puis partager et organiser une liaison chaude et tendre, qui durait depuis maintenant quelques mois. Valérie cherchait à vendre son affaire depuis quelques années déjà, mais, par ces temps de crise, n’y parvenant pas dans de bonnes conditions, avait fini par la céder à un jeune couple, mais elle avait dû considérablement en rabattre le prix. De son point de vue, elle l’avait même carrément bradée, mais elle était lasse de ce métier. Elle avait passé vingt ans derrière son comptoir à écouter et supporter, du matin au soir, les mêmes clients, leurs problèmes, toujours les mêmes, et leurs continuels radotages. Elle n’était pas fâchée de quitter ce quartier de Saint-Pol-de-Léon, qu’elle appelait, Bricoli city3 mêlant breton et anglais en une expression amusante. Elle allait maintenant partir pour la Nouvelle-Calédonie, passer tout le mois d’août chez sa fille Annabelle et son gendre Laurent, elle infirmière, lui instituteur à Nouméa, et qu’elle n’avait pas vus depuis quatre ans, et surtout faire enfin la connaissance de sa petite-fille, Margot, née deux ans auparavant et qu’elle ne connaissait jusque-là que par des photos et quelques vidéos. Quelques semaines auparavant, elle m’avait proposé de l’accompagner ou de venir la rejoindre, avait même insisté, mais j’avais vivement refusé. Je n’avais personne à voir ni rien à faire à l’autre bout du monde. C’était trop loin pour moi et, dans ma tête, beaucoup trop compliqué, j’étais tellement mieux ici à contempler la mer et à regarder circuler les nuages. J’avais passé chez Valérie tout le weekend précédant son départ, trois journées et surtout deux nuits, plutôt chaudes et agitées que, pour l’essentiel, nous avions passées au lit. Elle me prêtait gracieusement sa petite maison face à la mer devant Poul Lous. L’anse sale. J’avais d’abord proposé et même exigé de payer un loyer pour le mois, mais elle avait refusé net, scandalisée et levant les bras au ciel. En manière de contrepartie, pourtant, j’avais pour mission de surveiller et de nourrir son chat, Bisig, un gros matou jaunâtre et poilu, à la tête large et carrée, méfiant et antipathique, qui refusait mes avances et ne voulait pas me laisser approcher, feulait, crachotait, dès que j’allongeais prudemment la main vers lui. Je n’aimais pas les chats, ces animaux insensibles, distants et ingrats. Le dénommé Bisig me regardait de loin, à travers la fente étroite de ses yeux mi-clos, la voix rauque et grondante, prêt à bondir... J’aurais bien aimé l’apprivoiser un peu, je n’avais pas souvent mis un genou à terre devant un chat, et je le faisais uniquement pour complaire à Valérie, mais il n’y avait rien à faire, le gros tas de poils jaunes ne voulait pas de moi ! Il me fallait aussi arroser les plantes vertes, nombreuses et réparties un peu partout dans la maison, dans toutes les pièces, sur toutes les marches de l’escalier, une véritable invasion, presque une forêt tropicale, et même une véritable mangrove dans la salle de bains aux abords de la baignoire. J’avais aussi l’intention d’entretenir son jardin durant son absence. Quelques massifs de roses, une touffe de roses trémières déjà en graines, cassées ou tordues vers le sol, un parterre de dahlias et d’hortensias, ainsi qu’au fond du jardin, un petit carré de plantes aromatiques, thym, ciboulette et menthe, encadré d’une petite clôture de quatre planches pourries, retourné à l’état sauvage et envahi par les pissenlits et les orties. J’avais accepté la proposition de Valérie, non sans quelques réticences personnelles et intimes, car j’étais très jaloux de mon indépendance. Les derniers jours, elle ne voulait plus me quitter et voulait rester passer le mois d’août avec moi à Roscoff. J’en étais secrètement flatté, mais il y avait la promesse faite à sa fille et à son gendre, le billet d’avion acheté depuis plusieurs mois, qu’elle avait payé fort cher, et toutes les dispositions arrêtées depuis longtemps. Elle tenait surtout à voir sa petite-fille et ne pouvait plus revenir en arrière. Nos adieux furent passionnés et tendres, puis je la conduisis à l’aéroport de Guipavas dans sa voiture, une petite voiture anglaise à la mode, une voiture de fille, couleur chocolat fondu, dont le toit représentait le drapeau anglais, une petite caisse rectangulaire, une boîte de galettes bretonnes, où ma tête cognait le plafond et qui me meurtrissait les fesses au moindre chaos de la route. J’avais l’impression de circuler dans un sabot de Noël. De plus, arborer le drapeau anglais au-dessus de ma tête ne me réjouissait pas particulièrement. Revenu à Roscoff, je remisai soigneusement la petite voiture dans le garage que je fermai à double tour, rangeai la clé dans un tiroir de la cuisine, peu enclin à renouveler l’expérience et décidé à oublier jusqu’à nouvel ordre et même à tout jamais la boîte couleur chocolat. J’avais choisi de laisser ma propre voiture à Morlaix, et ma collègue Joana m’avait déposé à Roscoff. Si je devais retourner à Morlaix, pour une raison ou pour une autre, ce que je ne souhaitais pas vraiment, je prendrais le car ou plutôt le train, la petite rame qui fait, en ferraillant, l’aller-retour Morlaix-Roscoff, deux ou trois fois par jour. J’avais envie, depuis longtemps de faire ce trajet qui enjambe la Penzé par un pont métallique gris. Je voulais être tranquille et subir le moins de contraintes possible. Cela m’était rarement arrivé, et j’allais enfin être seul et libre dans la petite cité de tous mes rêves pour mener à bien mon projet d’écriture...
*
« PROLOGUE
« Bonsoir ! Ce crapaud-là, c’est moi ! »
Les Amours jaunes - Tristan Corbière
Jeudi 15 août 1872. Environs de minuit.
Roscoff se remettait à peine d’une tempête qui avait frappé toute la côte quelques jours auparavant. La tourmente de la saint Laurent qui survient assez régulièrement vers la mi-août et surprend les hommes dans leurs occupations d’été, et particulièrement les gens de mer. La tempête s’était levée l’avant-veille au soir et l’orage avait éclaté un peu avant la nuit, un véritable déluge, accompagné de vents violents. Des ifs et des cyprès étaient tombés dans le cimetière du Vile et plusieurs embarcations avaient brisé leurs amarres dans le port et avaient été drossées contre les rochers de la côte, au pied de la chapelle Sainte-Barbe.
Ce jeudi 13 août, un homme élégamment vêtu, d’allure bourgeoise et distinguée, remontait la rue du Quai, lourdement appuyé sur sa canne. Les douze coups de minuit venaient de sonner à l’église de Kroas Batz. Il boitait bas et avançait d’une démarche difficile et heurtée, traînant derrière lui sa jambe gauche. Sa canne frappait régulièrement le sol et rythmait sa marche. Un autre homme, tout de noir vêtu, chapeau noir à large bord, redingote cintrée et fermée par une grosse ceinture, le suivait à distance prudente, en s’abritant à l’angle des maisons, s’arrêtait, attendait, hésitait, puis repartait jusqu’au coin de mur suivant, en évitant la lumière pauvre et poudreuse des becs de gaz. Il tenait sous son bras une grosse canne à pommeau de plomb. Plus une arme qu’une canne. On entendait la rumeur rauque de la mer qui battait les rochers, un peu en contrebas dans l’anse du Vile. Le phare de l’île de Batz allumait par intermittence le faîte des cheminées des maisons du front de mer et des matous se battaient quelque part dans un jardin. L’enseigne de l’auberge Le Gad était restée allumée, mais les fenêtres de la façade donnant sur la rue du Quelen étaient toutes éteintes. L’homme parvint au cimetière, enjamba difficilement la plaque d’ardoise dressée dans l’entrée pour empêcher les animaux domestiques d’y pénétrer, s’engagea dans l’allée, passa auprès d’un grand Christ en bois sombre de châtaignier. Le sol sablé crissait sous ses chaussures, les cyprès et les ifs dans lesquels soufflait le vent de la nuit formaient une masse sombre et funèbre. L’homme vêtu de noir l’avait suivi dans le cimetière et s’en rapprochait méthodiquement sous le couvert des arbres. À l’angle de l’ossuaire, il arriva dans son dos et le frappa à l’arrière du crâne de la canne qu’il brandissait comme une massue. L’homme tournoya un peu sur lui-même, voulut s’accrocher au mur de l’ossuaire, sa main dérapa sur la pierre, ne trouva aucune prise, puis il s’abattit sans un cri. Le meurtrier s’acharna et lui martela la tête de coups violents et redoublés. Une bouillie de sang, d’os et de cervelle se répandit dans l’allée et s’enfonça lentement dans le sable.
L’homme en noir enfonça la main dans les vêtements de sa victime, fouilla ses poches, trouva un portefeuille, en vérifia le contenu, déplia puis replia des documents en papier et enfouit le portefeuille sous sa redingote. Il se baissa à nouveau, tira la montre de son gousset, l’arracha du passant du gilet, voulut retirer la chevalière, dut la tourner dans un sens, puis dans l’autre pour l’arracher enfin. L’homme en noir tourna la tête d’un côté et de l’autre, écouta un moment les bruits de la nuit, tira un mouchoir de sa poche, en essuya vivement le pommeau de sa canne, jeta le chiffon derrière un buisson d’hortensias et disparut à grandes enjambées à l’angle de l’ossuaire. Bientôt, il ne demeura qu’une grande tache sombre auprès du corps étendu sous la lune.
Un chien aboya, réveillé dans un jardin, au-delà d’un haut mur de pierre. Une voix lourde et rauque.
Un gros chien noir sûrement, qui remontait sa chaîne du fond de la nuit...
*
« CHAPITRE I
Roscoff vivait la nostalgie de ses heures de gloire, les temps révolus où son port abritait une puissante flottille de bateaux corsaires, une véritable armada qui, toutes voiles dehors, cinglaient sus à l’anglais, se livraient à la guerre de course et attaquaient les convois de navires de sa Majesté, qui remontaient la Manche, ramenaient des prises dont les cargaisons valaient des fortunes et qui firent la richesse et la renommée de la ville. Marchandises des Indes et de toutes les colonies anglaises, étoffes, épices et minéraux précieux. De l’or et de l’argent souvent. Il y avait aussi les voyages triangulaires, de la côte de Guinée vers l’Amérique centrale, avant le retour en Bretagne, où on se livrait au trafic des esclaves noirs, désigné par l’euphémisme bien connu « trafic du bois d’ébène ». Au retour des Amériques, les cales étaient remplies à sombrer de sucre, de cotonnades et de produits exotiques. Les armateurs roscovites gagnaient des fortunes et se faisaient construire de magnifiques maisons fermées sur leur jardin, entassaient leurs richesses dans leurs vastes caves parfois hantées par les grandes marées d’équinoxe. Tristan Corbière écrira Au vieux Roscoff, un admirable poème, hommage à la gloire passée de la petite cité corsaire, ce trou de flibustiers, ce vieux nid à corsaires.
Ces temps héroïques étaient depuis bien longtemps révolus, vers 1870, à l’époque qui nous occupe, mais la ville était restée fidèle à ses traditions commerciales et maritimes et au port, régnait toujours une grande activité. On importait du vin de Bordeaux, on roulait des fûts sur le quai, des tombereaux les emportaient chez les marchands de vin. Le bois venu des Landes ou des pays du Nord s’entassait sur la place Thiers, on expédiait des légumes vers l’Angleterre et le nord de l’Europe, surtout les oignons, on importait la rogue en barils, un mélange de farines diverses et d’huile de poisson qu’on faisait venir, par bateaux entiers, de Norvège pour les pêcheurs de sardine de la baie de Moguériec où grouillaient alors ces poissons et qu’on livrait, selon la marée, en charrette ou en bateau, à la conserverie établie à la pointe de l’île de Sieck. Édouard Corbière avait créé un service de transport de passagers et de marchandises entre Roscoff et Le Havre. Il en était le directeur à Morlaix, une entreprise florissante et en plein développement.
Son fils, Édouard comme lui, mais qui préférera se faire appeler Tristan, avait dû interrompre ses études vers l’âge de dix-sept ans à la suite de graves problèmes de santé, une sorte maladie articulaire dégénérative. Il était maigre, bancal et d’une absolue laideur. Ses parents, ne sachant quoi en faire, l’avaient installé dans leur maison de Roscoff, place de l’Église, auprès de l’anse du Vile. La servante, Marie, qui travaillait pour les Corbière à Morlaix, depuis plusieurs années, fut détachée à la maison de Roscoff. Elle avait vingt-cinq ans et le jeune Édouard vingt. La coexistence d'un jeune homme d’une vingtaine d’années et d'une jeune femme à peine plus âgée, seuls dans cette grande maison, excitait l’imagination et les mauvaises langues des commères et alimentait bien des rumeurs. Marie revenait presque toujours en pleurant du lavoir, accablée de questions et d’allusions salaces, et déclarant qu’elle n’irait plus laver le linge de Tristan à cet endroit. Elle changeait de lavoir, la semaine suivante, mais les commères lui posaient les mêmes questions et, ainsi, chaque lundi, elle revenait en pleurs et poussant la brouette qui grinçait sur le pavé inégal.
Tristan possédait un bateau, objet de tous ses soins et de toutes ses attentions, “Le Négrier”, un cotre breton à voilure aurique, grand’ voile, foc et trinquette, que lui avait offert son père Édouard. Tristan l’avait appelé ainsi parce que c’était le titre du roman le plus connu de son père, un roman d’aventures maritimes sur fond de traite des Nègres entre le golfe de Guinée et la Martinique. Il l’avait ainsi nommé en hommage à son père, mais peut-être aussi par nostalgie des aventures contées dans les romans de son géniteur et qui avaient nourri et enchanté son enfance. Son père, ancien capitaine dans la marine, qui avait commandé quantité de navires, lui avait enseigné l’art de la navigation à voile. Tristan était un marin téméraire, faisait sur la mer des prouesses d’une imprudence folle, sortait quand tous les autres rentraient et se mettaient à l’abri dans le port. Il avait acquis une réputation de casse-cou et les vieux pêcheurs qui le regardaient prendre son bateau et quitter le port alors qu’un un coup de chien était annoncé par le sémaphore de l’île de Batz, haussaient les épaules et secouaient la tête. Ils prédisaient qu’un jour ou l’autre, il lui arriverait malheur car, disaient-ils, on ne brave pas ainsi la mer impunément, elle qui, de toute manière, finit un jour ou l’autre par avoir raison des imprudents. La mer n’oublie jamais ! Mais ce fils Corbière, ajoutaient-ils, ne respectait pas la mer comme il ne respectait rien ni personne à Roscoff, et avait de toute évidence le diable au corps.
*
Tout un groupe de peintres prenait pension à l’auberge Le Gad et y séjournait tous les étés, depuis de longues années. Certains n’étaient que des rapins en mal d’originalité, qui se donnaient le genre artiste et passaient la belle saison à faire la fête à Roscoff, quand d’autres étaient des peintres reconnus et même des talents avérés. Chaque été, ils débarquaient de Paris et passaient deux ou trois mois à peindre sur place et sur le motif, paysages bretons et scènes de genre. Ils posaient leurs chevalets sur la côte et couraient les pardons où se pressait une foule aux costumes bigarrés, et croquaient la population locale. Les Bretons étaient alors aussi pittoresques et exotiques que les habitants de la Polynésie ou les Indiens d’Amérique. Ces peintres composaient habituellement un petit groupe de fêtards qui scandalisaient les habitants de Roscoff, arboraient des tenues vestimentaires extravagantes, braillaient dans les rues et se couchaient à l’aube, à l’heure où les habitants de Roscoff partaient pour leur travail. Ils avaient leurs habitudes, table et coucher, à la pension Le Gad, rue du Quelen, face à l’église ou dans la pension Castel près de la chapelle des Capucins, à l’entrée du bourg... Comme tous les soirs, sous les lourdes poutres qui écrasaient la salle, ils parlaient fort dans la vapeur des grogs et la fumée des cigares et se lançaient des défis bruyants. Ils entretenaient d’interminables discussions, et deux générations se disputaient sur différentes théories de la peinture. Les plus anciens défendaient des positions classiques et académiques, quand les plus jeunes parlaient de pointillisme et même d’impressionnisme. Personne ne s’entendait et tous parlaient en même temps. C’est là que Tristan Corbière, qui habitait juste à côté, les rencontrait et partageait leur vie de bohème, libre, bruyante et désordonnée. Il écrivait d’étranges poèmes qui étonnaient ses amis, peignait, lui aussi, et dessinait des caricatures dont il illustrait les brouillons successifs de ses poèmes. Tous se retrouvaient et finissaient la soirée et même la nuit dans l’établissement d’Ursule Calarn où ils buvaient sec et menaient grand tapage.
Le plus pittoresque, sans doute, et le plus connu de tous ces peintres, était Albert Duroc qui venait depuis des années peindre à Roscoff. Sa lourde silhouette, son grand chapeau et sa longue redingote noire, qu’il portait même en plein été, étaient familiers aux habitants de la petite cité. Il y séjournait les mois de juillet, d’août et de septembre, et prenait, comme la plupart des peintres, pension à l’auberge Le Gad, près de l’église. Il allait plusieurs jours par semaine à l’île de Batz, du moins quand la marée et l’état de la mer le permettaient. Son chevalet sous le bras, ses toiles sous l’autre, sa boîte de couleurs et sa palette en bandoulière sur le dos, courbé sous son chapeau de paille, il marchait lentement et difficilement, encombré et ralenti par son bagage, gêné par son embonpoint d’éternel viveur et d’amateur de bonne chère. De loin, il ressemblait à une grosse tortue. Il peignait les paysannes à genoux dans les champs de carottes et d’oignons, avec leurs coiffes bleues à rubans et leurs tabliers noirs, les goémoniers qui faisaient brûler leur goémon sur la dune, dans de grands fours faits de pierres plates, d’où s’élevait une fumée lourde et âcre, qui allait se perdre au loin sur la mer, vers les rivages de Sibiril et de Cléder. Duroc était donc toujours affublé de la même redingote noire, tachée de peinture de toutes les couleurs, beaucoup trop grande, qui traînait au sol et dont les basques flottaient au vent. Il puait l’essence de térébenthine. Les habitants de l’île, qui le voyaient passer ainsi accoutré, le montraient du menton et se moquaient de lui en breton. Ils l’appelaient Ch’wil du4car il était éternellement vêtu de noir et se déplaçait comme un cloporte ou un bousier, appuyé sur une lourde canne. On lui reprochait surtout de trop s’approcher des femmes qui sarclaient à genoux dans les champs ou battaient leur linge au lavoir, et de chercher à lier conversation avec elles pendant que leurs maris pêchaient en mer, ramassaient le goémon sur les grèves ou besognaient dans un autre endroit de l’île. « Pitaouer lous ! »5criaient-elles en faisant mine de lui jeter, comme à un chien errant, de l’eau, des cailloux ou des mottes de terre. Il s’éloignait alors de son pas lent et pesant, marmonnant on ne sait quoi, et allait planter son chevalet un peu plus loin. Albert Duroc avait fait un marché avec un vieux pêcheur de l’île qui le ramenait à Roscoff, le soir venant, du moins quand la marée était propice. Il aurait probablement mieux fait de rester coucher sur l’île de Batz, mais il faisait remarquer que l’unique café fermait beaucoup trop tôt et qu’il ne saurait jamais quoi faire de sa soirée. Il lui fallait au moins sa carafe de vin de Bordeaux, ses petits verres de cognac du soir, le jeu de cartes et le billard, tard le soir avec ses amis, sans oublier, surtout, les filles de la maison close de la rue des Chanoines où il avait ses entrées régulières, sa table réservée et ses filles attitrées.
Ursule Calarn tenait, en effet, au numéro soixante-neuf de la rue des Chanoines, l’unique maison close de Roscoff, que fréquentaient les marins du port et les bourgeois de tout le canton, armateurs et capitaines, gros marchands de légumes, boutiquiers, artisans et clercs de notaire. Et l’été, les Parisiens et une demi-douzaine de peintres familiers de l’établissement. Ursule opérait un tri sévère dans sa clientèle, régnait sans partage sur un personnel réputé de qualité, contrôlé et choisi avec soin, qu’elle renouvelait par tiers tous les six mois, et réservait ses dernières recrues aux bourgeois fortunés de Roscoff et de Saint-Pol-de-Léon. L’établissement était considéré comme propre et bien tenu, et la moralité, l’hygiène et la bonne santé des filles étaient vantées dans toute la région et même au-delà. Tristan fréquentait assidûment cette maison située à quelques pas de chez lui. Elle était à sa porte, et il y jouissait même d’un tarif de faveur. Il montait les marches usées du colimaçon en pierre du vieil escalier, parfois avec Giroflée, mais surtout avec Ophélie, une lourde et copieuse créature, qu’il choisissait invariablement parmi la demi-douzaine de pensionnaires de la maison, poussant de hauts cris et provoquant un véritable scandale quand elle accompagnait un autre client ou quand elle était indisponible pour une quelconque raison. Tristan prétendait qu’Ophélie avait une ressemblance certaine avec l’une de ses cousines à la mode de Bretagne, Héloïse, avec qui, quelques années auparavant, il se promenait dans les bois de Coatcongar ou sous les grands châtaigniers du parc du Launay quand, adolescent, il séjournait chez ses tantes Puyo. Une grosse fille, assurait-il, molle et profonde comme un édredon de plumes. Parvenu dans la chambre, il n’enlevait jamais ses longues bottes de pêcheur ni son chapeau, se relevait et se reboutonnait sans dire un mot, puis payait très généreusement et sans la moindre discussion, laissant habituellement aux filles de généreux pourboires. C’était, de toute manière, l’argent de papa Édouard et de maman Marie-Aspasie, qu’il dépensait sans compter, et quand il venait à en manquer et qu’il avait entièrement mangé la pension mensuelle que ses parents lui accordaient, il descendait à Morlaix, à la barre de son bateau jusqu’aux écluses du grand bassin, à quelques encablures de l’appartement familial du quai de Léon, ou attelait Souris, sa vieille jument grise, et venait par la route réclamer une rallonge à son allocation. Son père se faisait un peu tirer l’oreille, pour la forme et pour le principe, mais sa mère ne pouvait rien lui refuser. Finalement, les deux parents ne savaient pas comment appréhender cet enfant, un être si différent, si sauvage et en