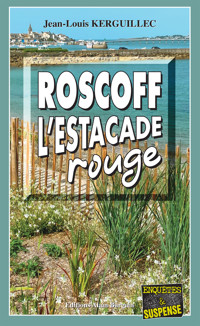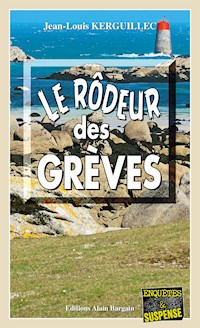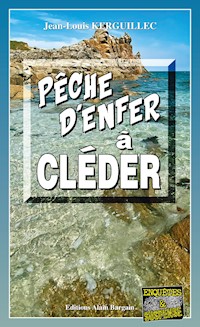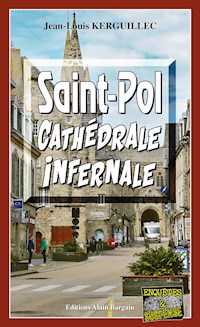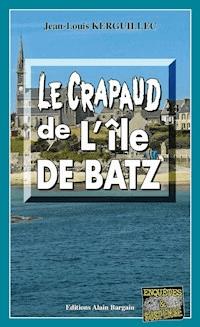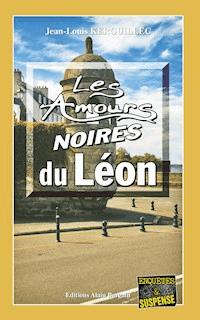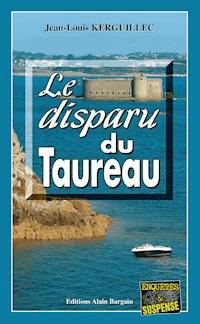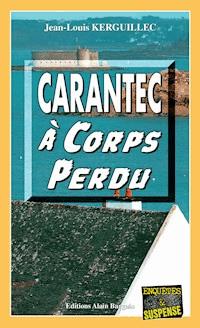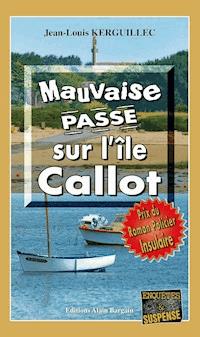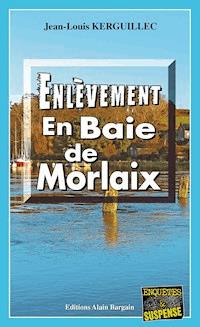
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Krimi
- Serie: Les enquêtes du commandant Le Fur
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Enlèvement, assassinats, tueurs en série... Les enquêteurs de Morlaix ne chôment pas !
Le commandant de police Guillaume Le Fur et sa jeune équipe, le lieutenant Guy Millau et la belle Joana Mélion, traquent un insaisissable tueur en série qui sévit dans les déchetteries de la région de Morlaix. Déjà trois personnes assassinées dans des conditions atroces et pas vraiment de piste sérieuse en dépit d’un travail d’enquête acharné…
Et voilà que Le Fur se fait voler son chien dans sa voiture, Horace, un petit yorkshire devenu son inséparable compagnon. Violemment remonté, il va tout mettre en œuvre pour trouver et punir le coupable de cet enlèvement…
Découvrez deux enquêtes parallèles menées à fond par un policier intelligent et humain, avec ce tome 2 des enquêtes trépidantes du commandant Le Fur !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean-Louis Kerguillec né à Kervaliou dans les dunes de Cléder, au plus près de la côte léonarde dont il connaît le moindre recoin, a exercé une longue carrière de professeur de lettres classiques au lycée Tristan Corbière à Morlaix. Désormais retraité, il cultive son jardin, pratique la pêche en mer, la course à pied et se passionne pour la peinture et toutes les littératures. Il vit actuellement et écrit à Taulé.
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -
Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
À mes enfants,Véfa, Maël, Julien, Vincent.
I
Vendredi 12 avril 2013. 23 heures. Penzé.
Un vent de galerne violent et glacial balayait le plateau de Ker-Ar-Vran, sur les hauteurs de Penzé, auprès du village de Kerdalidec qui dominait le bras de rivière vaseux et sinueux qui descendait vers la mer jusqu’au pont de la Corde et la baie de Saint-Pol-de-Léon. On était déjà au mois d’avril et le printemps se faisait attendre et, depuis bientôt deux mois, on avait l’impression d’endurer un interminable automne froid et venteux. De courtes éclaircies succédaient à des averses de pluie et de neige fondue. La nuit était claire, mais de gros nuages noirs passaient en roulant devant la lune, une pleine lune ce soir-là, qui éclairait de quelques reflets d’argent les longs moutonnements de serres sur les hauteurs des hameaux de Keryunan et de Kersiroux.
Là précisément, au sommet de la colline toujours battue par le vent d’ouest, se trouvait la déchetterie du canton de Taulé, au bout d’un long chemin de terre, une véritable fondrière, dont les ornières creusées par le passage incessant des voitures, des tracteurs et des camions étaient profondes et remplies d’eau croupie, et présentaient, de chaque côté, d’épais bourrelets de boue. Il avait été mille fois question, dans les assemblées d’élus, de faire empierrer puis goudronner ce chemin, mais le projet avait toujours été remis à plus tard, sans doute par faute de volonté politique ou par manque d’argent. L’endroit était sinistre. Le vent ronflait dans une rangée de grands pins parasols au bord de la route communale. Tout à côté, au carrefour de la route tortueuse qui mène de Penzé à Henvic, tout auprès de la grille d’entrée, un grand calvaire noir étendait les bras et marquait l’endroit où, dans les dernières années du XIXe siècle, deux petites filles qui revenaient de l’école communale par un chemin creux à travers la lande, à la tombée de la nuit, avaient été dévorées par une horde de loups. Cette déchetterie était construite et agencée selon le modèle habituel et désormais familier à tous. Derrière une haute clôture de grillage vert, s’allongeait un grand quai de béton contre lequel étaient alignées plusieurs bennes de couleur rouge où les usagers font le tri de leurs déchets, ferrailles, objets tout venant et une autre pour les matériaux inertes. Des bannières multicolores indiquaient la destination de chaque benne, tournoyaient sur leur socle et claquaient au vent. L’électroménager hors d’usage était entreposé, un peu à l’écart, dans un petit préau recouvert de tôle ondulée où chaque appareil et chaque objet mis au rebut était maculé de peinture fluorescente rose, sans doute pour décourager d’éventuels voleurs. Des sacs en plastique de toutes les tailles et de toutes les couleurs, emportés par le vent, restaient accrochés dans les mailles du grillage, gonflaient, se débattaient et claquaient dans la bourrasque. On entendait les cris d’une bande de vanneaux huppés qui venaient passer la nuit sur les friches alentour et les emblavures gorgées d’eau, des cris plaintifs et lancinants, sortes de miaulements et de vagissements sinistres. Les vieux paysans prétendent que leur présence en groupes importants dans nos contrées, surtout à ce moment-là de l’année, est le signe d’un hiver long, tenace et particulièrement rigoureux. On aurait dû, en effet, être aux premiers jours du printemps, mais toutes les journées étaient sans fin, grises, froides et désespérantes. Des sonnailles claires et des meuglements continus et lugubres provenaient d’un grand troupeau de vaches salers, enfoncées dans la boue jusqu’aux jarrets, quelque part en contrebas, au milieu des joncs et des hautes touffes de roseaux d’une vaste prairie marécageuse, dans les méandres de la rivière, et auprès d’un vieux moulin en ruines, reconquis par les ronces et le liseron.
Cette nuit-là encore, comme presque toutes les nuits, René Lethierry fouillait dans la benne à ferraille et travaillait à récupérer des métaux qu’il ramenait chez lui, entassait dans un vieux hangar et revendait ensuite à des marchands en gros à Garlan, à Plouigneau ou encore à Plougourvest. Une lampe frontale projetait devant lui un mince pinceau de lumière.
Petit, rond et lourd, les pieds coincés et enfoncés dans le tas de ferraille, engoncé dans un gros blouson de moto, un bonnet de laine enfoncé sur le sommet du crâne, d’où la pluie lui dégouttait sur le visage, il avait les gestes lents et maladroits, et se déplaçait avec peine. Une démarche de scaphandrier et des allures de robot. Un amas de grillage écrasé le gênait particulièrement. La benne à ferraille, en effet, était furieusement tassée tous les soirs au bulldozer, pour gagner de la place, mais aussi, un peu par calcul et par vice, pour en rendre la récupération plus difficile, et l’ouvrier pelleteur commis à ce travail y mettait notoirement un zèle et même une violence dictée par on ne sait quel ressentiment ou jalousie secrète.
René Lethierry, se frayait un passage dans le tas de ferraille, déplaçait et repoussait les pièces sans valeur, à la recherche des métaux les plus nobles, les plus prisés et les plus rentables, cuivre, zinc, inox et bronze essentiellement. C’était un travail pénible et dangereux. La benne, ce soir-là, était remplie de vieilles tables à huîtres, en fer à béton, rouillées, emmêlées et jetées par des ostréiculteurs de Carantec. Elles avaient très longtemps séjourné dans l’eau de mer, s’y accrochaient encore des touffes de goémon, et elles présentaient de longues pointes acérées et redoutables. Lethierry projetait ses trouvailles sur la plate-forme à plus de deux mètres au-dessus de lui, en espérant faire le moins de bruit possible. Mais c’était d’avance peine perdue. Les casseroles et les poêles à frire en inox ou en aluminium, les plaques de tôle, les gouttières en zinc et les barres en acier résonnaient inexorablement sur la dalle de béton. Il y fit monter la lourde embase en aluminium d’un moteur hors bord, puis un volumineux embrayage de voiture qu’il peina à hisser à bout de bras, dut s’y reprendre à plusieurs reprises et ne réussit qu’au prix d’un gros effort à le poser sur le rebord de la benne et à le faire glisser à bout de bras sur la plate-forme. Lethierry connaissait le prix de revente au kilo de chaque métal, pouvait évaluer la valeur de chacune de ses trouvailles et en concevait un vif plaisir intime. Il évita et repoussa plus loin, avec dégoût, le zinc d’un cercueil, terreux, plié, puant et informe, débarrassé d’un cimetière et jeté là, parmi les autres ferrailles, par une quelconque entreprise de marbrerie.
De temps en temps, il s’arrêtait, se redressait, se massait les reins et écoutait les bruits de la nuit, le beuglement des vaches et les appels plaintifs des vanneaux dans les champs alentour. Parfois aussi, il retenait son souffle, quand une voiture passait sur la route en contrebas, tendait l’oreille, écoutait passer tout près, puis s’éloigner et disparaître le roulement mouillé, et reprenait son travail de fouille. Il avait, aussi, entendu une voiture descendre la route d’Henvic, arriver tout en bas, dans les virages auprès du ruisseau et de la réserve d’eau des agriculteurs, mais étrangement, il ne l’avait pas entendue remonter et passer devant la déchetterie. Elle avait dû s’arrêter, mais pour quelle raison ? Ou peut-être avait-il mal entendu, à cause du vent qui soufflait toujours aussi fort et ronflait dans les grands pins, au bord de la route. René Lethierry était sans cesse sur le qui-vive et s’attendait toujours à être surpris. Les gendarmes de Taulé et de Saint-Pol-de-Léon passaient régulièrement, l’avaient déjà pris sur le fait, sérieusement averti, menacé de poursuites, et une rumeur tenace affirmait que le gardien de la déchetterie faisait parfois du zèle et improvisait des rondes, en pleine nuit, avec son fusil de chasse et deux bergers allemands.
À ce même moment, un homme avait dissimulé sa voiture, une vieille AX grise, sur un petit délaissé de terrain à l’écart de la route, le long du ruisseau, en avait repoussé la portière avec beaucoup de précaution, et, au clair de lune, montait vers la déchetterie par un petit chemin connu seulement des habitués, un raccourci qui serpentait à flanc de colline parmi les genêts, les orties et les ronces. Il portait une veste et un pantalon de treillis enfoncé dans des bottes de caoutchouc, et avançait d’un pas décidé malgré l’obscurité, évitait les endroits les plus boueux en passant d’un côté à l’autre du sentier et semblait donc connaître parfaitement les lieux. Arrivé au grillage de la déchetterie, il la contourna un instant, repéra un endroit précis, avança le bras et déboîta d’un coup sec un élément de clôture, introduisit son buste au prix de quelques contorsions et se faufila à l’intérieur de l’enclos.
La benne à ferraille délestée des métaux qui l’intéressaient, Lethierry visitait ensuite le grand bac en plastique bleu, où l’on entreposait les batteries, enlevait celles qui s’y trouvaient, puis le préau où s’entassait le matériel électroménager, le “platin” comme le dénomment les ferrailleurs : réfrigérateurs, fours, machines à laver, congélateurs, téléviseurs, machine à café et tout le petit matériel hi-fi. Il coupait câbles et fils électriques qu’il enfournait dans un vieux sac à patates. Un soir par semaine, pour récupérer les fils de cuivre, il brûlait ces câbles dans un chemin creux sur les hauteurs de Locquénolé, plutôt les jours où le vent, soufflant du sud ou de l’ouest, portait et rabattait sur la mer, vers Le Dourduff, l’épaisse fumée noire et nauséabonde.
Enfin, il rassemblait son butin auprès de la clôture, le balançait par-dessus le grillage, passait par la petite trouée qu’il avait aménagée et qu’il refermait aussitôt, allait chercher sa voiture et la remorque dissimulées un peu plus loin derrière un talus ou au coin d’un champ de maïs, selon la saison, chargeait le tout et partait pour la déchetterie suivante. Selon les nuits, il pouvait ainsi en visiter plusieurs, celles de Penzé, Pleyber-Christ, Guimaec régulièrement, celle de Plougonven à l’occasion et toujours celle de Langolvas. Il lui était arrivé d’aller jusqu’à Plouescat, Sizun et même, plus rarement, jusqu’à Plestin-les-Grèves. Tard dans la nuit, et souvent au petit matin, il entassait ses trouvailles dans un vieux hangar à demi délabré auprès de sa maison, à Prat Lochouarn, entre le pont de la Corde et Kerlaudy. Plus tard dans la semaine, dès qu’il avait un moment libre, il triait, démontait, séparait du reste les métaux nobles et précieux et, chaque samedi après-midi, après sa semaine de travail, parfois au prix de plusieurs voyages avec sa remorque, livrait son trésor accumulé au cours de la semaine aux établissements “Paul Bastien et Fils”, un marchand de ferraille en gros, dans la campagne de Garlan.
Pour que mon lecteur comprenne, il me faut juste donner quelques nécessaires informations sur ces trafics de ferraille, car René Lethierry n’était pas le seul à se livrer à cette occupation très lucrative et la concurrence était rude et parfois violente entre les récupérateurs, souvent amateurs, mais de plus en plus organisés comme de véritables professionnels. C’était, on peut vraiment le dire, la loi de la jungle et les affrontements n’étaient pas rares sur la plate-forme des déchetteries. On en venait aux mains pour une vieille casserole en aluminium, on s’affrontait pour un robinet en bronze, parfois même des manches de pioche sortaient des coffres de voiture, des crans d’arrêt et même des armes à feu de la poche des blousons. Car le prix des métaux flambait depuis quelques mois et l’appât du gain conduisait à des trafics et à des vols en tous genres. On volait, dans les cimetières, les croix en bronze et même en régule, un alliage mou et sans valeur aucune, les tuyauteries en cuivre des fontaines publiques et des toilettes municipales, les plaques d’égout en fonte sur les trottoirs et les jantes de voiture en aluminium. Les gouttières des maisons isolées étaient enlevées et les journaux locaux rapportèrent que le curé de Plouzévédé, réveillé en sursaut en pleine nuit dans son presbytère, se risqua dans sa cour en pyjama et dérangea deux hommes qui démontaient, au plein clair de la lune, les plaques en cuivre de la toiture de son église. De véritables bandes organisées dévalisaient les réserves de cuivre dans les garages des artisans plombiers et les entrepôts industriels, malgré les dispositifs d’alarme, la présence de chiens de garde et même de vigiles armés. On parlait aussi de bandes organisées venues des pays de l’Est. Plus encore, dans les campagnes isolées, on enlevait les câbles des réseaux électriques et téléphoniques sur plusieurs kilomètres, parfois même les caténaires des lignes de chemin de fer, ce qui perturbait considérablement le trafic des voyageurs, occasionnant des retards importants qui irritaient les usagers des chemins de fer.
La rumeur publique et l’opinion populaire soupçonnaient et même accusaient presque automatiquement les gens du voyage de ces méfaits. Ils étaient des coupables commodes et désignés d’avance. C’était un peu trop facile, mais ce n’était pas toujours injustifié. Récupérer de la ferraille et la revendre était l’un de leurs gagne-pain traditionnels, et certains d’entre eux, surtout les plus jeunes, s’étaient laissé aller à des vols dans des entrepôts, et leurs méfaits alimentaient régulièrement la rubrique des faits divers et les chroniques judiciaires dans les journaux locaux. Nous n’irons pas jusqu’à écrire ici que les gens du voyage étaient autorisés à récupérer les métaux dans les bennes des déchetteries, mais il est clair qu’ils jouissaient d’une étrange tolérance. Il y avait là, surtout, un équilibre de la peur et même un véritable terrorisme. Si on ne les laissait pas faire, certains d’entre eux, nous disons bien certains d’entre eux, saccageaient les installations, mettaient le feu aux bennes, menaçaient les gardiens et leurs familles, crevaient les pneus de leurs voitures et barbouillaient leurs maisons. Il y avait aussi, sans doute, un calcul de la part des autorités, la volonté de préserver une petite économie parallèle, une économie de survie indispensable à de nombreuses familles dans le besoin, et précieuse pour la tranquillité générale et la paix civile.
Très souvent aussi, sans pour autant être une règle générale, mais de nombreuses enquêtes, beaucoup d’affaires jugées à Morlaix, à Brest, et un peu partout ailleurs, et quantité de vérifications l’ont clairement démontré, des gardiens de déchetteries, au mépris des clauses de leurs contrats d’embauche et des mises en garde et menaces de leur hiérarchie, se servaient les premiers dans les bennes qu’ils étaient censés garder, récupéraient les objets les plus intéressants, utilisaient leurs proches ou des prête-noms pour écouler la marchandise à des grossistes en ferraille ou à des brocanteurs. La plupart d’entre eux possédaient de petits véhicules utilitaires, repéraient les objets de valeur et les ramassaient discrètement entre deux passages d’usagers de la déchetterie. L’examen des registres réglementaires des établissements qui leur achetaient la ferraille, à Garlan, à Plougourvest, à Plouigneau, à Saint-Martin-des-Champs et au port de commerce de Brest, ne laissait planer aucun doute là-dessus. Les gens du voyage arrivaient ensuite, soit acceptés ou tolérés par les gardiens ou en affaires avec eux, soit imposant leur présence par la force et le chantage. Au bout du compte, un petit récupérateur amateur, comme René Lethierry et ses concurrents habituels, tout en bas de la pyramide, n’avaient pratiquement aucune chance de trouver des pièces de valeur, ou alors par miracle, enfouies et oubliées. Il ne leur restait que le dernier choix, souvent l’acier et la fonte. Beaucoup de poids et beaucoup d’efforts pour finalement peu de rapport. L’écrémage avait été fait depuis longtemps et même à plusieurs reprises. C’étaient pourtant ces derniers qui étaient inquiétés, poursuivis et parfois condamnés. Les autres opéraient en une relative impunité, une impunité d’évidence organisée.
Or, ce soir-là, 12 avril 2013, vers minuit, dans les rafales furieuses du vent d’ouest et la pluie glacée, René Lethierry, transi de froid et épuisé, en avait enfin terminé de sa fouille dans la benne à ferraille, s’apprêtait à se hisser sur la plate-forme à la force des bras, lorsqu’il entendit un bruit au-dessus de lui, une sorte de raclement sourd, et redressa la tête. Dans le petit faisceau de sa lampe frontale, il vit fondre sur lui une lourde masse qu’il reconnut en un éclair, l’embrayage de voiture qu’il avait fait monter quelques minutes auparavant et au prix d’un violent effort. Il n’eut pas le temps d’esquisser le moindre geste pour se protéger. Ce fut immédiat et brutal. Sa tête explosa. Il s’écroula en avant sur la pointe acérée d’un fer à béton dressé qui lui transperça le corps et repoussa dans son dos le cuir de son blouson en un étrange petit chapiteau. L’homme à la veste et au pantalon de treillis ne prit même pas la peine de jeter un regard dans la benne, tourna vivement les talons, cracha par terre et s’éloigna à grands pas vers le couvert des grands pins parasols qui bordaient la route, puis s’évanouit dans la nuit.
II
Lundi 15 avril 2013. Commissariat de police de Morlaix, place des Halles.
Le commandant de police judiciaire, Guillaume Le Fur, ce lundi matin, un peu avant huit heures, rangea sa Clio de fonction sur le parking privé du commissariat, place des Halles à Morlaix, et escalada, quatre à quatre et d’un seul élan, la volée de marches de l’escalier qui mène à la porte principale. Il pleuvait, il avait plu toute la nuit, et le pavé de la ville était brillant et gluant. Guillaume en était, aux abords de la cinquantaine, à l’heure des bilans personnels et du regard en arrière sur son parcours et sur sa vie. Gamin pauvre de l’école communale où on lui avait interdit de parler breton, sa langue maternelle, au prix de quantité de brimades physiques et morales, puis lycéen boursier et encore étudiant besogneux, obligé de faire, ici ou là, de petits travaux pour payer ses études, il était entré dans la police autant par nécessité que par vocation. Il aurait pu, tout aussi bien, être enseignant, il aurait sûrement préféré être professeur de littérature, militaire ou encore inspecteur des impôts. Pour un enfant pauvre de sa génération, l’ascenseur social, comme on dit aujourd’hui, passait, évidemment, par l’école publique et, presque nécessairement, par une carrière de fonctionnaire.
Il avait dû, comme tout le monde, se débrouiller avec quelques accidents de la vie, des deuils et des trahisons, violentes ou, feutrées, les pires, et saisir la chance quand elle passait. Il se souvenait de ses années d’études à l’École de police et des années passées aux Renseignements Généraux à Rennes, sa première affectation, occupé jour et nuit à surveiller des responsables syndicaux, ouvriers, étudiants et lycéens, à pister des autonomistes bretons qui réinventaient une Bretagne de rêve et parfois d’opérette, le verre de cidre ou de chouchenn à la main, dans les arrière-salles enfumées des nombreux cafés de la rue de la Soif. À chaque occasion, il produisait des rapports où le jeu consistait essentiellement, à la demande de sa hiérarchie, à diviser par deux ou par trois le nombre des participants à toutes les manifestations de rue, ruse et mensonge habituel des statistiques devant complaire aux gouvernements successifs, de gauche comme de droite. Guillaume Le Fur, souvent à son corps défendant, avait été le témoin de tant de magouillages et savait tellement de choses…
Après le décès accidentel de sa femme Agathe, dont la voiture était tombée dans un canal de la périphérie de Rennes, au retour de son travail d’infirmière, un petit matin glacé de neige et de verglas, il avait quitté la Bretagne et fait à Paris une longue et brillante carrière d’enquêteur, avait gravi échelons et grades, avant de demander et d’obtenir, quatre ans auparavant, sa mutation au commissariat de Morlaix. Il était au sommet de sa carrière et, de toute façon, n’avait aucune envie ni aucun besoin d’aller au-delà. Il était satisfait de sa situation et de son salaire, l’argent n’ayant que peu d’importance pour lui. Suite à une récente réforme, encore une, se disait-il, la police avait pris les grades de l’armée. Il préférait à son nouveau grade de commandant son appellation antérieure d’inspecteur divisionnaire. Mais ce n’était pas si important et il avait fini par s’y s’habituer. En lecteur inlassable des philosophes stoïciens de l’antiquité grecque puis romaine, il classait les événements et les aléas de sa vie en deux catégories, ceux qui dépendaient de lui et sur lesquels il avait une certaine prise, et ceux qui n’en dépendaient pas et contre lesquels il était vain de lutter. Il prenait donc certaines choses comme elles venaient, souvent avec le sourire. Ainsi, presque chaque jour, il avait grande pitié de tous ceux qui se plaignaient sans arrêt du temps qu’il faisait ou qu’il allait faire et n’avaient guère d’autre sujet de conversation. Guillaume Le Fur prenait les jours comme ils venaient.
Guillaume, malgré un travail quotidien où primaient l’action et le mouvement, était un homme de culture et de livres. À la différence de la plupart de ses collègues de travail qui passaient leurs soirées à regarder des séries télévisées, particulièrement des séries policières, comme s’ils n’en vivaient pas assez sur leur lieu de travail, Le Fur refusait de tuer ainsi le temps et de s’encombrer la tête de tels spectacles. Il faisait un tri sévère dans les programmes. Il lisait sans arrêt, se sentait mal à l’aise quand il n’avait pas un livre à portée de la main ou dans la poche, et, tout récemment, satisfaisant un besoin ancien, s’était lancé pour de bon dans l’écriture. Il avait décidé de narrer ses enquêtes ou celles de certains de ses collègues, en les romançant quelque peu, et se préparait ainsi un passe-temps et un amusement pour sa retraite. Il pouvait compter sur l’aide et l’attention amicale de Jean-Marie Kerguidu, son vieux professeur de français au lycée Tristan Corbière à Morlaix, à qui il rendait régulièrement visite au port de Carantec et montrait ses premiers balbutiements de romancier, qui lui donnait des leçons d’écriture et lui prodiguait conseils et critiques fermes mais bienveillantes.
Il avait encore, à cinquante ans passés, une santé et une condition physique assez étonnantes. Il faut dire qu’il la cultivait et la méritait, pour avoir pratiqué avec bonheur quantité de sports, pratiquait encore le vélo et surtout la course à pied, presque tous les jours, comme une sorte de drogue, partout et par tous les temps. Il aimait nager, était ceinture noire de judo et de karaté et diplômé de plusieurs autres arts martiaux, bien utiles dans l’exercice de son métier. Il était cultivé et large d’esprit, tolérant et bienveillant par nature et par art. On l’avait toujours jugé, et dès l’école primaire, comme remarquablement intelligent, ce qui l’avait toujours fait sourire, car il n’avait jamais su à quoi cela correspondait exactement. Il se manifestait rarement et, de l’avis général, cachait assez bien son jeu. Il avait désormais le cheveu poivre et sel, et on lui trouvait souvent une certaine ressemblance avec l’acteur américain Georges Clooney, ce qui l’amusait, ou l’agaçait parfois, en fonction du niveau et des intentions de ses interlocuteurs, et il disait, en haussant les épaules, que l’acteur en question, plus jeune que lui, avait bien de la chance de lui ressembler. Il avait un humour subtil ou dévastateur, les femmes lui trouvaient beaucoup de charme, et la plupart des hommes le jalousaient ou se méfiaient de lui. Mais dans l’exercice de son métier de policier, il jouissait d’un respect général, voire d’une certaine admiration, surtout de la part de ses plus jeunes collègues. Il était pour eux un modèle vivant, et en était conscient, les conseillait, les aidait et les accompagnait du mieux possible, désintéressé et amical.
Guillaume Le Fur considérait, à juste titre, qu’il existe deux sortes d’officiers de police. Les uns, les plus nombreux, dans leurs bureaux tranquilles et bien chauffés, très à leur aise, marinent dans la paperasse, traitent des dossiers à la suite, les empilent et même les entassent avec le sentiment et l’absolue satisfaction de contribuer à alimenter des statistiques que le pouvoir politique en place, quelle que soit sa couleur, utilise pour sa communication, pour forger son image et, le plus souvent, pour la redorer auprès des électeurs, quand d’autres, sans doute par vocation, et toujours par choix, préfèrent travailler sur le terrain, vivre la rue, la ville et ses problèmes, et continuent encore, un peu à leur manière, à jouer au gendarme et au voleur. De toute évidence, Guillaume Le Fur était de ceux-là, était dans tous les coups, même les plus durs, n’avait peur de rien, car prudent par nature. Il n’était jamais armé sauf pour quelques interventions à risque, où sa hiérarchie et le danger l’imposaient. La plupart du temps, son arme de service restait dans le tiroir de son bureau. Il estimait avoir très largement les moyens de se défendre par lui-même et se fiait toujours à sa bonne étoile.
Guillaume Le Fur donc, Lomic, pour quelques très proches exclusivement, abordait, ce matin-là encore, une nouvelle semaine d’un travail rendu de plus en plus compliqué par la montée de la violence sociale et familiale, liée au chômage, à la perte générale de repères moraux, à l’alcoolisme et à l’usage de stupéfiants. On assistait aussi depuis quelques mois à une recrudescence des vols et des cambriolages avec effraction chez les particuliers, une véritable industrie, souvent l’œuvre de bandes bien organisées, parfois étrangères à la région. Il écrivait rapport sur rapport et commençait à avoir besoin de vacances. Les dernières remontaient au mois de juillet de l’année précédente et elles étaient déjà bien loin…
* * *
Vendredi 12 juillet 2012. Oléron. Saint-Palais-sur-Mer.
En effet, Guillaume avait été invité à Saint-Denis-d’Oléron au mariage de Muriel, la sœur d’un jeune Charentais, Guy Noais, qui, dans une enquête antérieure, l’avait aidé à confondre et à arrêter un réseau de passeurs d’immigrés clandestins à Carantec.1 Son amie Stéren, alors secrétaire au commissariat, sa petite étoile du soir, dont le mari, ingénieur aux pétroles, était une fois encore en déplacement aux antipodes avait réussi à se libérer et à l’accompagner. Elle avait dû placer ses deux jeunes enfants auprès de leurs grands-parents paternels au prix de mensonges et de laborieuses contorsions diplomatiques et avait prétexté un stage de formation. Guillaume, au mois de mars, bien à l’avance, avait loué un petit appartement face à la plage de Saint-Palais-sur-Mer. Ils prenaient des bains de mer, pourtant encore bien fraîche, alternaient grasses matinées agréables et petites excursions dans la région. Ils avaient visité le zoo de La Palmyre et avaient pris le bateau pour le phare de Cordouan, dans l’estuaire de la Gironde, que Guillaume avait déjà visité quelques mois auparavant. Ils restaient longtemps attablés aux terrasses, à regarder les gens passer et à contempler la mer derrière leurs lunettes de soleil.
Mais la tête sur son épaule n’avait plus le même poids, ni ses baisers la même chaleur. Guillaume ressentait comme une retenue, une nuance. Elle semblait toujours inquiète pour ses enfants, et remplie de méfiance vis-à-vis de son mari et de ses beaux-parents. Elle n’était plus tout à fait là. Elle avait des réactions nouvelles, semblait avoir peur et regardait autour d’elle comme si quelqu’un pouvait les voir ou les surprendre. Plus intimement aussi, et même aux moments les plus secrets de leur relation, Guillaume percevait une modification de son comportement, une sorte d’absence, de distance et comme une volonté ou une nécessité, sinon de se détacher de lui, du moins de le garder à distance. Il s’en désolait secrètement, souffrait en silence, meurtri au plus profond de lui-même, et il se disait que tout cela augurait, pour eux, d’un avenir compliqué et incertain.
* * *