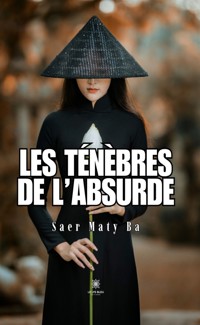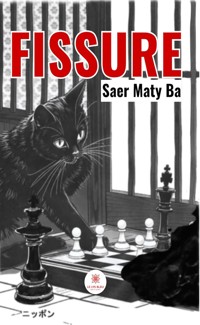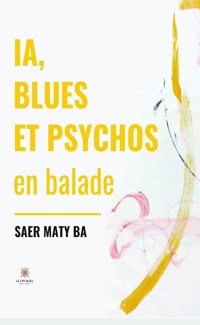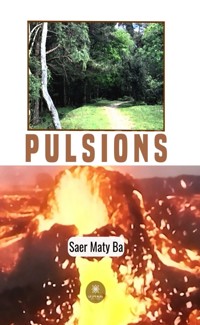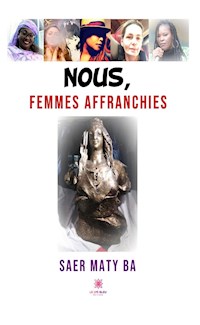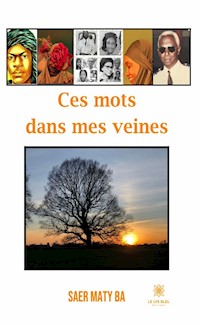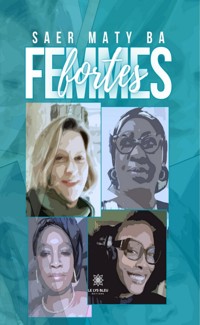
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Une radio privée fondée et dirigée par des hommes lance une série de podcasts mensuels exclusivement destinés aux femmes, intitulée Femmes fortes. La première question, d’intérêt national, frappe d’emblée : « Comment va notre pays ? » Quatre voix féminines sont choisies par une productrice pour alimenter le débat. Une écrivaine interroge : « De quel pays parlez-vous ? » ; une cinéaste explore « identités et existences » ; une animatrice culturelle prône « un dépassement épistémologique » ; une activiste défend l’idée de « l’insubordination ». Un échange vif et audacieux qui promet de bouleverser les perspectives.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Saer Maty Ba enseigne le cinéma, les études culturelles, l’anglais avancé ainsi que les littératures et civilisations anglo-saxonnes. Il explore à travers le prisme de l’écriture des thèmes qui lui tiennent à cœur, notamment la condition de la femme. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels le recueil de nouvelles "Nous, femmes affranchies", paru en 2022 aux éditions Le Lys Bleu.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Titre
Saer Maty Ba
Femmes fortes
Récit
Copyright
© Lys Bleu Éditions – Saer Maty Ba
ISBN : 979-10-422-5401-8
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Dédicace
Si l’encre est bonne, la plume belle,
c’est grâce à toi.
Si d’un désert a jailli une source intarissable,
c’est grâce à toi.
Si l’Oxydant a zappé sur mon métal,
c’est encore grâce à toi, l’introduction,
le développement et la conclusion ouverte de tout.
À ton ombre, j’ai grandi, appris, assimilé, appliqué.
Patiente, modeste dans ton érudition,
tu ne te prenais jamais trop au sérieux ;
pédagogue pleine de foi, d’amour et de compassion,
tu as su donner sans compter,
tu as su bien guider sans en avoir l’air.
Toujours as-tu cru fermement en mes frères et sœurs
et moi-même, toujours as-tu su tout de nous, jour après jour, puis, en une aube naissante, tu t’en es allée sans bruit,
ci suturë… mais, chère Maman,
tu ne seras jamais vraiment partie car tu nous as écrit,
tu nous as parlé et tes paroles pleines de sagesse
résonneront toujours en notre sein.
Alors, chère Maman, je te remercie du fond du cœur !
En attendant notre « rendez-vous au prochain rayonnement », repose en Paix, Femme forte ! amour éternel pour toi.
Le joyeux dialogue des altérités pour l’avènement d’un humanisme universel.
Fatou Diome
Préface
Dans un monde où les voix féminines se battent pour émerger, Femmes fortes de Saer Maty Ba se présente comme un écho nécessaire et percutant. Ce récit audacieux nous plonge dans les coulisses d’une radio privée, contrôlée par des hommes qui, tout en se revendiquant féministes, tentent de définir ce que signifie être une femme forte, à travers des profils de femmes qui vont nous tenir en haleine. À travers cette configuration, Ba interroge les dynamiques de pouvoir et les paradoxes qui habitent les discours sur le genre, la culture et l’identité.
En effet, ces femmes, au regard empreint de force et de douceur, s’élèvent au-dessus des ombres du passé pour nous plonger immédiatement dans une célébration, à la fois de l’héritage et de la résilience. Symboles de toutes les luttes, elles évoquent les voix de nos mères, de nos grands-mères, celles qui ont pavé la voie, souvent dans le silence mais toujours avec une détermination inébranlable.
Aussi Femmes fortes, riche en réflexions et en nuances, ouvre-t-il un dialogue essentiel sur l’identité, la laïcité et les héritages complexes de la post-colonisation. Loin de se limiter à une simple critique sociale, l’œuvre de Ba plonge au cœur des dynamiques de pouvoir qui façonnent nos vies, tout en honorant la voix de celles qui ont été trop souvent réduites au silence. Sa plume affûtée nous pousse à réfléchir sur notre propre identité, notre place dans le monde et les luttes à venir. Autrement dit, en ouvrant ce livre, le lecteur est invité à une exploration non seulement des défis contemporains, mais aussi des voix qui résonnent au sein de chaque page. Femmes fortes est un hommage à toutes ces femmes, à leurs histoires et à leur force ; c’est une invitation à écouter, à apprendre et à comprendre.
Femmes fortes se distingue également par sa capacité à tisser des récits complexes, révélant les enjeux pressants de la post-colonisation en même temps qu’elle questionne les fondements mêmes de la laïcité et de la culture. Loin d’être un simple divertissement, l’œuvre de Saer Maty Ba est un miroir critique qui réfléchit les luttes et les aspirations des femmes d’aujourd’hui, tout en permettant aux lecteurs de s’interroger sur la place qui leur est réservée dans une société en constante évolution.
Fort de son expérience en tant qu’universitaire et chercheur culturel, Saer Maty Ba nous offre une écriture raffinée, teintée d’une sensibilité aiguë. Ses réflexions s’appuient sur de longues années d’enseignement et de recherche, lui permettant d’aborder des thématiques complexes avec une profondeur et une clarté qui séduisent et provoquent.
À travers Femmes fortes, Ba ne cherche pas seulement à raconter une histoire, mais à établir un dialogue – un dialogue qui, nous l’espérons, continuera à résonner bien au-delà des pages du livre. Le lecteur y est convié à une exploration audacieuse des réalités féminines, à une remise en question des stéréotypes et à une célébration des forces invisibles qui habitent chacune d’entre nous.
Grâce à une prose incisive et une narration captivante, Saer Maty Ba nous entraîne ainsi dans un univers où les apparences se révèlent souvent trompeuses : l’idée d’une radio, fondée par des hommes qui se disent féministes pour cibler une audience exclusivement féminine, pose une question essentielle : qui a réellement le pouvoir de parler au nom des femmes ? Ce récit ambitieux et surtout atypique nous pousse à réfléchir sur les paradoxes du féminisme actuel et les dynamiques de contrôle qui persistent dans la société : il percute !
Hadjara Cissé
Déconstruire les murs que l’on érige.
Abd-Al-Malik
Une réflexion critique sur la notion de culture, sur la pluralité de nos appartenances, sur le caractère problématique de chaque culture et de chaque histoire nationale.
Tzvetan Todorov
La productrice
Précis
Nous ne voulions que des femmes. Des femmes qui ont un métier identifiable : n’importe lequel. Elles devaient aussi être des militantes et interpellées, à la fois par le concept et le contexte d’une France où elles ressentiraient un mal ; être en France et ne plus la reconnaître, être en France et vivre « le drame de se voir quitter par son pays » (Bruno Latour), résider dans une France qui n’est peut-être plus là, en d’autres termes, vivre en France et être sujette à « la détresse solastalgique », une condition tout à fait normale, selon le philosophe Australien Glenn Albrecht, car, ajoute-t-il, « elle indique que vous avez un lien puissant avec votre environnement ».
Les Femmes que nous voulions devaient également nous faire part de la place qu’elles occupent au sein de cette même France. « Comment va la France ? » leur avions-nous posé comme question et elles devaient nous donner une réponse écrite, abrégée (100 mots), réponse qu’elles devaient également lire et nous faire parvenir sous forme d’enregistrement audio ou de film. Celles sélectionnées se virent imposer cinq auteur-e-s, incontournables selon moi et mon équipe, à lire et avec lesquels-l-e-s établir un dialogue critique : Finkielkraut, Diome, Al-Malik, Maalouf et Jullien. Nous leur donnâmes quatre semaines pour s’imprégner de nos auteur-e-s français-e-s et venir en studio enregistrer un podcast pouvant être aussi long qu’elles le souhaitassent, pourvu qu’il n’excédât pas 60 minutes.
« Vous avez une fenêtre de 72 heures pour la pub ; notre radio a d’autres priorités en ce moment – bien plus pressantes ! » nous avaient dit nos patrons, tous des hommes se croyant féministes : annonces postées en ligne et faites à l’antenne, cent contributions au bout de 48 heures, cent-cinquante au bout de 72 et, en fin de compte, cinquante étaient sans qualité ni intérêt pour notre projet, quatre-vingt-dix provenaient d’exhibitionnistes voulant régler des comptes et/ou attiser un sentiment de haine : toutes se sont vues remerciées sans autre forme de procès. Mes collaboratrices et moi-même nous sommes ensuite intéressées aux dix restantes et parmi elles six sortirent du lot dont quatre mirent vraiment le pied dans le plat de ce qui ne va toujours pas en France en ce premier quart de XXIe siècle, tout en identifiant clairement les racines et dynamiques d’un tel état de fait. Ainsi, durant trois semaines et dans le cadre de votre émission Femmes fortes,nous avons eu le plaisir de vous faire écouter quatre podcasts de femmes brillantes. Nous travaillons présentement à essayer de réunir ces dernières pour un débat radiophonique, filmé et diffusé live en ligne… affaire à suivre. En attendant, nous vous souhaitons une bonne lecture de la transcription des podcasts, transcriptions que nos quatre participantes ont eu l’opportunité de vérifier et corriger avant publication.
Toute note bibliographique et autres interventions éditoriales sont de nous, Radio Cultures-Françoise, en collaboration avec nos éditeurs d’Afrique francophone, Yèwwooti Yèwwèti, sous la direction de la féministe et philosophe madame Wuri Pulho, que je remercie au passage. Merci également à nos fidèles auditrices et auditeurs – sans votre généreux soutien, Femmes fortes n’aurait pu être ou jouir du prestige qu’on lui connaît de nos jours !
Khadija de Gouges-Dia
I
L’écrivaine
Quelle France ?
« Quelle France ? » et toute autre question comportant ces deux mots – De quelle France parlez-vous ? Dans quelle France vivons-nous ? etc. – nous habitent sans nous abriter, nous interpellent sans nous hanter, nous remplissent sans nous emplir, nous… voyez-vous, nous sommes d’origine… hm… nous savons que certain-e-s pourraient trouver ce terme… origine s’entend… problématique mais il faut bien commencer quelque part : nous sommes d’origine noire-Kanupienne, oui, nous nous réclamons de Kanupia (Ka pour Kama, Nu pour Nubia et Pia pour Ethiopia) ; 80 % de notre Continent réunifié depuis avant notre naissance en son centre, en notre centre, précisément dans ce pays où la France dit n’avoir jamais commis de crimes durant sa longue colonisation d’une partie non négligeable de notre Continent, à une époque où ce dernier s’était vu balkanisé à outrance.
Nous sommes devenue Française par naturalisation. Appelez-nous Marianne, Marianne Abéga, une Kanupienne-Française qui va vous parler de la France et des Français, notamment et pour commencer, à travers le roman satirique Au pays du p’tit dans lequel un sociologue et universitaire français du nom de Romain Desseyn déclare que « dans tous les domaines, nos retards étaient imputables aux crispations de Blancs sur des valeurs laïco-christiano-républicaines qui ne concernaient (…) qu’eux-mêmes ».1 Ici, Desseyn cible l’emploi, l’économie, l’éducation et le rayonnement culturel, avant de diviser les Français en « Blancs » et « non Blancs » dans le but de résumer et d’imputer les malheurs modernes de la France à l’inaptitude des premiers à prendre les seconds au sérieux, « une fois pour toutes ». La France serait malade quelque part, les Français aussi et ce n’est pas nous qui contredirions monsieur le sociologue fictionnel, vu que de nos jours le constat de son géniteur, nous avons nommé l’auteur Nicolas Fargues, pourrait encore se vérifier si l’on sort d’une/de la fiction qui, soit dit en passant, aura dépassé une/la réalité. Car, peut-être bien que l’élément chrétien du son triptyque constitutif (sur lequel je reviendrai) n’a plus tellement droit de citer au sein du débat public sur ce qu’est la France – de ce qu’est « France » tout court – contrairement à « laïcité » et « république ». Ainsi, crucial devient-il pour tout argument sur le sujet « France » d’aborder ces deux derniers concepts, des berges de sables mouvants délimitant un cours d’eau houleux, féroce et qui ne cesse de les inonder, au même moment que lesdites berges engloutissent progressivement leurs pensionnaires : c’est-à-dire, Blancs comme pas Blancs. (NB : le préfixe « non » nous gêne, parce que Blanc ne nous est point utile pour être ou pour signifier. Donc, nous usons volontiers du préfixe « pas ».) Ce double mouvement d’inondation et d’engloutissement implique une nécessité d’émettre des réserves et de se pencher sur « France » d’abord, puis « république » et « laïcité » ensuite.
Dans cet ordre d’idées, laissez-nous d’abord vous dire que nous la connaissons à ma façon, cette France ; nous avons été auxiliaire de vie préparant des repas de cantine scolaire pour jeunes élèves. Nous avions des journées éprouvantes, parce qu’intensives et bruyantes, mais aussi des journées plaisantes car courtes et faites de travail facile pour nous qui savions cuisiner dès notre jeune âge. Et puis, tous les moyens et ingrédients permettant de bien effectuer ce travail étaient mis à notre disposition, moi et mes deux gentilles collègues Yasmina et Olympe. Ensuite, nous avons fait et réussi un concours d’aide-soignante dans une petite bourgade en Aquitaine (oh, quel racisme virulent ai-je rencontré lors de mon stage de formation !) Les femmes sont d’habitude des animales sociales très spé, espiègles, gentilles, médisantes et cruelles entre elles, mais lorsqu’elles sont racistes, leur toxicité devient exponentielle. Enfin, nous avons travaillé dans plusieurs maisons de retraite, communément nommées EHPAD en France, pendant une dizaine d’années intensives durant lesquelles nous avons passé des moments difficiles, mais aussi des instants de joie et de bonheur partagés avec les résident-e-s et mes collègues « issues de l’immigration » (pour employer un terme-tonneau-vide, encore en vogue en France) mais aussi celles Blanches (quelques-unes) en mal d’exotisme et/ou en quête d’expérience professionnelle auprès de nous autres. Durant ces dix années, nous avons dû changer de régions, d’arrondissements et d’établissements. Ensuite, lorsque notre corps et notre mental devinrent fortement éprouvés, à la fois par notre travail et un amant accro au sexe (que nous avons quitté !) nous réduisions notre activité professionnelle à mi-temps, ce qui nous donne aujourd’hui la possibilité de prendre le temps de vivre, de revoir notre CV en vue de jobs plus légers, de nous adonner à nos passions, parmi lesquelles nous comptons la lecture (autant que nous pouvons, tous les jours, fatiguée ou pas, virus attrapé dès notre enfance en Kanupia) et le cinéma. Nous la connaissons, disions-nous, cette France dont Vincent Duclert nous dit qu’elle « est une forme (…) sensible et intellectuelle à la fois, composée de populations, de générations, de cultures, de mémoires, de temps, de langues, de territoires, de saisons, de lumières, de rivages, de frontières. Un inventaire (…) sur lequel viennent s’exercer l’imagination et la raison pour rassembler ces fragments d’un sentiment amoureux. L’expérience de l’attachement, qui peut être aussi celle de la déception, de la douleur, décrit une France imaginaire. Mais parce qu’elle s’exprime, elle devient réalité ».2
Par nature, toute définition est toujours déjà limitée. Celle de Duclert pose davantage problème, par le truchement de sa présomption presque perverse qu’avec « France » l’unique poétique de relation possible est un sentiment amoureux, qui plus est, un sentiment fragmentaire, fragmenté, décevant, douloureux. « France » ne pourrait donc être la cible d’émissions de réserves ou de désapprobation, deux notions ou faits mort-nées et/ou larguées par la fenêtre conceptuelle de ladite poétique, si nous suivons bien Duclert qui semble approcher « France » de manière tronquée. Une approche bancale parce que « France » a beau pouvoir réveiller le for intérieur de notre conscience, elle n’en reste pas moins incapable d’assumer ou de prétendre nous amener, en moutons de Panurge inaptes, comme qui dirait une dictatrice Staliniste, « à concevoir un récit de filiation, d’adoption, d’appartenance »3. Une coercition qui, si elle était avérée et absolue, aurait poussé notre homonyme (Marianne, sa mère !) à porter plainte. Bonjour chère collègue écrivaine Diome, issue de l’immigration (rire) ! Fatou est notre collègue, la vôtre également, si, comme nous-mêmes, très tôt en Kanupia, puis en France durant tout le temps que nous y avons déjà passé (des cantines scolaires aux EHPAD), vous avez voulu être écrivaine – nous l’avons voulu – nous qui avons grandi avec à disposition une bibliothèque familiale bien fournie mais et c’est peut-être un grand mais, une ne comptant que des écrivains français : aucun de Kanupia et du reste du Continent. Depuis, nous avons écrit et caché, écrit et déchiré, écrit et proposé à des maisons d’édition et subi des rejets en cascade. Nous avons toutefois persévéré, jusqu’à être considérée aujourd’hui comme l’une des écrivaines Kanupiènne-Françaises les plus reconnues, même si nous devons avouer ne pas comprendre tout ce tintamarre autour de ma plume, que nous avons toujours voulu légère, fluide mais piquante telle une guêpe, pendant que nous écrivons pour expier des péchés que nous n’avons pas commis, pendant que nous écrivons pour nous sentir vivre, pendant que nous écrivons pour être pseudo-pseudo (RIP, Romain Gary), pendant que nous écrivons pour glisser sur les Lettres telle l’eau de marigot sur le dos d’une canne nonchalante. Alors, bonjour Diome Fatou, notre collègue, nous reviendrons sur votre pamphlet. En attendant, nos réserves vis-à-vis de la France de l’historien Duclert nous imposent un arrêt sur ce que « république » représente selon lui.
« République » – les Lumières et la Révolution de 1789 sont les deux mamelles d’où l’historien tire que « Les libertés et droits fondamentaux constituent progressivement le bagage commun des Français et de ceux qui souhaitent le devenir. Le régime de la République paraît épouser cette définition politique de la France et permet d’instaurer un nouveau code de valeurs nationales, non plus l’héroïsme conquis sur le champ de bataille mais la dignité de l’instituteur, le courage de l’intellectuel, la résilience de l’orphelin ».4 Une telle définition cause de sérieux problèmes, Duclert en est conscient, à savoir qu’à n’en point douter la France possède un héritage, en même temps que tout héritage peut être perdu et dans ce cas devra être reconquis au prix fort et, nous dit Duclert, être en mesure de remettre en question « les usages des valeurs définissant la nation France ».5 Pour ce faire, nous dirions qu’il est inutile de se cantonner nostalgiquement aux ambitions principielles de la IIIe République ; plus utile nous semble être le fait de revoir les limites de leur application, les contradictions de leur contemporanéité, en posant les bonnes questions comme, par exemple : où (en) sont les femmes en politique ? L’horrible Code de l’Indigénat a-t-il des conséquences dans la vie des jadis-colonisés-par-la-France et de leurs états/pays/nations artificiellement créés et soi-disant indépendants aujourd’hui ? Le système arbitraire d’incarcération, du type bagne, est-il révolu ? Enfin, dans la République française, la logique économique domine-t-elle encore « les garanties individuelles » de Duclert ?6
La République a certes sa dimension arbitraire. Néanmoins, pour efficacement mobiliser les valeurs démocratiques de cette même République et contrer une démocratie en chute (libre ?) comme le préconise Duclert, il faudrait d’abord que lesdites valeurs soient passées au peigne fin, combattues, pénétrées et vidées de tout superflu, re-conceptualisées, re-perçues. Bref. Il faudrait faire un travail de fond sur « France » et « république » car le fait qu’un valeureux enfant-poète français aille jusqu’à pleurnicher son abandon républicain, « République, Ô ma république, mais pourquoi donc ne m’as-tu pas dit que tu m’aimais ? »7 rend impératif le fait de (res) sentir que (la) république propose un prélude doublé d’une vase nauséabonde de vomissures et que les propos du même enfant-poète transpirent cette proposition.
Nous n’étions ni enfant ni poète en arrivant en France à l’âge de 18 ans, mais nous pouvions et pouvons comprendre le désarroi d’Abd-Al-Malik. Nous aurions pu vivre ce désarroi aussi, si ce n’était notre freedom, notre liberté d’être, férue de musique Rap, tombée sous le charme de la branche révoltée-je-m’en-fous-hardcore de son articulation hexagonale, notamment de NTM. (ah, Joey Starr et Kool Shen : des As lyriques !) NTM dont l’album Paris sous les bombes inspira notre nouvelle Qu’est-ce qu’on attend ? hélas jamais publiée (nous avons écrit et déchiré, disions-nous tantôt). Nous avions été également éprise de IAM, surtout après Je danse le Mia qui nous a fait bien bouger en boîte et dans les tonus, amoureuse d’Alliance Ethnik et enfin de MC Solaar qui, aimions-nous déclarer, nous a aidée à canaliser et orienter notre énergie et nos ambitions vers du positif, à ne pas être distraite par le racisme et à relativiser notre perte de statut social car, voyez-vous, c’est en bourgeoise-moyenne que nous vivions en Kanupia. Et, pensais-je naïvement, nous allions très vite retrouver ce statut dans l’hexagone de la République « France », mais le climat n’y a jamais été propice, la réalité « France » dépassa vite notre propre fiction et, sans demander à Allah de bénir la France, parce que c’est la bénédiction des jeunes Noir-e-s comme nous qui m’importait plus que tout. Nous avons commencé à comprendre de quoi le rappeur de Neuhof, Abd-Al-Malik, retournait, projet d’écriture après projet d’écriture, ce qui aujourd’hui nous permet de vous confier que ses prises de position dans le long essai Place de la république sont apparemment naïves.
Cela dit, pour nous (r) amener à « république », Abd-Al-Malik touche du doigt un autre triptyque très problématique – « liberté, égalité, fraternité » – à propos duquel il fait remarquer de manière incisive que l’isolement et/ou la séparation de ces éléments les uns des autres entraînerait la négation de la république et de la démocratie.8 Autrement dit, à travers ce triptyque de concepts (ce ne sont pas des « mots », cher frère), Abd-Al-Malik pose une équation relative aux conditions de fonctionnalité de « république », trois notions qui sont à la fois ses synonymes et sa définition collective. Et pourtant, ce triptyque a été et est d’emblée dysfonctionnel, que ce soit avec le sociologue de Fargues (fiction) ou entre les mains d’Abd-Al-Malik (réalité) qui décrit et décrie la condition de celles et ceux qu’il appelle « Français issus de l’immigration »9 (et voilà que nous revient le tonneau vide, rires). Nous déduisons provisoirement de tout ceci que chaque concept du triptyque pourrait être respectivement substitué par les trois qualificatifs que sont « provisoire », « dérisoire » et « aléatoire ». Une déduction en elle-même transitoire, jusqu’à ce que d’autres types d’exemples aptes à justifier notre insistance sur le caractère dysfonctionnel de « liberté, égalité, fraternité » soient fournis, exemples dont la riche histoire du cinéma français regorge. En voici deux que nous allons considérer brièvement : L’Afrance et La Haine.10
Dans L’Afrance, à cause des problèmes de carte de séjour, un étudiant sénégalais nommé El Hadji se retrouve en centre de rétention. Bien qu’ayant eu l’intention de retourner au Sénégal une fois ses études universitaires terminées, ce qui n’est pas encore le cas, El Hadji est en proie à de nouvelles interrogations pressantes, à savoir, doit-il rester en France sans papiers, rentrer chez lui sans diplôme, ou se lier à une Blanche par mariage blanc pour, à la fois obtenir des papiers et son diplôme ? Ainsi, stricto sensu, probant devient ce film parce que mettant en exergue des éléments constitutifs de la France, de la République française où El Hadji se meut, éléments pour le moins nostalgiques-naïfs et idéalisés (en dehors du film, s’entend) au point de coller parfaitement aux aspects dysfonctionnels de « république » que nous aurons rencontrés jusqu’ici. La Haine, en relatant pendant vingt-quatre heures les tribulations de trois jeunes Français d’une cité, emprunte un chemin épistémologique similaire à celui du film de Gomis. Qui plus est et hélas, le film de Kasso sonne encore vrai plus de vingt-cinq ans plus tard, comme beaucoup d’autres films français tels que Ma 6-T va craquer ou Banlieusards ;11 La Haine résonne bien encore car, pour Vinz, Saïd et Hubert, ses personnages, la laïcité de la République française est un concept dénoué de substance et de sens. Aussi, penser cette laïcité comme étant synonyme de spiritualité, ou conceptualiser la spiritualité comme laïque, ce que propose Abd-Al-Malik comme solution au et pour le XXIe siècle, n’est que purement puérile pour le « Juif » (Vinz), « l’Arabe » (Saïd) et le « Noir » (Hubert), des Français non aimés de cette même république, mais des Français qui choisissent toutefois de faire autre chose que pleurnicher, contrairement au talentueux auteur de Place de la république.