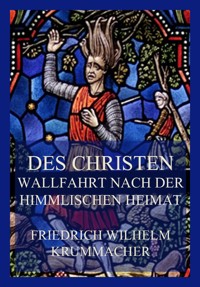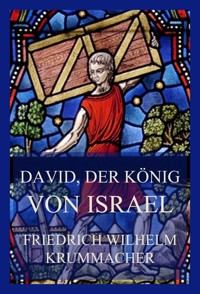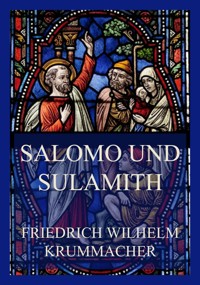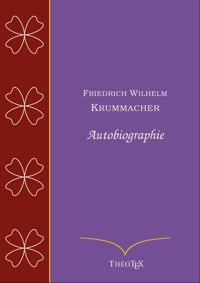
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
La culture protestante évangélique française ne retient généralement de l'Allemagne du dix-neuvième siècle que le triomphe destructeur et arrogant d'un libéralisme théologique qui refusait toute historicité aux miracles et au surnaturel bibliques. Ainsi les noms négatifs de Schleiermacher, de Strauss, de Baur, sonnent de façon vaguement familière à son oreille, même si leurs ouvrages ne sont plus lus par personne depuis longtemps. Cependant il existait aussi à leur époque toute une armée de pasteurs germaniques favorables aux réveils piétistes, et fidèles à l'interprétation traditionnelle de la Parole de Dieu. Friedrich Wilhelm Krummacher, l'auteur d'Élie le Thisbiste, d'Élisée fils de Saphat, de David Roi d'Israël a été un grand parmi eux. Richement doué sur le plan littéraire et poétique, c'est surtout par la fermeté de sa foi évangélique qu'il a eu une influence notable et bénie tant dans les assemblées dont il fut le pasteur, qu'à la cour de Postdam, où il avait pour ami le roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV. Son autobiographie a été publiée après sa mort à partir d'un projet qu'il avait laissé inachevé. Le ton positif et joyeux, les petits portraits d'ecclésiastiques tracés d'une main sûre, les expériences vécues, rendent cet ouvrage d'une lecture agréable et instructive pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Église. Cette numérisation ThéoTeX reproduit la traduction de 1870.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ce fichier au format EPUB, ou livre numérique, est édité par BoD (Books on Demand) — ISBN : 9782322485468
Auteur Friedrich Wilhelm Krummacher. Les textes du domaine public contenus ne peuvent faire l'objet d'aucune exclusivité.Les notes, préfaces, descriptions, traductions éventuellement rajoutées restent sous la responsabilité de ThéoTEX, et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation.ThéoTEX
site internet : theotex.orgcourriel : [email protected]Il fut un temps où les pays de langue française ignoraient absolument l'Allemagne. Ce temps est bien loin de nous. Tous ceux qui scrutent les questions de politique, de science ou de religion, sont conduits, par les besoins mêmes de leur étude, à s'enquérir soigneusement des idées qui circulent au-delà du Rhin. En politique, les événements de 1866 ; en science, les grands systèmes de philosophie idéaliste et les découvertes récentes dues à des travaux de premier ordre ; en religion, la masse énorme de travail que la théologie germanique a produit en notre siècle, ont forcé l'attention de tout esprit sérieux. On peut affirmer que savoir tant soit peu son Allemagne, est aujourd'hui, pour tout homme instruit, une nécessité.
Aussi, les ouvrages destinés à faire connaître ce grand pays se sont-ils multipliés pendant ces dernières années. Ce ne sont pas seulement les revues et les journaux, qui, en publiant de nombreux articles de politique ou de littérature, se sont mis à l'œuvre ; dans tous les camps et tous les partis, réviseurs, traducteurs ou compilateurs, ont travaillé. En religion surtout, on a vu plusieurs de nos auteurs les plus estimés, s'approprier l'érudition allemande, et en reproduire, trop servilement parfois, les principaux résultats. D'autres ne se sont mis en contact avec elle que pour la combattre. Ennemis et amis du christianisme ont puisé dans la littérature religieuse d'outre-Rhin des arguments de tout ordre pour ou contre l'Évangile. Il a paru dans notre langue des traductions d'Olshausen, de Néander, d'Ullmann, de Dorner ; il en a paru aussi de Schenkel et de Strauss.
Est-ce un bien, est-ce un mal que l'influence allemande sur notre littérature religieuse ? Les opinions sont fort divisées à ce sujet. L'Allemagne a des partisans enthousiastes qui ne connaissent qu'elle et sa science ; elle a des ennemis acharnés pour qui rien de bon ne peut venir de Nazareth. La science de nos voisins est aux yeux de ceux-ci la source de tous les maux, et lire de l'allemand c'est presque se perdre. Soyons plus indépendants et plus fiers, ne nous laissons pas éblouir par les prestiges d'une érudition immense, il est vrai, mais qui n'est pas toujours aussi sérieuse par son but qu'elle est patiente dans l'accumulation des matériaux scientifiques. Rappelons-nous que si, au commencement de notre siècle, le réveil de la foi s'est, dans nos pays de langue française, opéré sous l'influence de chrétiens anglais ; c'est l'Angleterre qui a naguère, chez nos voisins et chez nous, provoqué l'avènement du rationalisme. L'Allemagne est un vaste pays où des universités nombreuses entretiennent sans cesse le zèle d'esprits naturellement investigateurs. On y est, dans l'ordre de la pensée, hardi, patient, laborieux. Chaque jour naissent une foule de théories, les unes, hostiles à la foi chrétienne, les autres, au contraire, pleines de respect envers elle. Si, aux yeux de quelques-uns, la science allemande est incrédule et rien de plus, je ne serais pas surpris que pour beaucoup d'autres elle fut plus favorable à la vérité évangélique que la science française, et la science anglaise elle-même. La vérité est entre deux. Ce serait juger avec injustice l'influence de la littérature germanique que de la croire exclusivement favorable à l'incrédulité ou à la foi.
Il est au reste certain que la piété des Allemands affecte des caractères qui manquent généralement à celle des chrétiens de langue française. Nous aimons le grand air et la place publique. Nous sommes entreprenants et décidés, prompts à mettre la main à l'œuvre, et à déployer en tous sens une activité quelquefois fébrile. La polémique, non seulement en parole ou en brochure, mais en action, nous enflamme. Il ne s'agit pas, pour nous, de combattre le rationalisme sur le terrain des idées seulement, mais encore au scrutin, et l'on ne dépense ni moins de soins, ni moins d'activité, ni moins d'argent dans la lutte électorale que dans la presse.
Mais où est le recueillement ? Quelle place prennent dans notre vie, à côté d'affaires dévorantes, la prière, le tête à tête avec Dieu, l'intimité cordiale avec nos frères, la vie intérieure d'une foi qui jouit d'elle-même, la paix mystique d'une âme qui ne s'agite point, mais s'attend à son Dieu ? La piété allemande connaît bien mieux que la nôtre les joies sans ambition et sans fièvre de la foi chrétienne. Elle ne néglige point les œuvres, elle en fait même d'admirables, mais avec une tranquille persévérance que nous ne connaissons guère. On l'accusera de verser du côté du mysticisme ; c'est possible, mais est-ce à tort qu'on nous accuserait, nous, de verser souvent du côté d'une agitation stérile ?
Quoi qu'il en soit, j'estime que le livre dont nous offrons aujourd'hui la traduction à notre public chrétien ne saurait être inutile pour faire apprécier l'Allemagne religieuse à sa juste valeur. Krummacher, l'auteur d'Élie le Thisbite, en dernier lieu prédicateur de la cour à Potsdam, est une personnalité des plus attrayantes. D'une loyauté chevaleresque envers la dynastie des Hohenzollern, ami personnel du feu roi Frédéric Guillaume IV, patriote enthousiaste, Krummacher, par la largeur de son cœur sympathique, par son optimisme et son goût décidé pour la poésie et les arts, par une imagination brillante, qui colorait sa parole des teintes les plus chaudes, peut passer pour un type de l'allemand dans ce que l'allemand a de meilleur. Il a été orateur, écrivain, poète distingué. Sa piété a de la chaleur et de la profondeur tout ensemble. Jusqu'à la fin il a été inébranlable dans sa foi évangélique et dans la vivante affection qu'il avait vouée aux fidèles de tous les pays. Ayant fait ses études à une époque où, malgré le réveil qui éclatait, le rationalisme régnait presque sans contrôle dans la science, il en a connu les principaux représentants et a pu juger l'arbre à ses fruits. Passant de Francfort dans les Églises du Bas-Rhin, de celles-ci à Berlin et de Berlin à Potsdam, il a vu de près et la campagne et la ville, et le peuple et la cour, et les grands et les petits ; il a noué d'intimes relations avec les uns et les autres, et pu peindre, en écrivant sa propre vie, le portrait de beaucoup d'hommes éminents qu'il a personnellement connus. On trouvera donc ici l'Allemagne religieuse de notre siècle, racontée par un véritable Germain, sympathique et clairvoyant tout ensemble, qui nous la fait connaître en sa propre personne, et, parlant sans passion, n'en est que plus digne d'être écouté.
Si le lecteur — et je le désire — éprouve ce que j'ai moi-même ressenti en traduisant l'autobiographie de Krummacher, je m'assure qu'il ne pourra fermer ce livre sans conserver de l'auteur le souvenir le plus affectueux. Il a été conduit, par le cours même de son récit, à émettre son jugement sur bien des hommes et bien des événements. Enfant, il a vu l'Allemagne envahie par les armées françaises, victorieuses ou battant en retraite vers le Rhin après la campagne de Russie. Etudiant, il a visité Halle, foyer du rationalisme à cette époque. Gesenius et Wegscheider ont été ses professeurs. Plus tard, à Francfort et à Berlin, il a coudoyé d'autres savants, théologiens ou prédicateurs, réformés ou luthériens, dont les vues ne lui étaient point sympathiques. Il parle donc de la France, et du rationalisme, des luthériens et du confessionalisme ; grave écueil pour son impartialité.
On reconnaîtra, je l'espère, que, tout en énonçant avec franchise sa pensée de patriote et de croyant, il juge tout sans aigreur, avec une indulgence qui n'est point lâcheté, avec une humilité qui n'est point faiblesse. — Autre écueil ! Krummacher écrivait sa propre vie ! Parmi les autobiographies, combien en est-il où l'auteur n'a pas cédé aux tentations de son amour-propre ? Quand on a joué un certain rôle dans le monde, qu'il est difficile de parler de soi sans se mettre sur un piédestal ! Faire sa propre apologie, se justifier en tout et partout, quelle tentation ! D'illustres exemples nous ont démontré à quel point il est difficile d'y résister. Krummacher, humble, pieux, sincèrement admirateur d'autrui, vivant de dévouement, a évité, sans efforts, semble-t-il, cet écueil presque inévitable. Son livre est l'histoire de sa vie, et il parle beaucoup plus de ce qu'il a vu que de ce qu'il a fait. On le rencontre partout, cela va sans dire, mais on ne sent nulle part la présence d'une personnalité impérieuse ou égoïste qui veut tout absorber en elle. Son âme, heureuse, aimante, joyeuse, se répand. Il raconte sans vanité ses succès, dont il rend gloire à Dieu ; il dit ses fautes, et, ce qui serait une autre manière de s'applaudir soi-même, il ne les étale point.
Aussi, après avoir savouré ces pages, où respire une sorte de candeur poétique, on se sent ému de cette joie morale, pure et vraie, si rare hélas ! aujourd'hui, et qui dilate si doucement le cœur.
Nous l'espérons donc, ce livre servira à faire aimer l'Allemagne chrétienne. Pour en éclaircir le texte, nous y avons ajouté un bon nombre de notes qui contribueront, nous le croyons du moins, à l'intelligence de l'ensemble. Il ne nous reste ainsi que deux choses à faire en terminant cette préface ; adresser nos remerciements à Mlle Krummacher, pour l'aide si bienveillante qu'elle nous a prêtée, et les précieux renseignements qu'elle nous a fournis dans la rédaction de plusieurs notes ; appeler sur cette biographie la bénédiction d'en haut. Puisse la grâce de Dieu en accompagner la lecture pour chacun de ceux qui l'entreprendront !
Comment avoir vécu la durée de deux générations, et entrer dans la soixantième année de sa vie, sans se dire que la fin du voyage approche, que la dernière station est franchie ? Plus de voies nouvelles à ouvrir, plus de grandes entreprises à tenter. L'homme vit alors de ce qu'il a gagné. Il ne doit plus compter sur l'accroissement de son capital spirituel ; les rêves de l'espérance ne lui conviennent plus, et ne pouvant en jeter l'ancre de ce côté de la tombe — car le temps qui lui reste à vivre est trop court — c'est dans le monde des souvenirs qu'il aime à se réfugier. Heureux qui, parvenu au bout de la carrière, peut derrière lui regarder son passé, et devant lui contempler l'avenir sans être troublé ! Heureux qui possède la paix, cette paix, qui n'est pas comme celle du monde, fondée sur la trompeuse assurance des mérites acquis, mais comme celle du vieux Siméon, une paix de Dieu ! Ce ne sont pas toujours des chants de joie que le souvenir éveillera dans son âme. Plus d'une fois, courbant la tête, il s'arrêtera pensif, et les larmes du repentir baigneront sa paupière. Mais toujours, il se relèvera tranquille et fort. Ses justes regrets doivent céder au bonheur légitime dont nous inonde l'éternelle vérité. « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. »
Aux dernières limites du passé, la vie des peuples est voilée d'un impénétrable nuage. La légende et le fait, la poésie et la vérité s'y confondent. Il est impossible de les distinguer avec assurance. Les sept premières années de l'enfance sont ainsi noyées pour nous dans un nuage doré ; c'est un paradis perdu.
Je me l'appelle fort bien, on ne me l'a pas dit, et j'étais alors au berceau, de m'être comme baigné dans la joie de mon père dont je crois voir encore la figure rayonnante. Un jour, — je n'avais pas achevé ma première année, — un violent ouragan s'était déchaîné. Il menaçait sérieusement une vieille tour au pied de laquelle s'élevait la maison de mon père. Une amie de la famille me prit dans ses bras, et m'emporta, à travers la place du marché, dans sa propre demeure, où nous fûmes en sûreté. Cette aventure se grava profondément dans ma mémoire, et c'est même au souvenir qui m'en resta que je dus plus tard d'en obtenir le récit.
Le drapeau tricolore de la République française flottait déjà quand je suis né. On chantait la Marseillaise, cet hymne ardent et solennel, où se respire mieux qu'en aucun autre le fanatisme de la liberté. Ces images d'autrefois sont toutes vivantes dans mon souvenir. Je vois encore, — comme au temps de ma troisième année, — l'arbre planté au milieu de la place. Des bandes d'hommes rugissants, se tiennent par la main et dansent la Carmagnole. Non loin de là stationne l'équipage d'un charlatan français, grand dentiste. Tantôt du haut de son équipage il recommande au public, en mauvais allemand, mais d'une voix tonnante, ses remèdes à tous les maux ; tantôt, pour attirer la foule, il fait gambader un singe, ou débiter par un arlequin de sottes plaisanteries. — Et la salle d'école ! comme je m'en souviens ! je pourrais la peindre. On m'y conduisit avant trois ans révolus ; j'y passais la moitié de la journée, et je n'affirmerai pas que je m'y rendisse toujours de bon cœur. Mais quelle joie quand, en été, la maîtresse d'école revenait tout à coup du jardin ; chargée de rameaux où rougissaient des groseilles ! Avec quel bonheur je m'empressais de réclamer ma branche ! Je le sens aujourd'hui, tenir ces groseilles et les savourer, c'était un plaisir sans doute, mais non pas le seul. Il me semble que ces rameaux, fraîchement cueillis, éveillaient en nous l'amour de la nature libre et souriante ; ils en faisaient sentir aux pauvres petits captifs la généreuse amitié.
Meurs, petite ville située sur le Rhin, était autrefois le chef-lieu du comté du même nom. C'est là que j'ai vu le jour. Un siècle avant moi y était né Gerhard Tersteegen.
Il m'a fallu du temps pour apprendre à être fier de cette ressemblance. Aujourd'hui, il ne se passe guères de journée où je ne répète en moi-même quelque strophe du chant des pèlerins : « Venez enfants, allons, etc. »
L'époque où je naquis était orageuse et sombre. La rive gauche du Rhin venait d'être incorporée à la république des Robespierre, des Danton, des Hébert, ruisselante encore du sang des citoyens et du roi, et ce n'est pas sans une sourde colère que les heureux habitants de ces contrées, héritage du grand électeur, voyaient l'aigle française qu'ils détestaient, remplacer l'aigle prussienne. On n'entendait parler que la langue du soldat : « Voitures, chevaux d'ordonnance, pionniers, exécutions militaires, etc. » Tous les maux de la guerre, et tous ceux qu'entraîne avec elle la domination de l'étranger, se déchaînaient sur le pays. Et pourtant la gaieté et le courage n'avaient point disparu de la maison. Mon père, Frédéric Adolphe Krummacher, directeur de l'école supérieure, attaché de tout son cœur à la maison de Brandebourg, trouvait encore au milieu du tumulte politique, assez de loisir et de présence d'esprit pour ouvrir un journal au nom de son premier-né. Il y inscrivait avec soin toutes les circonstances, même les plus minutieuses, de la vie du nourrisson. Il en racontait, avec une vive reconnaissance envers Dieu, les progrès physiques et moraux. Tel jour l'enfant avait souri, tel autre il avait suivi des yeux un oiseau qui voltigeait dans la chambre, et prouvé par là qu'il avait bonne vue ; tel autre encore il avait prononcé pour la première fois les noms difficiles de maman et papa. Puis une petite vérole terrible s'était déclarée. On avait craint pour les jours de l'enfant. Toute autre inquiétude avait disparu dans ces heures d'angoisse ; la joie de voir enfin paraître les premiers signes certains du rétablissement avait presque fait oublier les calamités nationales, bien que des millions de concitoyens en souffrissent, et qu'on en souffrît avec eux.
A cette même époque, mon père, cherchant dans un monde idéal un refuge contre les fureurs de la guerre, écrivit ses poésies où ne respirent que la paix et l'espérance, entre autres son « Hymne à l'amour. » Que de belles heures il passait alors ! Il nous en a contés les souvenirs. Tandis que le tambour des régiments français faisait retentir nos rues, un petit jardin, dont il avait la jouissance dans le voisinage des ruines du château seigneurial, lui servait de retraite. Là, sous l'ombrage d'un vaste platane, se rencontraient avec lui des amis intimes et de bons voisins. On s'entretenait en des conversations tantôt graves et tantôt piquantes, d'un meilleur avenir. On s'encourageait en parlant de la « restitutio in integrum » qui ne pouvait manquer d'avoir lieu, et l'on chassait ainsi les mauvais rêves du jour présent. Ross, alors pasteur à Budberg, et depuis évêque ; Essler, pasteur de Kapelln, frère à ce qu'on pensait généralement du célèbre acteur du même nom, qui aurait changé la désinence de son nom en « air, » Spiess, pasteur à Duisbourg ; le professeur Möller, beau-frère de mon père, faisaient partie de ce groupe. Tous étaient des hommes jeunes, d'un caractère élevé et noble. Citoyens enthousiastes, ils ne doutèrent jamais de la patrie allemande, et purent en célébrer le triomphe.
Sept années d'une activité bénie s'étaient écoulées à Meurs, quand mon père reçut tout à coup avec étonnement sa nomination de professeur à l'université de Duisbourga. Il devait y enseigner la théologie et l'éloquence. Le docteur Berg, célèbre alors par sa science et sa piété, avait, peu de temps auparavant, quitté ce monde, porté comme en triomphe par sa foi. C'est lui que mon père devait remplacer, et il hésitait, désespérant, dans sa profonde humilité, de pouvoir en aucune manière succéder à l'homme excellent qui l'avait précédé. Après bien des anxiétés, il accepta toutefois. J'avais alors quatre ans. Un frère et une sœur avaient élargi le cercle de la famille. Elle comptait cinq membres quand nous passâmes le Rhin. Je n'ai appris que par tradition avec quelle douleur mes parents quittèrent la petite ville de Meurs, où ils s'étaient si bien blottis. De vieux amis nous accompagnèrent ; une réception cordiale nous fut faite dans notre nouveau séjour ; mais je ne m'en souviens point. Sans doute les sites nouveaux que nous traversâmes occupèrent seuls mon imagination enfantine. Je ne vis ni montagnes, ni vallées, mais des bois, des ruisseaux, des villages, des fermes, des troupeaux, des barques. C'en était assez pour m'éblouir et me faire oublier tout le reste.
Je me rappelle au contraire assez bien les années que nous passâmes à Duisbourg. Dans mes souvenirs apparaissent les amis et collègues de mon père, figures un peu voilées par la distance, originales, étranges même, qui excitaient ma curiosité. C'était le philosophe Plessing, rêveur transcendant, âme généreuse, ami de Gœthe, et son compagnon dans le voyage du Hartz. Il avait frappé à toutes les portes, cherché partout entre le ciel et la terre, et n'avait trouvé de durable que la sympathie de tous ceux qu'attachaient à lui son enfantine simplicité et son originale imagination. C'était Grimm — professor Orientalium — vieux déjà, plaisant, et qu'on surnommait sans malice entre ses amis « Rabbi Rambach. » Il avait le malheur de naviguer dans les eaux du plat rationalisme, et souffrit martyre quand le jeune chevalier Menken, dans son premier ouvrage intitulé : « Démonologie, » bouleversant son échafaudage scientifique, eût rigoureusement prouvé que le diable est autre chose encore qu'un personnage mythique. Cet homme, respectable d'ailleurs et savant, avait la tête de Socrate, et je crois le revoir toutes les fois que mes yeux rencontrent un buste du philosophe grec. — C'était Günther qui, célèbre comme médecin, jouissait, à ce titre, d'une confiance à peine égale au respect qu'on lui témoignait ; on le regardait comme un saint. C'étaient Spiess et Möller. Je les ai bien connus plus tard ; mais, pour moi jeune garçon, c'étaient des hommes qui n'avaient qu'à se montrer, et à parler avec l'esprit et l'humour qui distinguaient leur conversation, pour répandre autour d'eux comme de brillants rayons, le plaisir et la gaieté.
Ces intimes de mon père, appartenaient tous, comme lui, à cette génération près de disparaître, qui s'était fait de l'amitié une religion. C'était surtout le cas de mon oncle Möller, qui fut jeune homme toute sa vie. Il avait reçu le baiser fraternel de Klopstock, de Claudius, de Gleim, et admiré d'autres encore de ces astres de premier ou de second ordre, qui brillaient avant Gœthe au firmament littéraire de l'Allemagne. Jusqu'à la fin de ses jours il fut fidèle au culte des affections. C'était plaisir de l'entendre et de le voir, quand marchant du haut en bas de la chambre, le visage rayonnant d'enthousiasme, il débitait de mémoire des chants entiers de la Messiade, ou des odes de Klopstock. Celle des « Tombes prématurées » lui était chère entre toutes. Quant à mon père, il aimait à mêler à ses entretiens des citations spirituellement appliquées ; il en assaisonnait les propos de table. C'était du grec et du latin, des fragments de Shakespeare, ou des humoristes anglais. Le messager de Wandsbeckb lui en fournissait bon nombre, et il en empruntait souvent aux poésies de Gœthe. Chose étrange ! Je me rappelle à peine d'avoir surpris dans la société où s'écoulèrent les années de mon enfance l'impression douloureuse de cette cruelle époque. Mes parents avaient d'ailleurs pour principe d'être gais avec leurs enfants, et de leur dissimuler leurs peines.
C'est à Duisbourg que, pour la première fois, je soupçonnai que la vie est chose grave. En effet, ayant atteint ma sixième année, je dus échanger les jouets de l'enfance pour l'ardoise et le crayon, la douce liberté du premier âge pour le joug de l'écolier. — Trois années s'écoulèrent, et je fus en état de quitter l'école. Je me vis alors, moi bambin de neuf ans, tremblant et timide, appelé à comparaître devant le très honoré directeur du Gymnase, M. Nonnel Avec toute la gravité réclamée par un si haut emploi, il me fit subir l'examen requis : « Bien, bien, cela va bien, » me dit-il enfin d'un ton d'encouragement, et il me promut au rang des élèves de quatrième. L'institution assez chétive ne comptait que quatre classes.
De bonne heure on nous avait appris à joindre les mains pour la prière le matin, le soir et au moment du repas. Je ne puis dire néanmoins que mes parents se soient proposés de nous élever dans les principes de la foi évangélique. Ils n'étaient pas tombés dans les pièges du plat rationalisme qui régnait alors. Que de fois, pendant mon enfance, ne les ai-je pas vus, en des heures de prospérité, verser des pleurs de joie, en bénissant à haute voix la bonté de Dieu. Mais le sentiment religieux qui les animait, si sincère fût-il, leur était inspiré par la religion naturelle, plutôt que par la religion révélée. Ils s'inclinaient avec un respect profond devant le nom de Jésus, mais leurs hommages s'adressaient à l'idéal moral et humain, parfaitement réalisé en cette sainte personne, plutôt qu'au Fils de Dieu, au médiateur, au rédempteur divin. Au surplus, à cette époque de leur vie, la gloire de la foi évangélique, pleine de promesses magnifiques, apparaissait à leur âme dans le lointain, à travers les brouillards d'une vague religiosité. La tradition chrétienne de la famille exerçait sur eux une salutaire influence. Ils l'ont eux-mêmes reconnu plus tard.
C'était en effet « une maison de Dieu parmi les enfants des hommes, » que celle de mon aïeul paternel, Adolphe-Henri Krummacher, commandant au château du comte de Tecklenbourg. La réputation en était établie au loin, et pour bien des âmes elle fut l'instrument des plus excellentes bénédictions. Quant à la mère de mon père, elle a été pour lui, tant qu'elle vécut, une sainte à laquelle il rendait un affectueux hommage. Voici ce que le digne recteur Hasenkamp en écrivait à Lavater : — « Elle a brillé comme une étoile dans sa maison ; vivant au plein soleil de la vérité révélée, elle a fait luire à mes yeux dans toute sa personne la paisible clarté d'une foi évangélique enfantine. » — Il disait aussi à mon père : — « Si je pouvais jamais ployer les genoux devant une personne humaine, ce serait certainement devant votre mère. » — Mon grand-père lui-même, employé au fisc, commissaire de la justice et bourguemestre à Tecklenbourg, était si sérieux dans sa foi chrétienne, qu'il courut après sa mort, parmi le peuple, un bruit assez singulier. On avait observé au plancher de sa chambre de travail une légère dépression, et l'on prétendait qu'elle avait été formée par les pleurs du pieux Krummacher, quand, dans ses prières, il combattait avec Dieu. Parmi les ascendants de la famille Möller, celle de ma mère, je pourrais signaler des figures chrétiennes aussi grandes que celles qui m'apparaissent dans la lignée de mes ancêtres paternels. Je ne nommerai que la pieuse femme dont les soins, les saintes exhortations et les prières ferventes ont fait l'éducation de ma mère. Si jamais il est demeuré au cœur de quelques enfants, pour leur père et mère, un souvenir reconnaissant et fidèle, c'est bien au cœur de mes propres parents. Mon père, comme le dit fort bien son biographe : « ne pouvait parler de sa bienheureuse mère sans éprouver dans son cœur ému comme un ravissement enfantin. » C'est ainsi que jusqu'à la fin, il en conserva dans son souvenir l'image bénie, ineffacée et ineffaçable. De si nobles âmes ne cessent jamais d'être une bénédiction. Après avoir secoué de leurs pieds la poussière de cette terre, elles bénissent, par les souvenirs qu'elles laissent, mieux encore que par leur présence, ceux dans le cœur desquels une place leur est toujours gardée.
En dix-huit mois, la méthode un peu mécanique des professeurs du gymnase à Duisbourg, réussit pourtant à me faire passer de la classe inférieure, je veux dire de la quatrième, à la troisième qu'on surnommait la « classe des gamins. » — Par une nécessité facile à comprendre, la discipline y était sévère. Elle s'y faisait sentir fréquemment, l'exhortation pédagogique étant volontiers appuyée de la baguette de coudrier. C'est là néanmoins, qu'étudiant Ovide et César, je pressentis les vives jouissances et l'utile plaisir qu'on peut goûter dans le commerce des anciens, une fois les premiers obstacles de la grammaire et du lexique heureusement franchis. Je me rappelle si bien ces impressions, qu'aujourd'hui, plus sans doute qu'alors, je regrette le changement d'office qui, en obligeant mon père à transplanter ailleurs ses pénates, interrompit mes études de troisième, un peu moins d'un an après leur début.
L'université de Duisbourg, vu la négligence des autorités, agonisait déjà avant l'invasion française. L'an 1806, celle-ci lui donna le coup de grâce. Plessing, le philosophe enthousiaste, avait depuis peu quitté ses amis en larmes. Il avait émigré, s'il faut l'en croire, de cette terre de désordre en quelqu'un des astres du ciel. Le collège des professeurs s'était graduellement vu réduit par d'autres décès et plusieurs départs, à trois théologiens, deux docteurs en médecine et un docteur en droit, qui s'estimaient heureux quand ils voyaient s'asseoir à leurs pieds quatre ou cinq étudiants. Ils ne cessaient jamais d'être en lutte avec les autorités pour le payement de leurs chétifs honoraires. On les leur administrait goutte à goutte, et c'étaient encore les beaux jours. Le plus souvent on se contentait de leur administrer des promesses. L'université, n'ayant aucun avenir, on leur insinuait obligeamment qu'ils feraient bien de chercher ailleurs des moyens d'existence ; hélas ! on leur retenait même tout ou partie de leurs maigres émoluments. Il semble, au surplus, si j'en juge par des lettres de ce temps, qu'une bonne humeur, précieuse sans doute, et à laquelle n'était pas étrangère la foi religieuse, l'ait emporté sur le noir souci, atra cura, dans le cœur de ces messieurs. Les plus éprouvés apprirent eux-mêmes à la conserver. Quant à nous, jeunes garçons, nous comprenions à peine la dureté des temps. La fleur du patriotisme n'était pas encore éclose en nos âmes. Tandis que l'impôt du logement arrachait à nos parents plus d'un profond soupir, nous ne savions y voir qu'une occasion de plaisir et de gaieté. Un des fiers grenadiers du grand empereur daignait-il rire et s'amuser avec nous, nous n'étions pas peu flattés d'une si noble condescendance ; et quand l'un de ces brillants étrangers aux allures martiales nous aidait complaisamment à manger l'appoint que mon père se faisait par ses travaux littéraires, bien loin d'être un fardeau pour nous, c'était une vraie fête.
Aussi notre vie de famille à Duisbourg brille-t-elle à mes yeux dans le passé, de tous les rayons du plus franc bonheur. J'y vois avant tout Christiane Engel, fidèle amie de mes parents, bonne et tendre éducatrice de mon enfance. C'est elle qui, dans la suite, devint l'aide assidue du noble comte de Recke, à l'institut disciplinaire de Düssenthal ; c'est elle qui, plus tard encore, fut à Munster l'infatigable amie des pauvres et des misérables. Aimée au loin, et jusqu'en son âge le plus avancé, presque célèbre par son dévouement à toute épreuve, son aimable et joyeux caractère, elle ne saurait être oubliée par aucun des nombreux amis qu'elle s'est faits. Son remarquable talent pour la musique, transforma bientôt la maison. Chantant et formant de petits chœurs, elle réussit, charmante fée pourvue de cette baguette magique, à conjurer pour les hôtes en grand nombre qui s'arrêtaient sous notre toit, l'influence d'un temps difficile capable d'assombrir les esprits et de créer la discorde. Malgré les douleurs concentrées de son patriotisme, mon père trouva, grâce à elle, assez de courage et d'entrain pour écrire ses parabolesc, son livre des fêtes, son ouvrage d'esthétique sur « l'Esprit et la forme des Évangiles. »
En l'année 1858 cette excellente amie avait quatre-vingt-dix ans. Je lui adressai, pour fêter cet anniversaire, les strophes suivantes :
« Reine de cette fête, assise sur ce trône où tu es montée par quatre-vingt dix marches, couronnée de tes blancs cheveux comme d'un brillant diadème d'argent, je te salue dans ma reconnaissance et ma joie. Entouré d'une garde auguste, un monument m'apparaît. Quiconque passe auprès se souvient de la bonté de Dieu envers les enfants des hommes. Ce monument a un nom. Il s'appelle Christiane.
C'est toi qui nous as fait cet heureux temps où le cœur avait tous ses droits ; toi qui nous as fait cette famille, dont les querelles et la jalousie ne troublèrent jamais la sainte harmonie. Que ton image me paraît belle et grande ! Quand je cherche, dans un doux rêve, à me représenter ce qui pût rendre pour moi la vie si aimable et si bonne, c'est ton nom, Christiane, qui retentit dans mon cœur.
Où sont-ils, ceux pour la tête de qui tu tressais autrefois des couronnes de laurier ? — Tu vas maintenant visiter leurs tombes. Mais comme le reflet du soir sur le sommet des Alpes, je vois se réfléchir en toi le pur éclat de leur âme. Souvent je soupire et les appelle. C'est en vain… Il me semble pourtant les voir de plus près, du regard ravi de mon âme, dans le mystérieux royaume des esprits, quand ton nom magique est prononcé, ô Christiane !
Leurs pensées, leurs désirs et leurs poésies, vivent-elles ailleurs plus fraîches, plus brillantes et plus printanières qu'en ta mémoire, ô notre fidèle amie ? C'est un jardin fleuri près d'une source vive. Idylles, paraboles, discours sacrés, hymnes saints, chansons innocentes, maximes de la sagesse retentissant innombrables sur le balcon du château, qui les garde plus fidèlement en sa mémoire que Christiane ?
S'il est dans nos cœurs un peu de sentiment et d'amour, c'est par tes soins qu'ils y ont fleuri, c'est à ton image qu'ils s'y sont formés. Aussi, quand nous chantons au Seigneur un chant de louange, le bénissant de nous avoir fidèlement gardés contre les folies et les déceptions du siècle, nous y glissons tout bas, ô Christiane, ton nom bien-aimé. »
Pendant notre séjour à Duisbourg nous n'avions pas, à vrai dire, conscience des services éminents que nous rendait la sainte femme célébrée dans ces vers. C'est à peine si nous comprenions ce que, pour la moisson future, elle jetait en nos cœurs de semences fécondes. Rire et jouer nous plaisait mieux à nous, gais petits garçons, que des occupations sérieuses. Dans les bois verdissants, dans les prairies pleines de papillons, au bord du Rhin et de la Ruhr, dans leurs fraîches eaux où nous nous ébattions en été, retentissaient nos cris de joie. Nous préférions le tapage de ces libres jeux aux chants méthodiques qu'accompagnait le piano, et au cahier de musique. Il va sans dire que les avertissements de mon père ne nous manquaient pas, mais il était rare qu'il s'y mêlât rien de religieux. S'il lui arrivait de nous rappeler Dieu et ses commandements, il était saisi d'une émotion si vive, que nous ne pouvions alors nous empêcher de pleurer. Aussi, craignait-il fort de semblables scènes, qui pourtant nous laissaient jeter un regard au fond de son âme, et nous inspiraient pour lui la plus haute vénération.
L'université de Duisbourg brisée par l'orage, allait s'enfoncer dans les eaux et disparaître. Celui qui seul aurait pu prévenir cette catastrophe avait alors bien d'autres intérêts à sauvegarder que ceux des universités. En vain les professeurs réclamaient-ils le pain de l'État, on leur criait : « Sauve qui peut. Aide-toi, le ciel t'aidera. » C'était là tout ce qu'on leur donnait en fait de consolation. Mais déjà Dieu venait à notre secours. De tous côtés on invitait mon père à remplir des fonctions de professeur ou de pasteur. Les appels adressés de Detmold, Düren, Crefeld, avaient été les plus séduisants. Ce fut néanmoins la vocation qui lui fut adressée par la paroisse de Kettwig sur la Ruhr qui l'emporta. Kettwig n'était point alors la ville industrielle que nous connaissons ; c'était un simple village. Mon père n'y fut pas attiré seulement par la beauté des sites qui embellissent l'ancien Vicus Cattorum ; il aimait la forte et intelligente population campagnarde de ce lieu. Aussi quand les députés de cette vaste et industrieuse paroisse vinrent en grand nombre auprès de lui, se laissa-t-il facilement gagner par leurs sollicitations. — Donc, en octobre 1807, nous pliâmes notre tente, cette tente plantée à Duisbourg au milieu de toutes les tempêtes politiques, et pourtant si paisible. Transportés à notre nouveau séjour, nous y fîmes solennellement notre entrée, accompagnés comme il est d'usage, de tout un long cortège à pied et en voiture. Arcs de triomphe, volées de cloche, guirlandes de fleurs, rien ne manquait à la fête. Il n'était d'ailleurs pas difficile à mon père d'abandonner la chaire de professeur en théologie pour celle de pasteur à la campagne. Il aimait le peuple. C'était un besoin profond de sa nature poétique et de son âme candide d'exposer aux simples dans un langage figuré, les mystères du royaume de Dieu qui se dévoilaient de plus en plus à son propre cœur.
Kettwig ne possédait aucune école supérieure, et je dus, hélas ! me résigner pour quelque temps à une humiliation amèrement sentie. J'étais élève d'un gymnase, je redevins écolier. On m'assura que ma mauvaise écriture et mon peu de progrès en arithmétique en étaient cause. Ce fut mon père qui me fit poursuivre mes études classiques, souvent interrompues.
Au reste, nous autres garçons, nous n'avions plus rien à désirer. Ce que nous avions pu rêver naguères de plus beau, nous le possédions. Il y avait là de magnifiques bois de hêtre, peuplés d'oiseaux. Nous les parcourions avec des cris de joie. Pour saisir le nid de la pie, du corbeau ou de l'écureuil, nous nous livrions aux expéditions les plus aventureuses, et, des pieds et des mains, grimpions à la dernière cime des arbres les plus hauts. Un peu de fatigue, et nous voici parvenus, en conquérants, au sommet des montagnes, en face d'horizons infinis ; un peu de patience, et c'étaient dans la profondeur des bois, sur le penchant des coteaux des moissons admirables de fraises et de myrtilles. Puis venaient les joyeuses fêtes de la campagne, celle du printemps, celle des œufs de Pâques. On les célébrait, tantôt sur ce massif de rochers, appelé « la Chaise, » qui tout à coup tombant en précipice jusqu'aux eaux de la Ruhr, s'y reflète comme dans un miroir, tantôt dans l'aimable vallée de Kornthal, parmi les buissons d'aubépine que dominent les ruines de Kattenbourg. Et la fête des tireurs, avec ses drapeaux flottants, la détonation des carabines, les gaies fanfares, les danses sur le tapis de mousse, à l'ombre des hêtres et des chênes ; et les plaisirs de la nage, et de la pêche aux écrevisses dans la Ruhr dont le flot est limpide comme du cristal, et la glace unie que cette belle rivière offre en hiver aux exercices du patineur !… Ah ! n'en était-ce pas assez pour nous faire de ce coin du monde un petit paradis ?
Ce n'est pas tout : fils du pasteur, nous le suivions fréquemment dans ses visites. Les paysans de ces campagnes sont à l'aise. Nous revenions chargés de pommes ou de noix. On nous donnait même parfois des pigeons, que nous rapportions à la maison. Dans le voisinage habitaient des familles amies ; à l'abbaye de Werden, la famille Keller, ferme dans son amour pour l'Évangile ; à Mühlheim, celle du pasteur Engels, homme d'une imagination active et originale ; à Essen, celle de Badeker, si cordiale ; celle de Nathorp si paisible, à laquelle des liens intimes devaient plus tard nous unir. Nos excursions s'étendaient encore plus loin. Nous allions à Budberg, chez Ross, qui, dans la première fleur de la jeunesse, brillant de toute sa mâle beauté, ravissait les cœurs par sa joie aimable et toujours égale ; à Wülfrath, où mon oncle Gottfried-Daniel Krummacher, plus sérieux que Ross, mais également aimable, recueillait déjà, comme pasteur, d'abondantes bénédictions. — A son tour, le presbytère de Kettwig recevait des hôtes toujours bienvenus. Parmi les plus assidus, je dois nommer Frédéric Strauss, pasteur à Ronsdorf, jeune encore, et toujours monté au diapason le plus élevé de la poésie. Mon père se faisait le malin plaisir de tempérer amicalement son exaltation par une bienveillante raillerie. A cette époque ses « Glokentone », premier volume du précieux petit ouvrage qu'on ne peut oublier, étaient déjà connus. Tous ceux qui se plaisaient à prévoir pour l'Église des jours magnifiques, y répondaient sympathiquement dans leur cœur.
Il ne nous manqua donc rien en plaisirs et en saines jouissances pendant les cinq années que nous passâmes à Kettwig. En était-il de même de notre éducation scientifique ? Hélas ! qu'elle fut imparfaite ! Pendant les trois dernières années de notre séjour à Kettwig, mon père fut notre unique instituteur. On lui avait adjoint un collègue actif, mais malgré le zèle de ce compagnon d'armes, son temps était absorbé presque tout entier par les devoirs de sa charge, tant la paroisse à laquelle il donnait ses soins était étendue. Le chemin que je fis pour être en état d'entrer dans la seconde classe d'un gymnase fut donc un peu long, mais je le fis pourtant.
Ce n'est pas que je n'aie rien acquis pendant les cinq années passées à Kettwig. Au contraire, si notre vie fut assez décousue, je fis néanmoins plus d'une expérience précieuse pour l'avenir. Les relations de mon père avec ses paroissiens me permirent d'entrevoir ce que doit être la vie d'un pasteur. Il visitait l'une après l'autre les diverses localités de sa paroisse, et c'était un vrai plaisir de voir comment il se faisait accueillir et aimer de tous, surtout des paysans. Ne les rencontrait-il pas aux champs, il se rendait à la ferme où il était toujours joyeusement reçu. Il ne prenait pas, dès la porte, l'air solennel d'un homme qui ayant charge d'âmes, vient remplir les devoirs de sa charge. Son bonjour était amical, familier, plein de cordialité et de bonne humeur. A moins que de graves événements domestiques lui commandassent une autre conduite, il engageait avec ses paroissiens un simple entretien sur les objets qui les intéressaient le plus, leur maison, leurs champs, leurs affaires. Rien ne l'enchantait autant que ces conversations. Il admirait le bon sens et le jugement dont les paysans faisaient preuve. La richesse de pensée et l'esprit d'observation que révélait leur langage, souvent, il est vrai, impropre et grossier, l'étonnaient. « Ce sont, disait-il, au retour de ses visites, des joyaux qui n'ont pas été polis. Ces gens-là sont plus intelligents que bien des prédicateurs et des juges en perruque. » Avec tel d'entre eux, il pouvait sans peine causer astronomie, avec tel autre botanique. Ils avaient fait tout seuls ces études, et plus d'un appliquait à la culture de ses terres des procédés quasi-scientifiques. Peu à peu cependant, avec une dextérité remarquable, mon père, après avoir commencé l'entretien par les détails les plus familiers de la vie, élevait avec lui ses interlocuteurs aux plus hautes pensées. Sa méthode dans la cure d'âme n'était pas celle que nous appelons « piétiste ou méthodiste. » Il n'assaillait pas les consciences d'appels directs à la repentance, il n'accumulait pas dans ses discours la théologie et le dogme. Ce qu'il cherchait avant tout, c'était à former dans les cœurs la conviction que nous devons toute chose à la bénédiction de Dieu. Il y réveillait par degrés un besoin, celui de s'en remettre entièrement, avec une confiance joyeuse, à la grâce de Dieu, qui tient toutes choses entre ses mains ; confiance qui ne peut exister que dans la communion avec Jésus-Christ, le médiateur divin. Pour les maisons et les chaumières, chacune de ses visites devenait bientôt comme une fête paisible et sainte. Ses paroissiens sentaient combien ils étaient aimés de leur pasteur ; ils ne se séparaient de lui qu'en lui serrant énergiquement la main, ou les yeux mouillés de larmes. Lui-même, il croissait en foi et en vie spirituelle. Ses ouailles croissaient avec lui, et ces progrès accomplis ensemble, formaient entre eux le lien le plus solide et le plus doux qui jamais ait uni un pasteur à son troupeau. Aussi mille témoignages d'attachement lui étaient-ils donnés. Je ne parle pas seulement des cadeaux en nature qui affluaient au presbytère ; il recevait des preuves plus significatives encore de l'affection qu'il inspirait.
Que de fois n'avons nous pas entendu des gens, malades ou bien portants, dire à mon père : « Monsieur le pasteur, si vous voulez consoler nos chagrins et nous rendre heureux, faites-vous voir seulement, et laissez-nous vous regarder. »
Il y avait alors dans l'église de mon père, des chrétiens plus expérimentés que la plupart de ses paroissiens, et plus avancés dans la foi qu'il ne l'était lui-même. Ils s'appelaient entre eux « amis de Tersteegen », parce qu'ils cherchaient dans les écrits de cet homme de Dieu leur nourriture spirituelle. Vulgairement on les nommait « les raffinés », et on les accablait de moqueries. Etait-ce à leur piété qu'on en voulait ? Non, pas toujours ; c'était à l'air sectaire qu'ils affectaient volontiers, se tenant à part et évitant les chrétiens moins éclairés qu'eux. Mon père ne pouvait partager ni leur manière de vivre, ni leurs goûts, ni l'étroitesse de leurs vues. Quoiqu'il prît toujours leur défense, et les fréquentât volontiers, il aimait mieux ces âmes qui, animées d'une crainte de Dieu, simple, vraie et sérieuse, sont comme les prosélytes de la nouvelle alliance. C'est en elles qu'il croyait découvrir une force et une vie capables de se développer, et de se transformer insensiblement en vraie foi chrétienne. De ces âmes là, il y en avait un grand nombre dans son troupeau, qui lui étaient sincèrement attachées. Un jour que la conversation était tombée sur un malheureux, impie et blasphémateur, l'une de ces personnes lui dit : « Monsieur le pasteur, croyez-moi, ce misérable est un libre penseur, un athée, peut-être même un franc-maçon ! » Comme mon père était encore frère orateur à la loge de Duisbourg, ce « peut-être même » le troubla. Prenant résolument un parti auquel il avait déjà songé à son entrée dans le saint ministère, il cessa ses relations avec la société maçonnique. Dès lors il n'en parla plus, si ce n'est un jour où, pour toute réponse à un curieux qui voulait absolument savoir en quoi consiste la franc-maçonnerie, il répondit : « Demandez à Frédéric le Grand ; il est grand-maître de l'ordre. »
Les prédications de mon père attiraient au temple un nombreux auditoire. Elles édifiaient, et quoiqu'elles passassent de beaucoup mon intelligence, je crois encore en entendre l'écho dans mon âme. Je ne me souviens pas d'avoir jamais entendu prêcher l'Evangile avec plus d'onction, plus d'élan, et d'une manière plus propre à gagner les cœurs. Quand je cherche à caractériser d'un mot l'esprit de cette prédication, la parole de l'Apôtre à Tite s'offre d'elle-même à mon souvenir : « Quand la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour envers les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, etc. » (Tite.3.4-5). Lui-même trouvait sa mission de prédicateur exprimée dans cet appel d'Esaïe : « Consolez, consolez mon peuple ; parlez à Jérusalem selon son cœur, et dites-lui que son temps marqué est accompli, que son iniquité est tenue pour acquittée. » (Esaïe.40.1) Il est resté jusqu'au bout fidèle à cette mission ; il a seulement pénétré de plus en plus dans les mystérieuses profondeurs du message dont il se voyait chargé.