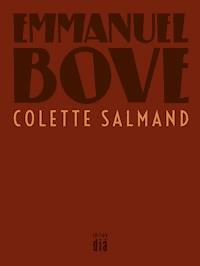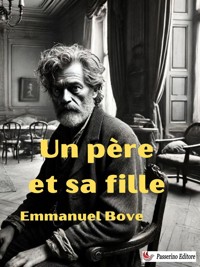1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
L’amour de Pierre Neuhart est un roman d'Emmanuel Bove, après Un père et sa fille. « Allons, je ne vais pas tomber amoureux d’une fillette », songe Pierre Neuhart. L’industriel rustaud a conservé ses ambitions de jeune homme, artiste déclassé qui espère parvenir dans le monde par les femmes. Ému par la fragilité d’Éliane, jeune fille sensuelle et ingénue, il subit caprices et colères. Et l’amour embrase toute sa vie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Table of Contents
CHAPITRE PREMIER
CHAPITRE II
CHAPITRE III
CHAPITRE IV
CHAPITRE V
CHAPITRE VI
CHAPITRE VII
EMMANUEL BOVE
L’AMOUR DE
PIERRE NEUHART
Roman
Paris, 1929
Raanan Éditeur
Livre 1242 | édition 1
raananediteur.com
CHAPITRE PREMIER
Pierre Neuhart se leva brusquement et se mit à arpenter son bureau. C’était une pièce assez vaste, située place Saint-Sulpice, au premier étage d’un vieil immeuble dont les appartements, privés d’eau et de gaz, avaient été aménagés en locaux commerciaux. Elle était meublée de classeurs de carton, de sièges usagés, d’une grande table couverte de paperasses, d’encriers, de règles, de pots de colle. Près de la fenêtre, un guéridon supportait une lourde et antique machine à écrire rappelant, par sa solidité et son aspect peu pratique, les premières automobiles. Un appareil téléphonique était fixé au mur, à hauteur d’homme. Quelques affiches, si mal clouées que l’on eût pu glisser le bras entre la paroi et elles, décoraient la chambre.
Invité à passer la soirée chez Madame Aspi, Pierre Neuhart était agacé. En même temps qu’il regrettait d’avoir accepté, il était enchanté de se délasser un peu, de pénétrer dans un monde nouveau, de changer d’atmosphère. Avant de sortir, il décida d’en finir avec son courrier. Il le remettait toujours au dernier moment, les lettres d’affaires étant pour lui une corvée.
— Simone, prenez ce que je vais vous dicter,
dit-il à l’employée qui partageait son bureau.
— Il est presque six heures. Je vous préviens, je m’en vais à six heures, répondit-elle. Il fallait penser plus tôt à votre courrier.
— Faites ce que je vous dis. Si vous n’êtes pas contente, j’en suis désolé. Vous y êtes ? Bien. Adresse : monsieur Muller, rue du Rempart, Maubeuge. Vous êtes prête ? Monsieur, votre lettre du dix courant. Je note d’avoir à vous expédier vingt tonnes de gravier numéro quatre, exempt de sable comme vous le désirez. Le départ aura lieu demain. Étant donné les bonnes relations que j’ai entretenues avec vous… je n’ai jamais rien entretenu avec lui… lorsque j’étais à Maubeuge, je suis prêt à vous accorder toute latitude pour le paiement… ce qui ne m’arrangera pas du tout, mais enfin… Espérant avoir par la suite la faveur de vos ordres qui auront mes meilleurs soins, veuillez agréer et caetera…
Pierre Neuhart s’arrêta de marcher. Il regarda Simone en souriant.
— J’aimerais mieux écrire à une jeune fille comme vous, dit-il. Ce serait plus amusant. Ce que ce genre de correspondance peut m’embêter ! Ah ! la, la, la… si je pouvais… Encore une lettre et vous partirez. Vous êtes satisfaite comme cela ?
— Mon travail finit à six heures. Je veux partir à six heures.
— Terminons, terminons. Adresse : monsieur Balié, douze, avenue de la Révolte, Aulnay-sous-Bois. Monsieur, votre lettre du neuf courant. En ce moment, je suis totalement dépourvu de la grosseur de grain de riz dont vous me passez commande. Mais par téléphone… Cela fait bien, n’est-ce pas, par téléphone ?
Simone posa son crayon et dit :
— Vous le faites exprès ; eh bien ! je m’en vais. Vous vous débrouillerez tout seul. Je commence à en avoir assez de vos façons.
— Écoutez, Simone, il faut absolument que cette lettre parte ce soir. Je continue… Mais, par téléphone, je donne les ordres à mon contremaître, non pas cela, à mes contremaîtres, pour qu’une première livraison de trente tonnes soit prête après-demain. Le solde de votre commande suivra au fur et à mesure de la fabrication. Comme par le passé, vous commencez à m’embêter…
L’employée se leva furibonde.
— C’est vous qui commencez à m’embêter ! Je m’en vais. À demain, et pas avant dix heures. Cela vous apprendra.
Simone avait été enhardie par la familiarité et les confidences de son patron. Il ne se passait point de jour qu’elle ne s’absentât une heure ou deux sous un prétexte quelconque. Souvent, elle lui disait qu’il était « bien bête ». Comme beaucoup de gens préoccupés ou indulgents, il n’attachait aucune importance à ces privautés et attendait patiemment que l’on fût mieux disposé à son égard.
――――――
Il y avait une vingtaine d’années, Pierre Neuhart avait été un jeune homme sans aptitude spéciale, pourvu d’une bonne instruction, d’une bonne éducation, conseillé par une famille honorable de fermiers et d’industriels du Nord. La politique seule l’intéressait. Il rêvait de pénétrer dans ce milieu par le journalisme ou par un secrétariat quelconque.
Ambitieux, il vit en ces professions, surtout en cette dernière, un moyen sûr de parvenir et, aujourd’hui encore, parlait-on devant lui d’une jeune secrétaire, qu’il dressait involontairement l’oreille. Cet emploi lui agréait par les relations qu’il permettait de faire, par les secrets qu’il devait autoriser de détenir, par la considération et l’envie qu’il entraînait et, surtout, par les soirées dont il lui facilitait l’accès et au cours desquelles il rencontrerait certainement la femme qui le lancerait par amour.
À dix-huit ans, il vint donc à Paris, loua une petite chambre au Quartier Latin, et, pour apaiser ses parents, alla de-ci de-là rendre visite à des amis de sa famille. Mais il le faisait avec une telle morgue qu’il rebuta les mieux intentionnés. Lui procurait-on quelque sinécure, qu’il avait une moue de dédain. Si l’on ne s’avançait pas, il demandait avec insolence : « Qu’est-ce que vous m’offrez ? ». Jamais il n’avait une parole de remerciement ni un soupçon de reconnaissance. La vie d’un homme d’État lui semblait tellement plus belle que tout ce qu’on pouvait lui réserver qu’il était même joyeux de blesser les relations de son père en étalant le mépris qu’elles lui inspiraient.
— Vous pensez bien, dit-il une fois à l’administrateur d’une compagnie de navigation, que j’ai une autre ambition que de faire de petits voyages sur l’eau. D’ailleurs, où cela me mènerait-il ? À Port-Saïd ? Et après ? Il faudrait revenir et recommencer. Non, ce n’est pas pour moi.
— Eh ! bien, allez faire de petits voyages à Montmartre…, lui répondit l’administrateur qui avait eu vent de la conduite du jeune homme.
Pierre Neuhart fréquentait en effet un monde oisif et déchu où, avec l’argent que son père lui envoyait, il faisait figure de mécène, cela pendant la première semaine du mois. Car ses subsides, il les recevait le trente, ce dont il avait un peu honte, pouvant ainsi, pensait-il, être confondu, par les hôteliers et par les boutiquiers, avec quelque employé. Il passait ses nuits au hasard des invitations de jeunes gens ivres, de femmes fraîchement émancipées, entraîné tantôt dans un café lointain, tantôt dans un tripot. Mais il conservait toujours, comme excuse, un air de fugitif qui s’encanaille. En dépit de cette feinte, il tombait de plus en plus bas. Bientôt, il ne fit plus le moindre effort pour masquer sa déchéance, prenant même plaisir à la compliquer d’attitudes théâtrales. Plusieurs jours durant, il ne se rasait pas, affectait une nonchalance blasée, rembarrait les jeunes femmes qui venaient à lui comme si le nombre de ses aventures amoureuses eût été tel qu’il ne songeait plus à aimer. Quand on lui adressait la parole, il regardait son interlocuteur d’un œil méfiant, une cigarette aux lèvres, voulant ainsi montrer que ce n’était pas à lui qu’on imposait. Ses paroles étaient comptées. À la fin d’un entretien, il disait simplement « compris » ou « vu ». L’hôtel qu’il habitait était souvent visité par la police. Lorsque les inspecteurs l’éveillaient au petit matin pour lui demander ses papiers, il le prenait haut, car, comme tous ceux dont le déclassement est un jeu, il ne tenait pas à être confondu avec les souteneurs, les escrocs de qui il partageait pourtant la vie. Il se levait à quatre heures de l’après-midi, essayait périodiquement de s’habituer à la cocaïne, mais n’y parvenait pas. Son rêve était de partir pour Venise où, lui avait-on dit, la réussite est certaine « quand on a du charme ». Mais son père ne voulait pas lui envoyer les vingt mille francs qui, d’après ses calculs, lui étaient nécessaires pour arriver là-bas avec une malle complète et y manœuvrer avec l’esprit libre et les coudées franches. Il résolut de les gagner. On l’adressa à un professeur de danse. Assidûment il suivit les cours. Le même soin que les sauvages mettent à la confection d’un piège, il l’apporta à ses préparatifs de départ, ne négligeant rien, demandant à des camarades faisant leur droit jusqu’où l’on pouvait aller sans tomber sous le coup de la loi, achetant des journaux de mode masculine, composant des billets amoureux.
La guerre éclata avant qu’il pût mettre son projet à exécution. Pour certains, elle fut un bienfait. Parti simple soldat à vingt-trois ans, sans avoir fait de service car il avait obtenu un sursis, il était nommé, en 1915, aspirant. Blessé plusieurs fois, il redemanda toujours à monter au front. Chaque jour, il perdait un lambeau de sa vieille enveloppe. La vie qu’il avait menée au contact de toutes les classes sociales, de tous les individus possibles, lui paraissait odieuse. En réalité, il retrouvait, au cours de ces années de guerre, le caractère exceptionnel du milieu où il était tombé, mais élargi. De même qu’il avait voulu partir pour Venise, de même il voulut partir pour Salonique. Il en revint lieutenant. La fin de la guerre approchait. Le jeune homme qui rêvait de devenir un aventurier s’était transformé.
Démobilisé, ce qu’il avait espéré obtenir par d’autres, il voulut l’acquérir par ses propres forces. Son père, riche propriétaire et conseiller municipal de Bleuchatel, près de Maubeuge, avait une grande autorité en matière électorale dans l’arrondissement où il disposait de quatre cent cinquante voix, chiffre qui se porta à six cents lorsque la conduite courageuse de son fils fut connue de tous. Il fréquentait en outre intimement un certain Hochet dont la fabrique de tuiles et de briques était la plus importante de la région. M. Neuhart père enjoignit à son fils d’entrer dans cette usine. Il lui avançait quatre cent mille francs. Pierre les apportait dans l’affaire qui était absolument sûre à cause de l’immense travail de reconstruction. En échange de cette somme, il devenait codirecteur, M. Hochet, fatigué par quatre ans de captivité et déjà âgé, ne désirant plus s’occuper que de la clientèle et de la marche générale. Pierre accepta avec joie. Aussitôt, se dépensant sans compter, il adjoignit un dépôt de ciment, de chaux et de plâtre à l’usine, passa des marchés avec l’État, entreprit la reconstruction de villages entiers sur des principes nouveaux, agrandit la clientèle, assura des débouchés. Au bout de trois ans, cette ardeur s’apaisa. Chaque samedi, il se rendit à Paris où il errait le dimanche, sans but, reposé pourtant de ne plus penser à la fabrique. Un dégoût pour Maubeuge l’avait envahi. Il ne pouvait plus voir cette ville ni les gens qui l’habitaient, ni encore les longs bâtiments sinistres de l’usine. Quand il rentrait, le lundi matin, il était si abattu que ses amis ne manquaient pas de faire allusion aux nuits blanches qu’il avait, d’après eux, passées. Ces sous-entendus ne firent qu’accroître l’appréhension qu’il avait du retour. Pourtant, dès que les affaires l’avaient repris, il oubliait ces fugues et redevenait celui qu’il avait été au début. De nouveau, il téléphonait, allait et venait dans la fabrique, prenait des rendez-vous, se déplaçait, surveillait les travaux, avait des démêlés avec la gare.
Une semaine, comme il s’était absenté un jour de plus que d’habitude, M. Hochet, vieillard qui jusqu’alors avait toujours réfréné la fougue de son associé, observa :
— Il me semble, Pierre, que vous avez perdu le feu sacré. Vous êtes en train de gâcher votre avenir. Je vous le dis dans votre intérêt. À mon âge, vous pensez bien qu’on ne désire plus que la paix.
Au lieu de stimuler Pierre Neuhart, cette intervention lui coupa bras et jambes. La briqueterie de M. Hochet lui inspira une aversion plus grande encore. « J’en ai assez, pensa-t-il. Je ne veux pas m’enterrer ici à trente ans. Je veux être libre. Je veux faire ce qui me plaît. Je les laisse tomber avec leurs tuiles et leur ciment. C’est tout de même effroyable de s’enfoncer là-dedans et de s’entendre dire, à peine lève-t-on la tête : Eh ! là-bas, petit, ne remuez donc pas tellement, restez dedans, c’est pour votre bien ! Non, alors, j’en ai assez. »
Une fois rentré dans son argent, Pierre Neuhart, contre le gré de son père que cette « trahison » avait indigné, vint à Paris. Il avait son plan : monter une entreprise d’exploitation de carrières pour laquelle il n’était pas indispensable de disposer d’un gros capital. Il dénicha donc quelques carrières, passa un contrat avec les propriétaires des terrains auxquels il remettait, en échange du droit d’exploitation, une redevance minime sur le chiffre d’affaires, fit l’achat d’un matériel complet pour l’extraction de la pierre, concasseur, cylindres-trieurs, wagonnets, camions, cheddite, perforeuse élecrique, et installa, justement place Saint-Sulpice, un petit bureau centralisateur des commandes. Il était absolument libre. Grâce aux relations qu’il avait conservées à Maubeuge, il ne tarda pas à s’assurer une clientèle. Une vie nouvelle commença, aussi indépendante qu’il l’avait désirée. Si la paresse le prenait, personne n’en souffrait. Il n’avait pas de comptes à rendre ni d’explications à fournir. De temps en temps, il allait au théâtre, au music-hall, soit en compagnie d’une femme rencontrée au hasard d’une promenade, soit avec des confrères. Mais il n’aimait pas à les fréquenter. C’étaient des hommes rudes qui tiraient une fierté de leur origine paysanne, alors que lui, au contraire, ne s’appliquait qu’à la dissimuler. Car, de tout temps, il avait rêvé de distinction, de bonnes manières, de réceptions. Tout en dirigeant ses affaires, il entrevoyait le jour où il serait reçu dans un salon parisien, où il serait très pris à cause des rendez-vous que les femmes de la bonne société lui fixeraient. Les hommes également s’intéressaient à sa conversation. Ils ne trouveraient rien d’anormal à le rencontrer puisqu’ils le considéreraient comme un des leurs. Mais tout cela n’était qu’un songe. Sa vie, elle, était beaucoup plus simple et comme attristée par l’ombre toujours grandissante de ses espérances. Il passait la plus grande partie de ses journées à son bureau de la place Saint-Sulpice. Il lisait beaucoup, portait le même intérêt à tous les livres. Au moment où il fit la connaissance de Mme Aspi, cette existence aisée et morose durait déjà depuis sept ans.
――――――