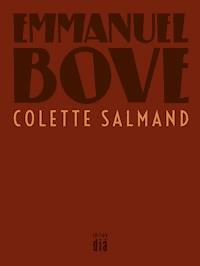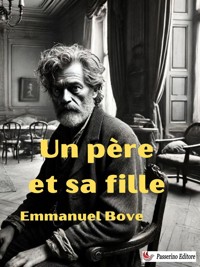1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
La Mort de Dinah est le septième roman d'
Emmanuel Bove, après
Une fugue.
La Mort de Dinah : Dinah va mourir ! Le titre n'en laisse pas douter. À treize ans, elle est atteinte de tuberculose. Un séjour à Leysin pourrait la sauver mais... En dernier recours, sa mère, désargentée, s'adresse à son voisin, Jean Michelez. Petit bourgeois, entrepreneur qui réussit, celui-ci va être ému par Dinah.
Mais enfermé dans un système défensif construit sur des trahisons, des déceptions et des rancoeurs, il ne peut envisager l'aide financière sollicitée. « Moi, chaque fois que j'ai rendu un service à quelqu'un, qu'est-ce qui est arrivé ! On s'est moqué de moi. Sans qu'il soit question de reconnaissance, on ne m'a même pas remercié. Aujourd'hui, j'ai quarante-sept ans. Si je regarde en arrière, je ne trouve pas un jour de bonheur. Si j'ai une situation, c'est grâce à mon père. Sans lui, que serais-je ? Qui m'aurait tendu la main ? Personne, personne. » Malgré tout, « un point gênait, quoi qu'il fît pour ne pas le voir, la conscience de Jean Michelez ».Finalement Dinah mourra de la mesquinerie de tous : celle de Jean et de sa femme, celle du propriétaire du pavillon qui n'hésite pas à tenter de profiter de la situation, celle de l'inconséquence d'un oncle qui dilapide son argent au jeu.« Ce court roman réussit à nous émouvoir tout en restant parfaitement honnête. Comme toujours Emmanuel Bove réussit à parler de l'intime et de la misère dans une langue courte et sans fioritures, visant à une sorte de transparence qui au lecteur non initié peut paraître fade et neutre alors qu'il s'agit très exactement de l'inverse. Toujours prompt à pointer les faux-semblants et la médiocrité des hommes, Bove ne s'autorise jamais la facilité et trace à la pointe sèche des psychologies tout à fait précises et crédibles. » |Barda, Critiques Libres Com|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
EMMANUEL BOVE
LA MORT DE DINAH
NOUVELLE
1928
Raanan Éditeur
Livre 1238 | édition 1
raananediteur.com
LA MORT DE DINAH
Par une belle fin d’après-midi d’automne, Jean Michelez, qui était descendu de tramway à la porte de Champerret, suivait à pied, en flânant, le long boulevard Bineau, à Neuilly, à l’extrémité duquel se dressait la villa La Vie là qu’il habitait avec sa femme et ses deux enfants. C’était un des derniers beaux jours de l’année. Un vent tiède soulevait la poussière de la chaussée. Tout gardait encore les traces de l’été. Les arbres n’avaient point perdu leurs feuilles, ces feuilles poussiéreuses de fin de saison que les orages n’ont mouillées qu’à demi. Dans les jardins, des tentes claires abritaient les meubles rustiques. Les appels, les voix, les conversations, étaient sonores. De temps à autre, une fenêtre ouverte laissait s’échapper vers le ciel bleu les chants d’un phonographe ou d’un appareil de TSF.
M. Michelez regarda sa montre. Il était sept heures. La nuit tombait déjà. Il pressa le pas, non point dans la crainte de faire attendre sa femme, mais parce que, brusquement, il venait d’éprouver le besoin irrésistible d’être chez lui, de parler, de se sentir entouré. Depuis trente minutes, il n’avait prononcé un mot. À six heures et demie, ses employés, d’une voix soumise contrastant avec la liberté qu’ils allaient retrouver, avaient pris congé de lui. Peu après, il était également sorti non sans avoir, auparavant, soigneusement fermé la porte de son bureau situé rue de la Michodière. Ce court instant de solitude, s’il lui avait paru agréable au commencement, lui pesait maintenant. En marchant, il s’était souvenu de sa jeunesse au cours de laquelle, tant et tant de fois, la perspective d’une soirée vide l’avait plongé dans un profond découragement, jeunesse interminable puisque, bien qu’il fut aujourd’hui âgé de quarante-sept ans, il y avait à peine trois ans qu’il était marié. Depuis, il avait pris la solitude en horreur. À elle il préférait n’importe quelle compagnie.
À ses débuts dans la vie, Jean Michelez avait exercé la profession d’architecte. Une ambition raisonnable l’avait poussé à s’établir à son propre compte, à posséder sa clientèle, à être sérieux, honnête et correct en affaires. « Je n’irai pas chercher les clients ; ils viendront à moi. Je ne leur promettrai pas monts et merveilles ; et ils seront contents. Ils me recommanderont à leurs amis. Petit à petit le noyau grossira. Alors je ne dépendrai de personne et je serai mon maître. » Cette attente stoïque dura dix ans. La guerre vint. Aussitôt après sa réforme, il abandonna sa profession sur les instances d’un camarade, Gaston Bonelli, pour celle, beaucoup plus lucrative, d’entrepreneur. Un peu comme chez ces médecins qui deviennent pharmaciens, chez ces avocats transformant leur étude en cabinet d’affaires, chez ces commissaires de police démissionnant pour prendre la direction d’une agence de renseignements, on découvrait sur son visage ce quelque chose de débonnaire et de susceptible particulier à ceux qui ont renoncé par intérêt. Leur lâcheté est cachée sous la nécessité de vivre. Elle se dégage pourtant des gestes et de la physionomie. En observant M. Michelez, on sentait que les écharpes de la déchéance le frôlaient, que s’il n’avait point d’ennemis, il ne se trouvait pas moins des anciens confrères pour le blâmer, que l’argent gagné à présent l’était au détriment d’une condition sociale plus élevée, car ceux qui persévèrent malgré les privations, l’indifférence de leur entourage, le doute de soi, sont rarement indulgents à ceux, plus faibles, qui renoncent, bien que ce soit justement dans ces défections qu’ils puisent l’orgueil de continuer.
M. Michelez avait souffert de ce mépris et en souffrait encore. Par amour-propre, il avait ménagé une sorte de compromis entre sa vie passée et celle présente. Il n’avait pas voulu être le premier entrepreneur venu. C’était un entrepreneur unique, de l’ancienne école à laquelle, pourtant, il n’était attaché par aucun lien, qu’il rêvait de devenir. L’honnêteté, la conscience professionnelle, la rectitude quant à ses devoirs et l’indulgence quant à ceux d’autrui, étaient ses principales qualités. Ses devis, il se faisait un point d’honneur à n’en jamais dépasser le montant, quitte à en être de sa poche.
En quelques mots, il voulait atténuer ce qui, à certains moments, lui apparaissait comme un déclassement, par une perfection qui n’eût point existé sans lui, pensait-il, dans sa corporation.
Le même enchaînement se découvrait dans sa vie sentimentale. Longtemps il avait cherché une amitié parfaite. Tendue vers autrui, vers l’affection, vers la tendresse, son enfance s’était passée à attendre l’être idéal qu’il devait, selon lui, rencontrer tôt ou tard sur son chemin. Il avait traversé l’existence aux aguets, préoccupé plus de saisir la chance au vol que de son avenir matériel. Chaque visage nouveau, entrant dans sa vie, lui avait donné les plus folles espérances, chaque attention, une joie maladive qui durait parfois une semaine entière, sans décroître, toujours aussi forte, et qui s’évanouissait brusquement, à la première vexation. Car, chaque fois qu’il se lia, il fut profondément déçu. Il eut beau tout donner, jamais les partenaires ne l’imitèrent. Et, justement, ce qu’il n’acceptait pas, ce qu’il ne voulut jamais accepter, c’était de donner sans recevoir. Il avait bâti une philosophie à lui sur la réciprocité. Elle était la base de tout amour durable. Sans réciprocité, il n’était pas deux êtres au monde qui pussent s’entendre. Mais au début d’une liaison, il se gardait bien de l’exiger et de s’en préoccuper. Il se contentait de se livrer. Ce n’était que plus tard, au premier doute, qu’il pensait à elle, devenant alors ombrageux, jaloux et tyrannique.
Lorsqu’il quitta le petit village de Lagny, aux environs de Nancy, où son père exerçait la profession de vétérinaire, et où il avait été élevé, pour venir habiter Paris (il avait alors vingt-trois ans), il fit la connaissance d’un étudiant allemand nommé Hans Schiebelhut. Jean Michelez avait loué une chambre rue Monge, chez une vieille personne, Mme Greuze. Cette Mme Greuze était une veuve bizarre qui, dès huit heures du matin, était coiffée, poudrée, vêtue de noir jusqu’au cou, et dont la préoccupation la plus importante était d’alterner le port d’une dizaine de bijoux de famille. Elle avait une touchante affection pour les jeunes gens à qui elle sous-louait deux chambres de son appartement encombré de trop de meubles. Dans l’autre pièce, justement, habitait Hans Schiebelhut. Ce fut ainsi qu’ils firent connaissance. Cet étudiant, dont le cou émergeait d’un col à la Schiller, était végétarien. Il faisait partie de ces adolescents que l’on appelle, en Allemagne, des wandervögel. Les cheveux au vent, le sac au dos, vêtus de culottes de velours à bretelles, les wandervögel parcourent en bandes, les dimanches ou durant les vacances, la Forêt-Noire ou la Suisse de Saxe, escaladent le Hartz ou le Taunus, accompagnant leur marche de chants et de guitares, couchant à la belle étoile, buvant aux sources mêmes, rêvant de retour à la grâce originelle. Chez Mme Greuze, ce goût de l’espace faisait qu’il ne fermait jamais sa porte. En passant dans le couloir au bout duquel se trouvait sa chambre, on pouvait le voir, tantôt le torse nu, tantôt vêtu d’un peignoir bariolé, aller et venir, ou, assis, en train de lire de très près un livre, ou encore penché comme un mauvais écolier sur une feuille de papier. On pouvait faire du bruit, il ne levait pas ses yeux cerclés de lunettes à monture d’or, car, comme la plupart des gens myopes, il était peu prodigue de ses regards. De certains de ces derniers il avait également le sans-gêne et l’absence de pudeur. Habitué à être vu sans voir, il en avait pris son parti, si bien que peu lui importait que l’on vît sur sa cheminée, sur sa table, des casseroles de lait, des épluchures d’oranges ou de bananes, des coquilles de noix. Il faisait sa cuisine lui-même. Le sel, le beurre, qu’ils se trouvassent à la portée de sa main, ne le gênaient nullement quand il étudiait. La bouteille de bière qui lui servait pour l’alcool à brûler se dressait sur la table de travail. Il l’utilisait même pour adosser, contre elle, un livre ouvert.
Les relations qui s’établirent entre les deux hommes, si elles furent, à leur début, pleines d’attentions réciproques, n’en eurent pas moins, par la suite, un certain côté comique. Cependant que Jean Michelez avait des habitudes régulières, un jugement raisonnable sur toutes choses, des goûts simples, Schiebelhut, lui, était gonflé d’orgueil, affichait une admiration sans bornes pour la grandeur et la force, se plaignait continuellement de manquer de temps pour travailler. Méprisant le bien-être, les plaisirs, le repos, on le trouvait à n’importe quel moment plongé dans la lecture ou en train d’écrire, les manches retroussées, la chemise largement échancrée, même en plein hiver. Quand Jean Michelez venait le relancer, ce n’était pas sur-le-champ qu’il se tirait de ses occupations. Comme une machine lancée à grande vitesse, il ne pouvait s’arrêter d’un coup. Il s’assimilait d’ailleurs à une machine, ou plus volontiers encore à un athlète, et croyait indispensable de prendre pour l’intelligence les mêmes précautions que pour le corps.
Jean Michelez, obéissant à un penchant de son caractère, avait tout de suite eu pour cet étudiant une profonde admiration. Sa force sauvage, son ardeur au travail, son indifférence, non voulue, mais naturelle, pour tout ce qui fait la douceur de l’existence, l’émerveillaient. Il aurait voulu le copier. L’impossibilité de le faire (l’architecte ne pouvait aimer sans qu’un besoin impérieux d’imitation naquît en lui) ne tarda pas à l’emplir de plus de respect encore.
Un soir, comme Jean Michelez se rendait auprès de son ami, il aperçut ce dernier – qui avait, ainsi qu’il le faisait habituellement, laissé la porte de sa chambre ouverte – en compagnie d’un jeune homme inconnu. Tous deux semblaient très gais. Tour à tour, ils riaient et parlaient fort. Par délicatesse, Jean Michelez n’osa entrer dans la pièce. Il rebroussa chemin et attendit avec l’espoir que le visiteur n’allait point tarder à partir. Mais les rires et les éclats de voix, au lieu de cesser, retentissaient avec encore plus de force, semblait-il. « Schiebelhut pourrait, tout de même, venir me chercher, pensa Jean Michelez. C’est à lui de faire le premier pas. Il devrait le comprendre. Puisque nous nous voyons chaque soir, il devrait au moins avoir la politesse de s’excuser. Je comprends très bien qu’il soit heureux de retrouver son compatriote, mais cela ne devrait pas l’empêcher de me présenter. »
Le lendemain, Jean Michelez, croyant que l’inconnu était parti, s’apprêtait à relancer son ami, lorsque, dans le corridor, il perçut un bruit de voix. Les deux Allemands étaient encore ensemble. Un lit-cage avait été ouvert dans la chambre de Schiebelhut. Certainement le visiteur y avait élu domicile.