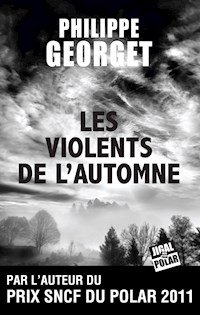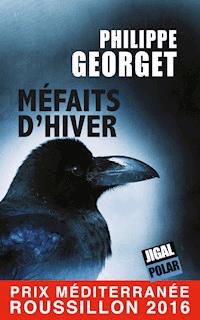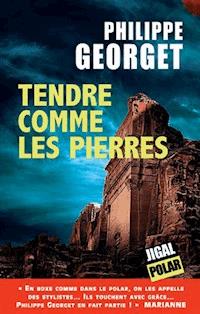Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions Jigal
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lieutenant Sebag
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Au programme des vacances de l'été : agression, enlèvement et assassinat. Reste plus que à trouver avec qui jouer au chat et à la souris !
C'est l'été, il fait chaud, les touristes sont arrivés et au commissariat de Perpignan, Sebag et Molina, flics désabusés rongés par la routine, gèrent les affaires courantes sans grand enthousiasme. Mais bientôt une jeune Hollandaise est sauvagement assassinée sur une plage d'Argelès et une autre disparaît sans laisser de traces dans les ruelles de la ville. Sérial killer ou pas, la presse se déchaîne aussitôt ! Placé bien malgré lui au centre d'un jeu diabolique, Sebag, à la merci d'un psychopathe, va mettre de côté soucis, problèmes de cœur et questions existentielles, pour sauver ce qui peut l'être encore !
Une intrigue affûtée récompensée par le Prix SNCF du Polar 2011 et
le Prix du Premier Roman Policier 2011 de la Ville de Lens.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
"Philippe Georget a ferré, il ne nous laissera pas nous échapper." -
Patrick Galmel, Polar noir
"Comme tout bon thriller,
L'été tous les chats s'ennuient tient en haleine l'amateur de polar, mais son charme tient avant tout à ce flic attachant et hors normes." -
Carole Vignaud, L'Indépendant
"[...] l’intrigue est prenante, le suspense est bien ménagé. Il y a dans ce polar une vraie atmosphère, avec des personnages crédibles et attachants."
- Le blog de ma fabrique de polars
"Ce livre n'est bien sûr pas qu'une visite touristique de cette magnifique région entre mer et montagne mais aussi et surtout une captivante intrigue policière."
- Le Boudoir des Livres
À PROPOS DE L’AUTEUR
Philippe Georget est né en 1963 en région parisienne. Après des études d'Histoire, il participe à une mission humanitaire au Nicaragua. Il voyage ensuite en Irlande du Nord, puis se rend à Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza. En 2001, il embarque sa femme et leurs trois enfants dans son camping-car et fait le tour de la Méditerranée en passant par l'Italie, la Grèce, la Jordanie, la Libye. Il opte ensuite pour le journalisme et poursuit sa carrière à France 3 comme journaliste-rédacteur, présentateur et caméraman (ce qui a sans doute influencé son écriture si originale?). Il est également investi dans le sport, la course et la boxe entre autres.
Il est l'auteur de quatre romans,
L'été tous les chats s'ennuient (Jigal, 2009), prix du Premier Roman policier et prix SNCF du polar,
Le Paradoxe du cerf-volant (Jigal, 2011),
Les Violents de l'automne (Jigal 2012) et
Tendre comme les pierres (Jigal, 2014).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 590
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Avertissement
« Les ressemblances avec des paysages existants ou ayant existé ne sont en rien fortuites : elles résultent au contraire d’un total renoncement de mon imagination à concevoir un décor plus approprié et plus beau que celui que j’ai trouvé un jour en Roussillon. En revanche, ceux qui croiraient reconnaître dans ce livre des personnages existants ou ayant existé ne seraient victimes que de l’emballement de leur propre imagination »
Chapitre 1
Robert se leva à quatre heures du matin. Comme tous les jours depuis plus de quarante ans.
Ce n’était pour lui ni un choix, ni une contrainte. C’était comme ça. Heure d’hiver ou heure d’été, peu importait : à quatre heures, il se réveillait et se glissait aussitôt hors du lit.
Il se servit une tasse de café froid. Y ajouta une goutte de lait. Puis il écarta les mots croisés pour poser sa tasse sur la petite table.
Robert avait travaillé toute sa vie comme ouvrier ajusteur dans une entreprise qui fabriquait des machines agricoles du côté de Gien, dans le Loiret. Il pointait à quatre heures trente précisément et, jamais, il n’avait eu une minute de retard. Bien noté, apprécié de ses supérieurs, non syndiqué et poli. Un ouvrier modèle. Licencié économique à l’approche de ses cinquante-cinq ans.
Il s’assit sur l’étroite banquette et avala avec force grimaces le breuvage amer et froid. Il aurait pu le réchauffer mais il avait la flemme. De toute façon, il n’avait pas le droit d’y mettre du sucre alors, mauvais pour mauvais, autant avaler le café sans traîner. Il avait bien tenté le thé à une époque mais il avait trouvé la punition plus sévère.
Malgré la cessation de toute activité professionnelle, Robert n’avait pu modifier le réglage de son horloge interne. Ce réveil matinal exaspérait Solange, sa femme. Alors, au début de sa retraite forcée, il avait essayé de rester au lit. De faire la grasse matinée au moins jusqu’à six heures. Mais il tournait et se retournait sans cesse s’emmêlant dans les draps, si bien que sa femme avait fini par l’autoriser de nouveau à se lever dès son réveil. Et puis elle était partie, Solange. En quelques mois. Cancer des os.
Robert vida la dernière goutte de son café dans l’évier et rinça sa tasse. La pompe à eau ronronna dans son coffre, sous la banquette. Il posa la tasse sur l’égouttoir et sortit de la caravane.
En cette mi-juin, le camping des « Lauriers Roses » d’Argelès était encore peu fréquenté. Quelques retraités comme Robert et une poignée de touristes étrangers. Les Hollandais arrivaient toujours les premiers puis venaient les Allemands. Robert se rendit directement aux toilettes. La veille, il avait utilisé la deuxième cabine en partant de la gauche. Aujourd’hui, ce serait la troisième. On était mercredi.
Il urina lentement et avec volupté dans une cuvette propre. Une douce odeur de lavande emplissait la cahute. C’était ce qui lui avait tout de suite plu, aux Lauriers Roses : la propreté des toilettes. Elles étaient lavées régulièrement et surtout une dernière fois le soir assez tard. Robert appréciait, au petit matin, de n’avoir pas les narines brutalement agressées par les odeurs de pisse et de merde des autres campeurs.
Il se délecta jusqu’à la dernière goutte qu’il fit tomber sur la paroi lisse et encore immaculée de la cuvette. Une fois sorti, il regarda sa montre. 4h19. Il se rinça les mains, comme la veille, au dix-neuvième lavabo d’une interminable rangée. Il s’essuya ensuite sur son pantalon. Il était prêt pour sa promenade quotidienne.
Il pressentait qu’elle serait la plus pénible de sa vie.
Le gravier blanc de l’allée centrale crissa sous les semelles de cuir de ses sandales. D’ordinaire, il aimait ce petit bruit délicat, mais ce matin, il n’y prêta aucune attention.
Robert et Solange avaient découvert les Lauriers Roses en 1976. Avant, ils pratiquaient plutôt le camping sauvage. Quand ils ne dormaient pas tout simplement dans leur vieille Diane. Mais la naissance de Paul, leur premier fils, les avait poussés à rechercher davantage de confort. Ensuite, il y avait eu Gérard et puis Florence. Les enfants s’étaient fait des copains au camping, ils étaient heureux de les retrouver chaque été. Robert et Solange aussi avaient pris leurs habitudes. Les parents des copains de leurs enfants étaient devenus des amis et les vacances filaient agréablement entre parties de pétanque, grillades et tournois de belote.
Robert repassa par sa caravane pour vérifier qu’il avait bien fermé la porte. Une manie. Du vivant de sa femme, il se surveillait. Mais Solange n’était plus là.
Il tourna la poignée. La porte résista. Elle était fermée. Évidemment.
Robert était fier de leur emplacement. Le mieux aménagé de tout le camping. Deux auvents se succédaient pour relier la caravane à une terrasse en bois bordée d’un barbecue en pierre qu’il avait construit lui-même en 1995. L’année de son licenciement. L’ensemble était clôturé par une barrière en pin sur laquelle s’accrochait une dizaine de pots de fleurs. Auparavant, c’était Solange qui s’en occupait. Le premier été après sa mort, les pots étaient restés vides. Puis Robert avait repris le flambeau. Fleurir la barrière, il trouvait ça mieux que de fleurir une tombe.
Sur les poteaux de bois, la peinture verte commençait à s’écailler sous l’action du sel et du soleil. Il avait prévu de repeindre. Il doutait de pouvoir le faire cet été.
La place était louée à l’année. Au début de sa retraite, ils séjournaient près de sept mois par an à Argelès. La saison estivale l’épuisait, maintenant. Il avait 65 ans et se sentait fatigué. Il aurait préféré passer l’été en bord de Loire, mais c’était la seule période où ses enfants et petits-enfants pouvaient venir le rejoindre.
Il traversa le camping d’un pas lourd et feutré.
Un rai de lumière filtrait sous la porte d’une caravane voisine immatriculée en Allemagne. Elle appartenait à un couple d’une soixantaine d’années. Lui, grand et passablement dégarni. Elle, petite, forte et permanentée. Ils s’étaient tous les deux copieusement engueulés durant la manœuvre de stationnement. D’abord, Robert avait bien ri. Puis il s’était senti tout bizarre. Les engueulades lui manquaient depuis qu’il vivait seul.
Juste à côté des Allemands, il n’y avait ni bruit, ni lumière dans la tente de la jeune Hollandaise.
Robert arriva à la petite porte qui donnait côté plage. Elle était fermée mais il avait la clé. Charles et Andrée, les gérants du camping, connaissant ses habitudes matinales, lui avaient depuis longtemps confié un double. Avec le temps, ils s’étaient habitués les uns aux autres. Robert leur filait parfois un coup de main hors saison pour la maintenance du camping. Une bricole par-ci, par-là. Un lavabo à déboucher, un coin de pelouse à regarnir, un grillage à redresser. Il aimait le bricolage et dans sa caravane, il n’avait pas grand-chose à faire. Robert et Charles papotaient en travaillant, ça occupait. Et puis, contrairement à ce que l’on prétend souvent, les confidences entre hommes venaient plus facilement autour d’un robinet à changer que devant un verre d’anisette. Il n’y avait qu’à Charles que Robert avait pu confier sa détresse à la mort de Solange.
Il s’était même laissé aller un jour à pleurer.
Il s’engagea dans le chemin qui traversait la réserve naturelle du Mas Larrieu. Les oiseaux, indifférents à ses tourments, sifflotaient leur éternel hymne à la vie. Sous leurs chants, on percevait déjà le souffle rauque de la mer.
Le vent marin se levait doucement apportant dans ses rets un parfum sauvage d’iode et de lointains. Le chemin filait sagement entre deux poteaux de bois censés endiguer le sable et canaliser les touristes. De part et d’autre, des figuiers de barbarie prospères développaient avec vigueur leurs oreilles de Mickey.
À mesure qu’on approchait de la plage, la progression se faisait plus difficile et le pas de Robert s’alourdissait dans le sable. Le retraité se mit à marcher au plus près de la clôture pour poser ses pieds sur les maigres touffes d’herbe. Près d’un bosquet de roseaux, il eut une hésitation. Puis il préféra filer d’abord jusqu’à la mer.
Encore quelques dizaines de mètres et il déboucha sur la plage. Le vent se fit plus fort, les parfums plus denses. La houle était forte ce matin. À l’horizon, le ciel s’éclaircissait déjà. La vie continuerait. Imperturbable.
Robert s’avança jusqu’à la ligne incertaine des vagues. Il contempla la masse sombre de la mer et le fil blanchi de ses crêtes. Aucune mer ne portera jamais plus son corps, se lamenta-t-il. Une solitude immense l’envahit. Un désespoir total. Ses genoux plièrent sous le fardeau et l’obligèrent à s’asseoir brutalement sur le sable humide.
Comme il aurait aimé revenir quelques heures en arrière. Oui, quelques heures seulement…
Des pensées frappaient son esprit sans jamais s’accrocher. Une houle déchaînée glissant sur les rochers. Solange, Florence… les seules femmes de sa vie. Des bribes de vacances heureuses surgissaient, aussitôt balayées par des images de fureur et de sang. La tempête battait sous son crâne. Il savait qu’elle ne s’arrêterait que le jour de sa mort. Le plus tôt possible…
Il resta prostré de longues minutes. Quand il releva la tête, un trait rouge déchirait l’horizon. Le soleil bientôt serait là. Les premiers enfants courraient sur la plage, les sourires, la vie… Péniblement il se décida à rebrousser chemin.
Il songea à rentrer se coucher. Se cacher complètement sous les draps comme un môme. C’était si loin l’enfance, il se sentait si vieux. Il paraît qu’un jour on retombe en enfance. Si seulement c’était vrai. Retrouver la joie et l’innocence juste avant de mourir…
Mais l’heure de la liberté n’avait pas sonné pour lui.
De retour devant le bosquet de roseaux, il s’imagina entendre un bruit glissant. Un bruit curieux. Il s’avança avec prudence dans les hautes herbes suivant une piste de tiges brisées. Et ce fut là, dans une minuscule clairière façonnée par la lutte mortelle de deux corps, qu’il découvrit le cadavre ensanglanté de la jeune Hollandaise.
Chapitre 2
Une brise légère rafraîchit son torse brûlant de sueur.
D’un seul regard, il embrassait toute la plaine du Roussillon jusqu’au bleu de la Méditerranée. Au nord, la crête des Corbières s’affaissait doucement vers l’étang de Leucate ; au sud, la chaîne des Albères cachait l’Espagne à ses yeux éblouis.
Le soleil étouffait les nuances de vert mais il faisait briller les toits de tuiles rouges. Chaque année l’urbanisation dérobait une bonne centaine d’hectares aux vignes et aux vergers. Les lotissements inondaient lentement la plaine. Ils entouraient les villages, les submergeaient, ne laissant plus deviner de leur passé que la silhouette dentée des vieux clochers romans. La population n’avait cessé de croître depuis cinquante ans et il fallait loger ces nouveaux arrivants avides d’une certaine douceur de vivre.
Gilles avait du mal à retrouver son souffle. Parti du bourg médiéval de Castelnou quarante-cinq minutes plus tôt, il avait gravi à petites foulées le sentier qui menait à la chapelle Sant-Marti de la Roca. La côte devenait rude sur la fin et l’avait contraint à marquer une pause. Avant, il l’avalait d’une seule traite.
Du piton rocheux où il se reposait, il ne pouvait voir la Têt mais il en suivait facilement le cours grâce aux villages qui bordaient la rivière jusqu’à Perpignan. Ces villages, il pouvait les nommer un par un. Pourtant, lui aussi avait été, quelques années auparavant, un nouvel arrivant, un de ces immigrés du nord que les Catalans accueillaient avec un mélange de sympathie, de fierté et de résignation. Par chance, il avait un travail. Un métier qui ne le passionnait plus mais qui lui apportait à la fin de chaque mois un salaire suffisant.
Il attrapa sa gourde et avala deux petites giclées d’une eau déjà tiède. Il s’en versa un peu sur la tête. L’eau coula sur sa nuque, puis chuta dans son dos.
Il frissonna.
Les bruits de l’activité humaine lui parvenaient dilués en un ronflement continu. Seul se distinguait le bourdonnement du Cessna des pompiers qui surveillaient sans relâche les massifs montagneux.
Sebag repensa à Léo. Son fils.
Ce matin, le gamin avait habilement évité de l’embrasser devant le lycée. La voiture à peine arrêtée, il était descendu rapidement en lâchant un truc inaudible qui voulait sans doute dire « Salut » ou « À c’soir ». Le manège durait depuis plus d’un mois. C’était de son âge. Il était en seconde. Le lycée. C’était un grand maintenant. Pas envie de montrer devant ses copains la moindre tendresse pour son paternel. La vie, quoi ! Sebag tentait de prendre la chose avec philosophie. Il avait toujours eu conscience que le temps des câlins était compté. Avec Léo comme avec Séverine. Et il en avait goûté chaque seconde, serrant leurs corps contre le sien, fermant les yeux pour s’imprégner de leur odeur. Il se souvenait de cette époque, pas si lointaine, où Léo passait les bras autour de sa taille et posait quelques instants sa tête contre sa poitrine avant de disparaître dans la cour de l’école. Ce temps-là était révolu. Définitivement. Le fiston avait du poil au menton et il approchait du mètre quatre-vingt. Dans quelques mois, quelques semaines peut-être, il dépasserait son père.
Il n’empêche ! Gilles ressentait un vide. Un manque. Physique. S’arrêter de fumer n’aurait pas été plus dur.
Il se leva, étira les muscles de ses bras, secoua ceux de ses jambes. Le dos était raide et sensible. Un peu plus que d’habitude.
Il fallait qu’il se décide à redescendre. À replonger dans ce monde turbulent. Et même s’il n’y avait pas grand-chose à faire en ce moment au bureau, Sebag ne pouvait rester absent toute la journée.
Il enfila son T-shirt, et se dirigea vers la chapelle Sant-Marti. Un petit sursis qu’il s’offrait.
C’était ouvert. Il entra. Le silence régnait dans la chapelle.
Il retira sa casquette et la tint sur son ventre entre ses mains croisées. Il longea la rangée de bancs. Par une ouverture carrée percée sur la face ouest, il contempla le Canigou. La montagne sacrée des Catalans tentait de retenir dans ses creux les dernières cicatrices de l’hiver. Le printemps avait été tardif, et en cette fin juin, la neige résistait encore. En s’accrochant dans les plis, elle en soulignait les reliefs. Le Canigou ainsi veiné de blanc sous le soleil était plus majestueux que jamais.
Il était temps de partir.
Sebag n’avait pas envie d’aller travailler. Il supportait de plus en plus difficilement la routine de son boulot.
Dehors, la luminosité l’obligea à fermer les yeux.
Il but une dernière gorgée et rangea sa gourde dans la pochette de son sac. Il régla sa montre chronomètre. Il allait lui falloir une petite demi-heure pour rejoindre la voiture. Vingt minutes de route pour atteindre Perpignan. Quinze minutes encore, le temps de prendre une douche dans les vestiaires du stade de l’Université.
Il serait au commissariat vers 11h30.
Chapitre 3
Elle flottait entre conscience et somnolence sans parvenir à rejoindre une berge. Elle ne pouvait bouger, ankylosée par un sommeil trop profond. Ses membres engourdis excluaient tout mouvement. Elle n’était pas pressée : le jour ne tarderait pas à se lever.
Elle sentait ses rêves lui échapper doucement. Il ne lui restait déjà plus que de fugitives impressions. De la chaleur, un peu de tendresse, de la douceur. Loin, elle le supposait, de ce qui l’attendait au réveil. Aucun son ne lui parvenait. Aucune image. C’était le vide. La nuit. Le silence. Elle n’existait que par une pensée fugace qui refusait de se poser.
À mesure que le froid se répandait dans son corps, elle sentait monter la douleur. Elle avait mal partout. Aux jambes, aux bras, à la tête. Mal au dos également.
Ses membres - elle commençait à comprendre - étaient solidement entravés. Pieds et poings liés, attachés dans le dos par une corde. Elle ne pouvait bouger. Elle parvenait seulement, par instants, à soulever sa tête lourde et fébrile. Son visage semblait à demi enfoui dans un matelas qui sentait le moisi.
Elle avait dû se livrer à un jeu bien étrange. Elle ne se souvenait plus des règles.
Au-delà du contact humide du matelas, elle percevait une autre sensation sur son visage. Comme un tissu. Sur les yeux plus précisément. On lui avait masqué la vue. Elle réalisait maintenant que le jour ne se lèverait pas. Qu’il ne se lèverait plus, peut-être. Ce n’était pas la nuit mais l’horreur. Elle tenta de lutter contre l’immense frayeur qui s’emparait d’elle.
Ce n’était pas un jeu.
Après avoir eu tant de mal à émerger des brumes épaisses qui anesthésiaient sa conscience et son corps, elle aurait souhaité maintenant se rendormir. Peut-être réussirait-elle à se réveiller loin d’ici. Dans le confort douillet d’une chambre d’amis, par exemple. Mais son esprit se faisait de plus en plus lucide, titillé par les douleurs lancinantes qui déchiraient son corps. Un mot se formait dans sa tête, impossible, incroyable, un mot qu’elle refusait.
Elle tenta de se souvenir. Rien de précis ne lui revenait. Juste la sensation de s’être endormie la tête appuyée contre la fenêtre d’une voiture, doucement ballottée par les virages d’une route de campagne. Souvenir récent ou réminiscence lointaine ? Enfant, elle aimait se laisser ainsi gagner par le sommeil au retour d’un dimanche joyeux passé dans la maison de ses grands-parents. Elle revoyait la lumière des phares perçant la nuit noire de la campagne hollandaise. Elle se souvenait du ronronnement du moteur et de la conversation tranquille de ses parents. Cette fois-ci, ce n’était pas sur la banquette arrière qu’elle s’était endormie mais sur le fauteuil passager à droite du chauffeur. Ce souvenir-là au moins était précis.
Elle souffrait mais ne se rappelait d’aucune violence. Elle plongea à l’écoute de son corps. La douleur venait surtout des meurtrissures infligées par les liens. Elle s’insinuait ensuite dans ses membres raidis par une position de plus en plus inconfortable. Par la pensée toujours, elle entreprit d’examiner sa tête. Sa douleur était celle d’une migraine, pas d’un coup. Elle n’avait pas été frappée. Son esprit glissa jusqu’à son sexe. Aucune douleur à cet endroit intime, pas la moindre impression de brûlure. Elle n’avait pas été violée.
Le mot s’imposa soudain à elle. Il n’y avait pas de doute possible. Un enlèvement ! C’était un enlèvement.
Mais pourquoi ?
Elle remua la tête, frotta son visage sur le matelas pour essayer de faire glisser ce maudit tissu qui lui cachait le jour. Puis elle s’immobilisa. Des souvenirs de films policiers lui revenaient en mémoire. Si ses ravisseurs lui avaient bandé les yeux, c’était pour qu’elle ne puisse pas les reconnaître plus tard. Quand ils l’auraient relâchée.
Ils comptaient donc la relâcher.
Quand ?
Peu importait pour l’instant. Elle avait entrevu un espoir. Une lumière. Il s’agissait donc bien d’une sorte de jeu. Un jeu cruel. Elle voulait le voir ainsi. Elle était prête à jouer avec application. Elle apprendrait les règles, les respecterait scrupuleusement.
Tout allait bien se passer.
Dans quelques jours tout au plus, elle rentrerait chez elle. Elle retrouverait son petit appartement d’Amsterdam et serrerait fort ses parents dans ses bras.
Au moment où elle se formulait à mi-voix ces pensées rassurantes, elle entendit une clé tourner dans une serrure.
Qui donc avait bien pu l’enlever ? Elle avait une idée mais la repoussait avec effroi.
La porte grinça. Les larmes d’Ingrid se perdirent dans le tissu grossier qui lui masquait les yeux.
Chapitre 4
— Tu peux me rendre un service, Gilles, s’il te plaît ?
Percevant l’hésitation de son collègue, Jacques Molina regarda ostensiblement sa montre. Il était tard pour arriver au travail.
— À charge de revanche, bien sûr, insista-t-il.
Jacques Molina faisait équipe avec Gilles Sebag depuis quatre ans. Ils partageaient le même bureau, enquêtaient souvent ensemble. Ils s’entendaient bien mais n’étaient pas amis. Trop de différences. Ils se supportaient, ils se respectaient. Ils estimaient tous les deux que ce n’était pas si mal.
— Qu’est-ce que je peux pour toi ?
— Au bureau des plaintes, j’ai reçu une jeune femme qui affirme que son mari a disparu. C’est une affaire qui semble… intéressante, mais là, je dois absolument me casser. Je suis pressé, j’ai un rencard important ce midi. Si tu pouvais me la garder au chaud, je t’en serai éternellement reconnaissant.
— Qu’est-ce que tu veux dire par « garder au chaud ».
Molina lui fit un clin d’œil complice.
— J’ai juste eu le temps de prendre les grandes lignes de sa déposition. J’aimerais que tu peaufines les détails et que tu me donnes tes impressions. Je poursuivrai l’affaire plus tard.
Sebag soupira longuement.
— Pas de problème. Je m’en occupe.
Molina était ravi.
— Je savais bien que je pouvais compter sur toi ! On mettra nos deux signatures sur le PV, comme si on avait traité l’affaire toute la matinée ensemble. Comme d’hab.
— Comme d’hab, répondit Sebag avec lassitude.
Il n’était pas très fier de lui. Pas très fier d’eux.
— Allez, file, tu vas te mettre en retard.
— Merci. À tout à l’heure.
Molina avait déjà tourné les talons. Il s’éloignait. Sebag lui cria :
— Brune ou blonde ?
Molina fit un grand geste de la main et répondit sans se retourner.
— Blonde le rencard, brune la déposition.
— Alors… vous vous appelez Sylvie Lopez, née Navarro. Vous avez 24 ans et vous habitez rue du Vilar à Perpignan. Vous travaillez comme femme de ménage dans une entreprise de nettoyage industriel. Vous êtes mariée depuis… trois ans et vous avez une petite fille née en janvier dernier.
Sebag releva la tête des notes prises par son collègue pour observer la jeune femme. Elle était brune effectivement, une coupe à la garçonne, façon Louise Brooks. Elle avait un joli minois triste, éclairé par de grands yeux noirs et humides. Fatigués. Sebag comprenait ce que Molina entendait par une « affaire intéressante ».
— Votre mari s’appelle José. Il est chauffeur de taxi. Et il n’est pas rentré depuis deux jours. C’est cela ?
Elle confirma d’un signe de tête timide.
— Racontez-moi tout, continua Sebag. La dernière fois que vous l’avez vu… Ce que vous vous êtes dit… À quel moment vous avez commencé à vous inquiéter, etc.
La jeune femme lissa sa jupe de sa main droite et se lança.
— La dernière fois que je l’ai vu, c’était mardi midi. Je partais travailler et lui devait partir aussi. Nous travaillons tous les deux l’après-midi et le soir. Enfin… c’est plutôt moi qui travaille comme ça et lui qui s’est adapté à mes horaires. C’est plus facile dans son métier, vous comprenez, chauffeur de taxi indépendant, c’est plus libre quoi.
Elle tira un fil de son ourlet de jupe et poursuivit.
— Je suis rentrée vers 22h30 après être passée chez mes parents pour récupérer la petite. Je l’ai couchée et j’ai préparé le dîner en regardant la télévision. Normalement, José rentre vers 23h30. Il attend le dernier train à la gare de Perpignan.
Elle releva légèrement les yeux et regarda l’inspecteur par en dessous. Sebag ne dit rien. Ne fit aucun geste. Il fallait laisser venir.
— À minuit, il n’était pas encore rentré. Je me suis dit que c’était une bonne nouvelle : ça voulait dire que le dernier client lui avait demandé une longue course. À cette heure-là, c’est le tarif de nuit, et les longues courses, ça rapporte bien, vous comprenez. Ça ne fait pas longtemps que José, il fait le taxi, et c’est un peu difficile. Il faut rembourser la voiture, la licence, payer l’essence, c’est vraiment dur. Mais bon : y’a mes parents qui nous aident…
Sebag s’autorisa à hocher la tête pour l’encourager. Service minimum. Elle avait ouvert une parenthèse sur leur situation financière et familiale. À elle de juger si elle devait la refermer tout de suite.
— Finalement, à minuit je me suis décidée à dîner. Je ne dois pas me coucher trop tard. La petite, elle se réveille tous les matins vers six heures et souvent même elle pleure plusieurs fois par nuit, alors, côté sommeil, vous comprenez…
Il comprenait, oui, il le lui exprima d’un clignement de paupières.
Elle ne reprit pas tout de suite. Elle retourna l’ourlet de sa jupe, sembla en vérifier la solidité. Les pauses tout comme les digressions pouvaient être significatives.
— Jenny… Jenny, c’est la petite, elle s’appelle Jennifer mais nous on dit Jenny, elle n’a pas du tout pleuré cette nuit-là et elle s’est réveillée plus tard que d’habitude. Juste avant sept heures. Ça n’était arrivé qu’une fois ou deux depuis sa naissance.
Elle semblait fière de sa fille. Tellement fière qu’elle osa abandonner l’examen de sa jupe pour relever la tête vers Sebag. Il lui sourit. Lui aussi se souvenait des premières semaines avec Léo, comment le sommeil et les repas d’un enfant pouvaient faire la pluie et le beau temps au sein d’une maisonnée.
— Je… je me suis occupée de la petite, reprit la jeune femme, je lui ai donné son biberon. Et comme José n’était toujours pas là, j’ai décidé de l’appeler sur son portable. Mais je suis tombée sur sa messagerie.
— Quelle heure était-il quand vous avez téléphoné ?
— Euh, je ne sais plus trop. Peut-être huit ou neuf heures.
Sebag se redressa et posa les coudes sur son bureau, les mains jointes devant sa bouche. Il lâcha comme si cela allait de soi :
— Vous avez laissé un message ?
— Oui… Non, bredouilla-t-elle. Enfin, pas tout de suite. J’avais du ménage, du repassage. Je me suis occupée. J’ai joué avec Jenny.
— Vous n’étiez pas inquiète ?
— Pas trop… Pas encore vraiment.
Sebag essaya d’imaginer ce qui se serait passé chez lui si un soir il n’était pas rentré. Claire n’aurait pas attendu le matin pour l’appeler. Elle l’aurait fait avant de se coucher et aurait laissé des messages sur son portable. Elle se serait inquiétée rapidement, elle aurait probablement mal dormi. Policier était un métier dangereux mais pas autant que chauffeur de taxi. La route tue davantage que les voyous.
La situation de son couple n’était pas comparable. Sebag, lui, ne se serait jamais absenté toute une nuit sans prévenir sa femme.
— À quel moment, avez-vous commencé à vous inquiéter ?
La question sembla briser la confiance qui s’était installée entre eux. Sylvie Lopez repiqua du nez vers son ourlet.
— Ben… euh, dans la matinée. J’avais rappelé sur son portable, j’avais laissé un message et comme il ne donnait toujours pas de nouvelles, là, j’étais inquiète.
— Et qu’avez-vous pensé alors ?
Sebag ne voulait pas bousculer la jeune femme. Il était partisan des accouchements sans douleur.
— Je ne me souviens pas précisément, reprit Sylvie Lopez après quelques hésitations. J’étais embêtée : il se faisait tard et il fallait que je parte travailler.
— Vous ne vous êtes pas inquiétée plus que ça, en fait.
Elle délaissa brusquement son ourlet pour se remettre à lisser sa jupe.
— Pas plus que ça, non.
Sebag la regarda. Il attendit quelques secondes qu’elle se décide à relever les yeux vers lui. Il prit sa voix la plus chaude, son ton le plus compréhensif. Même lors d’un accouchement sans douleur, il fallait bien à un moment ou à un autre passer à la phase de l’expulsion.
— Ce n’était pas la première fois qu’il découchait ainsi ?
Le menton de la jeune femme se mit à trembler. Elle posa sur lui ses yeux noirs brillants de honte.
— Ce n’était pas la première fois, n’est-ce pas ? insista-t-il.
— Non, avoua-t-elle dans un souffle.
Les larmes se décrochèrent et coulèrent lentement sur ses joues creuses. La jeune femme renifla. Sebag ouvrit le premier tiroir du bureau et sortit un paquet de mouchoirs en papier. Le dernier. Il faudra en racheter, se dit-il. L’administration fournissait gratuitement les balles de revolver mais n’avait pas prévu les mouchoirs. Ils étaient pourtant plus utiles au quotidien.
Sylvie Lopez se moucha longuement. Sebag attendit qu’elle termine.
— Votre mari a une maîtresse ?
Elle sursauta. Le mot l’offusquait. Comme s’il braquait un coup de projecteur sur une situation qu’elle avait toujours feint d’ignorer. Tant que l’on ne nomme pas les choses et les gens, on ne leur donne pas vie. Et on les empêche d’avoir trop de prise sur nous.
— Non… je ne crois pas que l’on puisse dire ça.
Elle cherchait ses mots, aurait voulu préciser sa pensée mais elle avait besoin de faire un peu de lumière dans sa tête. Elle devait d’abord commencer à regarder la vérité en face.
— Je pense qu’il a eu des… aventures, mais sans suite. Je ne crois pas qu’il ait une…, euh, une relation continue, quoi. Je l’aurais remarqué.
Elle essuya ses yeux avec le mouchoir. Son rimmel avait coulé et laissé des traces sur ses joues. Elle ne parvint pas à tout effacer. Sebag aurait aimé se lever et l’aider.
— Vous en avez parlé avec votre mari de ses… aventures ? demanda-t-il.
Elle fit non de la tête. Sebag ne chercha pas à masquer son étonnement.
— Vous semblez avoir accepté facilement cette situation…
Elle haussa les épaules.
— À quoi cela aurait-il servi d’en parler ?
Elle se moucha à nouveau et, devant le silence de Sebag, se sentit obligée d’expliquer.
— Je pense que les hommes ont parfois des besoins que les femmes n’ont pas. Et puis, je crois que le fait d’être père, ça l’a un peu angoissé. Il avait peut-être besoin de se rassurer, je ne sais pas. Vous avez des enfants ?
Sebag se garda bien de répondre.
— Et puis tant qu’il rentrait à la maison et qu’il était gentil avec moi, avec nous, je n’avais pas de raison de me plaindre, non ?
Sebag la trouvait touchante dans sa naïveté d’un autre temps. Elle avait dit cela comme si c’était banal. Son mari était vraiment le roi des cons, se dit-il. Une femme comme elle, on ne la quitte pas. Il griffonna quelques mots-clés dans son cahier. Un petit cahier bleu à grands carreaux. Ces notes lui seraient précieuses pour retranscrire l’entretien le plus fidèlement possible.
— Qu’est-ce qui vous fait penser que votre mari n’a pas simplement découché deux nuits de suite ?
— Comme je n’avais pas de nouvelles, j’ai appelé certains de ses collègues, j’en connais deux ou trois qui étaient venus à la maison. J’ai dit que la petite était malade, que je devais le joindre d’urgence, qu’il avait perdu son portable. Mais personne ne l’a vu de toute la journée de mercredi.
Sebag pesa ses mots pour ne pas la blesser.
— Il aurait pu, si je puis dire, « découcher » aussi toute la journée.
Elle secoua énergiquement la tête. Une mèche de cheveux se colla à son rimmel humide.
— Cela vous semble impossible ? poursuivit-il.
— Il aurait appelé, pris des nouvelles de la petite…
— Il a peut-être eu peur.
Ses grands yeux sombres s’arrondirent. On aurait dit deux calots noirs.
— Peur de quoi ?
— Peur de vous.
— Mais pourquoi puisque je ne lui demande rien ?
— Vous ne lui auriez pas fait de scène ? Et vous l’auriez laissé repartir sans rien dire ?
Ses deux calots sombres agrippèrent le regard de Sebag. Elle voulait le convaincre.
— À quoi cela aurait servi que je lui fasse une scène ? On risquait de le perdre pour toujours. Et puis, s’il voulait nous quitter définitivement, il pouvait rentrer nous le dire, non ?
— Même le meilleur des hommes a parfois quelques lâchetés, ironisa Sebag. Peut-être n’a-t-il pas osé vous le dire ?
Elle réfléchit quelques secondes aux arguments de l’inspecteur, puis les balaya d’un mouvement de tête énergique.
— Non, vraiment, je ne pense pas. Il faut me croire, monsieur l’inspecteur, il lui est arrivé quelque chose. Je le sais, je le sens. Quelque chose de grave.
Après le déjeuner, Sebag relut la déclaration de disparition remplie par Sylvie Lopez. Ils l’avaient complétée ensemble en dressant un signalement rapide de José : la trentaine, 1m75, trapu, yeux noirs, cheveux et sourcils bruns et drus, un grain de beauté sur la nuque. Ils avaient noté les vêtements qu’il portait le jour de sa disparition - un pantalon léger marron clair et une chemise bleu ciel. Puis Sebag avait fait signer le procès-verbal à la jeune femme avant de la renvoyer chez elle sur quelques paroles rassurantes qui ne l’avaient pas rassurée le moins du monde.
Il restait perplexe.
L’inquiétude de la jeune épouse avait fini par le contaminer. Il n’arrivait pas à éteindre dans sa mémoire l’éclair de jais humide et implorant de ses yeux doux. Qu’est-ce qui l’incitait à poursuivre cette affaire ? se demanda-t-il. L’intuition que cette disparition cachait effectivement quelque chose de grave ou la sympathie qu’il éprouvait pour la jeune femme ?
Il composait le numéro de portable du mari quand le téléphone fixe de son bureau sonna. C’était le commissaire Castello. Son chef.
— Ah, Sebag, enfin… Vous pouvez venir me voir, s’il vous plaît.
Il précisa mais à son ton Sebag avait déjà compris :
— Tout de suite.
Le bureau du commissaire était situé au troisième étage, juste au-dessus du sien. Sebag gravit rapidement l’escalier. La porte était ouverte mais il s’arrêta sagement sur le seuil.
— Entrez, fit Castello, et refermez derrière vous, s’il vous plaît.
Sebag s’exécuta. Redoutant des reproches pour son absence matinale, il tenta de devancer son patron.
— Alors, comment ça se passe l’entraînement ? La forme ?
L’inspecteur et le commissaire s’étaient croisés plusieurs fois sur des compétitions de course à pied. Sur la ligne de départ. Sebag, plus jeune et plus entraîné, courait loin devant. Mais Castello, malgré sa cinquantaine, continuait de progresser. Il ambitionnait de s’aligner un jour sur un marathon. Paris ou New York, d’ici un an ou deux. Sebag lui prodiguait conseils et encouragements. Il en avait trois à son actif, lui, des marathons.
Castello ne se laissa pas distraire par la question de son subordonné.
— Dites-moi, Gilles, je n’ai pas réussi à vous trouver ce matin.
— Vous aviez besoin de moi ? éluda Sebag.
— Oui, j’ai eu un entretien téléphonique avec le capitaine Marceau, le responsable de la douane, vous savez pour cette affaire de contrebande de cigarettes…
— Le dossier avance ?
— Lentement, mais Marceau envisage tout de même une descente dans un entrepôt près du marché Saint-Charles ainsi que dans quelques bars perpignanais. Ils auront probablement besoin de nous.
À la suite de quelques saisies fructueuses au printemps, les douanes avaient constaté qu’une petite bande de malfaiteurs locaux était en train de mettre sur pied un véritable réseau de vente clandestine de cigarettes, profitant ainsi des énormes disparités de prix d’un côté et de l’autre des Pyrénées.
— C’est pas un peu tôt pour faire une descente ? s’inquiéta Sebag.
— Sans doute. Mais la préfecture nous met la pression. Le gouvernement souhaite des résultats rapides.
Le sujet était politiquement sensible. Depuis les augmentations du prix des cigarettes en France au début des années 2000, les bureaux de tabac fermaient les uns après les autres en Roussillon alors que les ventes de cigarettes doublaient au village frontière du Perthus. Les principaux fautifs n’étaient pas les trafiquants d’ailleurs, mais les particuliers qui s’approvisionnaient en Espagne. Vingt euros d’économie par cartouche, le voyage était vite remboursé. À défaut de pouvoir arrêter tous les fumeurs, la préfecture voulait faire un exemple en mettant fin au trafic.
— Si les douanes agissent trop vite, cela risque d’être un coup d’épée dans l’eau, fit remarquer Sebag.
— Je sais, je l’ai dit à Marceau. Mais quand la politique s’en mêle…
— Il faut qu’on se démène, c’est ça ?
— On peut le dire comme ça, sourit Castello.
Sebag hocha la tête avec dépit. Si les politiques voulaient s’occuper sérieusement du problème, il leur suffisait d’harmoniser les politiques fiscales entre les deux pays. Le trafic cesserait aussitôt. Les douanes pourraient alors se concentrer sur des magouilles plus dangereuses et les policiers sur la vraie délinquance. Celle que l’on ne pouvait régler d’un simple décret ministériel. Les vols, les agressions, les incendies de voitures. Celle qui touchait vraiment les gens.
— Marceau me disait que notre ministre envisageait de profiter de l’occasion pour venir faire ici une opération de communication, ajouta Castello.
— Je vois d’ici le topo, maugréa Sebag. On va monter vite fait un gros barnum : opération conjointe police, douanes et peut-être même gendarmerie. On va brasser beaucoup d’air, arrêter une poignée de trafiquants et saisir quelques cartouches. Et ce qui sera important, ce ne sera pas le résultat de l’opération mais ses retombées médiatiques.
— Eh bien ! Ce n’est pas avec ce type de réflexion que vous ferez carrière.
Sebag se retint de ricaner. Sa carrière, il y avait bien longtemps qu’il avait tiré un trait dessus. Ou plutôt qu’on l’avait contraint à le faire.
— Vous ne regrettez pas aujourd’hui les choix que vous avez faits ? demanda soudain le commissaire.
Sebag croisa les bras nerveusement. Il n’avait pas envie de parler de ça. Castello caressa sa barbe grisonnante. Elle était un peu longue. Les cheveux aussi d’ailleurs. Ils commençaient à lui descendre dans le cou. Le commissaire saisit un stylo sur son bureau et le rangea dans un pot en terre que Sebag connaissait bien. Il avait reçu le même pour sa participation à la Ronde cérétane, une célèbre course du département.
— Je n’ai jamais eu l’occasion de vous le dire mais je trouve que c’était un choix courageux.
La réflexion surprit Sebag. C’était la première fois qu’on le félicitait à ce sujet. Jusqu’ici, il avait eu davantage l’impression d’être considéré comme un paria. Du jour au lendemain, il était passé du statut de jeune flic prometteur à celui de vilain petit canard. Et tout cela dans un non-dit absolu.
Le commissaire continua sur un ton grave :
— Moi, quand j’ai commencé à comprendre les choses, il était trop tard.
Castello vivait séparé de sa femme. Elle avait refusé de le suivre à Perpignan, préférant rester à Paris. La procédure de divorce était en cours, avait cru deviner Sebag. Castello avait deux grands fils, l’un suivait des études de médecine, l’autre était encore au lycée, en Terminale. Il n’avait jamais montré jusqu’ici que la solitude et l’éloignement lui pesaient : un chef, un peu comme un père, se devait d’être fort et sans état d’âme. Sebag était du même avis et ne chercha pas à susciter davantage de confidences.
— Vos enfants sont grands maintenant, reprit Castello, je pensais à vous pour une petite promotion.
— Dieu m’en préserve ! s’effaroucha Sebag.
Le commissaire fronça les sourcils. Ils étaient restés étrangement bruns quand sa barbe et ses cheveux avaient blanchi.
— Vous le savez, je vous considère de fait comme le coordinateur de l’équipe d’inspecteurs. Coordinateur et chef, c’est pareil dans la pratique mais officiellement, c’est très différent. Et le salaire n’est pas le même.
Sebag évita le regard de Castello. Il ne voulait pas de ce poste et des responsabilités qui allaient avec. Mais il n’avait aucun argument – valable aux yeux de son chef – à présenter.
— Je… La situation actuelle me convient très bien comme ça.
Castello se gratta furtivement le bout du nez.
— Réfléchissez. Vos enfants vont bientôt avoir l’âge des études supérieures et vous verrez alors que le salaire d’un simple inspecteur ne suffit plus.
— Léo n’est encore qu’en seconde. Et puis ma femme travaille aussi…
— Le temps passe toujours plus vite qu’on ne pense. Et d’ici que votre fils ait son bac, le poste aura été pourvu.
Sebag hocha la tête d’un air qu’il voulait grave.
— Je vous promets de réfléchir à la question, concéda-t-il.
Le commissaire se contenta de cette réponse mais Sebag le savait contrarié. La question suivante le lui confirma.
— Au fait, vous étiez où ce matin ?
— Sur une enquête avec Molina, euh, une affaire intéressante, enfin, je crois.
— Mais encore…
Sebag avait conscience de s’aventurer sur une pente savonneuse.
— Un chauffeur de taxi qui a mystérieusement disparu.
— Mystérieusement ? Allons donc ! Depuis longtemps ?
Il fit un compte rapide dans sa tête. Sylvie Lopez n’avait pas vu son mari depuis le mardi matin. Deux jours d’absence étaient suffisants pour inquiéter une épouse, pas assez pour bousculer la routine d’un flic.
— Depuis plus de soixante-douze heures, exagéra-t-il.
— Hum, hum. Je suppose que vous avez lancé une recherche dans l’intérêt des familles ?
La loi offrait aux policiers plusieurs possibilités d’action. La recherche dans l’intérêt des familles se limitait à une enquête administrative effectuée dans le seul département. Une sorte de service minimum. Pour les personnes majeures, c’était la procédure la plus courante.
— J’allais le faire quand vous m’avez appelé. Je me demandais également si je ne devais pas faire inscrire la personne dans le fichier national des personnes recherchées.
— Déjà ?
Castello porta machinalement deux doigts serrés à ses lèvres.
- C’est vrai que soixante-douze heures, ça commence à être long, poursuivit-il, un peu trop pour une simple histoire de fesses, non ?
— C’est ce qu’on s’est dit avec Molina. Cela pourrait cacher quelque chose.
— Quoi ?
— Je ne sais pas trop. Il y a certains détails, effectivement, qui ne cadrent pas avec l’idée d’une fugue ou d’un simple adultère.
Sebag hésita. « Plus c’est gros, plus ça passe » avait coutume de dire Molina.
— D’après les premiers éléments de l’enquête, le chauffeur de taxi faisait beaucoup d’allers et retours avec l’Espagne.
— Vous pensez qu’il est impliqué dans la contrebande de cigarettes ?
— Je ne sais pas trop, en fait, mais j’ai une drôle d’impression, ajouta-t-il.
— Votre instinct ?
Castello avait la religion de l’instinct. Sebag, lui, préférait parler d’intuition, mais le féminin ne semblait guère convenir au commissaire.
— Oui, peut-être… Il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire.
Sebag n’aimait pas mentir. L’habitude dans ce domaine lui avait apporté un certain talent mais aucun confort.
— Faites comme vous le jugerez bon, concéda Castello.
Il porta de nouveau les doigts à ses lèvres.
— Vous avez une cigarette ? demanda-t-il brusquement à Sebag.
— Je croyais que vous aviez arrêté.
— Ouais, comme toutes les semaines, bougonna le commissaire. Et comme toutes les semaines, j’ai repris dès le lendemain.
Sebag fit dépasser une cigarette de son paquet de blondes et lui tendit. Castello attrapa le paquet et lut à haute voix l’étiquette.
— Fumar puede matar. Vous achetez vos cigarettes au Perthus, vous aussi ?
— Comme tout le monde, j’y vais de temps en temps. Je ne fume pas beaucoup.
Castello posa le paquet sur son bureau et porta la cigarette à ses lèvres. Sebag sortit un briquet. Il lui présenta la flamme.
— Comme dit le proverbe : « On ne peut pas fumer sans feu. »
Le commissaire le gratifia d’un sourire service minimum. Il ferma les yeux et tira une longue bouffée voluptueuse. La fumée enveloppa son visage d’une auréole bleutée.
— Que c’est bon, cette saloperie, fit-il en rouvrant les yeux. Et c’est encore meilleur après plusieurs jours d’abstinence. Mais… il ne faut jamais être prisonnier de ses vices. Ni de ses choix.
Il tira lentement une nouvelle bouffée.
— Je vous l’ai déjà dit et je vous le répète : je respecte le choix que vous avez fait il y a quelques années. Vous êtes un bon flic, Sebag, mais un bon flic n’est rien sans un minimum de travail.
Sebag posa le briquet sur le bureau juste à côté du paquet de cigarettes.
— Je vous laisse le tout, patron. Des briquets, j’en ai des dizaines. Ils les donnent gratuitement au Perthus.
— Quand vous vous impliquez dans une affaire, vous êtes le meilleur, Gilles, mais uniquement à cette condition.
— C’est une chance qu’ils offrent des briquets en Espagne, sinon on aurait pu avoir également sur les bras un trafic de briquets…
Sebag s’interrompit. Castello se grattait le nez et se mordait les lèvres en même temps. C’était très mauvais signe.
— J’ai toujours eu confiance en votre instinct et j’espère pouvoir continuer. Je souhaite avoir bientôt des éléments tangibles sur cette « mystérieuse » disparition d’un chauffeur de taxi.
Sebag acquiesça d’un signe de tête. Il fit demi-tour et se dirigea vers la porte. Castello l’arrêta.
— Une dernière chose, Sebag.
— Oui, monsieur.
— Quand je dis bientôt, cela signifie : avant demain soir. Compris ?
À son domicile, tout était étrangement calme. Il s’avança dans le salon. La porte-fenêtre était ouverte.
Gilles Sebag habitait Saint-Estève, la proche banlieue de Perpignan. La maison construite en U, était orientée plein sud vers la terrasse et la piscine. Côté est, on trouvait un bureau et la chambre des parents avec sa salle d’eau ; côté ouest, il y avait les chambres des enfants et une salle de bains familiale. Entre les deux, l’espace commun : un grand séjour-salon avec une cuisine à l’américaine. L’habitation disposait également d’un garage mais Sebag l’avait divisé en deux parties pour faire office à la fois de buanderie et d’espace gym.
Il s’avança sur la terrasse. Personne dehors. L’eau de la piscine frissonnait sous le vent léger. Quelques feuilles d’abricotier flottaient à la surface. Il rentra.
Il ouvrit le bar, prit la bouteille de pastis et s’en versa quelques gouttes dans un grand verre. Il y plongea trois glaçons avant de finir de remplir le verre au robinet. Il but une gorgée. La boisson était encore trop chaude.
Il appela :
— Claire !
Pas de réponse. Il renouvela son appel.
— Claire !
Une voix flûtée lui parvint du fond de la maison.
— Elle n’est pas là, papa. Il n’y a que moi.
Il traversa l’aile ouest – ce terme faisait cossu, il aimait bien – jusqu’à la chambre de Séverine. Il frappa mais n’attendit pas qu’on lui dise d’entrer. Sa fille, assise à son bureau, faisait ses devoirs. Sebag n’en voyait que la tignasse brune et frisée.
Il posa un bisou sur sa nuque.
— Maman n’est pas là ?
— Non, elle a un conseil de classe.
— Un conseil de classe ? À deux jours des vacances !
— T’as raison, ce n’est pas un conseil de classe. Je crois que c’est plutôt un conseil de discipline, un truc comme ça.
— Ah, bon ! Et Léo ?
— Papa… Il est au basket à Perpignan. Comme tous les jeudis.
— C’est vrai ! Il faut que j’aille le chercher ou il y est allé en scooter ?
— Il a pris son scoot.
Sebag hésitait entre le soulagement de ne pas avoir à ressortir et l’appréhension de savoir son fils sur les routes avec son abominable deux-roues. Il ne voulait pas lui en offrir un, mais, au terme d’un âpre combat, il avait dû céder devant ses demandes insistantes relayées par sa mère. On n’était jamais mieux trahi que par les siens. Ou par les seins ! Il revoyait sa femme se pencher sur lui un soir avec son corsage largement échancré. Elle s’était assise sur ses genoux et avait fini par arracher son accord. Qui prétendra encore que les hommes sont le sexe fort ?
Séverine s’était replongée dans ses devoirs. Elle était en cinquième. Une bonne élève. Sans souci. Il posa ses mains sur ses épaules menues et se pencha sur sa feuille.
— Tu as encore des devoirs à la veille des vacances ?
— Non, pas vraiment, mais le sujet m’intéresse : Charlemagne et l’organisation de l’empire carolingien.
— Ouah. Les missi dominici, les marches, Aix-la-Chapelle, le sacre en l’an 800, l’empereur à la barbe fleurie…
— Eh, mais tu connais ça vachement bien !
— Tu parles si je connais… Qui n’a pas jamais entendu parler de l’affaire Dominici dans la police ?
Elle laissa échapper un petit rire cristallin. Enchanteur. Quelques semaines plus tôt, ils avaient regardé ensemble un documentaire sur ce vieux fait divers. Sebag ferma les yeux. Il savait que sa fille ne rirait pas toujours à ses plaisanteries faciles.
Avant de sortir, il jeta un regard sur la petite chambre. Quelques peluches patientaient sagement sur le lit. Un ours, un lapin, un chat. Derniers témoins d’une enfance qui s’enfuyait. Aux murs, les affiches de chanteurs à la mode clamaient déjà à la face du monde les émois de l’adolescente. Au moins, Sebag pouvait se réjouir des préférences de sa fille pour une certaine chanson française à textes, chanson qu’il découvrait en même temps qu’elle. Avec Léo, ce n’était pas pareil. Le fiston n’avait de passion que pour le sport et le rap, deux domaines dans lesquels Sebag se flattait de son inculture.
Il referma doucement la porte.
Son verre à la main, il se rendit à la buanderie. Il sortit le linge humide de la machine à laver. Claire avait lancé une tournée le matin avant de partir travailler. Dans le jardin, il étendit les vêtements sur le fil. La tramontane chantonnait et le soleil cognait encore malgré le soir qui tombait. Dans une petite heure, il pourrait tout rentrer. Les tâches ménagères ne le rebutaient pas. Ces gestes répétitifs exécutés avec soin favorisaient plutôt ses réflexions. Il en avait pris l’habitude après la naissance de Séverine lorsqu’il avait opté pour un mi-temps parental pour être davantage présent auprès de ses enfants.
Ce fameux choix de carrière qu’on lui avait fait payer cher.
La loi n’avait pourtant pas exclu les flics du dispositif. Chacun avait le droit de choisir un aménagement de son temps de travail durant les trois premières années de son plus jeune enfant et personne n’avait pu s’y opposer au commissariat de Chartres où il travaillait à l’époque. Mais sa décision avait surpris et déplu. Un homme qui choisit ses enfants plutôt que son métier, ce n’était apparemment pas dans les us et coutumes de la police française.
Sa carrière s’en était trouvée sensiblement ralentie. Après sa mutation sur Perpignan, il avait repris à plein-temps, mais son nom était sans doute resté inscrit sur une liste noire dans un fichier secret du ministère de l’Intérieur. Les promotions étaient tombées autour de lui, mais lui n’avait rien eu. Jusqu’à la nomination de Castello, il y a trois ans. Il avait enfin obtenu une gratification salariale et, plus important encore, il avait retrouvé la confiance de ses supérieurs. Cela lui rendait le travail plus agréable au quotidien mais pour le reste, il était trop tard. Aujourd’hui, sa vie se passait ailleurs qu’au commissariat et sa seule ambition était de ne pas trop mal faire son métier sans se compliquer inutilement la vie.
Dans le sac de linge, il ramassa un soutien-gorge qu’il ne connaissait pas. Rose. Petit. Il mit un peu de temps à réaliser qu’il appartenait à Séverine. Son premier soutien-gorge. Il se rappela d’un été où elle refusait obstinément de quitter le haut de son maillot de bain. Elle le gardait sous son T-shirt même pour aller à l’école. Elle devait avoir sept ou huit ans.
C’était hier.
Il attrapa un autre soutien-gorge. Plus grand et avec des dentelles. Il était à Claire, celui-là. La gamine avait encore du chemin à faire avant d’avoir les formes séduisantes de sa mère. Surtout que la nature ne se presse pas. Il accrocha les soutiens-gorge loin l’un de l’autre pour ne vexer personne.
Avec Molina, ils avaient bossé dur l’après-midi. Il les avait foutus dans la merde avec sa connerie d’instinct. La disparition du chauffeur de taxi n’avait probablement rien d’énigmatique. Quand il le saurait, le patron serait furieux. Si au moins ils pouvaient ramener le mari adultère au foyer conjugal d’ici demain soir, ils limiteraient les dégâts.
Par acquit de conscience, Jacques avait laissé à son tour un message sur le répondeur de Lopez pendant que Sebag appelait successivement l’hôpital de Perpignan et les principales cliniques du département. Il avait même contacté l’établissement psychiatrique de Thuir. Sans résultat. Ils avaient communiqué l’immatriculation du taxi aux patrouilles de police. À la municipale également. Aucune trace dans les rues de Perpignan. En fin d’après-midi, ils avaient transmis le numéro aux gendarmes du département. Jacques était retourné voir Sylvie Lopez à son travail. Elle lui avait donné une photo de son mari qu’elle conservait dans son portefeuille. Pendant ce temps, il s’était rendu à la gare et à l’aéroport. Il avait interrogé les confrères de Lopez. Personne ne l’avait vu. Ni aujourd’hui, ni hier. A priori, il avait effectué sa dernière course mardi, pas à 23 heures comme le supposait son épouse mais vers 19 heures. Enfin, armés de la photo de Lopez, ils avaient écumé ensemble les hôtels voisins de la gare au cas où le chauffeur de taxi y aurait emmené ses conquêtes.
Ils avaient fait chou blanc.
Molina devait encore travailler ce soir. Il irait dans un bar où Lopez jouait le vendredi au billard. Peut-être y rencontrerait-il des amis du chauffeur. Sebag, lui, devait reprendre dès le lendemain matin la tournée des hôtels en élargissant le cercle des recherches. Pour l’heure, il en avait sa claque.
À chaque jour suffit sa flemme. Telle était sa devise.
Avant de quitter le boulot, ils avaient reçu le casier judiciaire de Lopez. Une condamnation pour vol de voiture en 1994 – il avait 17 ans -, une autre pour coups et blessures cinq ans plus tard. Lopez n’était pas blanc-blanc, c’était plutôt une surprise. Deuxième élément tangible mais qui ne donnait pas plus que le premier d’orientation nouvelle à leur enquête.
Après avoir étendu le linge, il s’assit au bord de la piscine. Les pieds dans l’eau, il dégusta son pastis glacé.
Où était donc passé ce connard de Lopez ? Il avait une gentille femme qui, non seulement lui pardonnait ses incartades, mais en plus faisait semblant de ne pas les voir. Aucune remarque, aucun reproche. Pourquoi avait-il fallu qu’il en abuse ? Le baby blues du papa ? Il paraît que c’est fréquent, ces pères qui n’assument pas. Beaucoup de couples se déchirent dans les six mois qui suivent une naissance.
Gilles avait toujours trouvé cela étrange.
La naissance de Léo avait été le plus beau jour de sa vie. Il trouvait l’expression juste même si sa banalité en atténuait la force. En quittant la maternité après une longue nuit sans dormir, il avait erré dans les rues de Chartres sachant qu’il ne parviendrait pas à trouver le sommeil. Il scrutait le visage des hommes qu’il croisait pensant y lire le bonheur de la paternité. Comment pouvaient-ils être pères et ne pas le crier à la face du monde ? Comment pouvaient-ils être pères et continuer à vivre comme avant ? Il avait, lui, un tel sentiment de plénitude et d’accomplissement…
Il avait participé à l’accouchement du début à la fin. Il avait transpiré avec Claire, il avait poussé avec elle, ils avaient crié ensemble au moment de l’expulsion. En prenant dans ses mains cette petite boule d’homme recroquevillé sur lui-même, il s’était senti fort. Invincible pour la première fois de sa vie. Il avait alors compris ce que personne n’avait su lui expliquer. Que si les luttes âpres de la vie forgeaient le caractère, seule la chaleur étouffante d’une maternité pouvait faire de vous un homme. Un nouveau Gilles Sebag était né ce jour-là.
Séverine les avait rejoints à peine deux ans plus tard. Un garçon, une fille. Le choix du roi comme on dit. Le bonheur parfait.
— Bonsoir !
Une voix douce et chantante. Gilles s’extirpa de ses pensées. Il se retourna.
— Bonsoir.
Claire s’avança. Elle portait une robe à fleurs, légère sur sa peau bronzée. Sa démarche était aérienne. Elle avait fait dix ans de danse autrefois et son corps s’en souvenait. Elle se pencha sur lui et posa un bisou sur ses lèvres.
— Tu es belle.
Elle prit un air étonné.
— C’est gentil, fit-elle doucement.
— Non. Ce n’est pas gentil, c’est sincère.
Elle s’inclina de nouveau et lui roula un patin langoureux. Leurs lèvres s’attardèrent. Claire avait les pommettes rouges. Elle a dû avoir chaud dans la voiture, se dit Sebag.
— Tu rentres tard.
Les mots lui avaient échappé. Ils sonnaient comme un reproche. Heureusement, Claire ne releva pas. Elle se contenta de souffler longuement.
— Nous avons eu deux cas difficiles à régler : des élèves de seconde dont les parents refusent le redoublement.
Claire était professeur de français. Elle enseignait dans un lycée de Rivesaltes. Son métier la passionnait toujours. Il aurait aimé pouvoir en dire autant.
— Qu’est-ce qu’on mange ? demanda-t-elle
— Je ne sais pas. Il y a un reste de salade de tomates.
— Encore…
— On peut faire revenir quelques lardons avec des petits oignons. Ça renouvellera l’ordinaire.
Elle lui fit un nouveau bisou sur les lèvres. Tendre.
— Je peux te laisser t’occuper de tout ? J’aimerais me baigner.
— Pas de problème.
Elle laissa tomber sa robe à terre et dégrafa lentement son soutien-gorge. Tiens ! il ne le connaissait pas celui-là. Puis elle quitta son string et plongea nue dans l’eau.
Il la contempla un instant. Il la trouvait belle. Plus belle encore qu’avant. Il finit son verre, sortit les pieds de l’eau, les essuya et s’en alla à la cuisine préparer le repas.
Lorsque Léo rentra, ils terminaient de dîner sur la terrasse. Il était fier comme un pou et n’enleva son casque que pour se mettre à table.
— Génial, lâcha-t-il.
— Géniale, la salade de tomates ? demanda Séverine qui boudait devant son assiette.
— Non. Génial, le basket !
Sebag questionna à son tour :
— Le basket ou le scooter ?
Léo rigola :
— Les deux, mon capitaine.
— Lieutenant, crut utile de préciser Séverine. Un inspecteur, aujourd’hui dans la police française, on appelle ça un lieutenant.
— Ah ouais, c’est vrai, j’oublie tout le temps.
— Moi aussi, le rassura Sebag. Et je ne suis pas le seul.
— Lieutenant ! ricana Léo, c’est trop cool. Comme aux States. Toi, papa, t’es Starsky ou Hutch ?
— Ni l’un, ni l’autre. Inspecteur Gadget, plutôt.
Gilles et les enfants pouffèrent. Claire, qui ne semblait pas avoir suivi la conversation, sourit pour se mettre au diapason.
Après le repas, alors qu’ils étaient seuls à ranger la cuisine, Gilles demanda à sa femme :
— J’ai l’impression que tu es préoccupée depuis quelque temps. Le travail ?
— Oui un peu, répondit-elle sans conviction. Je ne sais pas. La fin de l’année peut-être.
— Ou la crise de la quarantaine ?
Elle fit mine de le gifler.
— Oh ça va, hein, je n’ai pas encore quarante ans.
— À peu de chose près.
— L’année prochaine.
— C’est ce que je dis : quelques mois.
Il l’embrassa dans le cou.
— Tu n’as jamais été aussi belle.
Elle passa la main dans ses cheveux. Lui fit doucement redresser la tête.
— Tu m’aimes ?
— Pas encore mais je sens que ça pourrait venir un jour.
— Dans combien de temps ?
— Patientons encore quelques dizaines d’années…
Ils s’embrassèrent longuement au-dessus de la porte ouverte du lave-vaisselle. Un peu plus tard, à l’heure de se coucher, il la déshabilla. Elle sembla gênée. Il ferma la fenêtre et ils firent l’amour. Il faisait chaud.
Le corps de Claire brillait sous la lumière de la lune. Il avait une teinte blanche presque irréelle. Gilles caressa sa peau. Ses doigts glissèrent sur son cou, puis son dos, jusqu’à ses fesses.
— J’aime le clair de lune. Et la lune de Claire.
Il lui avait déjà dit mille fois mais il fallait savoir se répéter. Elle tourna son visage vers lui. Lui sourit avec un peu trop de gravité. Ses pommettes étaient rouges. Comme tout à l’heure.
Chapitre 5
Elle avait mangé. Des pâtes trop cuites et pas assez salées, mais elle avait mangé. Et bu également.
Avant d’avoir une assiette et un verre devant elle, la jeune femme ne s’était pas rendu compte qu’elle avait faim et soif. L’angoisse lui serrait trop le ventre.
Son geôlier était entré sur la pointe des pieds. Il n’avait émis aucun son. Elle avait juste perçu sa respiration calme. Avant de lui délier les mains, il avait vérifié la bonne tenue du masque sur ses yeux. Elle avait compris le message, elle ne l’enlèverait pas ce masque, elle le lui avait dit. Elle lui avait beaucoup parlé d’ailleurs. En hollandais d’abord, puis s’apercevant de son erreur, en français. Les mots lui étaient venus tous seuls, même dans cette langue qu’elle maîtrisait encore mal. Les mots s’échappaient d’elle comme un flot trop longtemps retenu. Ils libéraient son angoisse. Parler, c’est vivre, c’est rester un être humain. Et c’est aussi créer un lien. Elle avait posé des questions à son ravisseur. Sur ses intentions. Ses motivations. Et sur son choix.
Pourquoi elle ?
Mais elle n’avait pas obtenu de réponse. Il lui avait pris les mains, les avait posées sur l’assiette. Et il était sorti.
Elle avait dévoré les pâtes, enfournant de pleines fourchetées dans sa bouche avide. C’était si bon de manger. Quand le corps s’occupe, l’esprit se repose.
Après le repas, elle s’était docilement recouchée sur le ventre pour qu’il puisse sans peine la rattacher.
Aussitôt, il était revenu.
Il devait la guetter derrière la porte. Mais il avait frappé avant d’entrer. Ce geste l’avait étonnée. Il s’était approché d’elle, l’avait prise par le bras et l’avait guidé dans un coin de la cave. La fraîcheur humide qui régnait dans ce lieu ne pouvait émaner que d’une cave.