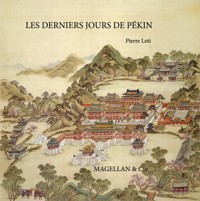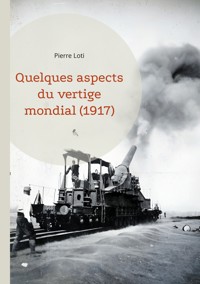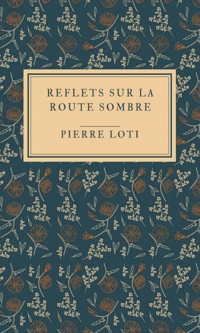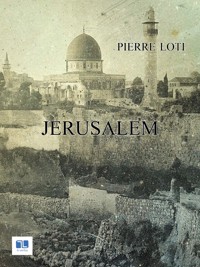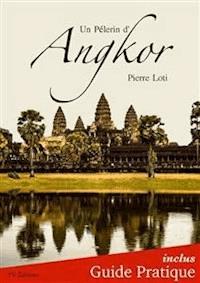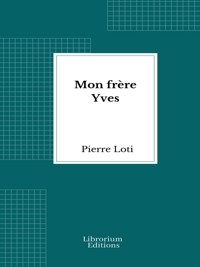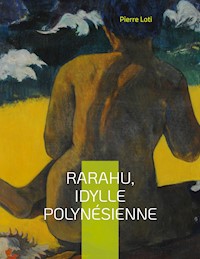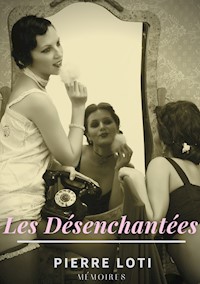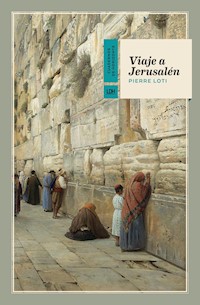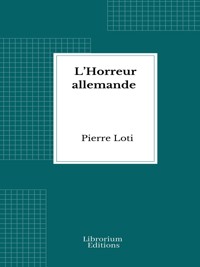
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Pendant des lieues, pendant des heures, traverser des dévastations que naguère encore aucune imagination française n’aurait su concevoir, et se dire qu’il ne reste que cela de nos belles provinces, sur lesquelles leur maître les avait lâchés !…
Faut-il qu’ils aient travaillé, les gorilles, travaillé avec une rage inlassable et un stupéfiant génie de la malfaisance pour avoir si vite obtenu ces vastes dévastations qui, à mesure qu’on avance, se déroulent toujours ! C’est tout un grand lambeau de notre pays qui a cessé d’exister. On voudrait s’évader de ce cauchemar ; à chaque minute, à chaque tournant des routes, on se dit, on espère : mais cela va finir ! Et non, cela ne finit pas, les ruines succèdent aux ruines ; villes, ponts sur les rivières, villages, humbles fermes isolées, tout est saccagé, émietté, pulvérisé ; les gorilles ont trouvé le temps de n’épargner rien… !
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
L’Horreur allemande (1918)
Pierre Loti
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782385744205
Au Général FRANCHET D’ESPEREY, sous les ordres duquel j’ai eu l’honneur deservir pendant deux ans, aux armées de l’Estet aux armées du Nord, je dédie ces notes, en hommage d’admiration et d’affectueuxrespect, m’excusant de les avoir écrites dansla hâte et de les lui présenter si décousues.
PIERRE LOTI.
IAUX ENFANTS DE NOS ÉCOLESÀ L’OCCASIONDE LEURS DISTRIBUTIONS DE PRIX[1]
On a bien voulu me demander de parler ici aux petits enfants de France, et de leur parler de notre patrie. Or, voici que soudain je me sens effrayé devant une si belle mission : en effet, jadis n’ai-je pas été plutôt un errant qui a trop éperdument vibré partout, sous le charme de tous les pays de la terre… Il est vrai, au soir de ma vie, je viens de connaître que rien n’est adorable comme notre patrie française et qu’il faut tout sacrifier sans mesure, nos biens, nos existences, celles de nos frères et celles de nos fils, pour la défendre ; non seulement à cause de nous-mêmes, qui ne pourrions que mourir de sa mort, mais aussi parce qu’elle est une lumière qui ne saurait s’éteindre sans obscurcir un peu le monde.
Laissez-moi en commençant relever une triste phrase, qui peut-être a déjà été prononcée devant vous, chers petits enfants de France, car il semble qu’elle ait une tendance à se propager dans certains milieux. « Nous faisons la guerre pour les riches », ai-je entendu dire, hélas ! de différents côtés, par de pauvres aveuglés, non pas, Dieu merci, dans les tranchées, mais à l’arrière, où des énergumènes sinistres ont eu le loisir de travailler les esprits. D’où peut bien sortir cette petite formule reptilienne, qui est l’absurdité même et qui sent le Boche ? Oh ! quel blasphème éhonté ! N’est-il donc plus de toute évidence que nous faisons la guerre pour nous défendre, les uns aussi bien que les autres, contre la plus abominable agression qu’aient connue les temps modernes et qui dépasse en horreur ce qu’avaient osé jadis les tyrans Barbares. Les « riches », comme on les appelle souvent sans bienveillance dans les classes plus humbles, les « riches », mais ce sont précisément ceux-là au contraire qui auraient eu le moins à souffrir des tyrannies et rapacités du Monstre de Berlin, les travailleurs pauvres se seraient affaissés plus vite encore sous les terribles saignées allemandes.
Chers petits enfants de France, prenez le temps de la lire, cette brochure, bien qu’elle soit infiniment moins attrayante que les jolis livres qui vous seront donnés en même temps le jour de vos distributions de prix. Lisez-la, car elle n’est pas une œuvre de haine, mais de vérité et de justice. Que ceux d’entre vous qui ont eu le bonheur de ne pas naître dans nos provinces envahies, que ceux qui ont même été préservés de voir nos effroyables dévastations, en trouvent ici le compte rendu, que je viens d’écrire d’après nature, aux Armées, avec un grand effort d’exactitude.
Chers petits enfants de France, je ne vous demande pas, quand le sort des armes aura tout à fait tourné, d’aller vous venger, de l’autre côté du Rhin, et de faire là-bas ce que je vous raconte qu’ils ont fait chez nous. Non, laissez cela aux officiers et aux soldats d’un kaiser, — et du reste, n’est-ce pas, vous n’en seriez heureusement point capables. Mais cependant n’oubliez jamais. Ces gens d’Allemagne, je vous assure, ne sont pas des hommes dignes de fraterniser avec vous. Plus tard, quand ils tenteront de revenir encore s’insinuer cauteleusement à notre foyer, fermez-leur bien vos portes. Gardez-vous d’eux toujours, comme des loups et des vampires. Et tâchez que désormais notre bien-aimée patrie, instruite enfin par l’excès de ses malheurs, reste uniquement et plus que jamais française.
Juillet 1917.
↑
Cette lettre servait de
préface à une brochure
qui fut distribuée par les Affaires étrangères aux enfants de nos écoles, à l’occasion des prix de 1917.
IIUN LÂCHER DE GORILLES
« Nous n’avons à nous excuser de rien. Nous sommes moralement et intellectuellement supérieurs à tous, hors de pair. Nous ferons cette fois-ci table rase. »
(Lasson, professeur boche.)
Mai 1917.
Pendant des lieues, pendant des heures, traverser des dévastations que naguère encore aucune imagination française n’aurait su concevoir, et se dire qu’il ne reste que cela de nos belles provinces, sur lesquelles leur maître les avait lâchés !…
Faut-il qu’ils aient travaillé, les gorilles, travaillé avec une rage inlassable et un stupéfiant génie de la malfaisance pour avoir si vite obtenu ces vastes dévastations qui, à mesure qu’on avance, se déroulent toujours ! C’est tout un grand lambeau de notre pays qui a cessé d’exister. On voudrait s’évader de ce cauchemar ; à chaque minute, à chaque tournant des routes, on se dit, on espère : mais cela va finir ! Et non, cela ne finit pas, les ruines succèdent aux ruines ; villes, ponts sur les rivières, villages, humbles fermes isolées, tout est saccagé, émietté, pulvérisé ; les gorilles ont trouvé le temps de n’épargner rien… !
Or, il aurait suffi, pour s’y attendre un peu, de sonder l’âme de la Germanie, de jeter seulement les yeux sur son histoire. Avant cette guerre, si irréfutablement révélatrice, beaucoup de bonnes âmes chez nous entendaient par « industrie allemande » ces milliers d’usines, cette inondation de camelote et de « simili » qui, depuis quelques années, se déverse sur le monde. Mais il y avait une industrie bien plus allemande encore, bien plus foncièrement nationale : l’espionnage, la rapine, le viol et le meurtre. Lisons leurs penseurs, leurs grands (?) hommes : à chaque page, c’est l’apologie de cette industrie-là. Interrogeons leurs annales, depuis le début de notre ère : c’est de cette industrie-là qu’ils ont surtout vécu.
Quelques mois avant l’agression actuelle, si patiemment et diaboliquement préparée, un nommé von Bernhardi, à l’instigation du kaiser, entreprit d’avance de plaider les circonstances atténuantes des crimes prémédités par son maître : « C’est une question d’humanité, osa-t-il écrire, de faire la guerre atroce, pour qu’elle finisse plus vite. » Et dire qu’il s’est trouvé chez nous des gens pour prendre cela au sérieux et faire à ce Jocrisse l’honneur de le discuter !
Peu après, le Monstre de Berlin, croyant l’heure propice, ouvrit enfin les cages de sa ménagerie, et ce fut, sur la noble Belgique comme sur notre chère France, cette ruée de bêtes féroces que l’on sait. Cependant — stupeur — les Neutres ne bougeaient pas, et — stupeur plus grande — il s’en trouva même, à force de mensonges et d’argent, il s’en trouva de germanophiles !
Mais c’est aujourd’hui, au cours de leur brillante retraite[1], que l’horreur atteint vraiment son comble, c’est aujourd’hui le véritable démasquage de la Germanie, osant enfin tout à fait dévoiler au monde son visage de goule. Depuis Attila, l’Europe n’avait plus l’idée de mœurs pareilles : les populations civiles emmenées en esclavage ; la destruction, le vol, la tuerie, et jusqu’aux violations des sépultures de nos soldats, officiellement et minutieusement organisés par ordre des chefs.
Et cela, comment pourraient-ils le nier, puisqu’ils ont eux-mêmes conté en détails dans leurs propres journaux, se complaisant à glorifier toute la peine que leurs troupes avaient dû prendre, par ordre, au moment d’évacuer nos villes déjà martyres, afin de ne plus nous laisser derrière eux qu’un désert ? N’ont-ils pas eu la naïveté d’ajouter aussi que certains de leurs soldats — des simples évidemment, accessibles à quelque pitié — répugnaient trop à la basse besogne, et qu’il avait fallu de nobles exhortations de leurs supérieurs pour les y contraindre ! (Sic.)
⁂
« Faut-il que notre civilisation élève ses temples sur des montagnes de cadavres, sur des océans de larmes, sur des râles de mourants ? — Oui. »
(Feld-maréchal von Hæseler.)
Maintenant que le printemps, impassible ou ironique, a ramené ici ses manteaux de verdure avec ses chants d’oiseaux, rien ne s’égaie dans nos ruines toutes fraîches qui, pour ainsi dire, saignent encore ; au contraire, l’abomination de l’œuvre allemande n’en est que plus révoltante, et je crois qu’elles sont plus lugubres qu’en hiver, ces campagnes mortes d’où l’on vient tout juste de chasser les Barbares, mais où les habitants ne sont pas revenus et où le grondement lointain du canon se mêle seul aux petits trilles éperdus des rossignols. Un ciel de mai, immobile et doux, d’un gris rose de tourterelle, est tendu comme un voile d’une seule pièce au-dessus de mon long voyage de ce jour ; il fait paraître plus éclatant le vert des feuilles neuves et des interminables tapis d’herbe. Elle est trop touffue, cette herbe, receleuse de loques et de débris sinistres ; il semble qu’elle recouvre plus que de raison ce sol des plaines, qui est partout profondément labouré en boyaux et en tranchées, qui est partout semé de fascines et de grandes ferrailles, avec çà et là des trous d’obus ou de monstrueux entonnoirs de marmites. De temps à autre, surgit un village qui n’a plus forme de rien ; les maisonnettes et l’église se sont effondrées les unes sur les autres, comme un château de cartes contre lequel on a soufflé. Il y a aussi des bois, ne nous montrant que des moignons d’arbres, tordus et fracassés, où des branchettes, épargnées par hasard, essaient tout de même de reverdir, de se mettre en fête, comme aux tranquilles printemps de jadis. À mesure que l’on approche de la région que les Barbares tiennent toujours, bien entendu l’horreur augmente, et le canon tonne plus fort, mais sans empêcher les oiseaux de chanter. Une des étrangetés de ces déserts, improvisés en pleine France, c’est cette profusion de réseaux en fils de fer barbelés qui serpentent partout ; leurs inextricables lignes, larges d’au moins dix mètres, hérissées de piquants comme les chenilles de poils, se croisent, s’enlacent, pendant des kilomètres, à perte de vue, parmi les trop luxuriants herbages, et attestent le prodigieux travail de légions d’araignées humaines… Pour enlever tout cela, pour combler toutes ces déchirures de la terre, combien d’années faudra-t-il ? Sans même parler de rebâtir villes et villages, combien en faudra-t-il, d’années, pour ramasser tant de fer, pour emporter tant d’obus tombés comme grêle, et dont plusieurs, non encore éclatés, constitueront pendant longtemps une menace aux laboureurs ?
J’ai souvenir d’une rencontre, faite dans les ruines silencieuses d’un hameau, où beaucoup de giroflées jaunes avaient fleuri, imitant des dorures sur des pans de murailles, et où des lilas faisaient de magnifiques gerbes violettes, dans de vagues enclos qui avaient été des jardinets. Deux vieilles femmes demeuraient là encore, deux vieilles aux cheveux blancs, aux joues creuses, aux yeux hagards, qui semblaient devenues folles. Parce qu’elles n’étaient plus bonnes à rien, les Boches les avaient laissées, — et qui dira ce qu’ont bien pu devenir leurs fils ou leurs filles, qui dira quelles tortures d’attente, d’angoisse morale, de terreur physique elles ont endurées, grelottant au fond de quelque cave, pendant deux ou trois hivers, jusqu’au retour des Français ? C’est au bord d’un puits qu’elles m’apparurent, un puits qui sans doute avait, pendant des générations, fourni à leur famille la bonne eau claire. Péniblement, avec une pauvre corde toute raboutie, elles venaient d’en tirer un seau, et elles le flairaient avec méfiance : « Ça pue encore », disait l’une. « Oui, oui, répondait l’autre, ça pue. Jette, va, jette vite. » Ces petites phrases triviales, prononcées avec une morne hébétude, étaient aussi poignantes à entendre que n’importe quelles plaintes… On sait qu’en partant ils avaient eu aussi la délicatesse d’empoisonner les eaux ; dans les poches de leurs prisonniers ou de leurs morts on a trouvé du reste, à ce sujet, les instructions précises de leurs officiers : « Le soldat un tel, aidé de son équipe, sera chargé des puits ; il y jettera en quantité suffisante du poison, de la créosote, ou, à défaut, des pourritures. »
⁂
Je cours depuis environ deux heures au milieu des régions saccagées, quand là-bas, tout là-bas, commencent de se dessiner des milliers de pyramides rougeâtres, irrégulières, qui couvrent une très vaste étendue.
De plus près, cela se révèle les ruines pantelantes d’une ville, une ville ouverte, une grande et belle ville française qui, il y a deux mois, vivait encore. L’œuvre des anthropoïdes civilisateurs a été là tout à fait hors depair. « Le soldat un tel, aidé de son équipe, portera le matériel incendiaire dans telles maisons… ou bien ira placer les explosifs dans telles caves, ou sous telle église, etc., etc. », disaient les irrécusables papiers de service saisis dans leurs poches, — et l’exécution méthodique du crime a été, en son ensemble, vraiment merveilleuse.
Entrer pour la première fois dans cette ville cause une poignante et inoubliable impression d’angoisse, de révolte et de stupeur. On a envie de crier et de maudire… Quel chef-d’œuvre de destruction enragée ! Nulle part certes, et à aucune époque de l’histoire, le monde n’avait connu rien d’approchant. Même l’une de nos malheureuses villes de l’Est, qui jusqu’à ce jour détenait le record du genre, n’offrait comme horreur rien de comparable. Et puis cela s’est fait d’un seul coup, cela s’est fait hier, pendant leur brillante retraite ; c’est, pour ainsi dire, une immense blessure où les chairs palpitent encore.
Les rues de la grande ville succèdent aux rues, les places succèdent aux places, et le massacre est partout pareil. Pas une maison, petite ou grande, qui n’ait été crevée du haut en bas ; elles montrent toutes leur intérieur, leurs entrailles déjà aux trois quarts épandues ; on dirait qu’elles ont toutes la tête coupée et le ventre ouvert. Les plus élevées et luxueuses, celles de quatre ou cinq étages, sont les plus invraisemblables ; leurs pans de murs déchiquetés, qui dans le lointain simulaient de capricieuses pyramides, sont par places restés debout jusqu’au faîte, en gardant leurs tentures à l’éclat tout neuf, quelquefois même leurs tableaux, leurs glaces. En l’air, il y a des fauteuils, des canapés encore frais, des lits qui pendent, qui surplombent, accrochés par un pied, et des vêtements de toutes sortes, vomis par les armoires ; des enseignes dorées dansent la sarabande de la mort, parmi ces monceaux de briques rouges qui représentent, l’émiettement des façades. Quelques charpentes, quelques toits d’ardoises n’ont pas fini de tomber, et des murs qui ne tiennent plus en sont coiffés tout de travers, en casseurs ; pour provoquer des éboulements, il suffit d’un peu de vent qui se lève, ou des vibrations d’un fourgon trop lourd qui vient à passer.
Cependant il y a du monde, dans ces longues rues, dans tout ce grand décor d’enfer, du monde malgré les obus qui ne cessent encore de tomber. D’abord il y a des détachements de nos soldats couleur d’horizon, et il y a aussi quelques vieilles femmes, — toujours ces vieilles femmes des ruines, laissées là par les Boches comme choses de rebut, vieilles pauvresses ou vieilles bourgeoises, hâves, égarées, avec des regards de saintes ou de martyres. Et nos chers soldats bleus, qui étaient entrés ici il y a quelques jours avec de tels sursauts de fureur indignée, de tels élans de vengeance, se promènent à présent bien calmés, déjà prêts au pardon ; en voici même qui conduisent un groupe de prisonniers boches, et leur parlent presque en camarades… Dans notre France, nous sommes trop débonnaires !…
Je crois que c’est dans les quartiers modestes de la ville que le cœur se serre encore davantage : humbles petites installations soignées et proprettes, réalisées sans doute à force d’économies, et détruites en un jour, par l’ordre féroce du Monstre de Berlin !… Oh ! pauvres, pauvres gens !… Entre tant de milliers de détails, le long de ces rues, il en est, je ne sais pourquoi, qui plus que d’autres vous poursuivent. Ainsi je me rappelle, au premier étage d’une maison, au-dessus de cassons informes, une image de première communion sous verre, qui tient encore, intacte, à son clou, et regarde les passants par l’ouverture béante de la façade. Ailleurs, dans ce qui reste d’une chambre tapissée de papier bleu, une toute petite robe blanche à dentelles s’est accrochée à une poutre, les manches pendantes, comme la tête en bas : la belle robe de quelque gentille fillette d’ouvriers, pour ses promenades du dimanche… Et toujours, et toujours, on a beau s’éloigner, retourner, changer de direction, on ne change pas d’ambiance ; la destruction farouche n’a rien oublié. À leur retour, ceux des exilés qui ne seront pas morts en esclavage ne doivent plus espérer trouver chez eux rien de ce qu’ils chérissaient ; c’est ce chaos qui les attend, et il faut plutôt leur souhaiter de ne jamais revenir, de ne jamais revoir. Tout est irréparable ; avant même de songer à réédifier, il y aura urgence d’achever d’abattre.
Est-ce possible, tant de travail humain, qui représentait l’apport de quelques siècles, stupidement anéanti en deux ou trois jours ! Car c’est à peu près le temps qu’il a fallu pour parachever le crime, préparé à si grand renfort d’explosifs. Et les Alliés, qui arrivaient pour la délivrance, les Alliés ; ici comme aux abords des autres villes dont nous avons chassé les Barbares, les Alliés obligés de regarder l’éhonté sacrilège, de voir tout flamber, d’entendre tout sauter et crouler, mais de trop loin encore pour intervenir !
Avoir fait cela, est-ce assez misérable ! Et puis, est-ce bête ! ! Outre que c’est immonde, est-ce assez marqué au sceau de cette lourde bêtise teutonne, qui déjà, au temps du grand (?) Frédéric, amusait tant Voltaire ! Car enfin, à quoi bon, en vue de quel profit ? Uniquement pour satisfaire un dépit rageur du kaiser, avoir affiché, gravé, d’une façon indélébile, pour le monde entier, une si incurable sauvagerie !
« Hors de pair », oui, professor von Lasson, oh ! oui, en effet, les Boches sont hors de pair ; heureusement pour l’humanité, ils n’ont point leurs pareils !
Des Neutres, mon Dieu, dire qu’il y a encore des Neutres !… Mais c’est parce qu’ils n’y croient pas, parce qu’ils ne savent pas, c’est parce qu’ils n’ont pas vu !… Ah ! combien je voudrais amener ici quelques-uns de mes amis espagnols ! Certes les écailles tomberaient enfin de devant leurs yeux !
Si je songe particulièrement à l’Espagne, à l’Espagne cependant si chevaleresque, c’est que je l’avais tant aimée, depuis vingt-cinq ans que j’habite à sa frontière… Nous nous passerons de son aide et, quand nous en aurons fini, je ne serai pas jaloux qu’elle ait sa part de délivrance. Mais j’aurais tant souhaité l’avoir aussi vue à nos côtés, à la peine et à l’honneur !
⁂
Après que j’ai longuement traversé la ville angoissante et ses faubourgs aussi infernalement saccagés que ses quartiers de quasi-opulence, j’arrive à une région où m’attendait, pour tableau final, le désastre des arbres. « Tel soldat, — disaient leurs instructions abominables, — tel soldat, avec son équipe, sera chargé de scier les arbres fruitiers. » Donc, méthodiquement comme toujours, chacun s’en est acquitté. Dans une zone de plusieurs lieues, les grands poiriers, les magnifiques pommiers centenaires qui représentaient la richesse des paysans, s’arrangeaient en bordure de chaque côté des routes, ou bien en quinconces dans les vergers, — et les gorilles (sans négliger pour cela de faire sauter le moindre hameau), les gorilles ont trouvé le temps de les scier tous à un mètre du sol. Dès que la ramure de l’un chancelait et s’abattait, ils passaient à un autre, sans perdre leurs précieuses minutes à donner le coup de grâce, dans leur hâte de les atteindre tous ; c’est pourquoi beaucoup de ces belles cimes d’arbres, ainsi couchées, se rattachent encore au tronc par quelques lambeaux d’écorce qui leur ont fourni la sève pour refleurir une dernière fois, à leur dernier printemps. On dirait ainsi d’énormes bouquets blancs ou roses, déposés sur la terre. Cette sève évidemment va manquer bientôt ; les fleurs vont se faner sans donner leurs fruits ; mais c’est presque touchant, dans sa mélancolie, toutes ces pauvres floraisons suprêmes d’arbres vénérables qui vont mourir.
↑
Il s’agit ici de la retraite qui, au début de 1917, nous avait momentanément rendu Noyon, retraite qu’ils avaient eux-mêmes, on s’en souvient, qualifiée de
brillante
.