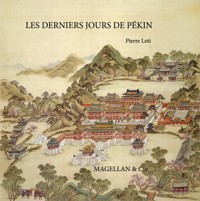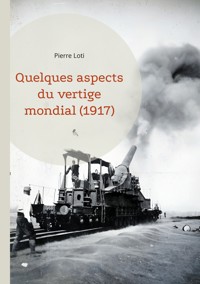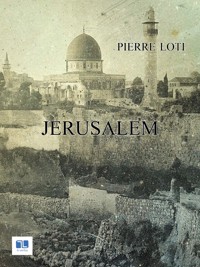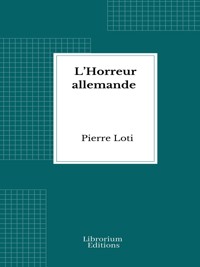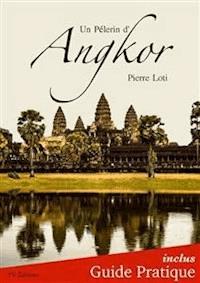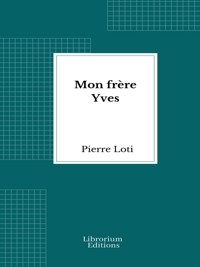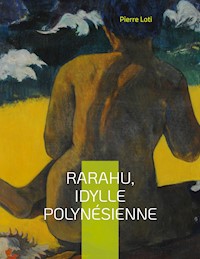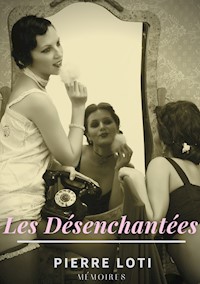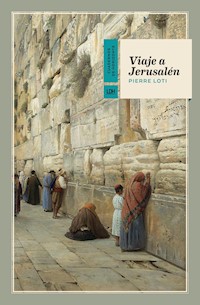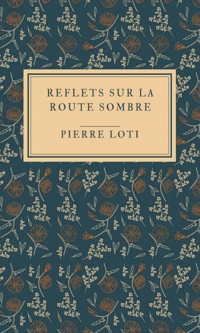
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Deux heures du matin, une nuit d'hiver, loin de tout, dans la profonde solitude des campagnes pyrénéennes. Du noir intense autour de moi, et sur ma tête des scintillements d'étoiles. Du noir intense, des confusions de choses noires, ici, dans l'infime région terrestre où vit et marche l'être infime que je suis ; un air pur et glacé, qui dilate momentanément ma poitrine d'atome et semble doubler ma vitalité éphémère. Et là-haut, sur le fond bleu noir des espaces, les myriades de feux, les scintillements éternels. Deux heures du matin, le cœur de la nuit, de la nuit d'hiver. L'étoile du Berger, reine des instants plus mystérieux qui précèdent le jour, brille dans l'Est de tout son éclat blanc.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
REFLETS SUR LA ROUTE SOMBRE
Pierre Loti
REFLETS SUR LA ROUTE SOMBRE
NOCTURNE
ALPHONSE DAUDET
PITIÉS VAINES
I
II
MA PARENTE DU SÉNÉGAL
CHIENS ET CHATS
AVANT-PROPOS
UN CHAT
AUTRE CHAT
RENCONTRE DE CHATS
RENCONTRE DE CHIENS
ÉPILOGUE
UNE AUDIENCE DU GRAND SPHINX
IMPRESSIONS DE THÉATRE1
A MADRID
LES PREMIERS JOURS DE L’AGRESSION AMÉRICAINE
I
II
III
IV
V
VI
AUBADES
CHEMINEAUX
MES DERNIÈRES CHASSES
I
II
ADIEUX AU PAYS BASQUE
NUIT DE FIÈVRE
DIMANCHE D’HIVER
L’ILE DE PAQUES
JOURNAL D’UN ASPIRANT DE LA « FLORE »
I
II
III
IV
V
APRÈS UNE LECTURE DE MICHELET
NOCTURNE
Deux heures du matin, une nuit d’hiver, loin de tout, dans la profonde solitude des campagnes pyrénéennes.
Du noir intense autour de moi, et sur ma tête des scintillements d’étoiles. Du noir intense, des confusions de choses noires, ici, dans l’infime région terrestre où vit et marche l’être infime que je suis ; un air pur et glacé, qui dilate momentanément ma poitrine d’atome et semble doubler ma vitalité éphémère. Et là-haut, sur le fond bleu noir des espaces, les myriades de feux, les scintillements éternels.
Deux heures du matin, le cœur de la nuit, de la nuit d’hiver. L’étoile du Berger, reine des instants plus mystérieux qui précèdent le jour, brille dans l’Est de tout son éclat blanc.
La vie se tait partout, en un froid sommeil qui ressemble à la mort ; même les bêtes de nuit ont fini de rôder et sont allées dormir. Dehors, personne. Les laboureurs et les bergers, qui pourtant se lèvent avant l’aube, sont blottis pour des heures encore sous les toits des hameaux. Seuls peut-être, par les chemins, circulant dans le grand silence, trouverait-on les hommes que tient éveillés l’amour ou le vagabondage, — ou encore, en ce pays-ci, la contrebande. Sur la route où je marche, la lumière palpitante des étoiles semble tomber en pluie de phosphore. Et cette route, sèche et durcie, résonne, vibre comme si le sol était creux sous mes pas. D’ailleurs, je marche, je marche sans m’en apercevoir, tant est vivifiant cet air de la nuit ; mes jambes, dirait-on, vont d’elles-mêmes, comme feraient des ressorts une fois pour toutes remontés, dont le mouvement ne donnerait plus aucune peine.
Et je regarde, au-dessus du noir de la terre qui m’entoure, scintiller les mondes. Alors, peu à peu, me reprend ce sentiment particulier qui est l’épouvante sidérale, le vertige de l’infini. Je l’ai connu pour la première fois, ce sentiment-là, lorsque vers mes dix-huit ans il fallut me plonger dans les calculs d’astronomie et les observations d’étoiles, pendant les nuits de la mer. En général, les gens du monde ne songent jamais à tout cela, n’ont même pour la plupart, sur les abîmes cosmiques, aucune notion un peu approchée, — et c’est fâcheux vraiment, car, en bien des cas, cela arrêterait par la conscience du ridicule leurs agitations lilliputiennes... La connaissance et la quasi-terreur des durées astrales sont bien apaisantes aussi, et, à propos des petits événements humains, quel calme dédaigneux cela procure, de se dire : Mon Dieu, qu’importera, dans vingt-cinq mille ans, quand l’axe terrestre aura accompli son tour ? ou bien dans deux ou trois cent mille ?
L’atmosphère de la nuit, à cette heure fraîche et vierge, est comme vide de toute senteur, si ce n’est dans certains bas-fonds, au milieu des bois, où les exhalaisons des mousses, du sol humide persistent encore sous le fouillis inextricable et léger des ramures d’hiver. Autrement, rien ; il semble que l’on respire la pureté même, — tellement que l’on devinerait au flair, le long de la route, les rares métairies éparses, d’où sortent, par bouffées bientôt perdues, des odeurs de brûlé, de fumée, de fauve, de repaire de bêtes...
Et je regarde toujours, sur le bleu noir du ciel, scintiller la poussière de feu... Cela, c’est l’ensemble de ce qui est, et que nous cachent le plus souvent nos petits nuages, l’aveuglante lumière de notre petit soleil ; du reste, dans quel but nous l’a-t-on laissé voir, puisque la faculté de sonder et de comprendre devait se développer en nous avec les siècles, et que tout cela était appelé à devenir alors terrifiant ?... Voici qu’elles me font peur, cette nuit, les constellations — ces dessins familiers, qui sont quasi éternels pour les yeux humains sitôt fermés par la mort, mais qui, en réalité, pour des yeux plus durables que les nôtres, se déforment aussi vite que des figures changeantes et furtives apparues un instant dans un vol d’étincelles... Combien ceci déroute et confond : penser que ces choses là-haut, symbolisant pour nous le calme et l’immuabilité, sont au contraire en plein vertige de mouvement ; savoir que le peuple sans nombre des soleils, les non condensés encore, les flambloyants ou les éteints, tourbillonnent tous, affolés de vitesse et de chute !...
L’air vif de cette nuit donne assez nettement l’impression glacée du grand vide sidéral, de même que cette nuance sombre du ciel imite le noir funèbre des espaces où les soleils par myriades s’épuisent à flamboyer sans parvenir à y jeter un peu de chaleur, ni seulement un peu de lumière, sans y faire autre chose que le ponctuer d’un semis de petits brillants qui tremblent... Bien petits en effet, ces soleils, qui brûlent dans le noir, et consument dans le froid leur initiale chaleur ! Quelle misérable poussière ils figurent, errant ainsi par groupes et par nuages, perdus dans l’obscurité souveraine, tombant toujours, depuis des milliards et des milliards de siècles, dans un vide qui devant eux ne finira jamais de s’ouvrir !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Des pas résonnent en avant de moi, au milieu de la microscopique solitude terrestre ; un bruit de vie qui me surprend au travers de toute cette obscurité, de tout ce silence. Et deux silhouettes humaines croisent ma route, marchant lentement, le fusil à l’épaule... Ah ! des douaniers ! J’oubliais, moi, les petites affaires d’ici-bas, la frontière d’Espagne qui est là tout proche... Ils font une ronde, et vont deux par deux, comme toujours, par crainte des rencontres mauvaises... Mon Dieu, quelle capitale affaire si quelques brimborions prohibés allaient cette nuit passer de chez les pygmées de France aux mains des pygmées espagnols !... Quelle importance cela prendrait, vu seulement des mondes les plus voisins du nôtre, de Véga, de Bellatrix ou d’Ataïr !...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Est-ce que vraiment ce serait toute la réserve du Feu, est-ce que ce serait tout ce qu’il y en a, tout ce qu’il en existe dans le Cosmos, ces miettes qui tourbillonnent, promenées comme le sable des dunes quand il vente, qui tourbillonnent dans le grand noir glacial et vide — et qui, fatalement, par la suite des âges incalculés, doivent se refroidir et s’éteindre ?... Plutôt ne serait-ce pas les minuscules débris, les étincelles perdues de quelque autre réserve mille et mille fois plus inépuisable et située plus loin que notre humble petite vue, plus loin que la portée de nos plus pénétrants petits télescopes, plus loin, des millions de millions de fois plus loin, — laquelle réserve ne serait espaces, lequel infini nous sommes forcés d’admettre, bien qu’impuissants à le concevoir...
Et, qui plus est, le Dieu qui ne régirait que le Cosmos aperçu par nous — même ce Cosmos si prodigieusement démesuré, tel que l’entrevoient les plus profonds penseurs astronomes, — voici que ce Dieu-là ne me parait plus assez grand pour être tout. Et je considère comme impossible qu’il ne s’incline pas à son tour devant quelque autre Dieu plus terrifiant d’immensité, — lequel encore aurait au-dessus de lui une puissance mille fois plus lointaine, — et ainsi de suite, à l’infini. D’ailleurs, ce Jéhovah, qui serait tout, je le plaindrais de tant durer, dans l’épouvante de sa solitude, de son imperfectibilité et de son libre arbitre absolu... En ce moment, pour contenter un peu ma raison, la raison de l’atome que je suis, il faudrait qu’il y eut dans les Dieux aussi une progression qui ne prit jamais fin ; que toujours, toujours, au-dessus d’un Dieu, si haut et effroyable qu’il fût, planât le mystère d’un autre, plus inconcevablement créateur, éternel et inaccessible...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Et je marche, orgueilleux et troublé dans mon rêve. Mais devant moi quelque chose surgit et se dresse, comme une borne, comme un haut signal d’alarme qu’on aurait intentionnellement placé là devant mes yeux, devant la route de ma pensée en révolte : le clocher d’une église de village découpé en noir sur le ciel étoilé, sur les scintillements d’Antarès et sur les phosphorescences de la grande nébuleuse lactée. Tandis que tout dort si paisiblement alentour, il continue, lui, sa veille — commencée déjà depuis quelques négligeables petits siècles qui nous paraissent des durées longues ; il se tient là pour les humbles du voisinage et peut-être un peu aussi pour les téméraires comme moi, auxquels sa mission est de crier : Gare !... En effet, à cause de ma petitesse et à cause du point d’où je regarde, il me paraît gigantesque en cet instant, ce pauvre clocher de campagne ; il masque à ma vue des constellations, des milliers d’univers, des groupes incommensurables de mondes. Et il semble tout à coup me dire :
« Dans de plus mystérieux domaines, admets donc aussi mes proportions relatives ; bénis en moi, en l’idée chrétienne que je représente, l’écran protecteur capable de te cacher les abîmes, de t’épargner l’effroi des gouffres. Par rapport au rien que tu es, cette idée-là me parait infiniment grande ; elle offre, des vérités inconnaissables, une représentation très suffisamment approchée et mise avec sagesse à la portée de ta raison frêle. Essaye d’imiter les simples qui, à mes pieds, sont couchés sous les tombes, et qui s’en sont allés confiants, sans scruter le vide ni connaître les vertiges... »
ALPHONSE DAUDET
Hendaye. dimanche 19 décembre 1897.
J’arrive bien tard, moi, du fond de ma province, de la frontière d’Espagne, pour parler de lui... Aussi, je ne voudrais que simplement dire combien je l’aimais, et quelle était mon admiration pour son âme, surtout son âme toujours plus haute, des dernières années.
Avec quelle mélancolie je repense aujourd’hui à notre première rencontre d’il y a dix-sept ou dix-huit ans !... Si ignoré encore, je traversais Paris après la publication d’un de mes livres de début ; là, chez un ami commun, attendait une de ses cartes demandant qu’on me présentât, quand par hasard je passerais. Et ce fut au jardin du Luxembourg par un beau temps de mai, dans des allées fleuries de lilas, que je vins causer avec lui, un peu ébloui que j’étais par sa présence et son accueil. D’abord, je lui avais offert une de mes cigarettes de Turquie et, sitôt que parut la mince fumée grise, il s’arrêta, les yeux lointains : « Oh ! dit-il, tout ce qui s’éveille d’Orient dans ma tête, rien qu’à l’odeur de cette fumée !... » Nous causâmes une heure en faisant les cent pas ; je n’en revenais point qu’il fût si simple ; et puis, avec lui, ce jour-là, on disait à demi-mot des petites choses infinies, qui se continuaient comme d’elles-mêmes pendant les silences... Et je m’en allai charmé.
Depuis, dans les temps attristés où il ne se promenait plus, que de fois il m’a demandé : « Te rappelles-tu, mon Loti, notre première cigarette turque ensemble ?... Les lilas du Luxembourg ?... »
Nous ne nous voyions pas bien souvent, puisque je suis errant par métier. Mais, de même que se continuait pendant les silences notre première causerie dans le jardin, de même, pendant les absences et les longs voyages, notre amitié se continuait aussi et grandissait, pour devenir d’année en année plus confiante et plus profonde.
Et j’étais de ceux qui ne se figuraient point qu’il allait mourir. A chacun de mes voyages à Paris, je retrouvais, à peine plus changée, sa belle figure de souffrance, avec des yeux tout pleins de la bonne volonté de rester encore à ceux qu’il aimait, — et il semblait que cette volonté dût être triomphante.
Je me souviens de cette phrase de lui, prononcée il y a quelque dix ans, un jour d’angoisse : « Eh oui ! j’ai connu des minutes où j’ai senti comme un élan pour me jeter à genoux et pour prier. Et puis je me suis dit : « Non ! Oh ! pas ça ! Est-ce que ce serait possible ! » Et j’ai haussé tristement les épaules ! »
Mais, ces derniers temps, aurait-il encore parlé ainsi ? Il me paraît que non. Et j’aurais voulu suivre, imiter l’évolution intime de son âme revenant peu à peu, du fond des abîmes froids et noirs, vers des idées d’immortalité, des idées presque chrétiennes de pardon et d’éternel amour ; rien de précis peut-être, mais une foi dans une justice suprême, dans des Au-Delà resplendissants et tranquilles. El je crois que sa belle sérénité, son oubli de soi-même et de son mal, sa patience d’héroïque martyr, lui venaient un peu de là : souffrant presque sans trêve, il devenait de jour en jour plus inaltérablement aimable et bon, plein de haute indulgence et de pitié très douce ; il veillait à ce que ses douleurs physiques ne fussent jamais importunes à personne et savait encore se montrer gai, au milieu des siens qu’il adorait, savait encore sourire et étinceler d’esprit...
Mais je voulais seulement dire, pour eux, pour les siens qui liront peut-être ces ligues, qu’il laisse un vide douloureux à mes côtés, que je l’aimais d’une amitié rare. J’étais jaloux de ses jugements et de son estime ; j’écrivais en pensant à lui et souvent, pour lui. A présent, une part de cette affection si tendre, que j’avais, se reporte sur les êtres d’élite qu’il a laissés et en qui son âme est un peu continuée.
Et aujourd’hui, dans ma solitude de la Bidassoa, sous le ciel chaud, sombre et bas de ce dimanche d’hiver, c’est lui constamment que je revois ; avec un grand respect, je repasse en ma mémoire tout ce que, dans nos derniers entretiens, il m’avait dit de sage, de supérieur, de loyal, d’indulgent et d’apaisant, sur les hommes, sur les choses et sur la vie ; avec un attendrissement désolé, je retrouve fixés sur moi ses bons et charmants yeux de malade, ses yeux des derniers jours, m’adressant comme un reproche de ce que je ne serai pas là parmi ceux qui l’accompagneront demain... Mais je n’ai pas pu venir...
Certes, le regret longtemps me poursuivra de n’être point venu. Et, cependant, je sais si peu être l’homme des manifestations extérieures — tant respectables et touchantes soient-elles — si peu l’homme des cérémonies et des cortèges, que je me sens encore plus avec lui, ici, dans ma farouche solitude, que là-bas si je suivais, dans le brouhaha assourdi de la foule, le char noir qui va nous l’emporter...
PITIÉS VAINES
I
VIEUX CHEVAL
En Espagne, au splendide soleil de juillet. De grandes arènes ou douze mille spectateurs, captivés, haletants, suivent les péripéties d’une course à mort.
En face de moi, dans un éblouissement, toute la zone brûlante où le soleil tombe : du haut en bas de l’immense amphithéâtre, par milliers, des têtes qui semblent pressées les unes aux autres ; des chapeaux larges, des bérets, des mantilles, des mouchoirs blancs qui s’agitent, ou des éventails de papier rouge ; et, sur tout ce bas peuple vêtu de couleurs voyantes, la puissante lumière des étés espagnols.
Du côté de l’ombre où je suis, une foule plus triée, mais aussi compacte, aussi ardente au vieux spectacle national. Puis, derrière et au-dessus de moi, les loges où paradent les señoras élégantes : étalages de toilettes luxueuses et fraîches ; rangées de figures mates à longs yeux noirs, exquises pour la plupart, sous la mantille ancienne et le haut chignon piqué de fleurs naturelles.
Dans l’air, une débauche de bruits et de cris ; des musiques alternant, les unes de cuivres, les autres de tambourins et de musettes ; de temps à autre, d’anxieux silences, des frémissements qui courent comme une fièvre ; puis, soudain d’ironiques sifflets, ou bien la clameur formidable des foules, ébranlant tout comme un tonnerre.
A un long et déchirant signal de trompette, le troisième taureau vient de faire son entrée dans l’arène ; tête et cornes hautes, il galope, superbe, leste, rapide, semblable à quelque énorme gazelle en fureur, — et un murmure d’approbation dans là foule accueille sa beauté de bête combattante. Sous le poids de lourds cavaliers tout chamarrés de broderies, des chevaux maigres, que l’on a grisés d’avoine et qui, tout à l’heure, râleront le ventre ouvert, font gaîment autour de la piste leur promenade suprême. Voici maintenant les toreros étincelants d’or, bondissant dans le soleil ou l’ombre, superbes eux aussi ; avec des mouvements faciles et pleins de grâce, ils éployent leurs capas rouges devant la redoutable tête cornue, évitant la mort par des petits sauts de côté, ou, plus dédaigneusement, par de simples flexions de leurs reins cambrés. Et le taureau s’étonne ou s’amuse de ne trouver devant lui que l’inconsistance de manteaux qui s’envolent, jamais que le vide, jamais rien... Et, à son début charmant, ce jeu d’épouvante semble n’être qu’une chose toute gracieuse, toute légère ; en vérité, l’on dirait, entre la bête et les hommes, là plus innocente lutte de vitesse et d’élégance, — si les mares de sang restées çà et là des précédentes courses, et mal étanchées par la sciure de bois qu’on y jette, ne marquaient encore les places des agonies, les places où s’épandaient tout à l’heure des viscères et des poitrines crevées...
C’est un pauvre vieux cheval, à bout de fatigue et sans doute roué de coups, un pauvre et lamentable vieux cheval borgne qui, le premier, subit le choc de la bête souveraine, et roule culbuté dans la poussière.
Tandis que son cavalier aux bottes ferrées se remet lourdement sur ses jambes, lui aussi se relève, mais son poitrail est labouré d’une estafilade profonde, qui bâille toute saignante au soleil.
Ses maigres flancs tremblent de souffrance et de peur... Où chercher le salut, de quel côté s’enfuir ?... Une minute d’indécision, — et voici qu’il se jette tout confiant, l’œil très doux, vers un homme qui est là et qui tend les mains pour le prendre par la bride : un de ces valets immondes, voués aux basses besognes du cirque ; un de ceux qui, dans les entr’actes, bouchent avec du son les trous de corne dans le ventre des chevaux, ou bien leur repoussent les entrailles dans le ventre et recousent avec de la ficelle afin qu’ils puissent reparaître et courir encore.
Certainement, il se sentait tout rassuré, le vieux cheval, en se remettant ainsi entre des mains humaines, — et son pauvre œil semblait dire : « C’est vrai, que vous m’avez battu souvent, vous autres hommes, mais jamais déchiré comme ça ; ni éventré. Je pense bien que vous ne voulez pas me tuer, n’est-ce pas ? Je suis une humble bête qui a pu avoir des entêtements, des paresses, mais qui a tant travaillé pour vous, de ses braves pattes aujourd’hui trop fatiguées... » Et il se calmait de plus en plus, à mesure que l’homme lui redressait sa selle, lui rajustait son harnais, faisait semblant de le caresser, — d’un air un peu goguenard tout de même. Puis, quand la toilette fut réparée et le cavalier remonté à son poste, le drôle avec un sourire farceur à l’adresse du public voisin, attacha un bandeau sur l’œil du cheval pour le faire plus sûrement courir à la mort, tout en lui disant quelque chose comme ceci : « Attends, mon vieux, attends... Tu vas voir ce qui va t’arriver, n’aie pas peur... » — Oh ! la joie, s’il n’y avait pas les gendarmes, la bonne joie d’écraser d’un coup de gourdin le sourire, et toute la tête aussi, de l’ignoble drôle !...
Mon Dieu, les jolies señoras, là-haut derrière moi, penchées au rebord des loges ! Des mantilles blanches, des mantilles noires, de hauts peignes à la Carmen, et des bouquets de fleurs jaunes dans d’épaisses chevelures sombres. Quel dommage qu’ils ne reparaissent plus que là, aux arènes sanglantes, ces atours du vieux temps, qui sont merveilleusement composés pour les fines et blanches figures un peu grasses, d’une blancheur mate et chaude ; pour les longs yeux de velours, très noirs, souvent las et à demi fermés entre des paupières bistrées. Quel dommage qu’elles ne veuillent plus comprendre, les Espagnoles, que cette coiffure ajoute à leur visage la distinction et le mystère... Une surtout, une jeune femme dans la plénitude de sa beauté de vingt-cinq ans, vêtue de bleu atténué, avec des roses thé à la mantille et au corsage, appuyait sur la balustrade ses nobles hanches indolentes, s’inclinait de côté vers l’arène dans une pose qui la dessinait délicieusement sous son costume souple, et paraissait quelque personnification idéale de la señora brune aux joues pâles...
L’instant d’après, le pauvre cheval, avec son bandeau sur l’œil, toujours assez en confiance malgré le tremblement nerveux qui ne le quittait plus, était conduit eu main par le valet farceur, et honteusement offert au taureau qui lui enfonçait sa corne de tout son long dans la poitrine.
Presque à mes pieds, contre la barrière où je m’accoudais, il roula sur le sable, les poumons crevés, perdant à grands flots son sang, qui jaillissait par secousses comme l’eau sort d’une pompe. Et le drôle, toujours le même drôle, s’empressa, d’un empressement de brute, à lui arracher, pour les mettre à quelque autre bête martyre, son mors et sa bride, en déchirant sa bouche mourante. Ensuite, comme la foule cependant manifestait pour qu’on l’achevât, le drôle encore revint sur lui et se mit à lui fouiller dans le cervelet avec un vieux couteau qu’on entendait crisser sur les os du crâne. Pas de gémissements, pas de plaintes : les chevaux agonisent en silence. Une secousse convulsive des pattes, et ce fut tout ; la tête douloureuse retomba contre le sol ; soudainement commença pour lui la paix suprême, l’immobilité à jamais. Il semblait même que la mort eût laissé descendre tout à coup sur ce débris pitoyable un peu de sa calme grandeur.
Ah ! il avait fini, celui-là, au moins ! Délivré de tout, il était devenu une chose que personne ne pourrait plus faire souffrir.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Et moi, qui n’avais pas fini encore et à qui, sans doute, un valet ne viendrait pas mettre un bandeau pour la minute de grande horreur, je reportai ma pitié sur moi-même, et me sentis plus misérable, à cet instant, que le cheval mort.
Puis, me souvenant que ceci seul ne trompe pas, qui est la beauté physique, qui est le charme et l’enchantement des yeux, je me détournai de l’arène pour relever la tête vers la si jolie señora en bleu clair, coiffée d’une mantille blanche et d’un bouquet de roses thé...
II
VIEILLE FEMME
Toute courbée, toute cassée, portant sur le dos une charge énorme de bois mort, cheminait la pauvre vieille, le long d’une route de montagne, dans la splendeur du soir d’été.
Le lieu était solitaire, où je la rencontrai ; — solitaire et beau, comme les édens que l’on rêve. C’était en Guipuscoa, au milieu des grandes Pyrénées espagnoles et de leurs forêts. De tous les côtés, les cimes superbes, tranquilles et inviolées sous leur silencieux revêtement d’arbres, montaient vers l’infini du ciel. En bas, dans un vallon, une rivière s’étendait en miroir, ne reflétant que des branches de lierre, des fougères, des feuillages, de fraîches verdures de juin. Et la magnificence des fleurs, dans ce tiède pays d’ombre et d’eaux vives, avait quelque chose d’inusité et de pompeux, comme pour le passage des reines et des fées.
Mais la pauvre vieille, qui s’en allait toute cassée sous son fardeau, ne percevait rien, par ses yeux mornes, de cette fête des choses. Vers quelque gîte de misère, où son retour serait sans sourire et sans joie, elle se hâtait péniblement, d’une allure épuisée, la tête basse et le front marqué de deux plis de souffrance. Et son air était si honnête et si bon ! Si humble avec cela, si humble et si définitivement résigné ! Tout au bord de la route, elle s’était rangée par politesse, me voyant arriver, comme pour mettre plus de respectueuse distance entre la vulgaire créature qu’elle pensait être et le passant de distinction que je figurais pour elle.
Mon Dieu, que faire pour l’aider un peu, la si humble vieille ? Voici qu’une pitié soudaine me venait au cœur, parce que j’avais rencontré son bon regard souffrant. Mais quoi, pour ne pas l’humilier davantage, comment m’y prendre ? Ce faisceau de branches, si douloureusement porté sur son vieux dos, représentait une valeur dérisoire, et il eût été bien facile de lui dire : « Jetez-le, bonne vieille, et acceptez à la place ces pièces blanches. »
Je craignais cependant de la blesser, après tant de peine qu’elle avait dû prendre pour ramasser une à une ces brindilles dans le bois. Plus je la regardais d’ailleurs et moins j’osais offrir une aumône ; ses vêtements rapiécés paraissaient encore décents et propres ; elle n’était point une mendiante sûrement, mais plutôt quelque aïeule d’une modeste ferme, quelque obscure travailleuse des champs, usée à la peine ; quelqu’une de ces grand’mères dédaignées dont les âpres paysans attendent la fin comme une délivrance.
Et ce site était beau, ce site où elle traînait sa fatigue solitaire, — beau, tranquille et paradisiaque. Il semblait qu’on fût là au milieu d’une région heureuse, à un instant privilégié et rare ; on subissait à la fois, dans une extase, dans une ivresse de vivre, l’enchantement de la saison et l’enchantement de l’heure, — de la belle heure apaisée du soir.
Proches ou lointaines, les forêts de hêtres s’étageaient, toujours fraîches et pareilles, depuis les sommets voisins du ciel jusqu’en bas, jusqu’aux régions profondes des herbages, des fleurs et des eaux. Au-dessous de nous, la claire rivière, qui reflétait les cimes, avait des îlots de fleurs ; — des îlots garnis, comme des corbeilles, de grandes quenouilles violettes, d’amourettes roses et de je ne sais quelles plantes d’eau épanouies en ombelles blanches. Et, au bord de la route, tout de suite commençait un sol exquis, feutré de ces lichens et de ces mousses qui ne croissent que dans les lieux longuement tranquilles ; un sol qui semblait vieux comme le monde — et que l’on voyait fuir et se perdre sous la voûte mystérieuse des hêtres, sous la forêt aux puissantes ramures grises. On sentait que, depuis les origines, des pâtres seuls et des troupeaux avaient dû fouler ces tapis délicats, et la paix des temps anciens planait très douce sur tout ce pays vert...
Mais, par une anomalie bien étrange, les campagnards qui vivent dans de tels édens ne savent pas les comprendre ni les voir — et la vieille femme au fagot trop lourd cheminait aussi misérable au milieu de ces enchantements que si elle eût traversé n’importe quels bas-fonds des villes, entre des murs moroses.
La route à présent montait, devenait plus ardue ; le trottinement de la bûcheronne semblait plus saccadé, plus pénible, et j’avais entendu un pauvre soupir de fatigue s’échapper de dessous la charge de bois mort... Où donc allait-elle ? Et que faire, qu’imaginer pour lui venir en aide ?
Dieu merci, le village enfin parut, là tout près, à un détour du chemin, — son village, à elle, évidemment, le terme de son épuisante course. Posé très haut sur un fond de montagnes et de forêts qui venait subitement de s’élargir, il se dessinait en silhouette ancienne, maisonnettes noires et clocher noir, d’un style basque d’autrefois ; tout cela, immobile sans doute depuis deux ou trois siècles, vieilli côte à côte, lentement effrité ensemble par les pluies et les soleils ; et tout cela, arrangé comme avec un art supérieur, pour le plus grand plaisir des yeux.
Cependant le charme de ces choses est presque uniquement réservé à des étrangers, à des délicats et des raffinés qui passent ; il échappe aux hommes qui sont nés là et qui y meurent. Et ces lieux d’aspect idéal renferment beaucoup de tristes existences végétatives ; quelquefois, il est vrai, d’exubérantes et saines jeunesses, — mais si brèves, — et aussi tant de vieillesses hâtives, lamentables et délaissées...
J’avais ralenti mon allure de promenade, pour ne pas m’éloigner de la traînante bûcheronne ; je cheminais presque à ses côtés.