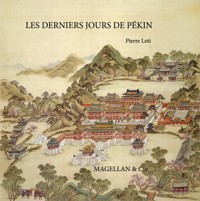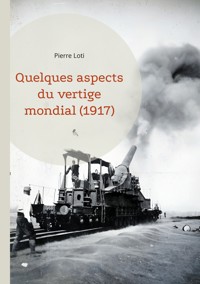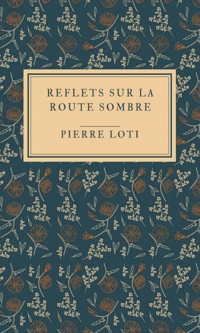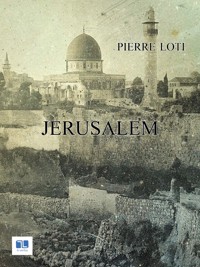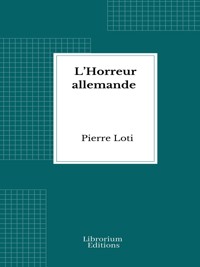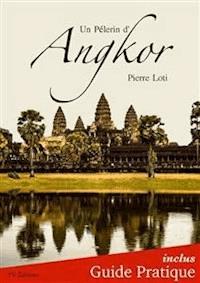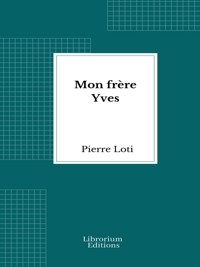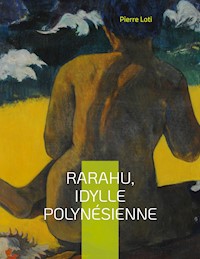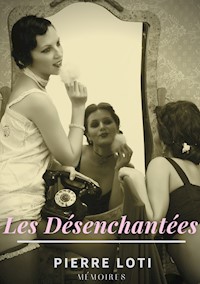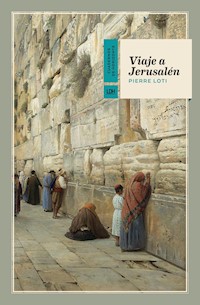0,89 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Sous la tente que j’habite depuis une heure, au seuil du désert, je relis cette lettre qui doit être mon sauf-conduit à travers les tribus hostiles. Au bas de la page, en mystérieux caractères, est inscrite la très occulte invocation divine de la secte des Senoussi, qui a son foyer là-bas, au Moghreb, et dont le séïd est le représentant pour l’Arabie orientale.
Les dangers du voyage, il est vrai, je n’y crois guère, et leur attrait chimérique n’est pas ce qui m’amène ici ; mais, pour essayer de voir encore, sous l’envahissement des hommes et des choses de ce siècle sans foi, la sainte Jérusalem, j’ai voulu y venir par les vieilles routes abandonnées et préparer mon esprit dans le long recueillement des solitudes.
Plusieurs de ces routes de sable m’étaient offertes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Pierre Loti
LE DÉSERT
1895
© 2022 Librorium Editions
ISBN : 9782383834168
PRÉFACE DE L’AUTEUR
Où sont mes frères de rêve, ceux qui jadis ont bien voulu me suivre aux champs d’asphodèle du Moghreb sombre, aux plaines du Maroc ?… Que ceux-là, mais ceux-là seuls, viennent avec moi en Arabie pétrée, dans le profond désert sonore.
Et que, par avance, ils sachent bien qu’il n’y aura dans ce livre ni terribles aventures, ni chasses extraordinaires, ni découvertes, ni dangers ; non, rien que la fantaisie d’une lente promenade, au pas des chameaux berceurs, dans l’infini du désert rose…
Puis, au bout de la route longue, troublée de mirages, Jérusalem apparaîtra, ou du moins sa grande ombre, et alors peut-être, ô mes frères de rêve, de doute et d’angoisse, nous prosternerons-nous ensemble, là, dans la poussière, devant d’ineffables fantômes.
I
Oasis de Moïse, 22 février 1894
Cet écrit émane de l’humble, devant la miséricorde de son Dieu très haut, le séïd Omar, fils d’Edriss, en faveur de son ami Pierre Loti, pour le recommander aux chefs de toutes les tribus d’Arabie, à l’effet d’avoir pour lui des égards et de l’aider pendant son voyage au pays des Arabes, car il vénère l’islamisme et il est animé des meilleurs sentiments pour notre religion.
Et je serai satisfait de tous ceux qui l’auront respecté et assisté, ainsi qu’il le mérite.
Écrit par nous, le 10 Chaban 1311, OMAR Fils d’Edriss, El Senoussi El Hosni.
Sous la tente que j’habite depuis une heure, au seuil du désert, je relis cette lettre qui doit être mon sauf-conduit à travers les tribus hostiles. Au bas de la page, en mystérieux caractères, est inscrite la très occulte invocation divine de la secte des Senoussi, qui a son foyer là-bas, au Moghreb, et dont le séïd est le représentant pour l’Arabie orientale.
Les dangers du voyage, il est vrai, je n’y crois guère, et leur attrait chimérique n’est pas ce qui m’amène ici ; mais, pour essayer de voir encore, sous l’envahissement des hommes et des choses de ce siècle sans foi, la sainte Jérusalem, j’ai voulu y venir par les vieilles routes abandonnées et préparer mon esprit dans le long recueillement des solitudes.
Plusieurs de ces routes de sable m’étaient offertes.
D’abord la plus facile et la plus courte, celle dite du petit Désert, par El-Arich et les bords du golfe égyptien ; déjà banalisée, celle-là, hélas ! suivie tous les ans par plusieurs oisifs d’Angleterre ou d’Amérique, avec le confort et sous la protection des agences spéciales.
Une autre ensuite, moins fréquentée, par le Sinaï et par Nackel.
Enfin, la plus allongée de toutes, par le Sinaï, Akabah et le désert de Pétra ; celle que j’ai choisie, parce que les guides me conseillaient de m’en détourner. Moins facile de tout temps, cette dernière est considérée, en Égypte, comme impraticable dans ce moment-ci, depuis la rébellion des tribus de l’Idumée, et il y a dix ans qu’aucun Européen n’a plus tenté de la suivre. Le cheik de Pétra surtout m’a été représenté comme un dangereux guetteur de caravanes, actuellement insoumis à tous les gouvernements réguliers, et sa personne, plus que son pays, m’attire là-bas. Il est d’ailleurs, comme presque tous les chefs de l’Idumée et du Hedjaz, affilié à la secte senoussise ; auprès de lui seul, sans doute, j’aurai à me servir de la lettre du séïd Omar, qui a tant de grandeur – et qui cadre si mal avec ces Bédouins de mon escorte, domestiqués, serviles, première déception de mon voyage.
Le désert, par exemple, n’est pas décevant, lui, même ici, à ce seuil où il ne fait que commencer d’apparaître. Son immensité prime tout, agrandit tout, et, en sa présence, la mesquinerie des êtres s’oublie.
Et si brusque a été la prise de possession de nous par lui ; si subit, notre enveloppement de silence et de solitude !… Hier matin encore, c’était Le Caire encombré de touristes, la vie comme dans toutes les stations hivernales élégantes. Hier au soir, c’était Suez, avec déjà plus d’isolement, dans un petit hôtel primitif, sentant la colonie et le sable.
Aujourd’hui, après nos adieux aux dernières figures européennes, un bateau nous a amenés, par grand vent, de ce côté-ci de la mer Rouge, pour nous déposer seuls sur la plage déserte. Plus personne et plus rien, à la tombée du soir désolé…
Cependant on nous guettait là-bas, derrière les maigres palmiers de l’oasis de Moïse qui faisaient une lointaine tache sombre sur l’infini des sables. Et nous vîmes venir à nous des chameaux qui se hâtaient, conduits par des Bédouins de mauvais aspect.
En s’approchant, ils souriaient, les chameliers, et nous comprîmes qu’ils faisaient partie de nos gens, que leurs bêtes allaient être nos montures. Ils étaient armés de poignards et de longs coutelas de fer ; leurs corps de momies desséchées apparaissaient par les trous des guenilles sans nom dont ils étaient couverts, débris de peaux de biques ou débris de burnous ; ils étaient grelottants sous ce vent triste du soir, et leurs sourires montraient des dents longues.
En une demi-heure, ils nous menèrent à l’oasis de la Fontaine de Moïse, qui est le point initial des routes du désert et où nos tentes, parties du Caire deux jours avant nous, étaient dressées parmi les palmiers grêles. Notre interprète et nos domestiques, tous Arabes de Syrie, nous attendaient là, et, autour du camp, nos vingt chameliers, nos vingt chameaux faisaient un amas de misères et de laideurs sauvages, bêtes et gens couchés ensemble, sur le sable où se mêlaient leurs fientes et leurs souillures.
Dans notre voisinage, une autre caravane plus nombreuse que la nôtre, mais plus humble aussi, gisait par terre en une confusion semblable : des pèlerins de Russie, popes, paysans, vieilles femmes exténuées de fatigue, tous gens de foi ardente, qui revenaient du Sinaï, après tant de jours de soleil et tant de nuits de plein air glacé, le visage défait et la toux creuse.
Et tout de suite, autour de nous, c’était l’infini vide, le désert au crépuscule, balayé par un grand vent froid ; le désert d’une teinte neutre et morte, se déroulant sous un ciel plus sombre que lui, qui, aux confins de l’horizon circulaire, semblait le rejoindre et l’écraser.
Alors, à regarder cela, nous prit une sorte d’ivresse et de frisson de la solitude ; un besoin de nous enfoncer là-dedans davantage, un besoin irréfléchi, un désir physique de courir dans le vent jusqu’à une élévation prochaine, pour voir plus loin encore, plus loin dans l’attirante immensité…
Du haut de la dune désolée où cette course nous mena, on voyait plus loin, en effet, et, sur le désert encore agrandi, traînait une dernière lueur de jour, descendue du ciel jaune par une déchirure qui lentement se faisait dans son voile…
Et voici, avec ce vent d’hiver, c’était sinistre tellement, qu’une mélancolie de source ancestrale et lointaine tout à coup se joignit à l’attirance du vide, un regret d’être venu, une tentation de fuir, quelque chose comme l’instinctive crainte qui fait rebrousser chemin aux bêtes des pays verts, à l’aspect de ces régions où plane la mort.
Sous la tente ensuite, à l’abri du vent, aux lumières, pendant notre premier dîner de nomades, l’insouciante gaieté nous revint, avec déjà l’accoutumance de ce grand seuil silencieux où le crépuscule achevait de s’éteindre.
Et puis, il y avait l’amusement très enfantin de revêtir nos costumes d’Arabes – nouveaux pour mes deux compagnons de voyage, s’ils ne l’étaient plus pour moi-même. Pas bien nécessaires, il est vrai, ces déguisements-là, surtout dans cette première partie du désert sinaïtique où tant d’Européens ont déjà passé : mais plus commodes, au brûlant soleil des jours autant qu’au froid des soirs, et surtout incontestablement plus décoratifs pour cheminer sur des dromadaires : lorsqu’on n’est pas seul, on doit à autrui de ne pas promener dans son tableau de désert la tache ridicule d’un costume anglais, et c’est presque une question de bon procédé envers son prochain que de s’habiller au gré de son rêve d’artiste.
Donc, nous voici pour bien des jours dépêtrés de nos jaquettes occidentales, libres et peut-être embellis dans de longs burnous et de longs voiles ; semblables à des cheiks d’Arabie – et impatients du départ matinal de demain.
II
Après cela, Moïse fit partir les Israélites de la mer Rouge, et ils tirèrent vers le désert de Sur ; et, ayant marché trois jours par le désert, ils ne trouvaient point d’eau.
(Exode, XV, 22)
Vendredi 23 février
Dans des barils et des outres, l’eau du Nil nous suit au désert de Sur. Tout le jour, cheminé dans l’immensité des sables arides, suivant ces vagues traces que font, à force de siècles, les rares passages des hommes et des bêtes, et qui sont les chemins du désert. Au loin, les monotones horizons tremblent. Des sables semés de pierres grisâtres ; tout, dans des gris, des gris roses ou des gris jaunes. De loin en loin, une plante d’un vert pâle, qui donne une imperceptible fleur noire – et les longs cous des chameaux se baissent et se tendent pour essayer de la brouter.
Les horizons tremblent de chaleur. Parfois on espère rencontrer, pour sa tête, l’ombre d’un nuage errant dans l’infini du ciel, ombre errante aussi sur l’infini des sables. Mais elle passe et fuit. Elles s’en vont, les petites ombres inutiles des nuages, rafraîchissant seulement des pierres ou de vieux ossements blanchis.
Inutiles aussi, les plus épaisses nuées qui maintenant, à l’issue du clair matin, vers l’heure méridienne, commencent à s’amonceler là-bas, sur les montagnes mortes, portant leur voile de fraîcheur et de mystère là où il n’y a rien. De plus en plus, elles se condensent, embrouillant de vapeurs ces lointains sans vie ; du changeant et de l’irréel semblent à présent nous entourer ; les sables où nous marchons se noient de tous côtés dans un ciel toujours plus bas et plus sombre, et enfin le soleil lui-même se ternit comme pour s’éteindre. Çà et là, seulement, au hasard d’une déchirure dans ces rideaux d’ombre, la cime dénudée d’une montagne s’éclaire, ou bien, plus près de nous, sous une percée d’où quelques rayons tombent, une colline de sable, toute pailletée de mica, se met à briller comme un tumulus d’argent.
Pendant la halte alourdie du milieu du jour, nos chameaux de charge nous dépassent, comme il est d’usage en caravane, emportant, au fond des inquiétants lointains, nos bagages et nos tentes, pour que nous trouvions notre camp monté d’avance, en arrivant après eux à l’étape de nuit.
Plus solitairement donc, nous reprenons la marche de la fin du jour. Et, peu à peu, l’esprit s’endort dans la monotonie de l’allure lente et toujours balancée de la grande bête infatigable, qui s’en va, s’en va sur ses pattes longues. Et, au premier plan de toutes les choses grises, les yeux voilés de sommeil, qui s’abaissent, ne perçoivent plus que la continuelle ondulation de son cou, du même gris jaune que le sable, et le derrière de sa tête poilue, semblable à une petite tête de lion, qu’entoure un ornement sauvage, de coquilles blanches et de perles bleues, avec pendeloques de laine noire.
Vers le soir, nous entrons dans une région semée, à perte de vue, de maigres genêts ; sorte de triste jardin sans limites visibles, – et le vent, qui se lève, le couvre et l’embrume d’une fine poussière de sable.
Toujours plus fort, ce vent que rien n’arrête. À la lumière mourante, on ne voit plus les choses qu’au travers de cet étrange nuage jaune, d’une transparence livide. Nos tentes, qui apparaissent là-bas, s’exagèrent dans le lointain, au milieu de l’immensité nue, prennent dans cette buée de sable des proportions de pyramides – et nos chameaux porteurs, qui errent alentour broutant les genêts, semblent des bêtes géantes qui mangeraient des arbres, aux dernières lueurs pâles du couchant.
Par grand vent, qui agite nos tentes avec un bruit de voilure de navire, nous nous arrêtons là pour la nuit, en ce point quelconque de la solitude infinie.
III
Samedi 24 février
Jusqu’à deux heures du matin, le vent tourmente sans trêve notre petit camp, si isolé au milieu d’espaces vides. Nos tentes s’agitent avec des claquements de voiles ; dans l’obscurité, on sent passer sur sa tête des draperies qui remuent ; la couchette légère est secouée, comme en mer durant les nuits mauvaises et, à l’entour du camp, les chameaux crient tous ensemble à la façon des bêtes de ménagerie. Malgré soi, on songe combien serait peu de chose la nomade maison de toile contre les pillards de la nuit, contre toutes les surprises du désert : avec tant de bruit, tant de remuement dans ces ténèbres, des mains seraient sur vous, une lame sous votre gorge, sans qu’on ait rien entendu venir, sans que les compagnons de route, dans les tentes voisines, aient rien soupçonné.
Au jour levé, le temps est redevenu calme, immobile. Alors, au sortir de la tente, on regarde : le soleil monte, dans une pureté absolue d’atmosphère ; plus rien de l’irréel d’hier au soir ; les choses ont repris leurs apparences et leurs proportions vraies, des chameaux, du sable, de maigres genêts ; tout est net, comme figé sous une lumière trop crue, et, au loin, au-dessus d’une nappe de lapis qui est la mer Rouge, les montagnes d’Égypte se dessinent encore.
Tout le matin, cheminé, cheminé dans les solitudes, à la même allure lente et balancée. Les genêts se font plus rares. Çà et là croît, solitaire, une étrange fleur de sable, quenouille sans feuillage qui sort du sol, teintée de jaune et de violet.
Et rien de vivant nulle part : pas une bête, pas un oiseau, pas un insecte ; les mouches mêmes, qui sont de tous les pays du monde, ici font défaut. Tandis que les déserts de la mer recèlent à profusion les richesses vitales, c’est ici la stérilité et la mort. Et on est comme grisé de silence et de non-vie, tandis que passe un air salubre, irrespiré, vierge comme avant les créations.
Le soleil monte, brûle, éclaire d’un feu blanc toujours plus admirable. Sur le sol, il y a des semis de petits galets noirs, ou bien des étincellements de mica ; mais plus une plante à présent, plus rien.
Et la région commence à se faire tourmentée, presque montagneuse : des amas de graviers et de pierres, à jamais inutiles et inutilisables, affectant, on ne sait pourquoi ni pour quels yeux, des formes très cherchées, qui sans doute sont là immuables depuis des siècles, dans le même silence et les mêmes splendeurs de lumière. Sous l’éblouissant soleil, on ferme les yeux malgré soi, pendant des instants très longs ; quand on les rouvre, l’horizon dur semble un cercle noir qui tranche sur la clarté du ciel, tandis que reste étonnamment blanc le lieu précis où l’on est, et où se meuvent, sur les parcelles des micas argentés, les ombres des grandes bêtes cheminantes, au balancement éternel.
Vers le soir, nous approchons d’une région de hauts sommets. Et, à l’heure triste où le soleil d’hiver étend démesurément nos ombres, dans un grand cirque de sable et de pierre où nous sommes, ces montagnes devant nous étalent un merveilleux luxe de couleurs, des violets d’iris pour les bases, des roses de pivoine pour les cimes, le tout profilé sur la limpidité d’un ciel vert.
De plus en plus allongées, les ombres des choses, celles des moindres dunes, celles des moindres pierres ; et les nôtres, qui cheminent près de nous sur le sable, sont presque infinies ; nous semblons montés sur des chameaux qui auraient des échasses, sur des bêtes apocalyptiques aux longues pattes d’ibis.
Cependant la nuit tombe et nous n’apercevons pas notre camp. Comme l’étape est interminable aujourd’hui !
La nuit est tombée à présent, bien que les montagnes là-bas restent lumineuses, rougeâtres, comme recelant du feu, encore incandescentes. Et nous sommes, nous, dans le noir de petites vallées sinistres, dénuées de toute vie, où nos chameaux, qui n’y voient plus, se plaignent ne sachant trop où poser leurs larges pieds hésitants. Où donc sont-elles, nos tentes, ce soir ? Notre guide semble ne plus se reconnaître, et une inquiétude vague nous prend, dans cet isolement sans bornes.
Enfin, enfin, au tournant d’une colline, des feux, des flammes jaunes, dansent devant nous ! C’est là, nous arrivons, nos Bédouins viennent à notre rencontre avec des lanternes. Ils ont monté notre camp cette fois dans un lieu choisi, adossé à une muraille de roches qui donnent l’illusion d’une protection contre les surprises nocturnes, et on éprouve une plus réelle impression de chez-soi en entrant dans les maisons de toile où les flambeaux sont allumés ; avec leurs arabesques brodées, leurs tapis d’Orient par terre, elles font, à nos yeux déjà habitués aux tons neutres du néant, des effets de petits palais nomades.
Cependant le même vent froid qu’hier s’est levé, le même qui, paraît-il, se lèvera chaque soir, et qui est comme la respiration du désert. Il commence à agiter les toiles de nos frêles demeures errantes, au milieu de la désolation et de la nuit qui sont partout alentour.
Et des hommes sont sortis de ces rochers, qui d’abord semblaient protecteurs ; ils sont là, quelques inconnus, visages noirs et dents blanches, qui rôdent dans l’obscurité autour de nos feux.
IV
Dimanche 25 février
Au lever du soleil splendide, notre camp s’éveille, s’ébranle, se replie pour le départ. Au-dessus des rochers qui tendaient derrière nous leur muraille, se tient la lune blanche qui, de son œil éteint dans le ciel bleu, nous regarde partir.
D’abord, jusqu’au brûlant midi, les solitudes sont semées de cailloux noirs, comme saupoudrées de charbon, et ces cailloux luisent, brillent sous l’ardent soleil, donnant une illusion d’humidité aux altérés qui passent. Elles défilent pendant des heures, les solitudes noires, pleines de miroitements ; par places, des salpêtres, des affleurements de sels y font des marbrures grises. Rien ne chante, rien ne vole, rien ne bouge. Mais le silence immense est martelé en sourdine par le piétinement incessant et monotone de nos chameaux lents…
Vers midi, passe une région moins morte. Au bord de quelque chose qui doit être le lit desséché d’un torrent, croissent des tamarins incolores, de pâles genêts à petites fleurs blanches – et même deux hauts palmiers. Une hirondelle grise nous croise d’un vol effaré, des mouches reparaissent autour des yeux pleurants de nos chameaux. Tout un essai de vie. Et deux grands oiseaux noirs, les maîtres de ce lieu, déploient leurs ailes, poussent leur cri dans ce silence.
Nos Bédouins d’escorte, voyant les palmiers, flairent qu’il y a de l’eau sous leur ombre mince et y conduisent nos bêtes. En effet, dans un creux de sable, un peu d’eau s’est amassée, et les chameaux, en grondant de joie, s’en approchent, essayent d’y plonger, à deux ou trois ensemble, leurs museaux, emmêlant leurs longs cous tendus.
Puis le désert recommence, plus sec et plus stérile. Nous nous éloignons toujours de la mer Rouge, depuis hier disparue, nous enfonçant dans les contrées montagneuses de l’intérieur. Combien de vallées lugubres, de grands cirques désolés, traverserons-nous encore, avant le repos du soir ! Nos chameaux vont toujours, toujours au même rythme balancé qui endort, suivant presque d’eux-mêmes les imperceptibles sentes du désert, qu’ont suivies et tracées, depuis des âges sans nombre, les bêtes pareilles dont ils descendent, dans cette même direction, la seule un peu fréquentée de l’Arabie sinaïtique.
Vers le soir, passent trois femmes impénétrablement voilées, sur de jeunes chamelles le museau au vent. Un moment plus tard, un garçon, tout de bronze, qui paraît inquiet de leur fuite, suit la même direction qu’elles, dans la solitude où nos yeux les ont perdues. Son chameau, orné de broderies en coquillages, a des franges et des glands de laine noire, qui flottent au vent de sa course.
Autour de nous, à mesure que s’en va la journée, les montagnes s’élèvent et les vallées se creusent. Les montagnes sont de sable, d’argile et de pierres blanches : amas de matières vierges, entassées là au hasard des formations géologiques, jamais dérangées par les hommes, et lentement ravinées par les pluies, lentement effritées par les soleils, depuis les commencements du monde. Elles affectent les formes les plus étranges, et on dirait qu’une main a pris soin de les trier, de les grouper, par aspects à peu près semblables : pendant une lieue ce sont des suites de cônes superposés, étagés comme avec une intention de symétrie ; puis les pointes s’aplanissent, et cela devient des séries de tables cyclopéennes ; ensuite viennent des dômes et des coupoles, comme des débris de cités fossiles. Et on reste confondu devant la recherche et l’inutilité de ces formes des choses – tandis que tout cela défile dans le même silence de mort, sous la même implacable lumière, avec toujours ces parcelles brillantes de mica, dont le désert est pailleté ici comme un manteau de parade.
De temps à autre, un des chameliers chante, et sa voix nous tire d’une somnolence ou d’un rêve. Son chant est plutôt une suite de cris d’appel, infiniment tristes, où le nom terrible d’Allah sans cesse revient : il éveille, dans les parois des vallées, de clairs échos, des sonorités presque effrayantes, qui dormaient.
Le soir, à l’heure où la magie du couchant descend pour nous seuls sur le désert, nous campons dans un grand cirque mélancolique et encore sans nom, tout d’argile grisâtre, entouré d’une muraille de rochers géants. Le lieu est sans eau ; mais, pour deux ou trois journées encore, nous avons de l’eau du Nil et le cheik, notre guide, promet de nous faire camper demain soir près d’une source.
Sitôt les tentes montées, nos chameaux, débarrassés de leurs charges lourdes, se répandent autour du camp, à la recherche des rares genêts ; nos Arabes, à la recherche des brindilles sèches pour faire du feu – semblables alors à des sorcières en longues robes qui ramasseraient des herbes, à l’approche du soir, pour des maléfices. Et pendant une nuit, notre petite ville nomade apporte l’illusion de la vie dans ce lieu perdu où elle ne reviendra jamais plus et où retombera demain le silence de la mort.