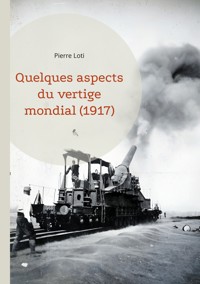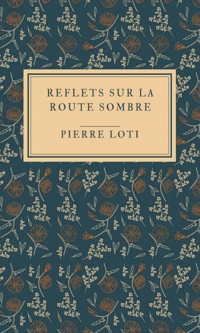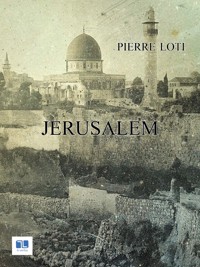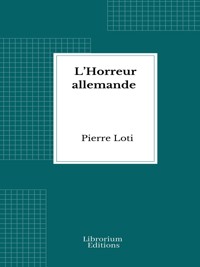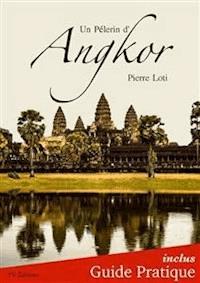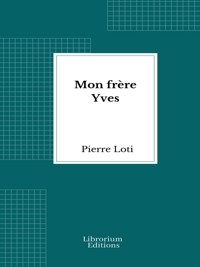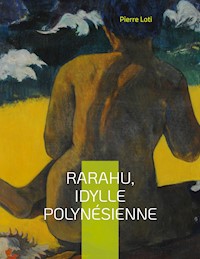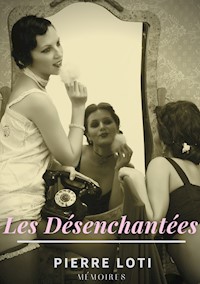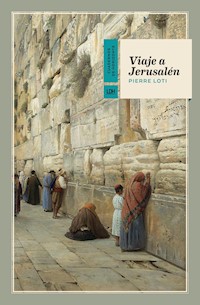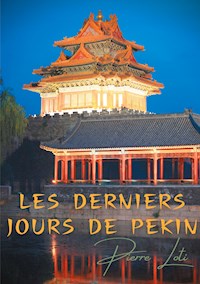1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Ce livre, si j’ose l’appeler ainsi, sera le quatrième que j’aurai écrit pour défendre la plus juste des causes, et écrit, hélas ! dans une stupeur et une indignation croissantes devant tant d’irréductibles partis pris et tant d’entêtements aveugles. Il ne mérite même pas le nom de livre ; il n’est qu’un incohérent amas de documents et de témoignages — tous irréfutables, il est vrai, mais qui cependant auraient beaucoup gagné à être présentés avec un peu plus d’ordre, moins de répétitions, moins de maladresses. Pauvre livre, que de difficultés entravèrent son éclosion ! Il y eut d’abord la censure, dont la partialité fut excessive. Et puis surtout, il y eut par centaines des banquiers levantins qui, les mains pleines d’or, veillaient partout ; c’étaient gens habiles et acharnés à découvrir, au flair, les quelques rares petites âmes à vendre qui çà et là entachaient nos rangs, et, sous leur patronage, des calomnies salariées s’insinuaient de temps à autre par surprise dans nos feuilles les plus intègres ; contre les pauvres Turcs, des insultes infiniment regrettables se faufilaient sans trop de peine, tandis qu’il ne fallait jamais toucher aux Arméniens ni aux Grecs.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
La Mort de notre chère France en Orient
Pierre Loti
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782385742317
AVANT-PROPOS
I LES ALLIÉS QU’IL NOUS AURAIT FALLU[1]
II LES TURCS
III SMYRNE « L’INFIDÈLE »
IV NOS INTÉRÊTS EN ORIENT
V LES MASSACRES D’ARMÉNIE
VI UN CRI D’ALARME
VII NOS ÉGARDS SPÉCIAUX POUR LES TURCS, EN RETOUR DES LEURS[1]
VIII RECTIFICATION DE CHIFFRES[1]
IX LE DOUZIÈME POINT DU PRÉSIDENT WILSON[1]
X UNE LETTRE QUI, À ELLE SEULE, SUFFIRAIT À PROUVER LA « FÉROCITÉ » DES TURCS[1]
XI LA CILICIE
XII LETTRES DE COLLECTIVITÉS TURQUES
XIII À PROPOS D’UNE INTERVIEW
XIV QUELQUES PROCÉDÉS ANGLAIS
XV UNE LETTRE À MOI ADRESSÉE PAR LE JOURNAL TURC « L’ENTENTE »
XVI « LEUR » HONNÊTE PETITE PROPAGANDE
XVII RÉVOLTANTE PARTIALITÉ DE CERTAINE PRESSE FRANÇAISE
XVIII FRAGMENTS DU DISCOURS DE SULEÏMAN NAZIF BEY[1]
XIX LETTRE À MOI ADRESSÉE PAR UN FRANÇAIS DE CONSTANTINOPLE
XX AUTRE LETTRE DU MÊME
XXI COPIE DE L’ACCORD SECRET CONCLU ENTRE LA TURQUIE ET L’ANGLETERRE QUI A ENSUITE RENIÉ SA SIGNATURE
XXII UN FILM SENSATIONNEL
XXIII AUTRE LETTRE D’UN FRANÇAIS DE CONSTANTINOPLE
XXIV ARTICLE D’UN POILU DE FRANCE REVENANT DE CONSTANTINOPLE
XXV UNE LETTRE DE M. PIERRE LOTI AU DIRECTEUR DU « FIGARO »
XXVI LETTRE OUVERTE DE M. ABEL HERMANT À PIERRE LOTI
XXVII ATTESTATION DU COMMANDANT LIBERSART
XXVIII LES SOI-DISANT INGRATITUDES DES TURCS
XXIX AUTRES PREUVES DE LA « FÉROCITÉ » TURQUE
XXX QUELQUES PETITES CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
XXXI UN ARTICLE HAINEUX ET MENSONGER DU « TIMES », REPRODUIT LE 3 FÉVRIER 1920 PAR « LE MATIN »[1]
XXXII LETTRE D’UN OFFICIER DE L’ARMÉE D’ORIENT
XXXIII LETTRE D’UNE FRANÇAISE AYANT HABITÉ LA TURQUIE
XXXIV LETTRE D’UNE MÈRE DONT LE FILS EST TOMBÉ AUX DARDANELLES
XXXV LETTRE D’UN COMBATTANT DE L’ARMÉE D’ORIENT
XXXVI LETTRE D’UN JOURNALISTE FRANÇAIS
XXXVII LETTRE D’UN OFFICIER DE L’ARMÉE D’ORIENT
XXXVIII LETTRE DE M. KORN BLUM
XXXIX LETTRE DE M. GABRIEL CHARRAZAC, EX-SERGENT DES T. F. L.
XL LETTRE À MOI ADRESSÉE PAR UNE DAME TURQUE
XLI LETTRE D’ENVOI DE M. LE CAPITAINE DE CORVETTE CHACK[1]
XLII LETTRE D’UNE FRANÇAISE HABITANT CONSTANTINOPLE
XLIII AUTRE LETTRE DE LA MÊME FRANÇAISE
XLIV LETTRE DE M. PIERRE HOFFMANN
XLV LETTRE DU COMMANDANT DEFORGE.
XLVI LETTRE D’UN FRANÇAIS DE CONSTANTINOPLE
XLVII LETTRE D’UN FRANÇAIS DE CONSTANTINOPLE
XLVIII LETTRE DU MÊME
XLIX LA FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET 1919 À CONSTANTINOPLE, RACONTÉE PAR LE JOURNAL « LES DÉBATS »
L LETTRE D’UN MÉDECIN MILITAIRE DE L’ARMÉE D’ORIENT
LI FRAGMENT D’UN REMARQUABLE ARTICLE PARU LE 5 FÉVRIER 1920 DANS LE JOURNAL « L’ŒUVRE »
LII QUELQUES TÉMOIGNAGES DE PLUS
LIII UN TRAITÉ DE PAIX QUI DIGNEMENT COURONNE LA LONGUE SUITE D’ÂNERIES DE NOTRE POLITIQUE ORIENTALE
AVANT-PROPOS
Ce livre, si j’ose l’appeler ainsi, sera le quatrième que j’aurai écrit pour défendre la plus juste des causes, et écrit, hélas ! dans une stupeur et une indignation croissantes devant tant d’irréductibles partis pris et tant d’entêtements aveugles. Il ne mérite même pas le nom de livre ; il n’est qu’un incohérent amas de documents et de témoignages — tous irréfutables, il est vrai, mais qui cependant auraient beaucoup gagné à être présentés avec un peu plus d’ordre, moins de répétitions, moins de maladresses. Pauvre livre, que de difficultés entravèrent son éclosion ! Il y eut d’abord la censure, dont la partialité fut excessive. Et puis surtout, il y eut par centaines des banquiers levantins qui, les mains pleines d’or, veillaient partout ; c’étaient gens habiles et acharnés à découvrir, au flair, les quelques rares petites âmes à vendre qui çà et là entachaient nos rangs, et, sous leur patronage, des calomnies salariées s’insinuaient de temps à autre par surprise dans nos feuilles les plus intègres ; contre les pauvres Turcs, des insultes infiniment regrettables se faufilaient sans trop de peine, tandis qu’il ne fallait jamais toucher aux Arméniens ni aux Grecs.
Pauvre livre, je n’ai même pas eu le temps de le composer ; il s’est fait tout seul, au jour le jour, au hasard des aberrations de notre politique hésitante, qui, au fond, sentait bien la pente fatale, mais n’avait pas le courage de se raidir, de s’arrêter. Avec angoisse, comme la plupart des Français de mon temps, j’ai suivi, de chute en chute, cette course à l’abîme, qui laissera dans l’histoire de notre race la première tare indélébile ; je l’ai suivie en me disant : Non, cela ne se peut pas, la conscience et le bon sens français vont finir par se reprendre au bord du précipice ; nous ne commettrons pas cette imbécillité et ce crime de contribuer à anéantir la race la plus loyale de l’Europe et la seule vraiment amie, au profit de notre implacable rivale et de sa méprisable petite alliée… Eh ! bien, si, hélas ! le voilà déjà aux trois quarts commis, le crime sans réparation possible, comme sans excuse. Et ce sont les Anglais qui nous ont entraînés là ; non pas tous les Anglais, je ne leur fais pas l’injure de les en accuser tous, mais l’un d’eux, et l’un presque seul, ce Lloyd George qui a toutes les roublardises du primaire qu’il est resté. Et d’ailleurs, comme premier résultat de son absurde gloutonnerie de conquête, en attendant les pires désastres de l’avenir, il a déjà conduit son pays à cette humiliation, d’être obligé d’appeler la Grèce à son secours, malgré les énormes machines à tuer amenées par mer et qui commencent de détruire sans pitié les adorables et paisibles villages des côtes de Turquie, les délicates mosquées et les minarets frêles.
Je me serais donc découragé et résigné au silence si je n’avais la certitude que la vérité tout de même fait son chemin, depuis surtout que les esprits les plus obtus ont été forcés de constater les premières conséquences des complicités de cette grande Angleterre infiniment redoutable et de cette toute petite Grèce son abjecte servante. Si nos gouvernants, liés par je ne sais quelles paroles autrefois données, s’obstinent à perpétrer en Turquie le monstrueux attentat contre le droit des gens et contre le sens commun, déjà, dans le public, la stupeur et l’indignation grondent…
Jamais, hélas ! l’agonie d’un peuple n’aura été conduite avec une lenteur plus cruelle, jamais, pour la victime, avec de telles alternatives d’espoir et d’accablement, prolongeant le supplice. Pauvres Turcs, un jour réconfortés par de menteuses promesses et pouvant se croire sauvés, mais le lendemain précipités plus bas encore, sous la main perfide de l’Angleterre qui jamais n’avait desserré son étreinte d’étranglement !… Et que penser de nous Français, qui aurons admis à nos côtés cet humiliant manège, qui pour la première fois de notre histoire aurons manqué à notre serment et qui — d’un cœur léger semble-t-il, — aurons consenti à rayer d’un trait de plume les résultats de cinq siècles d’efforts, nous ravalant ainsi, sous les yeux plus que jamais ouverts de tout l’Islam, au rang haïssable des Anglais.
PIERRE LOTI
ILES ALLIÉS QU’IL NOUS AURAIT FALLU[1]
Janvier 1919.
« La Méditerranée est un lac français. » Il y a une cinquantaine d’années, cela se disait encore, mais, hélas ! qu’il est loin de nous, ce temps-là ! qu’il est loin de nous le temps où l’Égypte, au lendemain du percement du canal de Suez, ne voyait et n’admirait que la France ! Le temps où, à Jérusalem, dans la basilique du Saint-Sépulcre, pendant la messe solennelle de Pâques, on apportait en grande pompe la communion au consul général de France d’abord, toujours à lui le premier, avant les représentants assemblés de toutes les autres nations européennes ! Le temps où nous étions chez nous au Liban et en Syrie ! Le temps où Constantinople était une ville d’influence, de sympathie et de langue françaises !… Hélas ! Hélas ! une nation, depuis des siècles rivale de la nôtre et dont nous ne pouvons qu’admirer avec effroi l’inébranlable suite d’idées, poursuit à notre détriment son plan grandiose et tenace de devenir la plus grande, la seule puissance islamique du monde, et partout elle nous supplante. Pour contre-balancer un peu son influence, — pour le moment amicale, il est vrai, — surtout pour parer au danger d’un réveil des Boches, il nous faudrait en Orient des alliés puissants et sûrs, cela tombe sous le sens. Or, ces alliés où les prendrions-nous ? Les Russes, sur lesquels nous comptions jadis ? — Mais ils viennent de faire leurs preuves. Les petits Grecs ? — Mais toutes leurs trahisons, couronnées par le guet-apens et les assassinats d’Athènes !… Ah ! les Turcs, oui, ceux-là et rien que ceux-là, qui, de fait ou d’intention, nous restaient fidèles depuis l’époque lointaine où notre alliance avait été signée par les deux plus grands souverains de l’Europe d’alors, François Ier et Soliman le Magnifique. Mais, hélas ! demain ils n’existeront plus et nous voici prêts à souscrire, nous aussi, à leur décret de mort, après les avoir déçus de toutes les manières, abandonnés au milieu de leurs pires détresses.
Quand l’Angleterre s’installa en Égypte, ils avaient compté sur nous pour lui rappeler sa parole donnée à toute l’Europe, qu’elle n’y resterait pas, et nous nous sommes dérobés. À la fin du siècle dernier, quand la Grèce leur a déclaré la guerre, — et s’est du reste laissé écraser en huit jours, — nous avons fait chorus avec les autres nations occidentales pour exiger d’eux la renonciation aux fruits de leur victoire. Lors de la guerre Balkanique, non seulement nous avons pris fait et cause contre eux, en exaltant les féroces Bulgares et leur immonde Ferdinand, mais nous les avons insultés à jet continu dans tous nos journaux, leur attribuant tous les crimes de leurs ennemis : « Les Turcs massacrent, répétions-nous à qui mieux mieux, les Turcs continuent de commettre les pires horreurs » (cliché du cher paladin Ferdinand) et nous n’en avons jamais voulu démordre, alors même qu’il était prouvé par cent témoins, par cent commissions internationales, que les tortionnaires et les massacreurs étaient du côté des soi-disant chrétiens. En dernier lieu enfin c’est nous qui, avec une recrudescence d’injures à leur adresse, avons lancé l’Italie contre eux sur la Tripolitaine… Et après tout cela, nous avons la naïveté de nous indigner de ce que ces pauvres Turcs, reniés par nous et trouvant une occasion sans doute unique d’échapper à la menace séculaire d’écrasement par le colosse russe, se soient jetés dans les bras de l’Allemagne ! Qu’est-ce qu’ils nous doivent, s’il vous plaît ? Comme circonstance atténuante à leur décision de désespoir, il est de toute justice aussi de citer les imprévoyances, les maladresses sans nombre de notre diplomatie chez eux à l’heure du déchaînement de la guerre mondiale, alors que la diplomatie boche agissait au contraire avec la plus habile perfidie et la brutalité la plus impudente. Est-il nécessaire de rappeler aussi que ce comité « jeune turc », responsable de tout, ne représentait en Turquie qu’une minorité infime entièrement sous la griffe allemande, — comité qui du reste, sur ses vingt-cinq membres, comprenait à peine cinq véritables Osmanlis, les autres étant des métèques de toute provenance, Grecs, Crétois, Juifs, Arméniens, etc.
« Aux parties du présent empire ottoman,seront assurées pleinement la souveraineté et lasécurité », avait dit M. Wilson dans l’article 12 de son programme, lequel programme avait été accepté et contresigné par toutes les puissances de l’Entente. Mais voici que cet article 12 est le seul aujourd’hui foulé aux pieds, sans même que personne ait eu l’idée d’en donner une excuse, ou seulement une explication. Non, il semble maintenant admis en Occident que les Turcs sont des parias hors la loi et que leurs ennemis seuls aient le droit d’être entendus à la Conférence de la Paix. N’ont-ils pas, dans leur malheureux pays, une supériorité numérique écrasante, une communauté absolue de religion, de coutumes, de langue — et aussi d’honnêteté ! Et pourquoi la censure, cruellement partiale, coupe-t-elle tout ce qui peut déplaire aux Arméniens et aux Grecs, tandis qu’elle laisse passer les pires insultes pour les Turcs ? N’ai-je pas lu dernièrement dans un journal de Paris ces phrases aussi imbéciles qu’odieuses :
« De tous nos ennemis, les Turcs sont non seulement ceux que nous devons le plus haïr, mais ceux qu’il nous faut mépriser le plus. »
Nous devrions cependant craindre de les pousser aux actes désespérés et de seconder ainsi le jeu de ces agents provocateurs à gages qui continuent chez eux d’ignobles manœuvres. Que, pendant la guerre, ils aient eu pour nous des égards exceptionnels, il n’y a plus que des hommes de mauvaise foi pour oser le contester. Et voici notre remerciement !… J’ai déjà dit qu’ils meurent de faim ; or, sait-on chez nous qu’en ce moment même, tandis que nous nous apprêtons à ravitailler la monstrueuse Allemagne qui simule la famine, non seulement nous ne songeons pas aux Turcs, mais pour comble nous venons d’empêcher, à force de lenteur voulue à délivrer les permis, le départ de Barcelone d’un bateau de secours à destination de Constantinople, affrété par la pitié des Neutres pour apporter là-bas des vêtements et des vivres, les plus anodins macaronis, les plus innocentes lentilles et les plus inoffensives chaussettes !…
Pauvres Turcs ! dans leur stupeur et leur désespoir, de tous côtés ils s’adressent à moi, mais que puis-je, hélas ! pour faire entendre ma voix et le concert des voix si nombreuses de tous les Français qui vraiment les connaissent ? Tous les bureaux de la presse parisienne sont encombrés par la meute acharnée de leurs ennemis : Arméniens, Grecs, Levantins de toutes couleurs qui, les jugeant perdus, se précipitent à la curée. Sans plus rien espérer, je veux cependant citer la dernière dépêche qui m’arrive d’un de leurs plus importants comités de défense :
« Nous tournons vers vous nos regards suppliants dans la détresse que nous cause le sort réservé par la Conférence à la patrie turque, contrairement aux principes élevés de justice proclamés par l’Entente. Espérant quand même que la grande nation française ne voudra pas souscrire à une iniquité si criante, nous vous conjurons d’en appeler à sa générosité, pour savoir si les descendants de François Ier approuvent réellement sans pitié le sort infligé aux fils de Soliman. »
La générosité, disent-ils ! Mais en politique, la générosité, cela ne se porte plus, même pas dans notre chère France qui est, j’ose le dire, de toutes les nations la plus généreuse. Hélas ! hélas, mon humble voix ne peut rien, même pas faire entendre qu’il y aurait pour nous intérêt capital à maintenir à Constantinople une Turquie forte et alliée.
Non, je ne peux rien, même pas mettre une sourdine au tollé d’insultes qui monte de partout contre cette Turquie agonisante. C’est pourtant si peu chevaleresque, si peu français quand il s’agit de vaincus aux abois ! Oh ! je le sais bien, ceux qui les injurient sont des hommes, qui n’ont jamais mis le pied en Orient, des hommes que de vieux préjugés aveuglent et qui, de bonne foi, je n’en doute pas, se laissent encore monter la tête par les agents d’une propagande enragée. Le plus souvent aussi, le nom de ces insulteurs se termine par cette diphtongue : ian qui à elle seule dénonce l’Arménie nasillarde et geignarde ; ce sont de purs Arméniens, et alors, que prou vent leurs dires intéressés ? Mais quand même, cela porte sur les masses, qui n’ont ni le temps ni la ferme volonté de se documenter davantage.
J’ai entre les mains d’écrasants dossiers, contrôlés, signés et contresignés, sur les agents provocateurs[2] de massacres et sur les agissements des Arméniens, en Asie, au début de la guerre mondiale ; ils étaient sujets Ottomans ; on les laissait parfaitement tranquilles à ce moment-là, et pourtant ils n’hésitèrent pas à courir au-devant des armées de l’invasion russe, à servir d’espions et de pisteurs ; dans les villes et les villages, non seulement ils leur désignaient les maisons turques, mais ils étaient les premiers à incendier, torturer, massacrer à tour de bras, faire des piles de cadavres. Quel est donc le peuple au monde qui n’aurait pas réprimé violemment de telles forfaitures commises dans son sein et en pleine guerre ?
Pour finir, je voudrais demander à mes chers compatriotes une seule chose : si des considérations supérieures que je n’ai pas à apprécier, si des pressions étrangères irrésistibles nous forcent de souscrire à l’arrêt de mort de ces Turcs, qui auraient été pour nous de si précieux alliés, au moins écoutons avec un peu plus de confiance les innombrables voix de tous nos officiers ou soldats revenus d’Orient ; j’ai par centaines leurs lettres spontanées qui sont si terribles pour les Levantins et si affectueuses pour les Turcs, pour les Turcs seuls. Je citerai, de l’un d’eux, cette phrase textuelle qui par sa forme m’a amusé au milieu de mon angoisse : « Oh ! là là, les férocités turques, les massacresd’Arménie, nous avait-on assez bourré le crâneavec ce bateau-là ! » Et tous racontent les égards dont les Turcs entouraient nos prisonniers et nos blessés : « Ils nous laissaient aller relever noshommes tombés entre les lignes, ce qu’aucun belligérantn’eût jamais fait. Aux Dardanelles, quandils devaient bombarder un fort où nous avions uneambulance, ils nous avertissaient l’avant-veille, pournous laisser le temps de tout évacuer, etc., etc. » Et tous ont signé, donnant leur adresse et me priant de ne pas hésiter à les appeler en témoignage.
Oh ! avec quelle émotion j’ai lu la longue lettre de l’un de nos héroïques lieutenants de vaisseau ! Quand le glorieux navire qu’il commandait là-bas, percé de part en part, eut coulé, en gardant haut son grand pavillon de France, grièvement blessé lui-même, il se dirigea vers la terre, à la nage, soutenu par les épaves, à la suite de ce qui restait de ses matelots ensanglantés et presque mourants. Les Turcs alors, au lieu de les mitrailler à la manière boche, leur indiquèrent la plage où accoster ; n’ayant point de barque à leur envoyer, ils entrèrent dans l’eau pour les aider et les soutenir. L’officier turc qui commandait le détachement, après avoir salué et tendu amicalement la main, fit rendre les honneurs militaires à tous, jusqu’au plus humble des matelots, et leur exprima en français son regret profond d’avoir été obligé de tirer sur le pavillon tricolore. Nos hommes, exténués de froid et de souffrance, furent réchauffés, réconfortés, vêtus, pansés avec des soins fraternels. Un peu plus tard, il est vrai, comme on les conduisait à une ville proche où était l’ambulance, des groupes vociférants sortirent à leur rencontre, et le lieutenant de vaisseau se plaignit à son nouveau camarade turc : « Oh ! répondit celui-ci, — en les écartant avec une cravache, — mais regardez-les : ce sont presque tous des Grecs ! »
Et maintenant, j’ai dit à peu près tout ce que ma conscience m’obligeait de dire, mais je l’ai dit sans espoir. Donc je me retire pour un temps dans l’ombre, en haussant les épaules devant les insultes arméniennes. La lutte, hélas ! est par trop inégale, et la cause est perdue !… Plus tard seulement, quand cela me sera permis, je publierai un livre d’irréfutables témoignages.
↑
Nous avons demandé à l’auteur la permission de joindre à
La Mort de notre chère France en Orient
, les deux petites brochures sur le même sujet :
Les Alliés qu’il nous aurait fallu
et
Les Massacres d’Arménie
. Cette réunion s’imposait d’autant plus que
Les Alliés qu’il nous aurait fallu
, avalent tout d’abord formé un article imprimé et distribué clandestinement à cause de la censure.
↑
On sait qu’à Constantinople notre général Franchet d’Espérey vient de traduire en conseil de guerre le général allemand Liman von Sanders pour avoir été l’homme qui a ordonné les derniers massacres d’Arméniens. On sait aussi, et des Arméniens le disent eux-mêmes, que plusieurs Turcs ont risqué leur situation et leur vie pour essayer d’arrêter ces crimes.
IILES TURCS
Janvier 1919.
Notre chère et plus que jamais admirable France est, je crois, le pays du monde où l’on vit dans la plus tranquille ignorance de ce qui se passe chez le voisin. La Turquie, par exemple, qui fut pourtant notre alliée pendant des siècles, est aussi inconnue de nous que les régions du Centre-Afrique ou de la Lune. Ainsi n’ai-je pas vu à Constantinople, où l’hiver est plus dur qu’à Paris, des touristes de chez nous arriver en décembre avec des vêtements de toile ! N’ai-je pas lu dans de grands journaux parisiens, pendant que mon navire, là-bas, se débattait depuis des semaines au milieu des rafales de neige : « Qu’il est heureux, M. Pierre Loti, d’être au Bosphore, le pays de l’éternel printemps ! » — C’est que, vous comprenez, ce pays-là est en Orient, n’est-ce pas ; alors, pour la plupart des Français moyens, qui dit Orient, dit ciel bleu, soleil, palmiers et chameaux… Et, dans leur amusante ingénuité, ils confondent Turc avec Kurde, Osmanli avec Levantin, etc… ; pour eux, tout ce qui porte un bonnet rouge, c’est toujours des Turcs.
Allez donc essayer d’ouvrir les yeux à certains bourgeois de chez nous qui, de père en fils, se sont hypnotisés — crétinisés, oserai-je dire — sur la prétendue férocité de mes pauvres amis les Turcs ! Au début de la guerre balkanique, ai-je été assez bafoué, injurié, menacé pour avoir pris leur défense, pour avoir osé dire que les Bulgares, au contraire, étaient de cruelles brutes et que leur Ferdinand de Cobourg (pour qui toutes nos femmes s’étaient emballées et dont elles portaient les couleurs) n’était qu’un monstre abject.
De celui-là, par exemple, du Cobourg, je suis vengé aujourd’hui, car il a surabondamment prouvé ce que j’avançais : cinq fois traître en dix ans et tirant dans le dos de ses alliés sans crier gare, je ne vois pas ce que l’on pourrait demander de mieux ! Quant à ses soldats, — descendants des Huns par filiation presque directe, — j’ai eu beau relater de visu leurs atrocités, j’ai eu beau citer les rapports écrasants des commissions internationales envoyées sur les lieux, personne n’a voulu entendre. Non, c’étaient les Turcs, toujours les Turcs sur qui l’on persistait à crier haro, et, comme paroles d’Évangile, on acceptait chez nous de périodiques petits communiqués du paladin Ferdinand, qui répétaient ce refrain : « Les Turcs massacrent, les Turcs continuent d’assassiner et de commettre les pires horreurs, etc., etc. »
Pour différentes raisons, je me tairai sur les agissements de quelques-uns des alliés chrétiens qu’avaient en ce temps-là nos bons Bulgares…
Mon but, aujourd’hui, est seulement d’affirmer une fois de plus cette vérité, notoire du reste pour tous ceux d’entre nous qui ont pris la peine de se documenter, à savoir que les Turcs n’ont jamais été nos ennemis. Les ennemis des Russes, oh ! cela incontestablement oui, ils le sont, et comment donc ne le seraient-ils pas, sous la continuelle et implacable menace de ces derniers, qui ne prenaient même plus la peine de cacher leur intention obstinée de les détruire. Ce n’est pas à nous qu’ils ont déclaré la guerre, mais aux Russes, et qui donc à leur place n’en eût pas fait autant ? Plus tard, l’histoire dira, en outre, comment elle a été commencée, cette guerre-là, par quelques sauvages d’Allemagne, montés sur des petits navires au pavillon des sultans et qui, pour rendre la chose irrévocable, n’ont pas craint de tirer sans préambule sur la côte russe avant même qu’Enver, qui hésitait peut-être encore, en eût été informé. Que nous devaient-ils d’ailleurs, les Turcs ? Depuis l’expédition de Crimée, nous n’avons cessé de marcher avec leurs ennemis, et, en dernier lieu, pendant la guerre balkanique, pour les remercier sans doute de l’affectueuse hospitalité qu’ils nous avaient de tout temps donnée dans leur pays, nous les avons grossièrement insultés, à jet continu, dans presque tous nos journaux, ce qui leur a causé, je le sais, la plus douloureuse stupeur. C’est en désespoir de cause, pour échapper à l’écrasement par la Russie, qu’ils se sont jetés dans les bras de l’Allemagne détestée, — je dis détestée, car je me porte garant qu’à part une infime minorité, au fond, ils l’exècrent. Comment donc leur en vouloir sans merci d’une fatale erreur qui avait tant de circonstances atténuantes et pour laquelle ils sont tout prêts à faire amende honorable ?
Oh ! quel préjudice porté à la France, s’il avait fallu donner aux Russes ce Constantinople, qui était une ville si française de cœur, une ville où nous étions pour ainsi dire chez nous et d’où les Russes, à peine arrivés, nous auraient graduellement expulsés comme d’indésirables intrus ! Et quel manquement à ce principe des nationalités, invoqué cependant aujourd’hui par tous les peuples, quel manquement s’il avait fallu exécuter certain accord signé dans l’ombre, qui, en plus de Stamboul, arrachait encore à la patrie turque le berceau même de sa naissance et toutes ces villes asiatiques, Trébizonde, Kharpont, conquises jadis par les armes, il est vrai, mais qui, avec les siècles, sont devenues des centres de pure turquerie ! Mais ce ténébreux accord Sazonow, tout récemment divulgué par les Bolcheviks, la défection russe l’a fait tomber en déliquescence, et maintenant, au jour des règlements solennels, la question de la nationalité turque va être soumise aux membres de la Conférence de la Paix ; c’est donc en eux que je mets tout mon espoir, pour mes pauvres amis Osmanlis, bien qu’on les ait déjà circonvenus, je le sais, afin de les rendre défavorables à leur cause ; mais j’ai confiance en eux quand même, car ils ne pourront manquer d’être, ici comme en toutes choses, d’impeccables et magnifiques justiciers.
Je disais qu’ils n’étaient pas nos ennemis, ces Turcs si calomniés, et qu’ils ne nous avaient fait la guerre qu’à contre-cœur. Je disais, en outre, et j’ai dit toute ma vie qu’ils composaient l’élément le plus sain, le plus honnête de tout l’Orient, — et le plus tolérant aussi, cent fois plus que l’élément orthodoxe, qui est l’intolérance même, bien que cette dernière assertion soit pour faire bondir les non initiés. Or, sur ces deux points, voici tout à coup, depuis la guerre, mille témoignages qui me donnent raison, même devant les plus entêtés. Des généraux, des officiers de tous grades, de simples soldats qui étaient partis de France pleins de préjugés contre mes pauvres amis de là-bas et me considérant comme un dangereux rêveur, m’ont spontanément écrit, par pur acquit de conscience, pour me dire à l’unanimité : « Oh ! comme vous les connaissez bien, ces gens chevaleresques, si doux aux prisonniers, aux blessés, et les traitant en frères ! Comptez sur nous au retour pour joindre en masse nos témoignages au vôtre. » Je voudrais pouvoir les publier toutes, ces innombrables lettres signées, si sincères et si touchantes, mais elles formeraient un volume !
Pour terminer, voici une anecdote, que je choisis entre mille, parce qu’elle est typique. En 1916, un hydravion français tomba désemparé en Palestine, près d’un poste militaire turc ; les officiers qui commandaient là, après avoir, avec courtoisie, fait nos aviateurs prisonniers, télégraphièrent au pacha gouverneur de Jérusalem pour demander des ordres, et il leur fut textuellement répondu ceci : « Traitez-les comme les meilleurs de vos parents ou de vos amis. » La recommandation était du reste prévue, car ils l’avaient devancée en accueillant comme des frères ces camarades tombés du ciel. Et quelques jours après, quand ils reçurent l’ordre de les diriger sur Jérusalem, les sachant dépourvus d’argent, ils se cotisèrent pour leur prêter de quoi faire confortablement le voyage.