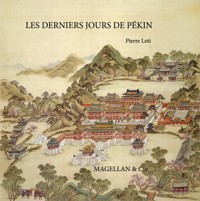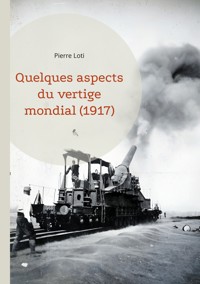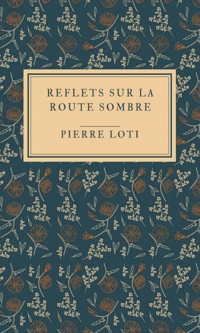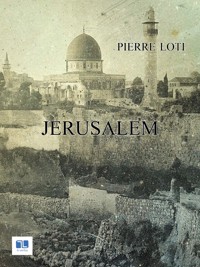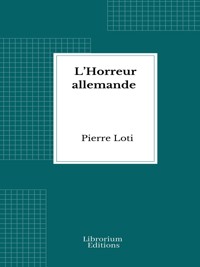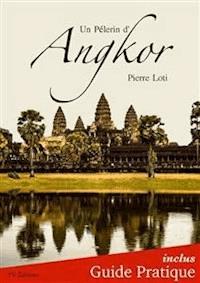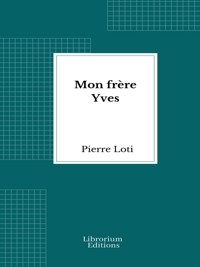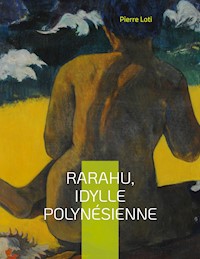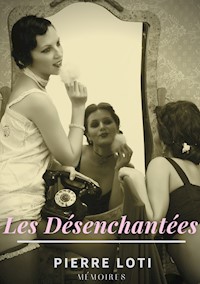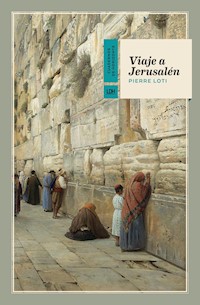0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Classica Libris
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
C’était en Algérie, à Oran, en 1869, époque à laquelle j’étais presque un enfant.
Plumkett avait encore tous ses cheveux. C’était un matin de mars, Oran se réveillait sous un ciel gris. Nous étions assis devant un café qu’on venait d’ouvrir dans le quartier européen. Nous n’avions pas froid, parce que nous arrivions de France ; mais les Arabes qui passaient étaient entortillés dans leurs manteaux et tremblaient.
Il y en avait un surtout qui paraissait transi ; il traînait une espèce de bazar portatif qu’il étalait devant nous et s’obstinait à nous vendre à des prix extravagants des colliers en pâte odorante et des babouches.
Une petite fille pieds nus, en haillons, se cramponnait à son burnous ; une délicieuse petite créature, qui était tout en grands yeux et en longs cils de poupée. Elle avait un peu l’exagération du type indigène, ainsi que cela arrive chez les enfants. Les petits Arabes et les petits Turcs sont tous jolis avec leur calotte rouge et leurs larges prunelles noires de cabris ; ensuite, en grandissant, ils deviennent très beaux ou très laids.
C’était sa fille Suleïma, nous dit-il. En effet, c’était possible après tout : en décomposant bien cette figure de vieux bandit et en la rajeunissant jusqu’à l’enfance, on comprenait qu’il eût pu produire cette petite.
Nous donnions des morceaux de sucre à Suleïma, comme à un petit chien ; d’abord elle se cachait dans le burnous de son père, puis elle montrait sa tête brune, en riant d’un gros rire de bébé, et en demandait d’autres. Elle retournait ce sucre dans ses petites mains rondes, et le croquait comme un jeune singe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Copyright
First published in 1882
Copyright © 2022 Classica Libris
Préface de l’auteur
Ce sera une histoire bien décousue que celle-ci, et mon ami Plumkett était d’avis de l’intituler : Chose sans tête ni queue.
Elle embrassera douze années de notre ère et tiendra, je pense, en une vingtaine de chapitres (dont un prologue, comme dans les pièces classiques). L’intrigue ne sera pas très corsée ; il y aura un intervalle de dix ans pendant lequel il ne se passera rien du tout – et puis, brusquement, cela finira par un tissu de crimes.
Il y aura deux personnages portant le même nom, une femme et une bête ; et leurs affaires seront tellement amalgamées, qu’on ne saura plus trop, à certains moments, s’il s’agit de l’une ou s’il s’agit de l’autre. Mes aventures personnelles viendront s’y mêler aussi – et, pour comble de gâchis, les réflexions de Plumkett.
Prologue
C’était en Algérie, à Oran, en 1869, époque à laquelle j’étais presque un enfant.
Plumkett avait encore tous ses cheveux. C’était un matin de mars, Oran se réveillait sous un ciel gris. Nous étions assis devant un café qu’on venait d’ouvrir dans le quartier européen. Nous n’avions pas froid, parce que nous arrivions de France ; mais les Arabes qui passaient étaient entortillés dans leurs manteaux et tremblaient.
Il y en avait un surtout qui paraissait transi ; il traînait une espèce de bazar portatif qu’il étalait devant nous et s’obstinait à nous vendre à des prix extravagants des colliers en pâte odorante et des babouches.
Une petite fille pieds nus, en haillons, se cramponnait à son burnous ; une délicieuse petite créature, qui était tout en grands yeux et en longs cils de poupée. Elle avait un peu l’exagération du type indigène, ainsi que cela arrive chez les enfants. Les petits Arabes et les petits Turcs sont tous jolis avec leur calotte rouge et leurs larges prunelles noires de cabris ; ensuite, en grandissant, ils deviennent très beaux ou très laids.
C’était sa fille Suleïma, nous dit-il. En effet, c’était possible après tout : en décomposant bien cette figure de vieux bandit et en la rajeunissant jusqu’à l’enfance, on comprenait qu’il eût pu produire cette petite.
Nous donnions des morceaux de sucre à Suleïma, comme à un petit chien ; d’abord elle se cachait dans le burnous de son père, puis elle montrait sa tête brune, en riant d’un gros rire de bébé, et en demandait d’autres. Elle retournait ce sucre dans ses petites mains rondes, et le croquait comme un jeune singe.
Nous disions à ce vieux : « Elle est bien jolie, ta petite fille. Veux-tu nous la vendre aussi ? »
C’était dans toute la candeur de notre âme ; nous nous amusions de l’idée d’emporter cette petite créature d’ambre, et d’en faire un jouet. Mais le vieil Arabe, nullement candide, écarquillait ses yeux, en songeant que sa fille réellement serait belle, et souriait comme un mauvais satyre.
Les gens du café nous contèrent son histoire : il venait d’arriver à Oran, où il était sous la surveillance de la police, ayant fait autrefois le métier de détrousseur dans le désert.
M’étant querellé avec Plumkett, je pris, après déjeuner, la route des champs, et passai par la montagne pour rentrer à Mers-el-Kébir, où nous attendait notre vaisseau.
Je montai assez haut d’abord, au milieu de rochers rougeâtres qui avaient des formes rudes et étranges. Il faisait vraiment froid, et cela me surprenait dans cette Algérie que je voyais pour la première fois. Je m’étonnais aussi de rencontrer çà et là, parmi des plantes inconnues, des tapis d’herbe fine avec des petites marguerites blanches comme en France.
Le temps était aussi sombre qu’en Bretagne. Le vent courbait les broussailles et les herbes ; il s’engouffrait avec un bruit triste, partout dans les ravins et les grandes déchirures de pierre.
J’arrivais maintenant à une crête de montagne.
Un gros nuage passait la tête derrière, et le vent l’émiettait à mesure ; en sifflant, ce vent l’éparpillait sur l’herbe, le faisait courir autour de moi en flocons gris comme de la fumée. Cela me semblait fantastique et sinistre, de voir s’enfuir sur l’herbe ces petits morceaux de nuage qu’on aurait pu attraper avec les mains ; et je m’amusais à courir après en tendant les bras pour les prendre – comme cela arrive dans les rêves...
Je me reposais à l’abri dans un recoin de rochers où donnait un rayon de soleil. Près de moi, tout à coup, un bruit très léger d’herbe froissée. Je regardai : une tortue !
Une tortue, drôle à force d’être petite, un atome de tortue ; son écaille jaune à peine formée, toute couverte de dessins en miniature.
En bas, très loin, sur une route qui fuyait dans la direction du Maroc, on voyait cheminer des silhouettes efflanquées de chameaux que conduisaient des Arabes vêtus de noir. (Le Ramadan, où l’on s’habille de laine sombre, tombait en mars cette année-là.)
Je pris cette petite tortue et la mis dans ma poche. À bord, nous décidâmes de l’appeler Suleïma.
Je restai trois mois dans cette Algérie. Pour la première fois, je vis le printemps splendide d’Afrique.
Souvent je rencontrai Suleïma (la petite fille) trottant pieds nus dans les rues d’Oran, pendue au burnous sordide du marchand de babouches.
Puis, un jour, mon navire reçut l’ordre de partir pour le Brésil, et je m’en allai, n’emportant des deux Suleïma que la tortue.