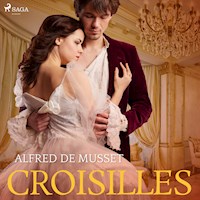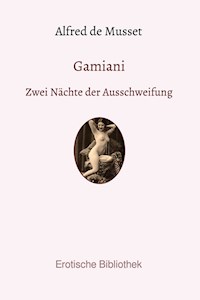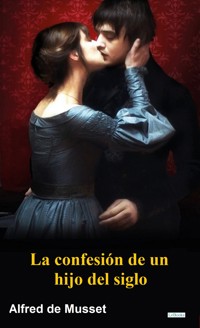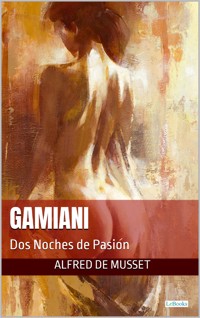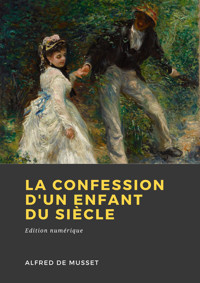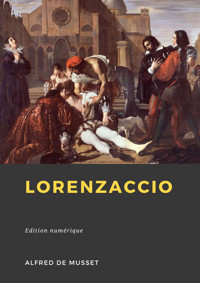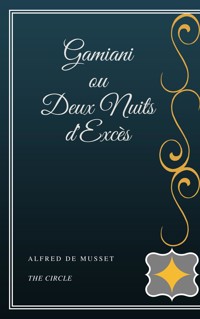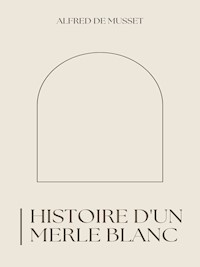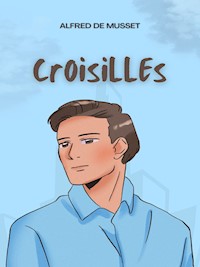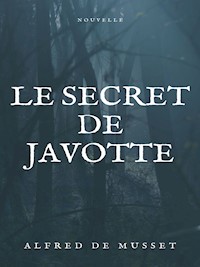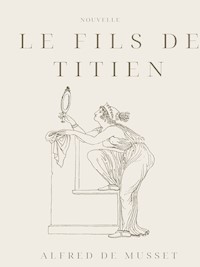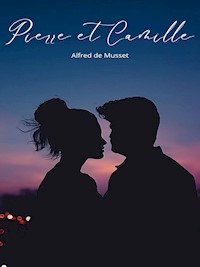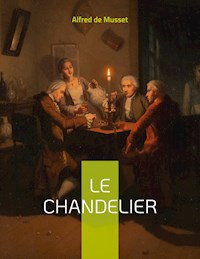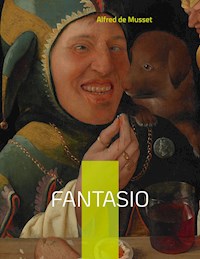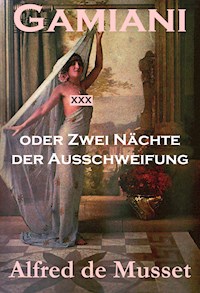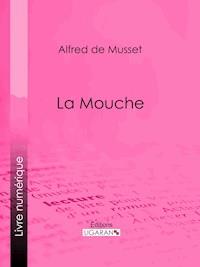
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "En 1756, lorsque Louis XV, fatigué des querelles entre la magistrature et le grand conseil, à propos de l'impôt des deux sous, prit le parti de tenir un lit de justice, les membres du parlement remirent leurs offices. Seize de ces démissions furent acceptées, sur quoi il y eut autant d'exils."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 74
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’esprit est maître en tout ; lui seul, de par sa légèreté, s’élevant assez haut pour voir l’ensemble des choses, peut d’un mot, d’un trait nous en indiquer la forme générale. À l’aide de patientes recherches, de fouilles dans les archives, d’emprunts aux mémoires du temps, il est aujourd’hui permis à tout le monde de parler savamment d’un siècle, d’écrire un gros ouvrage qui sera classé au fond des bibliothèques, mais il n’est donné qu’à l’écrivain, au poète, de reconstituer d’un mot toute une société, toute une époque. Qui n’a admiré avec étonnement les ébauches des maîtres, faites de quelques touches seulement et prenant à la reculée tout l’aspect d’un tableau achevé ? C’est que les points principaux sont indiqués si précisément que l’œil croit voir et termine le détail là où le peintre n’en a légèrement tracé que le contour.
Le XVIIIe siècle a eu particulièrement à souffrir de ces restitutions maladroites, et ses élégances ont, hélas ! été maintes fois écrasées sous la pesanteur d’auteurs documentaires qui l’étouffaient en croyant le faire revivre. Il n’appartenait qu’à un poète de race aristocratique de prendre d’une main assez délicate ce papillon sans lui briser les ailes, et de lui rendre pour quelques instants sa vie et son vol aérien. C’est ce qu’a fait Alfred de Musset quand, après s’être promené dans la grandeur majestueuse et mélancolique de Versailles, il l’a vu renaître pour un jour dans une fête royale. Tout ce passé des splendeurs de Louis XIV et de Louis XV est venu envahir son esprit, et de cette vision faite de salons étincelants, de dorures et de lumières, des bruits soyeux des longues jupes des marquises, de l’élégance de leurs mouvements, des habits chamarrés des courtisans, des rires étouffés, du respect royal, est née cette exquise nouvelle qui s’appelle La Mouche.
Paul de Musset, de qui M. Anatole France a si justement dit qu’il avait l’âme assez haute pour ne pas souffrir de voir sa renommée pâlir auprès de la gloire éclatante de son frère, nous donne en quelques lignes l’histoire bibliographique de ce petit chef-d’œuvre : « Le Moniteur demandait une nouvelle, Alfred écrivit en quelques jours La Mouche, et je ne crois pas que, pour la grâce et la fraîcheur, cette petite composition soit au-dessous de ses autres écrits en prose. On se sent, à la lecture de cette historiette, en rapport avec un esprit toujours vif et jeune. Les derniers chapitres de La Mouche furent achevés en décembre 1853, au moment où les premiers étaient livrés à l’imprimerie ; ce ne fut pas son dernier ouvrage, puisque l’année suivante il fit encore L’Âne et le Ruisseau, mais ce fut sa dernière publication. »
Pour écrite qu’elle fut au courant de la plume, La Mouche n’est pas moins une œuvre pesée, réfléchie et mûrie comme les autres nouvelles du poète. J’imagine qu’il la composa dans ces longues promenades qu’il faisait dans son appartement quand une idée venait hanter son cerveau. Madame Lardin de Musset, pieusement dévouée à la mémoire du grand poète son frère, nous disait qu’il ne se décidait jamais à écrire une œuvre qu’après l’avoir longuement méditée en marchant dans son cabinet ; il se mettait ensuite devant son bureau et semblait improviser.
Alfred de Musset pouvait reconstituer d’instinct toute la vie du XVIIIe siècle, il en était pour ainsi dire imprégné et ne dut pas avoir un grand effort à faire pour transporter son esprit à Versailles et à Trianon, dans le boudoir de la Pompadour. Comme s’il avait vécu de son temps, respiré le même air qu’elle, il savait, sans avoir à feuilleter les mémoires de madame du Hausset, quelle femme était la favorite de Louis XV, et quand il nous la montre sortant de la comédie, causant avec le jeune chevalier de Vauvert, ou se glissant masquée dans le bal de la galerie des Glaces, on sent que, rien qu’en obéissant à sa propre nature, sans se surveiller, il doit la faire parler et agir avec les mots et les gestes de son temps.
D’instinct aussi, et comme par l’effet d’un lointain souvenir, il restitue toute la mise en scène, le décor dans lequel se joue sa fine et élégante comédie ; il décrit bien les appartements de Versailles, modifiés, coupés, cloisonnés, moins grandioses, mais plus coquets que sous le grand roi, et tout ce qu’il dit de ce théâtre des petits appartements, en un mot, sans se perdre en détail ni en regrets sur le magnifique escalier des Ambassadeurs, est aussi scrupuleusement exact que ce qu’ont écrit les faiseurs de mémoires ou l’attentif Piganiol de la Force.
Mais c’est surtout la femme qu’il a voulu peindre, et que ceux qui ont étudié madame de Pompadour retrouvent tout entière dans ces quelques lignes qui la font revivre aussi bien que ses beaux portraits de Boucher ou de La Tour : « Pendant qu’elle décachetait la lettre du roi, ses mains tremblaient sur l’enveloppe. Elle la dévora d’abord, pour ainsi dire, d’un coup d’œil, puis elle la lut avidement avec une attention profonde, le sourcil froncé et serrant les lèvres. Quand elle fut au bout, elle sembla réfléchir. Peu à peu, son visage, qui avait pâli, se colora d’un léger incarnat ; non seulement la grâce lui revint, mais un éclair de vraie beauté passa sur ses traits délicats. » Toute la comédie, tout le drame de la vie de madame de Pompadour se résument dans cette contention d’esprit, dans ce froncement de sourcils qui témoignent de la crainte perpétuelle dans laquelle elle s’était enfermée. Que prévoir de ce roi qui ne savait que sourire, qui ne disait rien et qui ne trouvait rien mieux que de se déguiser en if pour fêter le premier mariage de son fils !
Sans y mettre de complaisance, il me semble voir marcher, respirer cette femme qui disait en parlant de la cour : – « Tout ici n’est que méchanceté, platitude. Belle matière à réflexions, surtout pour quelqu’un aussi réfléchissante que moi ! Partout où il y a des humains vous trouverez de la fausseté et tous les vices dont ils sont capables ! » Quelles tempêtes durent gronder sans pouvoir éclater, sous ce front calme et poli que ses peintres ornèrent de toutes les grâces et de toutes les fleurs ! Jusques dans cet appartement même où l’avaient précédée les Montespan, les Châteauroux, la crainte la poursuivait sous toutes les formes possibles ; à la comédie, elle n’acceptait de limonade que celle préparée par son chirurgien, redoutant, disait-elle, d’être empoisonnée, comme la Châteauroux, par M. de Maurepas ; superstitieuse, elle paie une pension de 600 livres à M. Lebon qui lui avait prédit à l’âge de neuf ans qu’elle serait un jour la maîtresse de Louis XV ; la preuve de ce fait est consignée dans le relevé des dépenses de madame de Pompadour, manuscrit conservé aux archives du département de Seine-et-Oise. La sorcellerie l’a toujours attirée, et elle ne cesse de se répéter que la mort ne la prendra pas à l’improviste, parce qu’une sorcière lui a dit qu’elle aurait le temps de se reconnaître avant de mourir ! Une légion de préoccupations envahit ce cerveau où, à côté de l’impérieux désir de plaire au maître, il faut trouver place pour des combinaisons de budget. En effet, trente-six millions neuf cent vingt-quatre mille cent quarante livres, dépensées en dix-neuf années, pouvaient créer de grands soucis à celle qui, en mourant devait laisser trente-sept louis d’actif et un million sept cent une livres de passif !
Il était loin le temps d’insouciance de la petite d’Étioles portant aujourd’hui ce nom pimpant et élégamment empanaché de marquise de Pompadour, ce nom qui semble représenter toute la grâce décorative, légère et pompeuse, du règne de Louis XV. La voilà maintenant, comme dit un de ses biographes, surmenée, pressée, affairée, ardente à combler de biens parents et créatures, mais toujours conseillère attentive et sensée « bonne femme autour d’elle ». Elle n’a pas oublié que Jéliotte lui a appris le chant, Guibaudet la danse et Crébillon la déclamation ; elle a même conservé pour ce dernier un souvenir reconnaissant qui la pousse à faire imprimer ses œuvres à l’imprimerie royale aux dépens du roi ; tout en assurant la vie des siens, de son frère, de son père (je ne parle pas de M. de Tourneheim), elle protège Voltaire, quitte à se brouiller avec lui pour une lettre anonyme. Celui-ci d’ailleurs ne lui garde pas rancune et, en apprenant sa mort, il s’écrie que les vrais philosophes, les vrais gens de lettres doivent regretter madame de Pompadour.