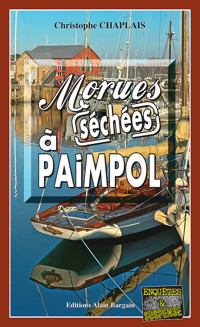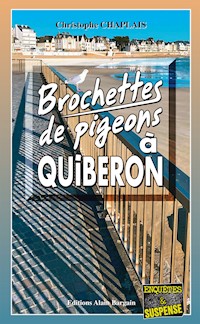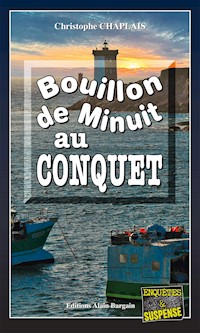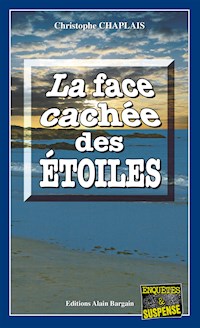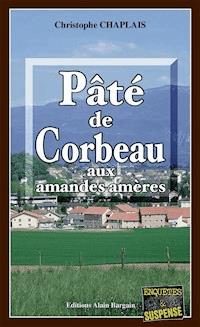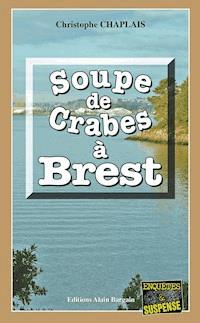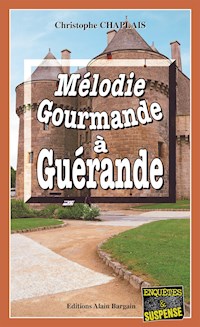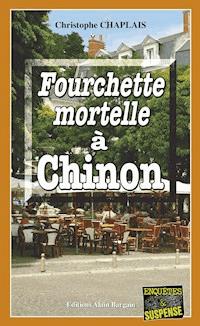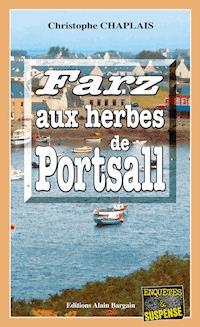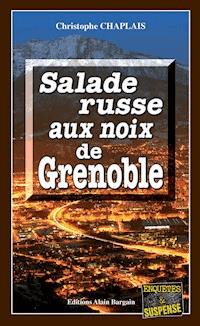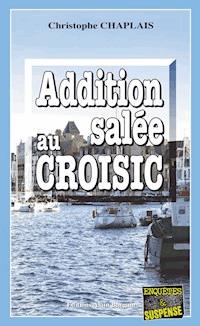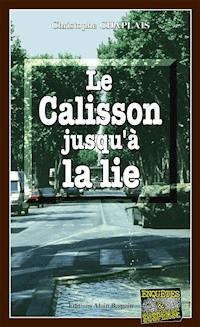
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Les enquêtes gourmandes d’Arsène Barbaluc
- Sprache: Französisch
Un mystérieux suicide perturbe le déroulement d'une joyeuse soirée de noces...
Arsène Barbaluc, inspecteur gastronomique au guide
Le gastronome français, est heureux. Son meilleur ami et collègue de travail, Geoffrey, l'a choisi comme témoin à son mariage. Hélas, le soir de la noce, le frère du marié se suicide. Quelques jours plus tard son cadavre disparaît. Il réapparaît à 600 kilomètres de là, dans une cuve servant à la fabrication du nougat. À Aix-en-Provence, Arsène Barbaluc mène l'enquête.
Dans le second tome de ses enquêtes gourmandes, l'inspecteur Arsène Barbaluc devra se plonger dans les méandres de la cuisine provençale afin de résoudre une énigme épicée !
EXTRAIT
L’arrière-saison s’annonçait prometteuse. En ces premiers jours de septembre, le port de Cassis était baigné de soleil. Le club des « Amazon », qui regroupe les propriétaires et amateurs de Volvo 121, 122 et 123, avait choisi la Provence pour sa sortie annuelle. Ces amoureux
de la solide berline, produite entre 1957 et 1970, discutaient par petits groupes de leur passion. Ils pouvaient passer des heures sur les avantages et les inconvénients du moteur B18 par rapport au B 20, ou de la transmission avec ou sans overdrive. Ils étaient capables de se rappeler, à longueur de soirées, des exploits sportifs de leur belle suédoise dans les rallyes européens du début des années soixante, de la victoire finale de Tom Trana.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Un vrai plaisir de retrouver Arsène Barbaluc pour une nouvelle enquête ! -
mijue, Babelio
À PROPOS DE L'AUTEUR
Christophe Chaplais aime être là où on ne l'attend pas. Il suit des études de journalisme et est Dir'com dans une collectivité locale. Il passe son enfance
au cœur des Alpes et se passionne pour les fonds sous-marins. On l'imagine leveur de fonte, on le découvre manieur de plume. Il joue les bourrus, c'est un sensible. Il est comme ça Christophe : 50 % breton, 50 % dauphinois, 100 % bon vivant ! Il aime tellement la bouffe qu'il devrait vivre à Lyon, en Bourgogne ou en Dordogne, et il vit à Grenoble. Décidément, il est toujours là où on ne l'attend pas. Alimentaire, mon cher Watson ! Après le succès de « Pâté de Corbeau aux amandes amères », il signe ici son second roman policier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nous remercions tout particulièrement les Éditions Valoire-Estel à Blois, pour leur participation (photo de couverture) et vous recommandons leurs magnifiques cartes postales.
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près, ni de loin, avec la réalité, et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
À Valérie.
I
DARNE DE SAUMONÀ LA CRÈME DE CASSIS
— Moi, j’en connais une qui a parcouru plus de 600 000 bornes sans ouvrir le moteur !
— Combien avez-vous, mon cher Barbaluc, au compteur de votre “Amazon” ?
— C’est une petite jeune de 1968 qui vient à peine de dépasser les 191 000 kilomètres. Quand mon grand-père m’en a fait cadeau, elle atteignait péniblement les 75 000.
— À peine rodée !
L’arrière-saison s’annonçait prometteuse. En ces premiers jours de septembre, le port de Cassis était baigné de soleil. Le club des “Amazon”, qui regroupe les propriétaires et amateurs de Volvo 121, 122 et 123, avait choisi la Provence pour sa sortie annuelle. Ces amoureux de la solide berline, produite entre 1957 et 1970, discutaient par petits groupes de leur passion. Ils pouvaient passer des heures sur les avantages et les inconvénients du moteur B18 par rapport au B 20, ou de la transmission avec ou sans overdrive. Ils étaient capables de se rappeler, à longueur de soirées, des exploits sportifs de leur belle suédoise dans les rallyes européens du début des années soixante, de la victoire finale de Tom Trana lors de l’édition 1963 du championnat européen, catégorie tourisme.
— Même de nos jours, elle fait encore des malheurs dans le championnat de France des rallyes réservé aux véhicules d’époque.
— C’est vrai, il y a d’ailleurs un provençal qui, certaines années, a trusté les victoires avec une 123 GT.
Certains sortaient avec fierté de leurs archives les coupures de presse, relatant la présentation de cette Volvo au public dans la bonne ville d’Örebro au centre de la Suède.
Le trésorier du club, ancien directeur d’une usine de pâte à papier aujourd’hui en retraite, ne manquait pas une occasion de raconter sa visite, en 1965, de l’usine canadienne de la marque, à Halifax.
— P’pa ! Je crois que tu devrais venir. Judith n’a pas l’air contente.
Arsène Barbaluc se retourna et chercha des yeux sa compagne.
— Où est-elle ?
— Là-bas, indiqua-t-il du doigt.
Il donna une bourrade amicale à l’adolescent et, d’un pas rapide, longea le quai en direction de la jetée. Les terrasses des bistrots semblaient attendre le rush de cette mi-journée dominicale. Dans une petite paire d’heures, les Marseillais, amoureux de cette localité, allaient débarquer en nombre. Après déjeuner, la promenade digestive les porterait à la calanque de Port-Miou. Les plus courageux pousseraient jusqu’à celles de Port-Pin, ou d’En-Vau.
— Judith, ça ne va pas ?
— Non, pas vraiment…
Il enroula son bras autour de son épaule. Elle se dégagea vivement.
— Mais enfin, qu’est-ce qui se passe ?
— Il se passe qu’un week-end complet avec ton club de “fêlés”, c’est un peu long ! Ils ne savent que parler de leurs foutues bagnoles. D’accord, j’ai toujours trouvé que ta relique avait une bonne bouille mais, de là, à disserter pendant des heures sur la qualité des tissus des sièges utilisés à partir de 1961… ça me saoule !
Elle avait pris son air buté. Les pupilles de ses yeux avaient dévoré le bleu gris de ses iris.
— C’est la première et la dernière fois que je t’accompagne à l’une de tes sorties d’obsédés du vilebrequin suédois.
Arsène éclata de rire.
— Toi, tu sais à quoi sert un vilebrequin ?
— Un vieux bonhomme sentant la naphtaline m’a donné un cours accéléré de mécanique pendant tout le dîner d’hier soir. J’aime bien ta vieille Volvo. Je sais qu’elle a pour toi un parfum de nostalgie. Je peux même lui reconnaître un certain charme… désuet. Mais, de là, à…
Elle ne poursuivit pas sa phrase et poussa un long soupir.
— On aurait mieux fait de passer ces deux jours en amoureux. Je te rappelle que, dans quelques semaines, je pars pour deux mois aux États-Unis.
— Je n’ai pas oublié.
— Le week-end prochain, on est chez ma sœur ; celui d’après, tu es en inspection – sans compter le mariage de Geoffrey, juste avant mon départ. Les moments de tranquillité vont se réduire comme peau de chagrin.
Judith le laissa la prendre dans ses bras.
— Tous les deux, ici, on aurait été bien. Tu aurais même pu faire un peu de chasse sous-marine…
— Ici, il n’y a plus grand-chose à “raguer”.
Comme pour le faire mentir, un des pêcheurs à la ligne, installé sur les gros blocs qui protègent la jetée, ramena un superbe sar tambour.
— Tu vois qu’il y a du poisson !
— Un coup de chance, railla-t-il
— Si c’est un coup de chance, comme tu le dis, le type est verni. C’est le deuxième en un quart d’heure.
Sur les hauts de Cassis, devant les voitures des membres parfaitement alignées, Yann Le Pogam, l’énergique président du club des “Amazon” sonnait le rappel.
— Un peu d’attention, s’il vous plaît ! Dans quelques minutes, nous allons prendre le départ pour la dernière étape de notre périple. En tant qu’inspecteur du célèbre guide Le gastronome français, Arsène Barbaluc que vous connaissez tous, nous a concocté la visite d’un domaine viticole près d’Aix-en-Provence. Comme le dit le slogan : « Boire ou conduire, il faut choisir. » Je n’en dirai pas plus.
L’orateur rajusta ses lunettes.
— Nous allons donc nous rallier au panache vert anglais de la 123 GT de monsieur Barbaluc qui prendra la tête du cortège. Pour ceux qui s’égareraient, vous trouverez dans vos “road-books”, à la page treize, l’itinéraire vous permettant de rejoindre le domaine des “Grands Chemins”. Dernière précision ! Nous sommes attendus pour 11 heures. Par respect pour nos hôtes, je vous demanderais d’essayer d’être à l’heure.
Quelques-uns sourirent. Le souci de ponctualité de Yann Le Pogam était légendaire dans l’association. Membre fondateur, il animait, depuis son Finistère natal, le club d’une main de fer dans un gant de velours. Il ne changerait jamais.
Arsène aimait son métier d’inspecteur gastronomique. Il le vivait pleinement. Se rendre dans un restaurant, prendre du plaisir à découvrir la carte, déguster le vin qui se marie idéalement avec les spécialités du chef, il y a pire pour gagner honnêtement sa vie. Il appréciait beaucoup moins les longues heures passées à remplir les fiches et à rédiger les commentaires qui seraient insérés dans la future édition du guide. Son travail consistait également à écrire des articles sur des restaurants ou sur des vins qu’il recommandait aux lecteurs du mensuel édité par la même maison, en complément indispensable du guide.
Arsène avait sévi à plusieurs occasions dans ce coin de Provence, alors, quand on lui avait demandé d’organiser la visite d’un domaine viticole en Provence pour la sortie du club, il avait immédiatement pensé aux “Grands Chemins”.
Les vins élevés dans cette propriété méritaient le détour. Ces coteaux d’Aix, dont Grenache et Cinsaut formaient encore la base de l’encépagement, même si Syrah et Cabernet-Sauvignon progressaient, ils avaient longtemps été décriés. Depuis une décennie, les viticulteurs avaient fait le choix de la qualité plutôt que de la quantité. Ils commençaient à toucher les dividendes de cette politique. Le rouge de ce domaine, long en bouche, possédait une palette aromatique complexe qui associait le café grillé et le cassis à la réglisse apportée par le grenache. Malgré un caractère moins marqué, le rosé n’était pas sans intérêt.
Les “Amazon” traversèrent Aubagne, Roquevaire puis Aix. Ils quittèrent la Nationale 7 pour traverser la chaîne de la Trévaresse afin de rejoindre Rognes. Dans le petit village, le passage de la trentaine de suédoises fit retourner quelques têtes. On entendit les inévitables : « J’ai eu la même, il y a quelques années… », « Ça c’était de la bagnole ! », « Ça monte à combien ? » Un petit garçon demanda à son grand-père :
— C’est quoi comme voiture, papé ?
— Oh ! Tu sais, moi les “trapanelles”, je n’y connais pas grand-chose.
Arsène ne participait pas à toutes les sorties du club et il avait imaginé que, pour une fois, emmener sa compagne était une bonne idée. Il aurait dû choisir une sortie plus sportive qu’un rallye “saucisson”, où l’on mange plus qu’on ne roule. Judith aurait certainement davantage apprécié. Erreur de stratégie. On ne l’y reprendrait plus !
Heureusement, Judith avait retrouvé son sourire. Sur la banquette, Axel, lui, n’en perdait pas une miette. Le petit garçon était devenu un grand adolescent à la voix mal assurée. Il ne le voyait pas souvent, le gamin vivait avec sa mère, et ce week-end les avait rapprochés encore un peu plus. À la grande satisfaction de son père, Axel s’était pris de passion pour les voitures anciennes. Rien ne pouvait faire plus plaisir à Arsène.
Le passage devant la chapelle Saint-Denis, érigée durant l’épidémie de peste en 1720 qui avait épargné le village de Rognes, permit à Judith d’essayer, sans succès, de convaincre une nouvelle fois Axel de l’intérêt des cours d’histoire au lycée.
II
COTEAUX D’AIX PRIMEUR
La route s’éleva doucement au-dessus du village en direction du Puy-Sainte-Réparade. Arsène s’apprêtait à tourner sur la droite pour s’engager dans l’allée bordée de platanes plus que centenaires qui marquaient l’entrée du domaine viticole, lorsqu’il s’aperçut que le chemin était bloqué par deux véhicules de la gendarmerie. Il s’arrêta le long de la route, imité par l’ensemble de la colonne de Volvo “Amazon”. Arsène Barbaluc attendit que le président s’extraie de son break 121 pour s’avancer au-devant de la maréchaussée.
Un jeune gradé les accueillit par le salut réglementaire.
— Excusez-moi, mais nous avions rendez-vous à 11 heures pour une visite-dégustation du domaine des “Grands Chemins”.
— Désolé, mais cela ne va pas être possible, Messieurs.
Les membres du club sortaient de leurs véhicules, cherchant à comprendre ce qui arrêtait la colonne.
— Que s’est-il donc passé ? se renseigna le président Le Pogam.
— Le propriétaire a été agressé… Je vais vous demander de circuler car vos véhicules représentent un danger…
Il fut interrompu dans sa récitation du manuel réglementaire, par un cabriolet Mercedes SLK qui remonta la file de Volvo, klaxon bloqué, et dérapa sur les gravillons de l’allée, manquant de peu de renverser Arsène Barbaluc. Deux gendarmes se précipitèrent la main sur l’holster de leur revolver.
— Est-il arrivé malheur à monsieur Bucailles ?
Blanc comme un linge, les yeux exorbités, l’homme qui devait avoir la cinquantaine, semblait affolé. Sa voix était chevrotante et ses mains, tremblantes. Sans prendre la peine de répondre, les gendarmes lui intimèrent l’ordre de descendre de son véhicule. Tel un automate, le chauffard descendit du cabriolet et se laissa conduire vers l’estafette bleu marine.
— Comme je vous le disais…
Le Pogam et Barbaluc, encore tout à leur émotion, sursautèrent.
— …Il est nécessaire que vous dégagiez cette portion de route départementale.
Sur le parking d’un routier, du côté de Pertuis, le président chagriné expliqua la situation. À regret, il fut décidé de mettre fin prématurément à cette sortie, les organisateurs n’ayant pas prévu de solution de repli. La seule ravie était Judith.
Arsène proposa, pour se remettre de toutes ces émotions, de faire un crochet par Aix-en-Provence. Il connaissait une pâtisserie “Au Calisson doré” qui avait une spécialité fameuse de dessert à l’abricot : “l’abricotin”. Il expliqua qu’il s’agissait d’une sorte de chausson fourré à la purée d’abricot caramélisée à la cannelle. Un délice ! La description d’Arsène convainquit aisément Judith et Axel.
— En plus de “l’abricotin”, c’est un très bon calissonnier !
— P’pa, c’est quoi un calissonnier ?
— Un fabricant de calissons. Le calisson, c’est la spécialité gourmande d’Aix-en-Provence. C’est à base de pâte d’amandes.
— Ah !
— En fait, la confection se fait en deux temps. On monde les amandes avant de les broyer. On les mélange ensuite avec des melons confits et l’on rajoute du sirop de fruits. On glisse cette préparation entre deux feuilles de pain azyme avant de donner à la pâtisserie sa forme ovale. Enfin, on la nappe de sucre glace. Mais l’important c’est les proportions…
Judith soupira. Pourquoi faut-il qu’Arsène prenne un ton aussi docte, dès qu’il explique une recette ? Après tout, c’est aussi ce qui fait son charme…
Pour les choses importantes, Arsène avait une mémoire d’éléphant, et une bonne pâtisserie était une chose très importante. Il retrouva assez facilement sa route dans Aix et rejoignit sans encombre la Rotonde. Cette grande fontaine, ornée de trois allégories de la justice, de l’agriculture et des beaux-arts, lui avait toujours beaucoup plu. Plantée au milieu de la place, elle semblait monter la garde à l’entrée de la vieille ville.
Il prit à droite et s’engagea dans l’avenue Victor-Hugo. Il eut la chance de trouver tout de suite à se garer.
— C’est à deux pas, précisa-t-il.
Ils descendirent l’avenue sans trouver trace de la pâtisserie.
— Je ne comprends pas. Je suis certain que c’était ici.
— Peut-être t‘es-tu trompé de rue ?
— Je ne suis pas fou ! “Au Calisson doré” était là. Planté devant une boutique à la devanture bariolée s’annonçant comme le spécialiste du téléphone mobile sur la ville, il fixait le bâtiment, ravalé récemment, comme si la pâtisserie allait réapparaître.
— J’y suis passé, il n’y a pas deux ans !
Un mendiant, affalé contre une porte cochère voisine, s’avança, son litron à la main. Le visage mangé par une longue barbe grise, il portait des vêtements trop chauds pour la saison.
— Vous cherchez “queq’chose”, M’sieur ?
— Je cherche la pâtisserie qui se trouvait ici, il y a encore quelques mois.
— Y’a plus !
— Comment ça “y’a plus” ? Elle a fermé ?
— Ouais.
— Ils ont changé d’adresse ?
— Non, elle n’existe plus.
— Vous êtes sûr ?
— Pour être sûr, j’suis sûr ! Ça fait des années que je fais la manche ici. Moi aussi, j’la regrette la pâtisserie. Les beaux messieurs et les belles dames qui venaient, ils donnaient toujours une petite pièce.
Il insista sur les derniers mots.
— Ce n’est pas possible ! Elle était la seule à proposer de “l’abricotin” !
— M’sieur, si vous aviez une petite pièce ?
Arsène fouilla ses poches et déposa dans la main crasseuse de l’homme deux pièces de dix francs. Le vieil homme remercia en portant un doigt à son chapeau mou et retourna s’asseoir près de ses affaires rassemblées dans des sacs en plastique.
— C’est quand même pas la fin du monde !
— Non ! Mais c’est dommage ! Je t’assure qu’après avoir goûté à “l’abricotin”, tu n’aurais plus regardé un abricot avec le même œil.
Arsène proposa d’aller déjeuner chez un de ses amis qui tenait un restaurant de spécialités provençales dans la rue Espariat, toute proche de la place d’Albertas. Judith fit la moue et préféra prendre tout de suite la route pour Paris. Après les maniaques de la Volvo, la visite de cave annulée et la pâtisserie fantôme, elle avait son compte !
Le long ruban de bitume défila pendant de longues heures. Comme souvent, ils abandonnèrent le soleil du Sud pour la grisaille du Nord du côté de Lyon. Comme d’habitude, ils se retrouvèrent pris dans les bouchons parisiens. Comme à chaque fois, ils évoquèrent la possibilité de partir s’installer en province.
III
PIÈCE MONTÉE
Le mois de septembre s’écoula tout doucement. Les attentats contre les tours du World Trade Center de New York et le Pentagone avaient été au centre de toutes les conversations. Judith préparait son déplacement professionnel aux États-Unis. Arsène espérait, secrètement, que les événements tragiques de ces dernières semaines annuleraient ce voyage. Il avait passé une dizaine de jours en Alsace pour assurer l’inspection de quelques restaurants de Strasbourg et des environs.
Ce samedi 29 septembre, l’appartement d’Arsène sur l’île Saint-Louis était en effervescence. Ils étaient attendus à Mornemont, petit village situé entre Chartres et Châteaudun, où était célébré le mariage de Geoffrey Trubert. Geoffrey était le rédacteur en chef du mensuel Le gastronome. Ami de longue date d’Arsène, il l’avait tout naturellement choisi pour témoin.
La matinée avait mal commencé. Judith s’était moquée des habitudes de vieux garçon d’Arsène. Celui-ci, tel un métronome, ne dérogeait pas aux règles de ce qu’il appelait son “rite matinal”. Ouvrir les volets, passer sous la douche d’abord tiède, mais jamais chaude, puis carrément froide, se raser avec un rasoir mécanique après avoir étalé la crème avec un blaireau, se laver les dents, s’habiller dans un ordre précis. Enfin, dernière étape, le petit déjeuner, un unique bol de café noir.
C’est lors de cette dernière étape que les choses s’étaient gâtées. Judith avait eu le malheur de se lancer dans une tirade sur les voisins du dessus qui avaient fait un potin de tous les diables jusqu’à deux heures du matin, comme tous les vendredis soirs. Encore cotonneux, il n’avait pas fini d’avaler “son grand noir”, Arsène répondit en grognant que cela n’était pas si grave, ce qui avait provoqué la colère de Judith.
Arsène était heureux d’assister au mariage de Geoffrey Trubert et fier que celui-ci l’ait choisi comme témoin. C’est avec lui qu’il avait fait ses plus belles virées. Ils se connaissaient depuis plus de quinze ans. Quand Arsène s’était séparé de la mère d’Axel, c’est avec Geoffrey et quelques autres qu’il avait brûlé sa trentaine. Il ne comptait plus les retours au petit matin blême après une nuit de fête. Arsène ne s’était calmé qu’après avoir rencontré Judith. Judith, elle, appréciait Geoffrey pour son intelligence et sa gentillesse, mais n’aimait pas beaucoup le dragueur impénitent qu’il était. Enfin, depuis qu’il était tombé sous le charme d’Hélène, il semblait s’être acheté une nouvelle conduite.
Ils arrivèrent juste à l’heure à la mairie du petit village. Le soleil était radieux. Mornemont était construit sur une butte. Les maisons se serraient autour de l’église du village. Une petite rivière serpentait doucement à l’ombre de saules pleureurs et d’aulnes qui trempaient leurs racines dans l’eau claire.
Le marié, en costume bleu marine, et sa promise, dans une robe toute simple, les accueillirent sur le perron de la mairie. Arsène et une grande brune aux yeux noisette tinrent leur rôle de témoins à merveille. Judith arriva à lui glisser à l’oreille qu’elle gardait un œil sur lui et qu’il avait bien de la chance d’officier avec une si “belle créature”. Arsène haussa les épaules.
— Ne te fâche pas, Arsène. Je plaisante.
— Hum… À moitié.
Ils échangèrent un regard complice.
Le maire s’avéra être un piètre orateur. Il se lança dans une diatribe sur les difficultés de la vie de couple à notre époque qui n’avait ni queue ni tête. Arsène eut du mal à ne pas éclater de rire, quand l’homme déclina l’état civil du marié. Le premier magistrat de Morne-mont confondit Aix-en-Provence et Aix-les-Bains. Il vieillit ensuite de dix ans la pauvre Hélène qui le corrigea de sa petite voix. La cérémonie religieuse, quant à elle, fut parfaite. Le vieux curé de la paroisse sut jouer à bon escient de l’humour et de la solennité nécessaires. Il y eut un moment d’émotion forte quand il évoqua la joie qu’aurait été celle des parents de Geoffrey de voir leur plus jeune fils se marier enfin.
Tous les invités se retrouvèrent dans la salle des fêtes communale à l’heure de l’apéritif. Arsène et Judith discutèrent un bon moment avec André Gibon et sa femme. Le directeur du guide Le gastronome français était tout heureux d’être là. Très pince-sans-rire, il raconta quelques anecdotes succulentes sur une vie passée au service de son guide. Charles, le frère de Geoffrey était égal à lui-même. Ce psychiatre de renom donnait toujours l’impression d’être perdu dans ses rêves. Le témoin d’Hélène et son mari s’avérèrent fort sympathiques. La soirée s’annonçait parfaite.
— Mon cher Geoffrey, ce repas est une merveille. Ce gigot de chevreuil, accompagné de morilles et de trompettes-chanterelles, est tout simplement délicieux !
— Ton lalande-de-pomerol est parfait, renchérit Arsène.
Le couteau en l’air, le rouge aux joues, André Gibon reprit :
— Le tokay d’Alsace 83 que vous avez servi avec le foie gras en brioche, m’a tout simplement emballé. Doré à point, capiteux à souhait. Il flatte l’œil et attaque le palais tout en douceur.
— Je n’en avais jamais goûté, avoua Judith.
— Nous devrions élever une statue au Général de Schwendi qui ramena le tokay de Hongrie, conclut le directeur du guide gastronomique.
— En tout cas, je suis heureux que ce repas vous plaise. Quand, avec Hélène, nous avons concocté le menu et retenu un foie gras en brioche, cela m’a rappelé une inspection que nous avions faite avec Arsène, il y a une dizaine d’années…
Arsène sentit que la discussion dérapait et que tout cela allait prendre une tournure quelque peu délicate. En face de lui, Judith le foudroya du regard. Elle savait très bien qu’à cette époque de sa vie, Arsène avait un cœur d’artichaut et qu’il passait de bras en bras. Mais Geoffrey négocia très bien la difficulté.
On parla gastronomie, cuisine, grands crus, vignoble… L’oncle Lulu chanta Le temps des cerises. Un ami de la famille fut conduit à l’extérieur, histoire de cuver un “vin mauvais”. Deux petites-nièces d’Hélène lurent un poème. Un copain de lycée de Geoffrey déclama un texte de son cru sur la fin du célibat.
— C’est vrai qu’on n’imaginait pas te voir un jour “la corde au cou”…
— Eh oui, mon cher Arsène. Tout arrive. La quarantaine, c’est l’âge de la sagesse. J’espère que bientôt ce sera ton tour. N’est-ce pas Judith ?
— Plus tôt que tu ne peux le croire.
Arsène, surpris, regarda Judith qui lui adressa son plus beau sourire. Il sentit une joie intense l’envahir. Jusqu’à maintenant, sans être catégorique, elle avait toujours repoussé cette éventualité. Il faut dire qu’Arsène n’avait pas été très adroit au début de leur relation. Malgré les demandes répétées de Judith, il avait toujours refusé de faire appartement commun sous prétexte qu’il était attaché à sa liberté et que cela demeurait le meilleur moyen de sauvegarder le couple… Tout un tas d’âneries qu’il regrettait d’avoir édictées en règle. Depuis, la situation s’était renversée. C’était lui, maintenant, qui n’arrêtait pas de lui proposer la vie commune. Ce soir, pour la première fois, elle avait entrouvert la porte.
Un peu plus tard dans la soirée, un extra vint chercher Charles, le frère du marié. Il réapparut quelques minutes plus tard. Il semblait groggy. Il héla Geoffrey. Les deux frères s’entretinrent à voix basse avant que le psychiatre ne quitte à nouveau la salle.
— Tu as un souci ? s’enquit Arsène.
— Ne t’inquiète pas… Mon frère a appris qu’un collègue à lui vient d’être assassiné.
— Oh ?
— Il s’agissait de l’un de ses meilleurs amis, alors forcément, ça l’a secoué.
Dans une salle contiguë, l’animateur lança ses platines. La mariée et son père ouvrirent le bal sur une valse de Strauss. On enchaîna les paso doble, les tangos, les javas pour la plus grande joie des seniors. Ils cédèrent la place à la génération des “quadras” et des “quinquas” qui se déchaînèrent sous les yeux moqueurs de la jeune génération. Il ne fallut qu’une demi-heure à l’animateur pour sentir son public et trouver les morceaux susceptibles de faire danser le plus grand nombre. Judith et Arsène se donnaient à fond sur Alexandrie, Alexandra de Claude François, après avoir enchaîné une salsa sur Buenaventura et un zouk, sur un vieux tube de Kassav’. Pour faire plaisir au marié, on venait de lancer Paint it Black des Rolling Stones, quand une adolescente d’une quinzaine d’années se précipita dans la salle.
IV
GIGOT À LA FICELLE
— Ce n’est pas possible. Il n’a pas pu faire ça !
De grosses larmes coulaient sur les joues de Geoffrey.
— Je ne comprends pas. Pas lui !
Quelques minutes plus tôt, une jeune cousine de Geoffrey avait trouvé Charles, le frère du marié, pendu avec du fil électrique dans la remise de la salle des fêtes. Geoffrey, trop choqué pour s’occuper de quoi que ce soit, avait laissé la famille de la jeune mariée prendre les choses en main. Arsène et son ami étaient sortis à la demande de ce dernier. Appuyé contre le tronc d’un tilleul, il avait du mal à retrouver ses esprits.
— Je ne comprends pas ce qui a pu le pousser à cette extrémité.
— Il avait peut-être des soucis que tu ne connaissais pas ?
— Je ne le pense pas. Malgré la différence d’âge, nous étions très proches. La mort de nos parents nous avait encore rapprochés. S’il avait eu de gros problèmes, il se serait confié à moi. Non, vraiment, je ne vois pas.
— C’est peut-être l’annonce du décès de son ami qui l’a poussé dans un moment de déprime…
— Non ! On ne met pas fin à ses jours parce qu’on a perdu un ami. Et puis, il n’aurait jamais fait ça le jour de mon mariage. Tu sais, il a toujours été là quand j’ai eu besoin de lui. Oh, ce n’était pas un boute-en-train, mais il était attentif, gentil, attentionné.
Un sanglot étouffa ses paroles. Geoffrey passa ses mains sur son visage. Arsène le prit dans ses bras et le serra aussi fort qu’il le put. Hélène, les yeux rougis par le chagrin vint chercher son mari : les gendarmes étaient là et demandaient à le voir.
Trois jours plus tard, les invités du mariage se retrouvèrent pour l’enterrement de Charles Trubert. La petite église, si gaie le samedi précédent, paraissait grise, triste, froide. On conduisit le corps du psychiatre au cimetière. Il prit la place qui lui revenait dans le caveau familial aux côtés de son père et de sa mère.
L’enquête et les premières constatations faites par les gendarmes confirmèrent la thèse du suicide. Charles Trubert s’était pendu entre 23 heures 15 et 23 heures 45. C’est-à-dire entre le moment où il était sorti de la salle des fêtes pour prendre l’air, après avoir appris l’assassinat d’un de ses amis, et la découverte de son corps par la jeune fille. Deux invités indiquèrent être sortis prendre l’air aux environs de la demie de 11 heures et avoir aperçu le frère du marié marcher de long en large sur le parking. À la même heure, un des aides du chef cuisinier qui s’accordait une pause-cigarette avant la préparation de la pièce montée, déclara l’avoir vu se diriger vers la remise sans se douter de la tragédie qui allait se dérouler. À part eux, personne n’avait vu Charles Trubert pendant la demi-heure fatidique. Sabrina, la jeune fille qui avait découvert le corps suspendu à la poutre, avoua qu’elle avait fixé rendez-vous à Antoine, un garçon de son âge qui faisait aussi partie des invités du mariage. Elle était arrivée quelques minutes avant l’heure fixée. Elle avait trouvé la porte entrouverte et pensait qu’Antoine était déjà là. Le gendarme lui demanda comment elle savait qu’ils pourraient s’introduire aussi facilement dans la remise. C’est Antoine qui répondit à la question. Quand, au fil de la soirée, les jeunes amoureux avaient imaginé se trouver un endroit tranquille, il avait fureté à droite et à gauche. Il avait ainsi découvert la remise et la clé dans la serrure de la porte d’accès. Il avait laissé la porte entrebâillée et subtilisé la clé, dans le secret espoir d’y revenir quelques temps plus tard en compagnie de Sabrina. D’après lui, il était environ vingt-deux heures quand il effectua cet emprunt.
Sur les lieux du drame, les enquêteurs ne trouvèrent rien de probant. Le suicidé s’était servi d’un fil électrique de fort diamètre dont la bobine était rangée sous l’établi. Il avait ensuite grimpé sur un escabeau. La suite était facile à imaginer. Malgré les protestations de Geoffrey, pour les gendarmes, il n’y avait pas de doute : Charles Trubert s’était donné la mort par pendaison. Il ne restait plus qu’à trouver les raisons de ce geste désespéré.
Alors que le corps de son frère venait de rejoindre ceux de ses parents dans la sépulture familiale, Geoffrey, en s’excusant auprès de Judith, prit le bras d’Arsène.
— Je t’emprunte Arsène pour quelques minutes.
— Je t’en prie.
Ils marchèrent quelque temps en silence pour descendre jusqu’au ruisseau de la Bazoche. Là, ils prirent un chemin qui longeait la rive.
— Je n’arrive toujours pas à comprendre les raisons de son geste. Rien ne laissait présager un tel acte. Et puis il n’aurait jamais fait ça le jour de mon mariage, se répétait Geoffrey.
— Tu sais, quand on est désespéré…
— Non, c’est impossible. S’il était déprimé à ce point on l’aurait deviné !
— Parfois on ne voit pas ce qui est sous son nez…
— Oui, mais, là, personne n’a rien vu. Ni son assistante, ni ses voisins, ni ses amis. Certes, Charles était peu expansif, mais on se serait rendu compte de quelque chose. Un mot, une attitude aurait éveillé notre attention. Là, rien de rien…
— Il n’avait pas de soucis financiers ?
— Bien sûr que non. J’ai eu ce matin son notaire, il laisse une petite fortune. Ce qui n’est pas très étonnant. C’était un psychiatre reconnu sur la place parisienne et il ne dépensait rien. Alors…
— Qui hérite ?
— Ben moi ! Vu qu’il n’a pas fait de testament.
Geoffrey avait vieilli de dix ans. Les larmes avaient gonflé le dessous de ses yeux. Ses rides étaient un peu plus marquées. Arsène ramassa machinalement une pierre et la lança dans la rivière. Le “plouf” sonore fit s’envoler une poignée d’oiseaux.
— Tu ne crois pas que c’est l’annonce de la mort de son ami qui l’aurait poussé à l’incompréhensible ?
— Mais pourquoi une telle nouvelle aurait pris ces proportions ? On ne se suicide pas pour la mort d’un ami, ça ne tient pas debout ! J’ai d’ailleurs appelé la veuve de cet homme.
— Tu les connaissais ?
— Je les avais rencontrés chez mon frère une ou deux fois. Bref, j’ai eu cette pauvre femme. Son mari a bien été assassiné et la police semble sur le point d’arrêter un de ses patients qui aurait déjanté, et…
— Et tu te demandes si la même mésaventure ne serait pas arrivée par hasard à ton frangin.
— Exact.
— Que disent les flics ?
— Que tout confirme la thèse du suicide.
La pluie avait cessé. Un geai fit éclater le bleu de ses plumes en passant à quelques mètres d’eux.
— Tu sais, Arsène, quelque part, le suicide est plus difficile à accepter car cela signifie que je n’ai rien vu venir… que j’aurais dû être disponible, à son écoute, l’aider et que je suis passé à côté…
Geoffrey ne finit pas sa phrase, sa voix s’était cassée dans un sanglot. Les mains dans les poches de son manteau, il regarda un long moment l’eau jouer sur les galets. Arsène respecta son silence.
Quand ils se remirent en marche, il passa affectueusement son bras sur les épaules de son ami.
— Tu sais, si un homme est désespéré et qu’il ne veut pas le montrer, il est parfois difficile de le déceler. Je ne connaissais pas beaucoup Charles mais il me paraissait plutôt introverti. Pas le genre à beaucoup parler de lui.
— C’est vrai. Mais je ne sais pas pourquoi, au fond de moi, je reste persuadé que ce n’est pas un suicide.
V
NOUGAT GLACÉ AUX FRUITS CONFITS
La sonnerie vrilla les oreilles d’Arsène. De sa main droite, en tâtonnant, il appuya sur la touche “arrêt” de son radioréveil. La sonnerie continua de plus belle. Il comprit enfin que le réveil n’était en rien responsable de cette agression mais que quelqu’un insistait à l’autre bout de la ligne téléphonique. Il était 7 heures.
— Allô ?
— Arsène ? C’est Geoffrey. Je te réveille ?
— Oui mais ce n’est pas grave. Le réveil allait bientôt me tirer hors du lit.
— Mon frère a disparu.
— Comment ?
Arsène ne comprenait rien.
— Je te dis que le corps de Charles a disparu. Ce matin, on a découvert la pierre tombale du caveau familial basculée, et l’emplacement du cercueil de mon frère vide.
—…
— Tu es là ?
— Oui, mais j’ai du mal à réaliser.
— Pas tant que moi. Je voulais te demander un service.
— Bien sûr.
— Est-ce que tu pourrais venir avec moi à Morne-mont ? Je ne me sens pas d’y aller tout seul.
Une demi-heure plus tard, Arsène prenait place dans la New Beetle jaune citron de Geoffrey. Ils n’échangèrent que quelques mots durant tout le voyage. La barbe naissante et le manque de sommeil renforçaient le gris du visage du conducteur. Ils retrouvèrent, comme convenu avec Geoffrey, les gendarmes devant le petit cimetière de Mornemont.
— Voilà le résultat, monsieur Trubert !
Le caveau était bel et bien fracturé. Le cercueil de Charles avait disparu.
— Qui s’est rendu compte de… ça ? demanda Arsène Barbaluc.
— Un certain Armand Huet qui est venu au petit matin sur la tombe de sa femme et qui, en passant devant la sépulture, s’est rendu compte des dégâts et nous a immédiatement appelés. Il était exactement 5 heures 45.
— Il se promenait dans le cimetière à 5 heures du matin ?
— C’est normal, lui répondit Geoffrey en devançant le gendarme, monsieur Huet a perdu son épouse au printemps dernier. Depuis, il n’a pas toujours les idées très claires. Il vient au moins une dizaine de fois par jour, et parfois la nuit, sur la tombe de sa femme.
— Et le cimetière reste ouvert toute la nuit ?
— Mornemont est un petit village. Il n’est jamais venu à l’idée de quiconque de le fermer à clé. En fin de journée, on repousse la grille, voilà tout !
— Cela a dû faire du bruit, raisonna à haute voix Arsène.
— Certainement, mais personne n’a rien entendu… Il n’y a que Victor Bonville qui aurait remarqué une camionnette immatriculée dans les Bouches-du-Rhône, stationné devant le cimetière. Mais rien de plus.
Arsène et Geoffrey se regardèrent à la dérobée.
— Bien, nous allons vous laisser. Vous voudrez bien passer à la gendarmerie dans la journée pour signer quelques papiers.
— Ne t’emballe pas ! Le vieux a peut-être eu des visions et même si la présence d’une camionnette immatriculée “13” est confirmée, cela ne veut rien dire.
— Avoue que c’est étrange tout de même ! On retrouve mon frère pendu après l’annonce de la mort, par assassinat, d’un confrère vivant dans la préfecture des Bouches-du-Rhône. Quelques jours plus tard, on vole son cadavre et un témoin déclare avoir vu, la nuit en question, une camionnette immatriculée dans le même département, garée à proximité du cimetière. Avoue que cela fait beaucoup de coïncidences ?
— Je te l’accorde.
— De plus, cela me conforte dans l’idée que la mort de mon frère n’est peut-être pas si volontaire que ça…
Cette fois-ci Arsène Barbaluc ne contredit pas son ami.
Les volets avaient beau être ouverts en grand, la lumière être allumée, la cuisine de Victor Bonville restait sombre. L’intérieur était bien propre et sentait l’encaustique. Un chien presque aussi vieux et aussi sourd que son maître était allongé de tout son long sur le carrelage.
— Alors, Victor comment allez vous ? cria Geoffrey.
— Bien, bien monsieur Trubert.
— Et votre dame ?
— Elle est allée faire quelques courses, mais elle ne devrait pas tarder maintenant.
— Je vous présente Arsène Barbaluc. C’est un ami.
Le vieil homme hocha la tête dans sa direction.
— Alors, il paraîtrait que vous avez eu une nuit agitée ?
— C’est vrai qu’on a profané la tombe de votre frère ?
— Oui mais…
— Si ce n’est pas malheureux ! Les médisants rapportent qu’on a même volé le cercueil ?
— Ce ne sont pas des médisants, Victor. On a effectivement volé le cadavre de Charles.
— Nom de Dieu ! Si, maintenant, même nos morts ne peuvent plus reposer en paix ! On n’aurait pas vu ça de mon temps. C’est une histoire à ne pas dormir de la nuit !
— Justement, à propos de ne pas dormir la nuit, Victor ! La nuit dernière, vous avez remarqué une estafette bizarre garée devant chez vous ?
— Non, pas devant la maison. En face, le long du mur du cimetière. Mais j’ai déjà tout raconté aux gendarmes. Vous me connaissez, monsieur Trubert. Pour moi, l’ordre c’est sacré !
Arsène s’impatienta, trouvant que le père Bonville avait du mal à aller au fait.
— Et alors, qu’est-ce qui s’est passé ?
Le vieux le foudroya du regard. Ce n’était pas un étranger qui allait lui couper ses effets. Pour une fois qu’on s’intéressait à lui.
— Vous prendrez bien un p’tit verre, votre ami et vous, monsieur Trubert ?
— Ça ne se refuse pas.
— À la bonne heure !
L’ancien ouvrit la porte du placard et en sortit une bouteille à moitié pleine. Il attrapa trois verres à moutarde et déposa son chargement sur la table.
— Ça peut pas faire de mal. C’est un petit saumur champigny.
D’une main experte, Victor Bonville remplit les trois verres sans qu’une goutte ne tombe à côté.
— À la bonne vôtre !
Pour un petit saumur champigny c’était un petit saumur champigny, même un tout petit, râpeux et acide. Une trop grande consommation et c’était l’ulcère assuré.
Le propriétaire siffla son godet d’un trait.
— Comme je l’ai dit aux gendarmes, cette nuit, sur les coups de trois heures du matin, j’ai été pris d’une envie pressante. Faut vous dire que j’ai la prostate qui n’est plus en bonne forme. Je descends pour aller aux toilettes, et là, je tombe sur Balthazar. Balthazar, c’est mon chien. Il est plus tout jeune, lui non plus. La pauvre bête gémissait devant la porte d’entrée. Alors, ni une, ni deux, j’ai attrapé ma veste, je l’ai fait sortir et j’suis allé pisser dehors.
— C’est là que vous avez vu la camionnette ?
— J’avais rien vu du tout. C’est Balthazar qui est allé lever la patte contre la roue d’une camionnette que j’avais jamais vue dans le village. Faut dire que Morne-mont c’est tout petit, on connaît la voiture de tout le monde. Alors, par curiosité, je me suis approché et j’ai vu qu’elle était immatriculée à Marseille.
— Vous voulez dire dans les Bouches-du-Rhône ?
— Ben oui quoi, 13 !
« Il faut vraiment leur mettre les points sur les i aux Parisiens… », pensa Victor Bonville.
— Avez-vous pu voir la marque ?
— Pour sûr. C’était un Ford. Mais il n’était pas neuf
— Vous n’auriez pas noté toute l’immatriculation, par hasard ?
— Ah ça non ! Je dois dire que j’n’avais point de raison de le faire. Et puis, y faisait pas chaud, alors avec Balthazar, on est vite rentré.
— Vous n’avez rien remarqué d’autre ?
— Désolé, monsieur Trubert. Rien de rien. Je vous en remets une petite lichette, pour la route ? dit-il la main déjà posée sur la bouteille.
Le dimanche suivant, Arsène accompagna Judith à Roissy-Charles De Gaulle. Elle partait pour plusieurs semaines aux États-Unis pour son travail. En plus de l’éloignement, les récents attentats commis sur le sol américain n’aidaient pas à la séparation. Arsène avait bien essayé de la dissuader, une dernière fois, mais en vain. Elle n’avait pas vraiment le choix.
Il ne fut soulagé que, lorsqu’elle l’appela de Boston pour dire que le vol s’était bien passé et qu’elle était bien arrivée. Quelques heures plus tard, les premières frappes américaines et britanniques embrasaient Kaboul, Kandahar et les principales villes d’Afghanistan. Arsène passa sa soirée à “zapper” pour essayer d’avoir un maximum d’informations. Il s’endormit sur son canapé.
Cela devenait une habitude. Geoffrey le faucha en plein rêve aux petites heures du jour.
— Arsène, on a retrouvé le corps de Charles !
— Où ça ?
— Dans une fabrique de nougat à Montélimar.
— Répète, s’il te plaît !
— L’usine est fermée le week-end. C’est la première équipe du lundi qui, en embauchant à quatre heures du matin, a découvert le corps de mon frère dans une cuve à nougat.
— C’est une histoire à dormir debout !
— Attends, d’après les gendarmes du coin, on a retrouvé à quelques kilomètres de là, une camionnette de marque Ford, immatriculée dans les Bouches-du-Rhône, à moitié carbonisée. Il semblerait qu’ils aient retrouvé, à l’intérieur, les restes d’un cercueil.
— On a arrêté les types qui ont fait ça ?
— Pas pour le moment. Mais tu vois, quand je te disais que le suicide de Charles était louche, je ne me trompais pas.
— Qu’est-ce que tu vas faire ?
— Je prolonge mes congés et je file à Montélimar.
— Veux-tu que je t’accompagne ? Depuis que j’ai été mêlé à une affaire criminelle dans le Royans, j’ai une certaine habitude de ces choses-là.
— Je te remercie, mais je préfère être seul. Si j’ai besoin de toi, je te promets, je n’hésiterai pas.
Arsène était presque déçu. Il serait bien descendu à Montélimar avec Geoffrey. Depuis qu’il avait participé, bien malgré lui, à cette enquête criminelle, il avait gardé un certain goût pour ce genre de situation. Enfin, tout cela s’éclaircirait rapidement. « Mais tout de même », pensa-t-il, « pourquoi voler le corps d’un suicidé pour aller le balancer dans une cuve à nougat ? À moins que Geoffrey n’ait raison et que son frère ne se soit pas suicidé. »
Pendant les jours qui suivirent, Arsène Barbaluc eut du mal à se concentrer sur son travail. Il chercha à appeler son ami sur son portable qui répondait invariablement que cet interlocuteur n’était pas joignable. En milieu de semaine, il appela Hélène qui l’informa que son mari allait bien mais n’avait pas de nouvelles de l’enquête. Le corps de Charles était pour le moment à l’Institut médico-légal de Lyon.
Sans savoir pourquoi, Arsène était angoissé, inquiet pour Geoffrey. Cela se ressentait sur son activité professionnelle. Il remplissait avec difficulté les fiches des restaurants visités lors de sa dernière tournée d’inspection en Alsace. En plus, le type qui assurait l’intérim de Trubert au magazine, était un imbécile. Il ne s’était jamais entendu avec lui. Ce n’était pas aujourd’hui que cela allait commencer.
Une semaine. Une semaine que l’on avait retrouvé le corps de Charles Trubert et pas de nouvelles de Geoffrey. « Il abuse, tout de même… », ragea Arsène en se dirigeant vers le bureau du rédacteur en chef du Gastronome. Celui-ci lui avait fait dire qu’il voulait le voir en urgence. Il le trouva occupé à relire les articles du prochain numéro. Sans attendre qu’il le lui propose, Arsène se laissa choir dans un des fauteuils.
— C’est de la merde, Barbaluc !
— Je te demande pardon ?
— Je vous dis que votre article sur les fleurs dans la cuisine française, c’est de la merde !
— Excuse-moi, on ne se tutoie plus ?
— Non.
Les mains d’Arsène se crispèrent sur les accoudoirs de son siège. Il respira profondément.
— Écoute, Bruno ! Si remplacer pour quelques jours Geoffrey t’a fait “péter les plombs”, je n’y peux rien. Mais que tu t’attaques à mon savoir-faire professionnel, ça, je ne le tolérerai pas.
— Il n’empêche que c’est de la merde !
On ne saura jamais ce qui se serait passé si la secrétaire du directeur du guide Le gastronome français n’était arrivée.
— Excusez-moi de vous déranger, messieurs, mais monsieur le directeur vous cherche partout, monsieur Barbaluc.
Quand il poussa la porte de l’antre directoriale, Arsène fulminait encore. La vue d’Hélène Trubert en larmes lui fit l’effet d’une douche froide et le calma immédiatement.
VI
MITONNE DE VEAU AUX PETITS OIGNONS
— Geoffrey est dans le coma. Un garde-chasse a trouvé son corps sur les bords de la Durance. D’après la police, il aurait reçu un coup à la tempe. Il porte d’autres traces sur le corps mais qui ne sont pas aussi graves.
— Que disent les médecins ?
— Ils réservent leur pronostic.
Hélène éclata en sanglots. Un lourd silence s’instaura dans le bureau. Ni le directeur ni Arsène ne savaient quoi dire. L’assistante d’André Gibon lui apporta un thé. Légèrement penchée en avant, tenant son mug à deux mains, elle le but à petites gorgées, les yeux dans le vague.
— Tu sais ce qui s’est passé exactement ? lui demanda doucement Arsène.
— Pas plus que ce que je t’ai dit. Je sais simplement qu’il était allé enquêter à l’usine de nougat à Montélimar avant de descendre à Aix-en-Provence. Là, il m’a dit qu’il avait rencontré la veuve du docteur Costes.
— Qui est le docteur Costes ?
— Le psychiatre dont on a annoncé la mort à Charles le jour de notre mariage.
L’évocation de la cérémonie, normalement synonyme de bonheur mais qui avait tourné au malheur, lui provoqua une nouvelle crise de larmes. Il lui fallut plusieurs minutes pour retrouver ses esprits.
— Je sais également qu’il cherchait à joindre une journaliste de ses connaissances. Une certaine Alice… Je ne me souviens plus de son nom de famille.
Felouze. Arsène la connaissait très bien. Elle était une ex-petite amie de Geoffrey, à une époque où celui-ci avait une vie sentimentale plus que débridée. Il se garda bien d’éclairer la lanterne d’Hélène à ce sujet.
— A-t-il découvert quelque chose ?
— Ça, il ne me l’a pas dit. La dernière fois que je l’ai eu au téléphone, samedi matin, il avait l’air surexcité. Je lui ai demandé s’il avait du neuf. Il m’a simplement répondu que c’était trop tôt pour le dire et qu’il en saurait plus le soir même. Il m’a promis de me rappeler dès le lendemain matin. Depuis ce coup de téléphone, je n’ai plus de nouvelles. Au début, je ne me suis pas inquiétée. Vous connaissez Geoffrey ? Il n’en fait qu’à sa guise.
Les deux hommes hochèrent la tête en signe d’assentiment.
— Et puis, ce matin, on m’a prévenue que…
André Gibon et Arsène essayèrent de réconforter la jeune femme. Elle leur apprit qu’elle descendait le jour même à Aix-en-Provence au chevet de son mari. Arsène dut la tenir par le bras pour la raccompagner jusqu’à la sortie et l’installer dans un taxi. La pauvre avait bien du mal à tenir sur ses jambes. Quand Arsène remonta au bureau, sa décision était prise. Si Geoffrey avait été sauvagement agressé, c’est qu’il avait fait une découverte intéressante sur le “suicide” de son frère. Arsène s’en voulait de ne pas avoir pris au sérieux les intuitions de son ami. Peut-être que, s’il l’avait accompagné, il ne lutterait pas aujourd’hui contre la mort, sur un lit d’hôpital. Cette fois-ci, il fallait se jeter à l’eau et partir pour Aix-en-Provence.
Le directeur du guide Le gastronome français accepta son congé exceptionnel. Le brave homme avait été secoué par l’agression subie par l’un de ses principaux collaborateurs. Si le mode de vie et les excentricités de Geoffrey lui paraissaient souvent incongrus, il aimait sa générosité et avait de l’estime pour le professionnel qu’il était.
— Je sais que vous avez une certaine expérience de ce genre d’affaires, mais faites attention à ne pas vous mettre dans le pétrin !
— Ne vous inquiétez pas, je serai prudent.