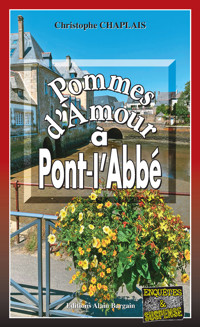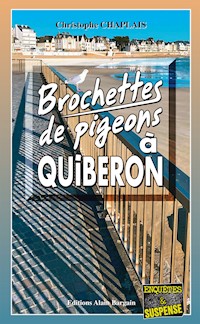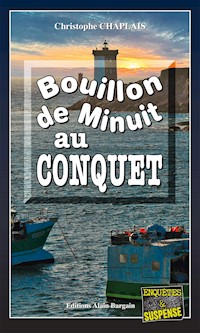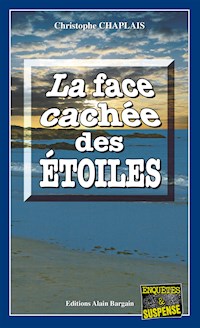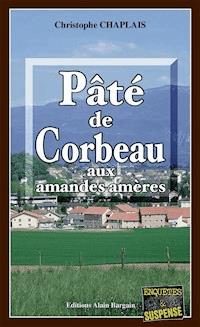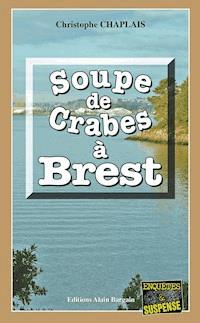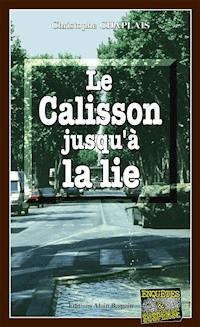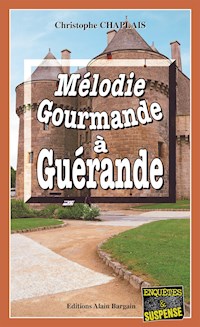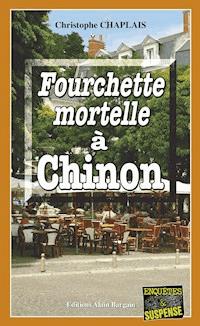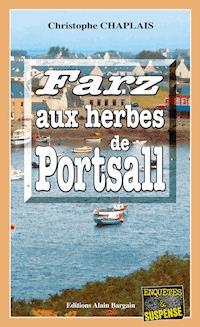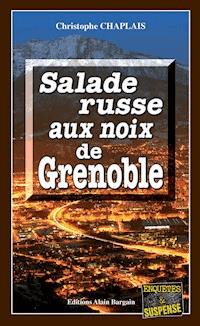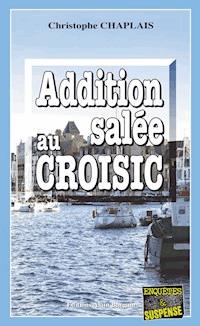Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Une aventure d'Arsène Lupin
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Arsène Lupin parviendra-t-il à honorer son pays dans cette grande course automobile ?
En 1907, alors que la plus grande course automobile à travers la France se prépare, Arsène Lupin s’ennuie. Le comte Sfonsa, grand favori de l’épreuve, déclare à qui veut l’entendre qu’il fera une nouvelle fois triompher les couleurs italiennes sur les routes de l’Hexagone. Touché dans son âme de patriote, Lupin relève le défi, pour l’honneur du drapeau tricolore.
Alors qu’il se bat pour la victoire finale, le gentleman-cambrioleur sauve de la noyade une jeune femme, poussée du haut du pont de Port-Launay.
Lorsqu’il apprend que l’inconnue a été agressée sur son lit d’hôpital, puis qu’elle a été enlevée, Arsène Lupin décide de voler à son secours…
Entre Brest et le pays des Abers, Lupin affrontera un ennemi redoutable qui ne recule devant rien pour arriver à ses fins, et découvrira la vérité qui se cache entre réalité et légendes du passé.
Plongez sans attendre dans cette aventure inédite d'Arsène Lupin !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Christophe Chaplais, né en 1965, partage son temps libre entre la Bretagne et la côte catalane. Auteur de la série “Arsène Barbaluc”, il allie gastronomie et affaires criminelles. Intrigue aux petits oignons, personnages à la sauce aigre-douce, rien de tel pour vous concocter un suspense qui ne manque pas de piment. Pour une fois, l’auteur choisit d’abandonner son héros pour un autre Arsène en nous proposant une nouvelle aventure de Lupin. Par ce roman, Christophe Chaplais rend un vibrant hommage à l’un des héros de son enfance et à son auteur, Maurice Leblanc, qui n’ont pas été étrangers à sa propre envie d’écrire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
À la dame aux yeux verts, à Carole.
AVANT-PROPOS
Comme beaucoup, j’ai été profondément marqué par l’œuvre de Maurice Leblanc et par Arsène Lupin. J’ai découvert cet univers alors que je n’étais qu’un jeune adolescent. Il fait partie de ceux qui m’ont fait aimer les livres et la littérature policière.
Après beaucoup d’hésitation, et un peu d’appréhension, je me suis commis à écrire une nouvelle page des aventures de celui qui avait bercé mon enfance. Cette envie n’est pas nouvelle, mais du temps m’a été nécessaire pour oser me lancer dans cette entreprise. En aucun cas ma volonté n’a été d’écrire un plagiat ou de me substituer à l’œuvre de Maurice Leblanc ni de vouloir de manière présomptueuse l’égaler, mais bien, à ma manière, de lui rendre hommage.
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
I ARSÈNE LUPIN S’ENNUIE
En ce mois de septembre 1907, l’automne s’annonçait déjà. Si le fond de l’air était doux, la lumière n’était plus aussi vive, et le soleil plus aussi brillant. Sur les boulevards, Arsène Lupin se promenait tranquillement parmi les badauds et la foule qui déambulait. Il choisit une place à l’une de ses terrasses favorites pour prendre un café. Alors que tout allait bien, il affichait une mine désabusée. Pourtant, lui et ses complices avaient réussi quelques jolies affaires ces derniers temps. Les cambriolages des hôtels particuliers du comte Édouard de Malveysie et du baron d’Ambert avaient dépassé toutes ses espérances. Ils lui avaient rapporté un joli pactole et, notamment, une splendide collection de vases de Chine d’une inestimable valeur, qu’il ne cessait d’admirer. Lassé de jouer au chat et à la souris avec son vieil ennemi Ganimard, pour une fois, Arsène Lupin n’avait pas signé ses forfaits. La presse s’était bien interrogée et, dans plusieurs articles ou éditoriaux, la question de son implication dans cette série de vols estivaux avait été clairement supposée. Ce à quoi la préfecture de police avait rétorqué que, de source sûre, Arsène Lupin était à l’autre bout du globe, très certainement en Inde !
Tripotant sa cuillère, il laissa son regard errer au hasard. Les femmes arboraient de belles tenues et faisaient tourner leurs ombrelles. Un jeune garçon poussait devant lui un cerceau, s’attirant les foudres de ceux qu’il bousculait. Des hommes importants, lorgnon sur le nez et cigare aux lèvres, discutaient avec véhémence de la décision de placer la Compagnie du gaz sous la surveillance de la municipalité de Paris. Ce qui pour eux était une aberration. À la table à côté de lui, deux jeunes gens évoquaient avec passion la victoire du prince Scipion Borghèse sur son Itala dans la course automobile Pékin-Paris. Arsène Lupin se mordit les lèvres pour ne pas répondre que, si lui avait participé, il l’aurait emportée pour sa plus grande gloire et celle de la France. Agacé, il posa quelques pièces sur la coupelle et se leva.
Comme cela lui arrivait de temps en temps, Arsène Lupin était mélancolique. Ses affaires étaient florissantes, la police le laissait en paix, ses amours naissants avec une jeune danseuse aux yeux magnifiques étaient prometteurs, mais l’aventurier s’ennuyait. Sa vie lui semblait routinière et manquant singulièrement d’imprévu. Il hésitait même à se rendre à l’invitation que lui avait faite le jeune banquier Louis Forat pour le soir même. Pourtant, sous l’identité de Paulin Nerse, ayant fait fortune de l’autre côté de la Méditerranée, Arsène Lupin s’était lié d’amitié avec cet homme affable qui partageait avec lui la même passion pour l’automobile.
Alors que la fin de journée s’étirait en longueur, Arsène Lupin revêtit l’apparence et le costume de Paulin Nerse. Devant sa glace, il fixa une fine moustache au-dessus de sa lèvre et modifia l’aspect de ses sourcils. Enfin pour parachever son œuvre, il se para d’une perruque arborant quelques cheveux gris. Il hésita, puis décida de se rendre à pied au domicile de son nouvel ami, à deux pas des Champs-Élysées. Comme toujours, une petite bonne boulotte lui ouvrit la porte et le fit patienter dans le petit salon. Il admira, une nouvelle fois, la série de tableaux italiens du siècle dernier. Il les effleura avec envie, mais Lupin ne volait jamais ses amis. Sur un chevalet, une toile qu’il ne connaissait pas trônait au milieu de la pièce. Il se penchait pour déchiffrer la signature quand son hôte entra dans la pièce.
— C’est un Picasso, mon cher ami ! l’informa Louis Forat en lui tendant la main.
Le banquier affichait un visage aux traits irréguliers et amaigris, comme son corps. Longtemps malade de la tuberculose, cet homme longiligne aux frêles épaules en avait gardé une santé fragile.
— C’est une toile intéressante, ne trouvez-vous pas ? Ce Picasso et ses amis appellent ce nouveau style le cubisme.
— Je ne déteste pas, assura Paulin Nerse en reculant de quelques pas pour examiner la trouvaille de son ami. Et puis, ce qui est moderne aujourd’hui deviendra à n’en pas douter les classiques de demain.
Il se promit intérieurement de s’intéresser d’un peu plus près à ses peintres… cubistes.
— Mais vous ne m’avez pas invité à dîner pour parler peinture ? reprit-il.
— Vous avez raison. J’ai un projet dont je voudrais m’entretenir avec vous et qui, je le pense, vous intéressera.
— Je suis tout ouïe.
— Passons à la salle à manger, nous serons mieux installés pour en discuter.
Ce n’est qu’une fois assis, et que leurs verres furent remplis d’un excellent bordeaux, que Louis Forat daigna lui présenter son idée.
— Comme vous le savez, je suis un passionné d’automobile et le retentissement de la course Pékin-Paris m’a conforté dans mon idée d’organiser moi aussi un tel événement.
— C’est-à-dire ? demanda Paulin Nerse.
— Eh bien, avec mes partenaires, nous imaginons proposer une course dont le parcours serait le suivant. Les concurrents partiraient de Paris pour se rendre à Bruxelles. Puis de Belgique, ils traverseraient les Ardennes et les Vosges jusqu’à Strasbourg en territoire allemand. La troisième étape obligerait les coureurs à franchir le Jura et les Alpes pour atteindre Nice. De la Côte d’Azur, ils prendraient la direction de Biarritz par les cols des Pyrénées…
— À quelle période de l’année imaginez-vous cette course ? l’interrogea son invité, de plus en plus intéressé.
— Cet hiver même.
— Mazette, pour peu que la neige soit au rendez-vous, les Alpes et les Pyrénées, ce n’est pas une mince affaire.
— C’est tout l’intérêt de cette course, qui mettra les hommes et les machines à rude épreuve. Nous terminerons par deux dernières étapes. Biarritz-Brest, et enfin Brest-Paris en passant par Rouen. Qu’en pensez-vous ?
— C’est très intéressant. Le parcours est sélectif, mais avez-vous déjà des inscrits ?
— Nous avons les accords de principe du baron Oppengäzen de Prusse occidentale, du belge Van Stappelaere, de l’anglais Pierce…
— Je suppose que le prince Borghèse, vainqueur de Pékin-Paris sera de la partie.
— Non, mais il nous envoie son protégé, le jeune comte Sfonsa. Tenez, je vous laisse lire la lettre que ce dernier m’a envoyée.
Paulin Nerse s’empara du courrier et le parcourut rapidement.
— Il ne manque pas de toupet ! s’insurgea-t-il. « J’ai hâte de parcourir les routes de France et une nouvelle fois de faire triompher les couleurs de mon pays, comme cela est si souvent le cas… » Que de prétentions ! Que de flagorneries ! J’espère, mon cher, que des pilotes français ont répondu présents.
— Il y aura bien Ferdinand Faverge et Paul Bérard, mais j’ai peur que nous ne soyons pas en mesure de l’emporter. De plus, le gouvernement ne voit pas d’un très bon œil ce genre de compétition sur route ouverte. Il a fallu tout mon entregent et celui de mes associés pour que celui-ci accepte de ne pas interdire purement et simplement cette course. Cette frilosité a très certainement convaincu nos compatriotes de ne pas donner suite à notre proposition. La concurrence étrangère, comme vous avez pu le constater, s’annonce féroce et a toutes les chances de l’emporter. C’est pour cela que j’ai pensé à vous. Vous êtes un fin pilote et, de ce que j’ai compris, vous avez les moyens de financer une telle participation. Une telle épreuve impliquera une bonne dose d’improvisation et d’adaptation, ce dont vous ne manquez pas.
Paulin Nerse ne répondit pas. Il s’était levé et arpentait la pièce de long en large.
— Le gagnant empochera une prime de vingt-cinq mille francs. Ce qui, vous en conviendrez, n’est pas négligeable.
— L’argent ne peut être le moteur de mon engagement. Non, ce qui me pousse à vous dire oui, c’est l’honneur de notre pays. Nous ne pouvons pas organiser une course qui parcourt les routes de France et laisser la victoire à des étrangers, et encore moins à ce comte Sfonsa, par trop prétentieux. Topez-la, mon ami ! Il ne sera pas dit que Paulin Nerse recule devant l’adversité. Je ne demande qu’une chose : avoir le numéro un.
Paulin Nerse, ou plutôt Arsène Lupin, passa l’automne à préparer ce nouveau défi. Il mobilisa toute son énergie et tous ses moyens, qui étaient grands, pour triompher une nouvelle fois. Il racheta la Mors Z, victorieuse de la course Paris-Madrid quelques années auparavant, et avec l’aide de son fidèle Grognard et de quelques mécaniciens et ingénieurs engagés pour l’occasion la désossa, la modifia, lui installa un nouveau moteur plus puissant et lui greffa une superbe carrosserie finement fuselée, arborant une robe tricolore des plus voyantes affichant le numéro un demandé.
— Nous n’allons pas nous cacher ! répondit Paulin Nerse à Grognard, qui trouvait cette robe pour le moins provocatrice. Nous sommes français, fiers de l’être et nous sommes là pour gagner. Alors, autant le dire haut et fort.
Grognard, le fidèle parmi les fidèles de Lupin, secoua la tête, un sourire au coin des lèvres. Il ne savait pas comment finirait toute cette aventure mais, au moins, le patron avait retrouvé sa joie de vivre.
II L’ENLÈVEMENT
Au même moment, dans un petit village du Finistère Nord, par une nuit sans lune, trois ombres se glissaient en silence le long des murs. Le portail de la maison presque accolée au presbytère s’ouvrit sans difficulté en laissant échapper un grincement lugubre. Les trois hommes se figèrent et attendirent quelques instants. Puis, comme rien ne bougea dans la maison, ils reprirent leur progression.
— On est certains qu’il est seul ? demanda dans un souffle le premier.
— Oui, la fille est chez une amie à Brest pour quelques jours.
Crocheter la serrure ne présenta aucune difficulté pour eux. Avec une légèreté que leur corpulence ne laissait pas imaginer, les deux plus grands montèrent à l’étage. Grâce aux renseignements qui leur avaient été communiqués, ils n’eurent aucun mal à se repérer. Devant la porte d’une chambre, ils écoutèrent avec attention et entendirent clairement le ronflement sonore et régulier de l’occupant. L’un des agresseurs imbiba un chiffon épais de chloroforme. Son complice entra en premier, maintint le vieil homme endormi profondément, pendant qu’il lui plaquait sur le visage de la ouate imbibée d’un puissant somnifère. L’un le prit par les pieds, le deuxième par les bras et ils rejoignirent ainsi le troisième larron au rez-dechaussée. Celui-ci s’empara des clés suspendues à un crochet dans le vestibule et, lorsqu’ils furent dehors, referma à double tour la porte d’entrée de la maison. L’agression n’avait duré que quelques minutes. Une opération parfaite, rapide et silencieuse. Les trois hommes et leur colis disparurent dans la nuit.
La victime s’éveilla, le nez dans une paillasse poussiéreuse. Il tira une épaisse couverture sur lui. Il était dans le noir le plus complet, mais il respira l’odeur si caractéristique de l’humidité et du moisi d’une cave ou d’un lieu enterré. Il n’entendait aucun bruit. Sa tête était lourde. « Certainement les effets secondaires du chloroforme », songea-t-il. Lorsque l’aube hivernale daigna enfin chasser la nuit, une faible lueur éclaira sa prison, par un soupirail dont la grille de protection était en partie mangée par la rouille. Dans la pénombre, il distingua une chaise positionnée devant une petite table rectangulaire sur laquelle était posée une cruche d’eau. Après l’avoir reniflée, puis trempé un doigt qu’il porta à ses lèvres, il but avidement. Dans un angle, un pot de chambre était à sa disposition. La pièce, relativement grande, possédait un sol en terre battue et une seule issue. Il éprouva la solidité de l’épaisse porte fermée à double tour sans l’ébranler. Il déplaça la chaise, monta dessus et tenta de regarder à l’extérieur par les interstices du soupirail. Il devina plus qu’il ne vit un parc bien entretenu, qui semblait assez vaste. À sa droite, le pignon d’un bâtiment obstruait son champ de vision.
La journée devait être avancée, car son ventre gargouillait désagréablement de faim. Ce n’est qu’un peu plus tard que deux hommes taillés comme des forts des halles, la tête encagoulée, l’extirpèrent de sa cellule. Chacun le prit par un bras et, à la lumière d’une lampe tempête, ils le forcèrent à descendre un escalier aux marches mal égalisées. Il essaya de se rebeller, en vain. Les poignes puissantes de ses geôliers l’obligèrent à s’asseoir sur une chaise et l’attachèrent solidement.
— Mais qu’est-ce que vous me voulez ? Qui êtes-vous ?
Il n’obtint aucune réponse. Ils furent bientôt rejoints par deux autres hommes, eux aussi le visage camouflé par un épais tissu.
— Alors, Kermeur, es-tu bien installé au moins ?
— C’est toi ! affirma le prisonnier, surpris. Libère-moi immédiatement ! ordonna-t-il en en gigotant sur sa chaise jusqu’à la faire tomber.
Les deux colosses le relevèrent aussi facilement que s’ils avaient eu affaire à un fétu de paille.
— Libère-moi, répéta-t-il avec vigueur.
— Tu veux retrouver la liberté, n’est-ce pas ? Rien de plus simple, tu me dis ton secret et je te fais ramener chez toi.
— Mais je n’ai pas de secrets.
— Tu mens mal, Kermeur. Tu as tous les éléments, depuis des années et tu y travailles presque tout le temps. Alors, dis-moi ton secret, scanda la voix en appuyant sur chacun des derniers mots.
Le vieil homme se mit à appeler à l’aide de toutes ses forces.
— Tu peux t’égosiller, ici, personne ne t’entendra.
— Une dernière fois, je te demande de me…
— Mais, il n’y a pas de secret. Je n’ai rien trouvé. Je n’ai rien à te dire, s’époumona le prisonnier.
Celui qui menait l’interrogatoire fit un signe de tête à ses deux hommes de main. Le vieil homme sentit leurs monstrueuses pattes se poser sur les épaules pour le maintenir. L’autre lui expédia une gifle magistrale. Puis une seconde. Il sentit le goût du sang dans sa bouche.
— Cela t’aide-t-il à te délier la langue ?
Le vieil homme le fixa, les yeux pleins de haine, mais garda le silence.
Avant d’être ramené dans l’autre pièce, il l’avait forcé à écrire une lettre pour expliquer son absence. Il avait refusé, mais n’avait pas eu d’autre choix que de céder devant les coups qui pleuvaient sur lui.
Les séances d’interrogatoire se succédèrent. Son visage tuméfié le faisait souffrir, surtout son nez, qui devait être cassé. Les brûlures de cigarettes sur ses avant-bras s’étaient infectées. Quand celui dont il connaissait la voix perdait patience, c’était son acolyte qui prenait la suite.
— Allons, Kermeur. C’est assez simple, vous nous dites ce que l’on veut savoir et tout s’arrête.
— Mais je n’ai rien trouvé, répéta-t-il pour la centième fois.
— Alors, donne-nous au moins les indices sur lesquels tu travailles. Là où tu as échoué, moi, moi je trouverai. J’ai tes livres, tes cahiers, tes papiers, mais il me manque quelque chose, j’en suis certain.
Une nouvelle fois, le vieil homme se mura dans le silence.
— Si tu continues à t’obstiner, on s’en prend à ta petite-fille, la jeune et jolie Andréa.
III LE MARATHON DE LA ROUTE
À Paris, le grand jour arriva enfin. Le dimanche 22 décembre, la foule avait bravé une pluie et un vent du nord glacial pour se masser place de la Concorde. Le premier concurrent à se présenter sur la ligne de départ de ce que la presse appelait déjà l’événement automobile de l’année fut le belge Van Stappelaere, au volant de sa Minerva. Le petit homme rondouillard au visage rigolard et rubicond engendrait la sympathie. Il fut bientôt rejoint par d’autres coureurs, dont le très britannique Pierce et sa Rolls-Royce supportant un immense drapeau de l’Union Jack. Mais l’apparition du baron blanc, l’allemand Von Oppengäzen, souleva une rumeur d’admiration chez ses admirateurs. Il est vrai que, dans sa tenue immaculée au volant de sa grosse Mercedes elle aussi toute blanche, il avait fière allure. Mais le comte Sfonsa, et sa puissante Isotta-Fraschini, le détrôna à l’applaudimètre. Son mécanicien faisait des allers-retours entre la voiture de l’Italien et les spectateurs pour distribuer des roses rouges aux femmes venues les soutenir. Tenant son volant d’une main, il envoyait des baisers de l’autre en direction de ses groupies.
— Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines, ici même, pour fêter ma victoire et celle de toute l’Italie, leur lança-t-il dans un français parfait, mais à l’accent chantant. Qu’attendons-nous pour prendre le départ ? s’impatienta-t-il en apostrophant un Louis Forat dégoulinant sous la pluie qui redoublait.
— Il ne manque plus qu’un concurrent, précisa l’organisateur de la compétition. Il ne saurait tarder.
— S’il est déjà en retard au départ, qu’est-ce que ce sera à l’arrivée, se moqua le comte Sfonsa.
Ces derniers mots furent étouffés par le vrombissement tonitruant de la Mors tricolore de Paulin Nerse, accompagné de son mécanicien Grognard, qui se rangea sagement à côté de l’Isotta-Fraschini. Chaque fois que le pilote transalpin cherchait à prendre la parole, le Français appuyait sur l’accélérateur pour couvrir sa voix. Sfonsa le dévisagea en lui lançant un regard mauvais avant de réajuster ses lunettes. Ses mains se crispèrent sur le volant. Il embraya et passa le premier rapport avec brutalité. Devançant presque l’abaissement du drapeau donnant le signal de départ, son Isotta-Fraschini se cabra avant de se lancer vers les faubourgs nord de la ville de lumière.
Cette première étape fut parcourue très rapidement. Au grand dam du pilote d’outre-Quiévrain, qui aurait tant souhaité gagner sur ses terres, il fut devancé par le sujet de Sa Gracieuse Majesté et sa Rolls-Royce. Au départ de Bruxelles, les routes à travers les Ardennes et les Vosges étaient beaucoup plus sélectives, et plusieurs concurrents durent abandonner sur accident ou panne mécanique. Le comte Sfonsa gagna haut la main et fêta la nouvelle année en leader du classement général de la course.
Une vague de neige, suivie d’un froid polaire, s’était abattue sur tout l’est de la France. Les concurrents durent affronter des conditions dantesques entre Strasbourg et Nice, tout particulièrement dans la traversée des Alpes. Paulin Nerse et son copilote ne furent pas épargnés. Malgré toute sa dextérité, sur la route Napoléon, ils partirent à deux reprises à la faute, égratignant et éborgnant leur Mors. Ils franchirent le col Bayard dans une tempête de neige qui les obligea à pelleter. Malgré les chaînes qu’ils avaient mises sur les pneumatiques, la voiture patinait. Grognard, transi de froid, dut prendre place à l’arrière du véhicule pour mettre du poids sur les roues motrices. De peur que l’eau du radiateur ne gèle, ils s’arrêtèrent devant une droguerie du petit village de Laragne-Montéglin pour acheter de l’alcool, qu’ils mélangèrent à l’eau du circuit de refroidissement. Ne s’accordant que quelques minutes de sommeil, quand il n’en pouvait plus, roulant à tombeau ouvert sur les routes verglacées des environs de Digne, Paulin Nerse ne put rattraper tout le temps perdu et accusa un retard de plus de quatre heures sur l’Italien. Sfonsa avait été porté en triomphe sur la promenade des Anglais par des compatriotes qui n’avaient pas hésité à passer la frontière pour fêter leur héros.
Le lendemain, après une nuit de repos bienvenue, Paulin Nerse dînait avec Louis Forat, qui avait fait le déplacement jusqu’à Nice pour accueillir les rescapés de la route.
— J’ai bien peur que la messe ne soit dite, avoua l’organisateur de la course.
— Pourquoi dites-vous cela ?
— Le comte Sfonsa a une confortable avance sur vous, presque cinq heures sur Pierce et huit sur le baron blanc. Je ne vois pas comment la victoire pourrait lui échapper.
— Je ne suis pas d’accord avec vous. La course est encore longue et si jusqu’à maintenant il a été épargné par la malchance, sur une épreuve aussi difficile, il y a forcément un moment où il y aura une occasion de lui reprendre du temps et Paulin Nerse sera là. Je vous le promets.
— Savez-vous que Van Stappelaere a déposé une réclamation contre lui ? Il reproche au comte Sfonsa de l’avoir envoyé dans le fossé, à la sortie de Grenoble dans la rampe de La Mure.
— J’en ai entendu parler. Même si je ne doute pas un instant de l’honnêteté de notre ami belge, c’est sa parole contre celle de Sfonsa. Ne pouvant prouver ses dires, il aurait mieux fait de se taire. Il va passer pour un mauvais perdant.
Le pilote de la voiture tricolore ne croyait pas si bien dire. Le lendemain, la presse se déchaîna. Il y avait ceux qui supportaient Van Stappelaere et les autres, dont les journaux transalpins qui le fustigeaient, criaient aux mensonges et portaient aux nues le comte Sfonsa. Celui-ci, avec intelligence, se garda bien de tout commentaire.
— Seule la route donne la vérité, daigna-t-il tout de même répondre aux scribouillards venus le questionner à son hôtel. Et je vous le dis, Messieurs, personne ne peut battre le comte Sfonsa et sa magnifique mécanique italienne.
Ce soir-là, Paulin Nerse rejoignit Grognard, qui fignolait les réparations de leur automobile dans un petit atelier sur la route de Cannes.
— Alors, mon vieux compagnon, tout est prêt ?
— Oui, Patron, le rassura-t-il en essuyant ses mains pleines de cambouis à un chiffon qu’il enfouit dans une des poches de sa combinaison.
— Elle est comme neuve. J’ai même fait quelques modifications qui devraient améliorer ses performances, sans pour autant mettre en jeu sa fiabilité.
— C’est parfait. Cette fois-ci, foi d’Arsène Lupin, nous allons faire mordre la poussière à ce prétentieux d’Italien.
— Vous ne voulez pas que…
— Non, Grognard, c’est à la loyale que je vais le battre.
— Oui, mais lui n’est pas honnête…
— Je le sais bien. Nous nous occuperons de lui une fois que nous aurons gagné la course. Que dirais-tu d’un petit voyage en Italie pour visiter la splendide demeure romaine du comte Sfonsa ?
— Je dirais que j’aimerais déjà y être.
Dès que le drapeau à damier avait été abaissé, Paulin Nerse se colla dans le sillage de l’Italien. Si peu à peu celui-ci le décrocha, l’équipage français n’avait que quelques minutes de retard à Perpignan. Mais, dans les Pyrénées, dès les premiers lacets enneigés, ils eurent l’Isotta-Fraschini en point de mire.
— Bravo, Patron ! Il ne vous reste plus qu’à les doubler.
— Certainement pas ! Laissons-les s’épuiser à faire la trace pour nous.
Le mécanicien du comte Sfonsa informa ce dernier que le Français gagnait du terrain. L’Italien enfonça un peu plus la pédale d’accélérateur de sa machine pour forcer le passage dans la neige fraîche. Dans la descente, il accéléra encore pour reprendre ses distances, sans succès. Dans la montée du troisième col, une volute blanchâtre s’éleva du capot moteur du bolide italien.
— Sens-tu la bonne odeur de l’huile brûlée, mon vieux Grognard ? Sens-tu l’odeur de la victoire ? La prétention et l’entêtement de Sfonsa lui ont fait commettre l’erreur de pousser trop loin sa mécanique.
Quelques centaines de mètres plus loin, l’Isotta-Fraschini poussa un dernier hoquet et s’immobilisa contre un talus de neige. Paulin Nerse la doubla en klaxonnant autant qu’il put et en le saluant de sa casquette. En se retournant, Grognard aperçut le comte Sfonsa s’emporter contre son mécanicien, qui avait déjà le nez dans le moteur.
Paulin Nerse ne relâcha pas son effort et, malgré les conseils de son compagnon, ne prit pas une minute de repos, si ce n’est pendant les quelques minutes nécessaires au ravitaillement en carburant et aux inspections indispensables de Grognard. Il prit tous les risques, même la nuit, frôlant les rochers et les précipices, dérapant dans les virages, traversant les villages endormis à toute vitesse. Il déboula enfin à Biarritz.
Cette fois, ce fut lui qui fut accueilli en triomphateur et eut les honneurs de la presse et des spectateurs. Le capot de la voiture du comte Sfonsa ne pointa qu’avec plusieurs heures de retard. Après cet exploit, la course était relancée. Paulin Nerse n’avait plus que cinq petites minutes de retard au classement général. Tout allait donc se jouer dans les deux dernières étapes.
Si le comte Sfonsa en avait rabattu, Paulin Nerse ne put s’empêcher, devant la presse, de cabotiner, de faire le beau. Affichant ouvertement son chauvinisme et son côté cocardier, il donna rendez-vous aux journalistes place de la Concorde.
— Ne vendez pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué, se permit Grognard.
— Allons, de l’optimisme, que diable ! Ne gâchons pas notre plaisir ! As-tu vu la tête de l’Italien ? Il a le portrait de la défaite. Une nouvelle fois, Lupin va triompher. Je te le prédis. Je te l’annonce.
IV L’ASSASSINAT DE PORT-LAUNAY
Laissant Biarritz derrière eux, les huit automobiles encore en course s’élancèrent pour l’avant-dernière étape, qui devait les conduire à Brest. Rapidement l’Isotta-Fraschini du comte Sfonsa et la Mors de Paulin Nerse se détachèrent. Dans un mano a mano incroyable, la lutte se poursuivit jusqu’à Nantes. Quand l’Italien prenait la tête, le pilote français louvoyait dans ses roues pour profiter de son aspiration et de nouveau le dépasser. L’engouement populaire pour ce Marathon de la route était incroyable. Sur les bords du parcours, dans les villages, des enfants agitaient des drapeaux, bleu, blanc et rouge. Des banderoles au nom du nouvel héros, Paulin Nerse, s’étalaient sur les façades, pour la plus grande joie de celui-ci.
Grâce à sa formidable condition physique, réduisant ses temps de récupération aux stricts ravitaillements en carburant et arrêts techniques, Paulin Nerse prit le dessus. Dès les premiers kilomètres après Nantes, il distança le comte Sfonsa qui, lui, accusait la fatigue.
— Il ne tient pas la cadence, le petit Italien, pérora Arsène Lupin. Cette fois-ci, il ne s’en relèvera pas. La victoire nous tend les bras, ajouta-t-il en criant pour que Grognard l’entende.
Même au milieu de la froide nuit d’hiver, emmitouflé dans de lourds manteaux, un maigre public soulevait ses lampes tempête pour saluer son passage. Tels des fantômes, dans un bruit d’enfer, Pontchâteau, Nivillac, Vannes, Lorient, Quimperlé et Quimper… furent avalés à toute vitesse. Dans l’aube naissante, les premières maisons de Châteaulin apparurent. Des travaux les ralentirent, et les induire en erreur. À une fourche, Paulin Nerse prit sur sa gauche une route qui longeait l’Aulne. Il s’arrêta à l’ombre de l’immense viaduc de chemin de fer de la ligne Quimper-Brest, qui enjambe à cet endroit le petit fleuve. À la lumière d’une lampe torche, il examina attentivement la carte routière.
— Sacre bleu ! Nous nous sommes trompés. Il nous faut faire demi-tour, pour reprendre la route de Pont-de-Buis.
Soudain, des cris perçants couvrirent le bruit du moteur, qui ratatouillait au ralenti. Paulin Nerse et Grognard tournèrent la tête de droite et de gauche sans rien remarquer. De nouveaux appels au secours lancés par une voix féminine les firent porter leurs regards sur le tablier du pont de chemin de fer, juste au-dessus d’eux. Deux ombres en poussèrent une troisième par-dessus le parapet. Après une chute qui parut interminable, le corps disparut dans l’eau du fleuve.
— Si elle est vivante après une telle chute, elle est bénie des dieux, affirma Paulin Nerse en se débarrassant de son accoutrement de pilote.
Sans plus réfléchir, il plongea dans l’eau froide et nagea vigoureusement vers le milieu du cours d’eau, où la jeune femme avait disparu. L’eau était glaciale et Arsène Lupin sentit ses muscles se raidir. Il dut plonger à plusieurs reprises avant de retrouver le corps de la malheureuse. La quatrième tentative fut la bonne.
À l’aveugle, ses mains en avant frôlèrent un bout de tissu et l’agrippèrent. Il remonta le corps de la jeune victime, lui maintint la tête hors de l’eau et nagea vigoureusement vers la rive. Grognard l’aida à reprendre pied sur la berge et à sortir la malheureuse de la rivière.
— Elle est vivante, je crois, haleta-t-il, grelottant de froid.
Grognard la couvrit de sa propre pelisse en épaisse fourrure. La victime tremblait de froid et gémissait doucement en répétant d’une voix à peine audible : « Je ne sais pas nager. » Il la tourna pour l’aider à vomir et à cracher de l’eau.
— Patron ! Je crois qu’elle a une jambe cassée et elle a un gros hématome sur la droite du visage.
Arsène Lupin se pencha sur elle. La jeune fille devait avoir tout juste vingt ans. Son visage, aux traits fins, affichait une douceur angélique. Il lui prit le pouls, qui était faible comme sa respiration.
— Mademoiselle, m’entendez-vous ?
À sa question, il n’eut pas de réponse.
— Il n’y a pas une minute à perdre. Installe-la à ta place pendant que je me change.
Arsène Lupin mit des vêtements secs et entreprit de se refaire le visage de Paulin Nerse, ayant perdu moustache et perruque durant son bain forcé. Grognard s’installa comme il put, le pied sur la poignée du coffre à bagage, ses mains accrochées au dossier du siège passager. Ils retournèrent à Châteaulin et, grâce aux indications d’une paysanne, ils s’arrêtèrent devant la gendarmerie. Paulin Nerse expliqua la situation au maréchal des logis de permanence.
— Il faudrait faire une déclaration en bonne et due forme.
— Mais cela va prendre des heures et j’ai une course à gagner, moi ! s’exclama-t-il.
— C’est vrai, Chef, assura un jeune gendarme. C’est Paulin Nerse, c’est le pilote qui est en tête du Marathon de la route automobile. Si on le retient trop longtemps…
Le gradé leva les yeux et l’examina attentivement.
— Je ne vous avais pas reconnu. Filez ! L’Italien est passé il y a seulement quelques minutes. Nous vous enverrons ce soir quelqu’un pour prendre votre déposition.
Rageusement, Paulin Nerse embraya et démarra vivement. Grognard ne l’avait jamais vu dans cet état. Les mains rivées au volant, jouant du levier de vitesse comme un virtuose, il donna à tous une leçon de pilotage. La Mors sautait d’un virage à l’autre, avant d’accélérer dans un nuage de poussière dès que la route le permettait. Malgré toute la vista et la maestria de son pilote, rien n’y fit. Lorsque la Mors tricolore se présenta sur la place Sadi-Carnot à Brest, le comte Sfonsa jouissait de sa victoire. Debout sur le capot de son bolide, les bras levés, il affichait un sourire d’une rare arrogance. Il s’adjugeait sa troisième victoire d’étape. Il était toujours en tête du classement général et avait même conforté son avance pour la porter à plus d’un quart d’heure.
À l’hôtel Continental, où coureurs et organisateurs avaient pris leurs quartiers, les discussions allaient bon train. Poussés par certains journalistes et supporters de Paulin Nerse, certains demandaient que, dans les calculs, on prenne en compte le temps qu’il avait perdu pour venir au secours de cette pauvre jeune fille dont il avait sauvé la vie. Le comte Sfonsa ne l’entendait pas de cette oreille.
— Le règlement, que le règlement, mais tout le règlement, répétait-il à l’envi.
Louis Forat et ses associés étaient bien embêtés. En droit, le pilote italien avait raison mais, ne rien faire, et la vindicte populaire, serait terrible. Les journaux ne manqueraient pas de pointer du doigt leur manque d’humanité. C’est Paulin Nerse, lui-même, qui leur trouva la solution. Après s’être entretenu avec son ami, il se présenta devant la presse pour une prise de parole restée célèbre.
— Mes chers amis, je vous remercie du soutien que certains d’entre vous m’ont apporté. Mais, ne croyez-vous pas que l’important soit qu’une vie ait pu être sauvée ? De plus, je suis un homme qui respecte la loi et les règlements. Je ne demande aucun passe-droit. Le classement est donc ce qu’il est. J’ai quelques minutes de retard sur mon adversaire, c’est vrai. Ce n’est que broutille. Et comme je vous l’ai déjà dit, je compte bien arriver place de la Concorde en vainqueur, en ayant battu le comte Sfonsa sans l’aide de qui que ce soit.
Alors qu’il regagnait sa chambre, Grognard lui glissa dans l’oreille :
— Parce que, vous, vous respectez les lois et les règlements, Patron ?
— Arsène Lupin, non, mais Paulin Nerse, oui !
Dans l’après-midi même, un inspecteur de police du nom de Lambélec vint prendre sa déposition. À cette occasion, il apprit que la jeune femme avait été transférée à l’hôpital à Brest. Elle était toujours entre la vie et la mort et n’avait pas repris conscience. L’enquête ne faisait que commencer, mais la police semblait bien démunie, n’ayant même pas réussi à établir l’identité de la victime.
— Aucune personne répondant à son signalement n’a été portée disparue. Nous lançons un appel à témoins qui passera demain dans la presse. Vous-même, vous ne pourriez pas faire une description plus précise de ces agresseurs ?
— Je vous l’ai dit, le jour se levait à peine, et puis j’étais loin. Il me semble juste que les deux hommes étaient de haute taille et d’une forte stature.