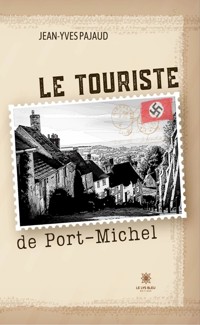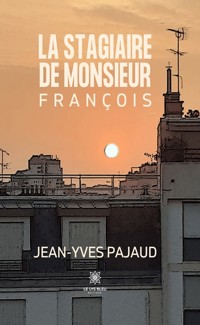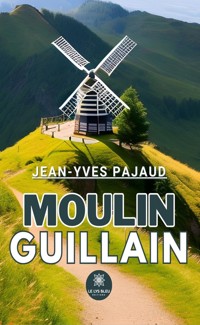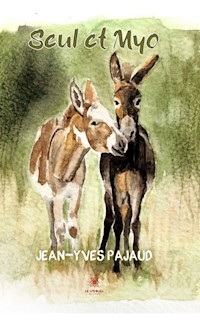Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Enfant unique élevée dans le cocon protecteur de sa famille congolaise, l’avenir d’Esther semblait tout tracé. C’était sans compter un bouleversant séjour à l’hôpital puis la tragédie de la guerre civile qui la contraint à fuir son pays. Réfugiée en France, les hasards de la destinée s’acharnent à la détruire. Paradoxalement, sa nature tendre et attachante, absolument pas préparée à affronter les coups du sort, révèle au fil des pages une étonnante capacité à rebondir. Sans jamais perdre espoir malgré les déboires successifs, elle retrace son odyssée d’une plume trempée dans les larmes, l’ironie et l’humour…
À PROPOS DE L'AUTEUR
La lecture a permis à
Jean-Yves Pajaud de surnager au long d’un parcours scolaire chaotique. Beaucoup plus tard, la presse réveillera sa passion pour l’écriture tout en affûtant son style. Par la suite, les manuscrits s’accumuleront avant qu’une belle rencontre l’incite enfin à les publier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean-Yves Pajaud
Le feu à l’âme
Roman
© Lys Bleu Éditions – Jean-Yves Pajaud
ISBN : 979-10-377-6369-3
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
À mon amie B…
qui, en évoquant son enfance au Congo, m’a permis de puiser dans le décor de ses réalités…
Partie I
Chapitre 1
Elle tape au carreau de la fenêtre fermée.
En vain.
Elle recommence ses « tac-tac », une fois, deux fois, dix fois, sans plus de résultat : on ne traverse pas une fenêtre close, même celle d’une chambre d’hôpital.
J’ai mal, par instants. Entre deux élancements, son petit bruit m’exaspère : le supplice de la goutte d’eau, version mouche en quête de liberté.
Que sait-elle de la liberté, de son ivresse et de ses dangers ? De guerre lasse, elle est venue se poser sur mon drap, à quelques centimètres de mon visage de gamine. « Tu veux quoi ? De l’aide ? OK ! Je vais voir ce que je peux faire… Mais je te préviens : ici, tu ne risques rien ou pas grand-chose. Dehors, c’est l’inconnu et le risque de mourir à chaque instant, celui de finir en petit déjeuner du premier oiseau qui passe… »
Rien qu’évoquer le petit déjeuner me donne envie de vomir.
J’ai mal.
La mouche, sourde à mes conseils, indifférente à mes souffrances, a repris son combat, inutile et têtu, contre la vitre. L’aube paresseuse repeint le ciel. Le jour se lève sur Brazzaville.
« Ça va, petite mademoiselle ? »
Elle a l’âge et la bienveillance d’une maman. Je tente : « Il fait trop chaud… Vous voulez bien ouvrir la fenêtre ? »
Un spasme me crispe le visage. Pour une fois, je ne vais pas me plaindre : c’est un avocat aussi efficace qu’inattendu. Le meilleur !
« Bon… J’ouvre mais un petit peu… et pas trop longtemps… » La douleur n’atténue en rien mon triomphe mais elle m’exonère de répondre et de remercier. La mouche ne peut invoquer une quelconque excuse à sa propre ingratitude. L’appel du destin a été le plus fort. Elle m’a abandonnée à mon sort sans le moindre remords : elle apprend vite la Loi du chacun pour soi. « Et Dieu pour tous », ajouterait Nka-Nka, ma grand-mère. Mes doigts se joignent mais c’est plus pour conjurer une nouvelle crise que pour prier. Évidemment, Il ne peut pas être partout mais, tout de même, il m’a bien laissée tomber sur ce coup-là !
Il est trop tôt pour que l’agitation de l’hôpital gagne le couloir du Service. Par la porte de la chambre restée entrouverte me parvient le bruit d’un pas que je connais trop bien : maman !
Elle est entrée sans frapper, sans la moindre appréhension, comme si elle avait fait ça toute sa vie.
Normal. Elle a fait ça toute sa vie. Enfin presque, depuis qu’elle a commencé ses études de médecine. Elle est pédiatre. Je ne me souviens pas l’avoir déjà vue en blouse blanche, stéthoscope autour du cou. Ou alors, il y a longtemps. À moins que les spasmes vicieux aient fermé provisoirement les portes de ma mémoire.
D’un coup d’œil circulaire, elle repère tout de suite ce qui cloche : « Qui a bien pu laisser cette fenêtre ouverte ? » La question n’est adressée à personne et l’incongruité est vite réparée. Trop tard ! Le forfait est accompli depuis longtemps, l’évasion a réussi mais si je ne proteste pas c’est surtout parce que je… commence à avoir froid !
Parce que sa silhouette est en contre-jour, j’ai l’impression que son visage reste impassible. Le son de sa voix me semble dénué de chaleur affectueuse, comme si j’étais une patiente ordinaire. Sa main tiède glisse le long de ma joue sans vraiment apaiser mes tourments…
Papa ! Papa ! Oh ! Comme je voudrais que tu sois là. Toi aussi, tu es médecin, gastro-entérologue renommé, au Congo et à l’étranger. Mais voilà : tu travailles dans un autre hôpital de Brazzaville et tu n’es pas homme à laisser les malades qui t’attendent, même pour accompagner ta fille chérie, ton enfant unique. Tu sais que maman est près de moi, que le personnel et tes confrères sont compétents et que je ne risque rien.
Non… Je ne t’en veux pas. Je me demande si ce n’est pas ton magnifique amour, tes torrents de tendresse, ta vigilante protection dont je suis la seule bénéficiaire qui t’ont fait préférer te noyer dans le travail pour ces quelques heures. Pour ne pas ajouter ton inquiétude à mon angoisse.
Maman n’est pas maman. Enfin, je veux dire que ce n’est pas celle qui m’a mise au monde. Cette maman-là, je ne l’ai pas connue. Lorsque mes parents se sont séparés, je n’avais que huit mois. D’aussi loin que les souvenirs explorent mon passé d’adolescente, un brouillard épais s’oppose à leurs investigations.
J’ai mal. Une fois de plus. Et ça dure depuis cette nuit.
C’est la douleur qui m’a réveillée. Pas véritablement une surprise. Je sais depuis des semaines que ça se terminera à l’hôpital. Maman m’avait prévenue : « Si tu ressens des douleurs insupportables, tu le dis. Si c’est la nuit, tu nous réveilles… » Ils dormaient et ce n’était pas « insupportable ». Alors, je suis allée aux toilettes et je me suis recouchée. Le manège s’est reproduit plusieurs fois. Douloureux, oui, mais pas « insupportable ». Jusqu’à la dernière, alors que je savais qu’à cette heure-là, mes parents sont debout.
Je crois que, rien qu’à ma tête, ils ont compris : « pourquoi tu ne nous as rien dit ? ».
Le soupir d’exaspération de maman se noie dans le tourbillon : retour dans ma chambre, auscultation et verdict : « On part tout de suite ! »
Les vingt minutes séparant la maison de l’hôpital ne m’ont jamais paru aussi courtes. Logique : parce qu’il faisait encore nuit et les rues désertes, maman a battu tous les records au volant de son 4x4. Pas le temps d’avoir peur, d’avoir mal, de penser au collège et à mes amis qui vont s’inquiéter de mon absence. Tout va très vite, trop vite.
On arrive.
Tout le monde connaît maman. Le sommeil qui pouvait s’insinuer sournoisement chez le personnel en fin de garde de nuit observe un repli stratégique en urgence. Je m’abandonne dans le brouhaha des voix, des ordres, des bras qui se tendent et me soulèvent. Puis, soudain, le silence de la chambre, la demi-obscurité vaguement contestée par une veilleuse faiblarde dans le couloir et la solitude.
Enfin presque. Des « tac-tac » répétés se succèdent en provenance de la fenêtre… Vous connaissez la suite… Mais pas la fin : je m’appelle Esther, tout juste 16 ans, collégienne en 3e et, d’ici peu, je vais être maman.
Chapitre 2
Un jour, papa s’est marié. Il vécut heureux et eut beaucoup… de ce qu’on veut mais pas d’enfant.
À part moi.
Mais moi, je ne compte pas parce que j’étais là depuis six ans. Beaucoup plus tard, j’ai appris un poème de Victor Hugo qui commence ainsi : « Lorsque l’enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris ».
Chez nous, ce fut plutôt « lorsque maman paraît » ! Le cercle de famille s’est (un peu) agrandi mais l’enfant n’a pas applaudi et pas poussé de cris non plus. Même pas pleuré… enfin peut-être, pas beaucoup, juste assez pour que personne ne s’en aperçoive. Et surtout pas papa ! Pour rien au monde, je n’aurais voulu lui faire de peine. N’empêche qu’il brisait notre duo et mon petit royaume.
Surtout mon petit royaume.
Jusque-là, les règles de ma vie étaient simples : « Vous la laissez faire. Interdiction de la gronder ni de lui apprendre des tâches si elle ne le réclame pas. » Les domestiques appliquaient la consigne à la lettre et cela me convenait tout à fait ! Donc, moi aussi, je me conformais à son souhait, si bien que je passais pour une enfant facile à vivre… si on veut bien oublier quelques caprices : « Que voulez-vous, c’est de son âge ! » Cette touchante mansuétude tenait probablement pour beaucoup d’un cas de famille rarissime au Congo et même en Afrique : un homme qui élève tout seul sa petite fille !
Cela conduisait parfois à des situations surprenantes. Ainsi, lorsque ma grand-mère n’était pas disponible et qu’il n’avait trouvé personne pour me garder, mon père allait travailler à l’hôpital avec sa progéniture unique mais encombrante, à bout de bras, dans son couffin.
Mon entrée à l’école maternelle chez les Religieuses régla en grande partie le problème. L’école communale lui succéda alors que je n’avais pas encore soufflé mes six bougies. Bien sûr, je m’étais rendu compte du changement d’école et de maîtresse mais, apparemment, personne ne m’avertit qu’en Primaire, il faut travailler. Alors, je faisais… ce que je faisais et pas du tout le reste. Je suppose que l’enseignante s’en ouvrit à mon père. Il la rassura certainement, lui promit tout ce qu’elle souhaitait et m’expliqua – bien que je n’en aie aucun souvenir – qu’il serait judicieux de faire quelques efforts. Comme j’ignorais ce que recouvrait le mot « effort » et que je manquais d’entraînement dans ce domaine, l’année scolaire s’écoula sans plus de progrès.
Maman n’est pas arrivée à la maison par surprise, encadrée par deux valises. Elle venait de plus en plus souvent et le mariage se prépara petit à petit. N’ayant pas vraiment vécu la période papa-maman-Esther précédente, je n’y voyais aucun inconvénient.
Dire que je l’aimais, non. Son apparence sévère m’impressionnait et notre relation en pâtit sur le long terme : jamais je n’ai osé lui demander quoi que ce soit et mon père est toujours resté l’interlocuteur unique de toutes mes requêtes.
* * * * *
La perspective de rencontrer la famille de ma future maman le jour du mariage m’inquiétait un peu. J’étais certainement un peu farouche à l’époque mais, surtout, je n’étais pas habituée à côtoyer plusieurs inconnus à la fois. Or, elle avait trois sœurs… et six frères auxquels il fallait ajouter ses parents, quelques oncles, tantes et cousins… Le mariage coutumier dura plusieurs heures qui me semblèrent une éternité bruyante de palabres, de cris et de rires. La tradition peut paraître étrange aux non-initiés : le futur époux se doit d’offrir aux membres de la famille de sa fiancée les cadeaux que chacun lui réclame.
Papa, évidemment très occupé, je me réfugiai près de ma famille au complet, c’est-à-dire de Nka-Nka, ma grand-mère. Elle-même entourée et de plus en plus sollicitée, une grosse pierre à l’ombre s’offrit comme siège, abri pour ne pas dire comme cachette. J’étais terrorisée !
Je ne sais plus qui m’avait désigné deux garçons un peu plus âgés que moi, susceptibles de m’accueillir dans leurs jeux. Pas fâchée d’échapper à ce monde d’adultes, je m’enhardis. Au moment de les aborder, un dragon me barra le passage. Un regard furibond, une moue méprisante relayée par une voix aiguë et criarde qu’accompagna un mouvement péremptoire du bras pour me renvoyer d’où je venais comme si j’avais franchi la frontière d’un territoire interdit. Sans doute son comportement ne contenait-il pas tant de violence mais c’est ce que je ressentis. C’est ainsi que je fis la connaissance de la mère de maman…
La cérémonie me plut lorsqu’elle se termina. À partir de ce soir-là, nous étions trois à la maison. Le « vrai » mariage se déroula quelques semaines plus tard.
La précédente expérience m’avait suffisamment aguerrie pour me confronter à tous ces gens qui constituaient la famille de maman. Ce que j’ignorais, c’est que tous les amis et les connaissances de papa et maman étaient conviés. Mais, finalement, me noyer dans la foule devait me protéger et me rendre invisible.
C’est alors qu’on vint me chercher…
On me présenta comme un merveilleux cadeau l’honneur de tenir la traîne de la mariée. Marcher au beau milieu des deux rangées d’invités entre la mairie et l’église puis de l’église au lieu de la fête m’effraya tout à fait.
Une sœur de maman eut beau déployer des trésors de gentillesse, elle ne parvint pas à me convaincre. Elle commit l’erreur d’appeler du renfort. À trois ou quatre, elles ne réussirent qu’à me faire fondre en larmes. L’impatience et l’énervement commençaient à gagner lorsque papa intervint. Il s’accroupit devant moi, m’apaisa d’une caresse sur la joue, souleva l’étoffe de terre et me la tendit. Il ne prononça pas un mot. Son regard parla le langage secret de notre complicité de toujours.
J’entendis à peine le murmure de satisfaction, de soulagement et de réprobation contenue qui escorta ma mise en place entre les deux garçons qu’on m’avait interdit de rejoindre quelques semaines plus tôt. Plus âgés et surtout plus grands que moi, leur présence me rassura. Je m’ingéniai à me blottir entre eux afin qu’ils me cachent au mieux. Ce fut une réussite : sur les quelques photos que j’ai eues plus tard entre les mains, on me distingue à peine…
De deux ou trois ans mon aîné, le plus jeune des deux garçons – en fait le petit frère de maman – se mit à me parler et contribua à me rasséréner. De cet épisode peu glorieux naquit une amitié dont seul l’éloignement érodera les contours.
La corvée enfin terminée, les festivités me parurent interminables aussi longtemps que papa me resta inaccessible. Un véritable jeu de piste !
Bien sûr, il me fallait rester éloignée de cette nouvelle grand-mère vindicative dont les circonstances m’affublaient à vie. Ce n’est que beaucoup plus tard que je compris que cette gamine préfabriquée dans le ménage de sa fille lui était insupportable. Pour une fois, ma petite taille s’avérait un atout. Je parvenais à me glisser de groupe en groupe jusqu’à me coller contre la jambe paternelle. S’il n’interrompait pas sa conversation, je sentais sa main rassurante se poser sur mon épaule. Je n’en demandais pas plus.
* * * * *
Notre vie de famille pouvait réellement débuter par une période d’observation où j’appris à appeler « maman » l’épouse de mon père. Cette habitude-là s’installa plus aisément que la cohabitation inédite à la maison. De ces premiers temps, je retiens les regards réprobateurs, les soupirs excédés et les sourcils froncés. Je ne tardais pas à comprendre que maman allait prendre en main mon éducation en instaurant des règles totalement inconnues. Tout aussi clairement, il ne me fallait pas compter sur le secours de papa pour me rendre à mon univers anarchique. À l’évidence, il abondait dans le sens de réformes qu’il n’avait su mettre en place lui-même.
J’entrais néanmoins en résistance.
À chaque nouvelle corvée qu’elle prétendait m’imposer, j’y allais de ma protestation : « Mais j’ai jamais fait ça… », « Je suis trop petite… », « Je sais pas comment il faut faire… », « J’y arriverai jamais… » Sans doute avait-elle moins d’imagination que moi car maman n’opposait qu’une formule, toujours la même : « Eh bien, tu vas apprendre ! »
Il me restait la ruse.
Une maladresse insigne faillit mettre à mal le contingent de verres et d’assiettes de la cuisine. Ramasser les morceaux des victimes de mon incompétence volontaire me remplissait d’une joie secrète que je masquais derrière une mine piteuse et désespérée. Mais elle ne céda pas : j’appris à faire la vaisselle.
Nous n’avions pas de machine à laver. Là encore, je n’échappais pas à une laborieuse initiation. Pour ne pas décourager mon embryon – soyons généreux ! – d’enthousiasme, maman limita l’expérience à mes petites culottes. Peut-être craignait-elle de lâches attentats contre ma garde-robe dont il aurait bien fallu envisager le remplacement. Mais, de mon point de vue, c’était encore trop. Elles disparurent du paquet de linge sale. Le stratagème fit long feu. S’étant assurée – je passe sur les détails – que je ne m’étais pas abaissée à n’en utiliser qu’une seule, jour après jour, elle fit une intrusion-surprise dans ma chambre. J’avoue que le butin s’avéra fructueux : deux sous le lit, une sous l’oreiller, une sous le matelas et les autres, bien visibles dans l’armoire au milieu des propres. L’après-midi fut très occupé… Une bien mince consolation me tint compagnie devant l’évier : elle n’avait pas découvert la dernière, perchée sur le dessus de l’armoire au bout de plusieurs tentatives de lancers.
Elle n’eut pas à instituer le brossage des dents après les repas que papa m’avait enseigné. Mais, contrairement à lui, elle émit rapidement des doutes sur mon savoir-faire. Pourtant, je laissais couler l’eau dans le lavabo et un peu de dentifrice sur l’index passé sur les incisives complétait l’alibi. Dans un premier temps, elle observa l’énergie que je déployais autant pour la satisfaire que pour endormir ses soupçons. Avait-elle un détective parmi ses ancêtres ou lisait-elle trop de romans policiers ? Mon haleine rafraîchie copieusement soufflée devant son nez ne réussit pas à occulter la naïveté de ma défense. Je laissais trop d’indices révélateurs : difficile de prétendre s’être brossé les dents alors que la brosse restait sèche et propre… et comment expliquer la rapidité de l’opération lorsque j’étais seule ?
On apprend toujours de ses erreurs : je mouillai consciencieusement la brosse et patientai longuement devant le lavabo. L’ennui me gagna et je ne trouvai qu’un moyen pour l’occuper : me brosser réellement les dents…
J’aurais pu m’en dispenser lorsque je sautais un repas. Avec maman, c’en était fini des menus de remplacement lorsque je n’appréciais pas le plat servi, à commencer par le poisson fumé aux blettes. Le « j’aime pas ça » non recevable, contrecarré par « il faut manger de tout », il ne restait que le sempiternel « j’ai pas faim… » qui présentait l’inconvénient suprême de devoir rester clouée sur ma chaise jusqu’à la fin du dîner, torturée par la vision d’un dessert qui m’était logiquement interdit.
Mais là, j’avais une parade…
Papa n’avait pas renoncé à nos tête-à-tête sans témoin. Le moment sacré, c’était le jeudi après-midi. Il m’emmenait faire les courses au supermarché avec le droit de choisir ce qui me faisait envie. J’avais déjà conscience qu’il n’existe pas de comportement plus mal élevé que de refuser la générosité des autres. Avec lui, c’était facile à mesurer : plus les boîtes de gâteaux et les bonbons s’accumulaient dans le sac, plus son sourire s’élargissait…
De retour à la maison, les friandises rejoignaient une grosse boîte en métal, généralement vide des achats de la semaine précédente. La diète consécutive à la privation de dessert était donc de courte durée. En grandissant, le système s’améliora. Aux effluves me parvenant de la cuisine, il était facile de deviner le menu. Un goûter un peu tardif à base de chocolat chaud régla le problème en amont !
Les quelques mois que durèrent ces rattrapages éducatifs atteignirent leur point culminant à la fin de l’année scolaire. Plus ou moins fièrement, je revins à la maison en exhibant un bulletin – pour moi indéchiffrable – qui m’envoyait en classe supérieure. Mes lacunes étaient abyssales et maman fit un petit scandale à l’école. Elle en revint avec mon redoublement et la promesse d’un suivi rigoureux de mon travail à la maison.
En dehors de la parenthèse du jeudi au supermarché, dès le retour de l’école, elle s’occupa de mes apprentissages scolaires sans relâche. La métamorphose s’opéra en peu de temps : la curiosité et l’appétit d’apprendre me gagnèrent et j’oubliais vite mes petits jeux solitaires de l’après-midi. Je devenais attentive en classe ce qui allégeait d’autant le cours particulier. Les résultats ne se firent pas attendre. Par ricochet, les autres exigences de maman m’apparurent pertinentes ce qui atténua d’autant mes griefs et scella nos relations sans néanmoins altérer mon lien privilégié avec papa.
Merci pour tout, maman.
Chapitre 3
De la petite enfance d’avant l’intrusion qui a bouleversé notre existence, les souvenirs sont rares ou fabriqués avec ce qui m’a été raconté. La béquille no 1 de ma mémoire défaillante, ce fut, sans conteste, Nka-Nka.
Divorcée de longue date, ma grand-mère n’avait gardé de son mariage qu’un bien précieux : papa. Elle habitait à Mabaya, un village tout proche. En France, on dirait en banlieue. Elle gagnait sa vie sur les marchés de Brazzaville en vendant du poisson séché. Elle ne se plaignait pas mais c’était certainement très dur. Régulièrement, elle partait, en train, s’approvisionner sur le marché de gros de Pointe-Noire, soit mille kilomètres, aller-retour. Elle y séjournait quelques jours dans une petite maison qu’elle y possédait et devait rencontrer les autres membres de sa famille. « Devait », car elle ne m’en parlait jamais et je ne l’y ai jamais accompagnée. Puis elle rentrait avec ses ballots de poissons baignant dans le sel.
Beaucoup plus tard, lorsque l’âge et la fatigue la contraindront à renoncer à son métier, elle ne pourra s’empêcher d’ouvrir une boutique dans son petit garage. Ainsi, dans son village, elle exercera plus ou moins officiellement la profession de commerçante « à l’Africaine », c’est-à-dire qu’elle vendait de tout, à tout le monde, avec un savoir-faire et un bagout sans égal.
Être avec elle était un bonheur incomparable : fille unique d’un papa lui-même fils unique et souvent absent à cause de son métier, Nka-Nka était donc à la fois ma grand-mère, ma seule famille, mon amie, mon refuge et ma confidente.
C’est elle qui, beaucoup plus tard, me raconta que mon père avait, après la séparation de mes parents, cherché à refaire sa vie. Mais si une ou plusieurs femmes sont venues vivre à la maison, elles n’y sont pas restées suffisamment longtemps pour s’imprimer dans ma mémoire de toute petite fille.
Les Religieuses de l’école maternelle non plus. Puis, un jour, j’ai pris le chemin de l’école communale. Pas toute seule ! Papa m’y emmenait et revenait toujours me chercher. Il est grand, j’étais toute petite mais je me demande lequel de ce couple déséquilibré était le plus heureux sinon le plus fier de tenir la main de l’autre…
À partir de mon redoublement, j’ai beaucoup aimé l’école. C’était le seul endroit où je pouvais côtoyer des enfants de mon âge. Même si je n’en souffrais pas, la maison avait des allures de prison dorée. Je crois que papa était terrorisé à l’idée que sa petite Esther puisse courir le moindre danger. Personne n’était invité à la maison et je n’allais nulle part.
Sauf à l’école.
La tutelle vigilante de maman s’avéra d’une miraculeuse efficacité. Non seulement le retard se combla rapidement mais elle m’enseigna une méthode de travail qui rendit les apprentissages faciles.
Au bout de deux ans, les progrès m’offrirent le cadeau de l’autonomie et de la confiance. En parallèle, je commençais à aller à l’école toute seule et à aller jouer chez des copines du voisinage, le week-end ou pendant les vacances.
* * * * *
C’est à l’école que j’ai rencontré mon premier amour. Il s’appelait… Amand ! Je ne savourais pas alors la coïncidence phonétique entre son prénom et son rôle prédestiné.
Nous appartenions à la même vague, c’est-à-dire que nous avions classe ensemble, le matin ou l’après-midi, au rythme du système scolaire. Ne connaissant personne, n’ayant pas l’habitude de jouer avec d’autres enfants, je m’étais d’instinct isolée dans mon coin et personne n’était venu m’y chercher… sauf lui !
Il faut dire qu’Amand et moi partagions plus ou moins équitablement et en exclusivité les premières et deuxièmes places dans toutes les matières. Ce combat acharné nous rapprochait dans une saine émulation qui ne s’embarrassait d’aucune jalousie. Nos brillants résultats contribuaient aussi à nous mettre à l’écart du reste d’une classe lassée des louanges inaccessibles que nous tressaient nos maîtres.
Nous nous sommes mariés au moins dix fois pour à peu près autant de séparations tout aussi définitives. C’est lui qui a commencé : « Quand on sera grands, je t’épouserai avec un mariage et il y aura plein de gens ! »
Mon expérience de cette cérémonie était unique et malheureuse. Amand les collectionnait ! Il se lançait dans une telle description aussi détaillée qu’enthousiaste des festivités qu’il n’eut aucune difficulté à me convaincre. Mais, « grands », c’était bien loin, trop pour mon impatience émerveillée. C’est ainsi que débutèrent des préparatifs secrets aux allures de complot.
Le lieu s’imposa d’évidence. Les toilettes étaient au fond de la cour. L’espace entre leur cloison et le mur de l’école était exigu mais néanmoins suffisant pour nous deux. L’atout majeur était ailleurs : l’endroit était discret et surtout hors de vue du maître qui surveillait la récréation !
Pour nos tenues vestimentaires, ce fut plus compliqué. Surtout pour moi. Amand décréta qu’il revêtirait le tee-shirt reçu à Noël : « Il est blanc avec une grosse moto rouge du Paris-Dakar. Tu verras, il est super beau ! » Admettons.
À la maison, j’étais tombée sur un magazine, sans doute rapporté d’un voyage quelconque par papa. En le feuilletant, je découvris la photo du mariage d’une actrice de cinéma française. J’en restais éblouie et admirative de sa longue robe blanche. La même, il ne fallait pas y songer mais la couleur suffirait pour le symbole.
Mon armoire subit l’assaut avec un craquement désapprobateur. Je vidais tout ou presque, y compris le panier de linge sale. Tout se mélangea allègrement par terre jusqu’à ce que je trouve enfin le vêtement désiré.
Désiré, certes, mais pas conforme à mon attente : la robe était mettable mais indigne d’un tel évènement. Qu’il manque un petit bouton n’était pas plus rédhibitoire que le minuscule accroc découvert sous la manche droite. À l’essayage, je la jugeais trop courte, trop petite, à sacrifier sur l’autel de ma croissance. Pour achever de convaincre, je testais allègrement la résistance des deux boutons survivants qui cédèrent rapidement. L’accroc se révéla minime et réparable en quelques minutes par une couturière, même débutante. Je poussais alors l’observation plus loin, mesurant minutieusement la largeur de l’ouverture en y glissant un doigt. Puis deux, puis trois jusqu’à prendre des proportions que j’estimais suffisantes.
Mon « œuvre » était un désastre, moins catastrophique que l’autre, celui de l’amoncellement de vêtements par terre, dépliés, froissés et mélangés au hasard de leur chute. Tant bien que mal, je reconstituai approximativement les piles sur les étagères. Ce n’est qu’en admirant mon travail que je réalisai que le panier de linge sale était vide. Qu’à cela ne tienne ! J’entrepris l’opération inverse en vouant une confiance aveugle au hasard jusqu’à obtenir un volume convenable. Pour la suite, j’avais un plan…
* * * * *
Puisque j’étais désormais bonne élève, c’était devenu un vrai petit bonheur de rapporter mon carnet de notes à la maison : le visage fatigué de papa s’éclairait d’un large sourire et ses yeux se mettaient à briller. Il ne me restait plus qu’à grimper sur ses genoux et à me pelotonner dans ses grands bras qui se refermaient doucement sur moi.
Dès que l’occasion se présenta – c’est-à-dire en l’absence de qui vous savez –, je vins me blottir contre sa large poitrine tout en l’abreuvant des preuves de ma tendresse. Lorsque je le sentis mûr à point, je lui susurrai à l’oreille : « Papa… Tu m’achètes une robe blanche ? »
Je n’insistais pas. En rentrant de l’école, le lendemain, la robe de mes rêves m’attendait à la maison…
Pour la bague, je n’avais qu’à piocher dans la boîte de colifichets qui traînait quelque part dans ma chambre. Amand ne savait comment se procurer un anneau mais il trouva la solution sur place. Profitant de l’absence du maître, il dévissa le robinet d’eau, subtilisa le joint et le revissa. Il faut préciser que, pour éviter tout gaspillage, l’arrivée d’eau était systématiquement coupée. La maîtresse qui l’utilisa la première se fit copieusement arroser, l’eau sous pression fuyant de tous côtés. Mais Amand avait son alliance et c’était le principal. Trop grande, il résolut le problème en solidarisant le majeur à l’annulaire.
Restaient le prêtre et la messe. Il était hors de question de solliciter l’un ou l’autre de nos camarades : « Tant pis ! On va faire le prêtre chacun notre tour. »
Il dénicha une vieille écharpe d’un rose criard, reléguée au rang de chiffon qui remplit parfaitement son rôle d’étole éphémère. Malodorante, certes, mais étole tout de même ! La messe, faute de temps, se résuma à la lecture d’un texte. La dictée de la veille fit très bien l’affaire. Au beau milieu de notre cérémonie, mon presque mari s’interrogea soudain : « Comment on va l’appeler, le curé ? » Je pointais du doigt son tee-shirt : « Honda racingue… Ce sera le Père Racingue… »
Personne n’apprit jamais l’existence de cette union aussi païenne que secrète. Nul doute que mon père l’aurait condamnée ainsi qu’Amand, chassé de mon entourage !
Mais, entre les deux hommes de ma vie, je n’eus pas à choisir. Mon époux intermittent ne me suivit pas au collège public. J’étais ainsi séparée de l’Amand de ma prime jeunesse. Il n’y eut pas d’adieux déchirants et même pas d’adieux tout court car nous ignorions, en partant en vacances, que nos tribulations scolaires se vivraient désormais séparément.
Je ne l’ai jamais revu.
Chapitre 4
Papa s’absentait souvent. En tout cas, trop souvent à mon goût. Le Service de gastro-entérologie à l’hôpital l’occupait énormément mais son sens de la générosité et sa Foi l’incitèrent à sillonner le Congo dans les nombreuses régions défavorisées, particulièrement dans le nord du pays.
Il avait adhéré à l’association « Groupe Évangile et Santé » et participait à la création de dispensaires pour les populations locales, privées de personnel médical, de soins et de médicaments. Je le voyais partir avec un petit pincement au cœur mais je le cachais de mon mieux.
Maman avait su gagner mon affection tout en matant mes velléités de caprices. Elle devait aller voir sa famille de temps en temps mais je n’y étais pas conviée, ce qui m’assurait de ne pas me trouver face à sa mère et à la terreur qu’elle m’inspirait.
Sauf à Noël.
Je redoutais la fête qui nous emmenait tous les trois à quelques kilomètres de Brazzaville, dans un endroit assez difficile d’accès : faute de chemin carrossable, il nous fallait abandonner la voiture et marcher pendant vingt minutes au rythme de mes petites jambes. Si je devais aujourd’hui refaire le parcours, il me semblerait certainement beaucoup plus court. De plus, la perspective de retrouver ma pseudo-grand-mère ne m’incitait pas à abréger mon chemin de croix !
Immanquablement, elle me toisait dès le premier regard et me faisait comprendre que s’il n’avait tenu qu’à elle, mon statut d’étrangère à la famille ne m’aurait jamais permis de franchir la porte de sa maison. Que maman n’ait jamais eu d’enfant n’apaisa pas notre relation. Au mieux, elle m’ignorait et, finalement, j’en pris mon parti. Sans doute, la gentillesse et la bienveillance de son mari à mon égard devaient la mettre en rage mais il jouait avec moi le rôle d’un vrai grand-père qui me comblait.
Mon autre interlocuteur préféré, c’était Fanfan, – Francis – mon sauveur du mariage, celui dont le corps filiforme m’avait néanmoins cachée aux yeux de la foule et aux cyclopes des photographes. Les trois ans d’écart avec le plus jeune frère de maman permettaient de partager la banalité des jeux et des conversations des enfants de notre âge. Sans doute aurais-je aimé un petit frère, une petite sœur ou les deux mais la Nature en a décidé autrement.
La Nature mais pas les circonstances.
À défaut de sœurs, elles m’ont affublée de deux tantes, Pascaline et Christiane, de ma famille par les œuvres d’un des frères de Nka-Nka. J’ignorais tout de leur existence et réciproquement, probablement. À la suite de déboires économiques, lors d’une visite de ma grand-mère à Pointe-Noire, cette branche de l’arbre généalogique se rappela subitement l’existence de ce neveu médecin, installé à Brazzaville, une réussite unique dans la famille qui ne pouvait refuser de subvenir aux besoins de deux filles puisqu’il n’en avait qu’une à charge…
À dix-neuf ans, Christiane suivait – de loin – les cours de Première au lycée. Pascaline, dix ans, s’ennuyait franchement en CM1 dans mon école. Sa seule utilité était de m’y accompagner.
Notre maison n’était pas très grande mais il restait une chambre inoccupée qui leur fut logiquement dévolue… et le prétexte du premier incident. Arguant de son âge, l’aînée revendiqua l’usage de la pièce pour elle seule, sa sœur trouvant refuge dans la mienne. C’est ainsi qu’elle fit la connaissance de l’intangible fermeté de maman mais ne s’avoua pas battue pour autant.
Dès que l’opportunité se présenta, elles envahirent ma chambre qu’elles trouvèrent tout à fait à leur goût. Il s’ensuivit une menace larvée et la promesse d’un déménagement imminent. Restée seule, les larmes aux yeux, je commençai à vider l’armoire et à empiler mes affaires sur le lit, ruminant le chagrin de devoir quitter mon petit univers tout autant que l’agressivité de Christiane. Évidemment, ma mine défaite n’échappa pas à mes parents qui réclamèrent une explication. Leur manigance éventée, les deux s’en tirèrent au bénéfice du doute, en assurant avec aplomb que c’était moi qui voulais changer de chambre.
L’incident n’était que le premier d’une longue série. Le jeudi suivant, le remplissage de la boîte de friandises n’échappa pas à la sagacité de Pascaline. Elle se fit une joie de communier au péché de gourmandise. Pour la première fois, dès le samedi, la réserve était à sec. La semaine suivante, c’est la boîte qui disparut le soir même pour réapparaître le lendemain matin, vide évidemment !
Lorsque je voulus protester, forte de ce que j’estimais mon bon droit, elles me traitèrent d’égoïste, de petite gosse de riche, assorti du « conseil » impératif d’augmenter le volume de l’approvisionnement à l’avenir. Papa s’en étonna mais céda devant l’affirmation candide de vouloir partager avec nos hôtes. Il me félicita pour mon bon cœur, même s’il mit bientôt quelques limites à ma générosité. Menacée de représailles douloureuses en cas de mouchardage, je pliais devant leurs exigences qui ne se contentèrent pas longtemps des friandises. Ainsi, ma consommation de crayons, cahiers et autres fournitures scolaires prit des proportions démesurées. Mais c’est lorsque je lui réclamais un flacon de parfum particulièrement coûteux qu’il comprit. Ce soir-là, on m’envoya dans ma chambre plus tôt qu’à l’accoutumée et une explication ponctuée de la menace d’un retour à Pointe-Noire ramena un semblant de normalité dans « mes » dépenses.
Mes parents n’étant pas dupes, ils s’évertuèrent à me blanchir de toute dénonciation. Si cela m’exonéra de tirage de cheveux et autres bras pincés, les tantes s’ingénièrent à varier les brimades quand nous étions seules à la maison. Ainsi, lorsque l’une ou l’autre était de corvée de ménage, j’étais « invitée » à les aider, ce qui les cantonnait dans la tâche d’inspecter la qualité de mon travail.
Ce qui les réjouissait tout particulièrement, c’était le petit déjeuner. Christiane profitait de sa grande taille pour ranger le chocolat et le sucre sur une étagère hors de ma portée. Il me restait à choisir entre le jeûne et l’escalade d’une chaise, en proie à un vertige tenace. Lorsque l’exercice s’avérait trop aisé, l’une ou l’autre prétendait m’aider en tenant la chaise, une merveilleuse occasion de la secouer sournoisement…
Un jour, ma grand-mère arriva avec un vélo tout neuf sous le bras. J’en rêvais. Comme une monture rétive qu’il s’agit d’apprivoiser, je commençais à le flatter de mes caresses et tout le bonheur affiché sur mon visage réjouissait ma généreuse Nka-Nka. En relevant la tête, je croisai le regard courroucé de mes tantes qui ne cherchaient pas à masquer leur jalousie ni leur évidente intention de profiter de l’aubaine tout en me punissant par avance de ma chance exorbitante.
La première fois que Pascaline l’emprunta, il revint avec le guidon tordu. Papa le rectifia en un tournemain : « Tu vois, ce n’était pas grave. Il devait être mal serré… Fais attention, tout de même ! »
Sa patience d’ange n’en finit plus de regonfler les pneus mille et une fois dégonflés, la selle déréglée, la chaîne sautée et les freins malencontreusement dévissés. Bizarrement, les incidents survenaient tout aussi fréquemment pendant mes absences. Il n’était pas question d’émettre le moindre doute sur l’origine des mésaventures de mon pauvre engin. J’avais fini par comprendre qu’elles enviaient surtout la tendre complicité qui nous unissait, papa et moi. Il suffisait d’observer leur satisfaction lorsqu’il me grondait ou me punissait. C’était rare, certainement trop à leur goût.
Avec le vélo, elles perdirent leur temps malgré les sévices qu’elles lui firent subir. Il n’avait pas été conçu pour porter le poids d’un adulte ce qui ne les empêcha pas de s’y jucher toutes les deux. Les deux roues voilées, le pédalier cassé et le cadre tordu, mon père constata le décès avec les condoléances d’usage : « Ne pleure pas… Je t’en achèterai un autre quand tu sauras en prendre soin ! » C’était simple et juste : il suffisait d’attendre que mes tortionnaires évacuent les lieux définitivement.
L’oubli n’en eut pas la patience : on ne m’a jamais remplacé le vélo…
* * * * *
« Eh bien, tu cherches ! »
Le chemisier fut le premier d’une longue liste de disparitions dont l’énigme ne trouva sa solution qu’au bout de plusieurs mois. La source des achats au supermarché tarie, mes tantes s’étaient mises à voler avec une discrétion qui dénotait un véritable savoir-faire.
Lorsque mes parents émirent leurs premiers doutes, elles poussèrent de hauts cris, exigèrent une fouille minutieuse de leur chambre qui, évidemment, s’avéra infructueuse : Christiane revendait rapidement les produits de leurs larcins, au lycée ou dans la rue…
Échaudés par l’esclandre de l’inspection de leur chambre, papa et – surtout – maman se contentèrent de mieux protéger leurs biens de valeur. Pire, ils doutaient de mes accusations à peine suggérées. Nka-Nka était moins naïve. Elle m’écoutait plus volontiers tout en m’enjoignant de rester prudente pour ne pas m’attirer les foudres des deux voleuses.
Lorsque mes parents s’absentaient, passer la journée avec ma grand-mère devenait un vrai bonheur et un immense soulagement. Souvent, elle m’emmenait sur le marché où j’étais censée l’aider à vendre son poisson séché derrière la planche posée sur deux tréteaux qui lui servait d’étal.
Je compris vite que présenter sa petite-fille à ses amies et connaissances la remplissait de fierté. Entrer dans son jeu était un devoir dont je m’acquittais de plus en plus volontiers même si ma conversation se limitait au minimum : « Mboté, Esther… Kolélé ? » (Bonjour, Esther… Ça va ?) Ce qui n’appelait que la traditionnelle réponse convenue : « éé… » (ça va…) Ma bien modeste prestation la ravissait et j’en étais heureuse pour elle. Pour peu que la vente de poisson ait bien marché, elle me glissait mille ou deux mille francs CFA dans la poche : « Tu as bien travaillé… C’est pour toi ! »
Cet argent ne restait jamais longtemps en ma possession. La logique était simple : papa m’achetait tout ce dont j’avais besoin, il était donc normal que cette somme toute symbolique lui revienne. Bien sûr, au début, il avait refusé. Mais, comprenant le bonheur que je ressentais à lui offrir mes « gains », il s’était incliné.
S’il bénéficia moins de ma générosité, ce n’est pas parce que Nka-Nka ne prélevait plus de billets de sa caisse. Le détournement des fonds s’effectua bientôt avant la transaction finale. Les deux Diaboliques s’étaient rendu compte – j’ignore comment – que le retour d’une journée avec ma grand-mère coïncidait avec la présence d’un petit pécule qu’il leur fut aisé de s’approprier, d’abord en le subtilisant puis par la menace…
* * * * *
« Entrez dans mon bureau… »
Au ton excédé de la voix de mon père, ce n’était pas un malade qui avait sonné à la porte. Papa n’avait pas de clientèle privée officielle mais qu’un patient – généralement démuni – se présente à la maison, il était certain d’être reçu. Et, si son état nécessitait des médicaments, il était courant qu’il reparte avec les remèdes fournis gratuitement.
Cela a toujours été. Il arrivait parfois qu’une grande part de son salaire du mois passe dans l’achat de ces médicaments. Lorsqu’il prévenait maman que ses revenus du mois seraient largement entamés, elle soupirait et se contentait d’un « heureusement que je travaille aussi… »
Mais cette visite-là n’avait rien de médical et je ne l’appris que beaucoup plus tard. Pascaline, à mon grand soulagement, était retournée à Pointe-Noire définitivement à la fin de l’année scolaire. Mais Christiane resta quatre ans, le temps nécessaire pour rater trois fois son bac. Et elle était responsable de ces entrevues dont papa se serait bien passé : des créanciers ! Lorsqu’elle avait besoin d’argent, elle empruntait. Si elle ne pouvait rembourser ses dettes, ma tante ne se faisait pas prier pour donner son adresse et s’épancher sur la profession de médecin de ses « parents », ce qui augurait d’une caution sans limites… Du moins, c’est ce qu’elle prétendait avec autant de culot que de succès.
Bien sûr, aussi magnanime et généreux qu’il ait toujours été, mon père refusait généralement d’éponger les escroqueries de sa cousine. Mais, il se trouva parfois contraint de sortir son portefeuille lorsque les sommes dues auraient pu valoir un procès à cette parente pour le moins indélicate. Les remontrances n’eurent guère d’effet : Christiane pleurait (beaucoup !) et menaçait régulièrement de recourir à d’autres moyens pour subvenir à ses besoins… Sa beauté et son charme pourraient lui assurer un revenu substantiel auprès des hommes…
Nka-Nka profita de ses séjours réguliers à Pointe-Noire pour mener l’enquête. Elle découvrit que l’exil à Brazzaville n’était pas lié à la poursuite des études et aux difficultés financières de la famille de Christiane. S’éloigner présentait surtout l’avantage de se faire oublier dans sa ville natale où ses comportements risquaient de lui valoir incessamment certains désagréments, judiciaires et autres…
Chapitre 5
« Papa, il faut que tu remplisses les deux feuilles. Je dois les redonner à l’école demain avec le livre de la famille… »
J’avais surtout compris que je ne devais pas ouvrir l’enveloppe. Ma dernière année à l’école primaire allait se terminer dans quelques jours. Je savourais avoir acquis le droit d’y aller toute seule, d’autant plus que ça n’allait pas durer. Le collège était éloigné de la maison et tous les trajets se feraient en voiture, avec papa ou maman… Plus question de faire un bout de chemin avec l’une ou l’autre copine de classe.
L’enveloppe était trop grande pour entrer dans mon sac à dos. Pour tout dire, elle m’encombrait. Main gauche, main droite, je la changeais tous les dix mètres jusqu’à ce que je m’arrête au moment où un nième transfert allait s’opérer. C’est alors que j’ai remarqué l’inscription, soulignée de deux traits, en travers, de la main de mon père : « CONFIDENTIEL ».
Il n’y a pas longtemps que je connaissais le mot et sa signification. C’est Amand qui m’avait renseignée : « Confidentiel, c’est quand c’est un secret ! »
Drôle de secret puisqu’il faut le donner à la maîtresse ! Ou alors, ce n’est pas secret pour elle… Mais alors, pour qui puisqu’il n’y a que papa, elle et m… moi ? moi !
Le livret de famille… de FAMILLE… Tout à coup, chaque mot prend son sens. Une famille, ma famille, papa, moi et maman… Enfin, l’autre, celle que j’imaginais parfois dans la solitude et l’obscurité de mon lit : une dame, sans nom, sans corps, sans visage… Juste de grands yeux très doux et un grand sourire, pour moi, rien que pour moi. Je me la créais, la dessinais à travers les femmes que je croisais, sélectionnant les plus jolies, repoussant avec terreur l’idée qu’elle aurait pu ressembler à celles que je trouvais moches ou mal habillées !
Et elle est là… Là… entre mes doigts, juste cachée par un voile de papier kraft qu’il me suffirait de… de…
Je me retourne. La rue est déserte. Qui aurait pu avoir envie de me suivre ? Papa et maman sont au travail, Nka-Nka à Pointe-Noire. Et Christiane au lycée… ou pas, loin d’ici, en tout cas.
Mes mains tremblent. J’ai peur. Je sais que c’est mal, que je n’ai pas le droit, que je vais tromper la confiance de papa. La première fois…
J’ai honte… Il ne faut pas… J’en ai mal au ventre. Mais je sais que je vais finir par le faire. Je m’appuie contre un mur : la tête me tourne, mes jambes ne me soutiennent plus. Je vais tomber. Mon corps, ma volonté ne m’obéissent plus : je regarde mes propres mouvements en spectatrice, sans la moindre velléité d’intervention. Je n’ai plus qu’à attendre, passive, l’inéluctable issue.
Une chance et un signe, complices de ma tentation : papa a mal cacheté l’enveloppe. Elle se décolle toute seule.
J’ai l’impression qu’en plongeant la main dedans, un serpent va jaillir et me mordre. Je tremble encore plus fort, mon ventre se tord de douleur, de crispation.
Je voudrais m’enfuir… Mes jambes sont paralysées ! Laisser tomber l’enveloppe par terre ? Mes doigts s’y agrippent !
Je cède enfin, épuisée, happée par le vide de mon vertige.
Déçue.
Comment un tel trésor peut-il n’avoir droit qu’à un vulgaire carnet sans aucune décoration comme écrin ? Finalement, c’est mieux ainsi : son indécente pauvreté balaie mes craintes et mes scrupules. Il ne mérite aucun respect. C’est une prison dont le secret de ma naissance va se libérer…
Voilà. Je sais.
Un nom, trois prénoms qui m’inondent, m’envahissent et m’apaisent. Ne pas les prononcer… Pas encore… Ma maman me pénètre… nous revivons l’accouchement à l’envers. C’est elle qui s’installe, délicieusement, voluptueusement en moi et ces instants nous appartiennent à toutes les deux, rien qu’à nous, pour toujours…
Alors, toi qui découvres ces lignes, modère ton impatience et pardonne-moi ces ineffables secondes qui ne se reproduiront jamais…
Juste un peu… Un tout petit peu.
Nom : ZIKALAONA
Prénoms : Joséphine, Marinette, Gisèle (soulignez le prénom usuel)
Lieu de naissance : Antananarivo République de Madagascar
Je m’arrête là.
C’est déjà presque trop pour mon émotion, mon envie de pleurer, ma culpabilité d’avoir transgressé l’interdit, divulgué le secret, anéanti mon imaginaire.
Maman Joséphine… Je viens de créer ma mère.
Et une autre : celle que j’ai toujours appelée « maman » devient maman Clotilde. Elle gardera toute sa place dans ma vie. Je viens seulement de m’approprier un autre territoire avec une identité pour unique mais immense réalité, une île rien que pour nous deux…
* * * * *
Lorsque mon père est rentré ce soir-là, j’ai attendu qu’il soit assis pour lui tendre l’enveloppe délestée du questionnaire. Son regard m’a paru bizarre, soupçonneux et j’ai cru qu’il avait tout deviné. Il a vérifié son contenu, hoché la tête d’un air mollement rassuré sans retrouver sa gaieté coutumière.
Alors, un mensonge en appelant un autre, je me suis glissée derrière son fauteuil puis me penchai en lui enlaçant le cou avant de l’embrasser : « Oh, papa ! Si tu savais comme je suis heureuse d’aller au collège… »
Si le changement d’établissement scolaire m’a angoissée, je ne m’en souviens pas. En tout cas, maman m’aura rassurée d’un : « Tu verras, si tu continues à bien travailler, il n’y aura aucun problème… »
Et il n’y a eu aucun problème, du point de vue strictement scolaire. Le programme du collège public s’était quelque peu affranchi des anciens programmes français et adapté à l’histoire de notre jeune république. Les modifications n’allaient pas dans le sens d’un approfondissement des connaissances, au contraire. De plus, nous subissions un absentéisme des professeurs à grande échelle qui faisait enrager mes parents.
J’y puisais une motivation supplémentaire pour tout apprendre quasiment par cœur dans toutes les matières. Les résultats s’en ressentaient mais, plus encore qu’en Primaire, mes notes creusaient un fossé tel que j’avais du mal à nouer des relations amicales avec les autres élèves. Mes camarades profitaient des nombreux trous dans l’emploi du temps pour sortir se promener ou rentrer chez eux. Il n’y avait aucun contrôle.
Gentiment, on m’avait proposé de les accompagner mais, chaque fois, je devais refuser : mes parents me l’avaient interdit. Une fois, deux fois, cinq fois et les bonnes volontés s’étaient lassées, me gratifiant de remarques parfois cruelles : « Oh, laissez tomber ! Vous savez bien qu’en classe, elle n’aime qu’étudier… et s’taire… » Le jeu de mots sur mon prénom en rajoutait sur mon peu de goût pour les chahuts qui émaillaient les cours. Humiliée, je les regardais s’éloigner, gratifiée au passage de leurs rires moqueurs.
Alors, je restais toute seule au collège, le nez dans les livres, à attendre la voiture familiale.
Sauf une fois.
La moyenne d’âge de la classe avoisinait les treize ans. Georgina devait en avoir quatorze. Son parcours scolaire passait par des chemins de traverse où elle avait longtemps musardé. Sa maturité régnait sur notre groupe de 6e