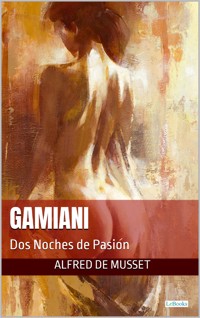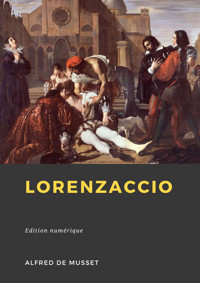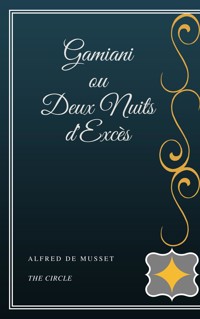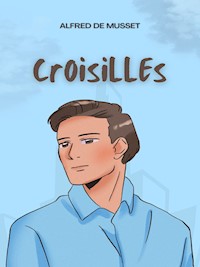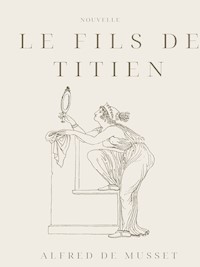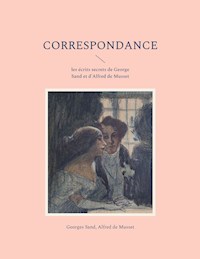1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Les "Premières poésies" d'Alfred de Musset, publiées entre 1828 et 1833, constituent une œuvre fondatrice du romantisme français. À travers une plume empreinte de musicalité et de lyrisme, Musset explore des thèmes tels que l'amour, la mélancolie et les tourments de l'âme, intégrant des références à la nature et un fort sentiment de subjectivité. Son style innovant se distingue par une utilisation audacieuse de la forme et de la métrique, oscillant entre la légèreté des vers et la profondeur des émotions. Ce recueil reflète également le contexte tumultueux du début du XIXe siècle, période marquée par des bouleversements politiques et sociaux, où les artistes cherchaient à exprimer leurs désirs de liberté et d'expression personnelle. Alfred de Musset, nourri par ses propres expériences de vie et ses relations tumultueuses, notamment avec George Sand, apporte une voix authentique et sensible à ses écrits. Son parcours, marqué par une jeunesse de bohème et d'amour, enrichit ses poésies d'une intense subjectivité. Musset, figure emblématique du romantisme, s'inscrit en réaction à un classicisme rigide et propose un regard profondément humain, où la fragilité des passions est mise en avant. "Premières poésies" est une incontournable pour les amoureux de la littérature française, car elle incarne les débuts d'un poète qui a su capturer les tourments de son temps. Ce recueil, par sa richesse stylistique et émotionnelle, invite le lecteur à une introspection sur ses propres désirs et douleurs. Sans aucun doute, une lecture indispensable pour quiconque s'intéresse à la poésie romantique.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Premières poésies, 1828-1833.
Table des matières
AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS
En présentant au public cette édition nouvelle des Œuvres Complètes d’Alfred de Musset, notre but n’est pas uniquement de les lui offrir dans une typographie et dans un format commodes et agréables. Nous prétendons, en outre, lui mettre sous les yeux la collection de ces œuvres la plus réellement complète qu’il soit aujourd’hui possible de réunir. Nous en établissons le texte, revu avec grand soin, nous les classons dans un ordre logique et, en partie, nouveau.
Jusqu’à présent, les éditions d’Alfred de Musset se sont succédé sur un plan uniforme. Pour tout ce qui a paru du vivant de l’Auteur, il est hors de doute qu’on serait mal venu à se permettre d’y rien changer, et nous n’avons point eu cette témérité.
Mais, après la mort de son frère, Paul de Musset a formé un volume de ses Œuvres Posthumes en 1860, et un volume de Mélanges de littérature et de critique en 1867.
Ensuite, des chercheurs et des érudits, en grand nombre, le vicomte Spoelberch de Lovenjoul, Maurice Tourneux, M. Octave Uzanne, beaucoup d’autres, ont recueilli des pièces plus ou moins curieuses, qui ne sont encore entrées dans aucune édition d’ensemble.
Le regretté Maurice Clouard, président, pendant de longues années, de la société «les Mussettistes», et son vice-président M. Paul Peltier ont, à leur exemple, multiplié les investigations les plus patientes et abouti souvent à des trouvailles intéressantes.
Les «œuvres vagabondes», comme les a appelées M. Uzanne, devaient fournir la matière d’un volume: les Œuvres Complémentaires réunies et annotées par M. Maurice Allem, en 1911.
Des lettres d’Alfred de Musset se rencontrent dans des journaux, des revues, des recueils divers, et, par exemple, dans la Correspondance de George Sand. Paul de Musset en a inséré dans les Œuvres Posthumes. Léon Séché en a formé un volume, plus un volume de Lettres à Aimée d’Alton qui allait devenir Madame Paul de Musset; M. Félix Décori a fait éditer à Bruxelles un recueil des Lettres à George Sand. Enfin M. Allem reproduit seize lettres dont J. Monval avait précédemment donné le texte dans le Correspondant.
Ces appoints, ces adjonctions, ces compléments, il nous a paru nécessaire de les fondre, selon leur nature, dans l’œuvre complète de Musset. Pour ne pas porter atteinte au plan définitif arrêté sous son contrôle et avec son assentiment, nous avons cru opportun, non de grouper ces pièces à part de façon à en composer la matière de deux volumes pour le moins, mais de les rapprocher, sous forme d’appendice à chaque partie, des pièces de même nature classées à leur place immuable.
Notre édition ne comporte donc plus de tome spécial aux Œuvres Posthumes ou aux Œuvres Complémentaires. On trouvera les Poésies posthumes et les Complémentaires à la suite des Premières Poésies et des Poésies Nouvelles ; les morceaux dramatiques à la suite des Comédies et Proverbes ; les fragments de nouvelles à la suite des Contes et nouvelles, etc.
Nous avons, dans le tome de la Correspondance, essayé de faire suivre les lettres dans leur ordre chronologique. La tentative était malaisée; nous craignons de n’avoir pas toujours réussi; la plupart des lettres ne sont pas datées, et, d’autre part, les originaux ne sont pas rassemblés dans un dépôt public ou facilement accessible; ils sont dispersés, en général, et l’on ignore souvent par qui et en quel lieu ils sont détenus.
Néanmoins, nous avons confiance de n’avoir rien négligé ; nous avons fait pour le mieux. D’ailleurs, l’homme de France le plus au courant sans contredit de tout ce qui concerne l’œuvre et la vie de Musset, M. Maurice Allem, nous a spontanément autorisés à nous servir des notes qu’il a diligemment prises et mises en ordre en vue d’établir une édition véritablement scientifique, absolument complète et appuyée pas à pas sur un commentaire historique, biographique, littéraire et social. Nous ne nous sommes pas fait faute de recourir à son érudition et de le consulter au risque de fatiguer sa bienveillance. Mais elle est inépuisable, et nous sommes heureux de lui exprimer ici notre profonde gratitude pour l’accueil et l’appui efficace qu’il nous a sans cesse réservés. Toutes les notes en bas de page, qui accompagnent les parties complémentaires ou inédites des Œuvres d’Alfred de Musset sont reprises, avec son assentiment, à l’édition de M. Maurice Allem, ou fournies par lui.
Nous nous sommes assuré la collaboration de Charles Martin, dans le dessein d’enrichir notre édition d’un attrait particulier. N’est-il pas, en effet, très attachant d’inviter un artiste d’aujourd’hui, avec son talent affiné et original, à traduire l’impression produite sur sa sensibilité par une œuvre classée depuis tantôt trois quarts de siècle? Des apparences extérieures propres à l’époque où elle a été écrite, se dégage ainsi, au premier coup d’œil, ce qui s’en avère durable et de tous les temps.
Puisse notre édition, conçue et exécutée de la sorte, rencontrer l’intérêt et le suffrage du lecteur.
AU LECTEUR
DES DEUX VOLUMES DE VERS DE L’AUTEUR
Ce livre est toute ma jeunesse; Je l’ai fait sans presque y songer. Il y paraît, je le confesse, Et j’aurais pu le corriger.
Mais quand l’homme change sans cesse, Au passé pourquoi rien changer? Va-t-en, pauvre oiseau passager, Que Dieu te mène à ton adresse!
Qui que tu sois, qui me liras, Lis-en-le plus que tu pourras, Et ne me condamne qu’en somme.
Mes premiers vers sont d’un enfant, Les seconds d’un adolescent, Les derniers à peine d’un homme.
1840.
CONTES D’ESPAGNE ET D’ITALIE
AU LECTEUR
Une préface est presque toujours, sinon une histoire ou une théorie, une espèce de salutation théâtrale, où l’auteur, comme nouveau venu, rend hommage à ses devanciers, cite des noms, la plupart anciens; pareils à un provincial qui, en entrant au bal, s’incline à droite et à gauche, cherchant un visage ami.
C’est cette habitude qui nous ferait trouver étrange qu’on entrât à l’Académie sans compliment et en silence. Me pardonnera-t-on d’imiter le comte d’Essex, qui arriva dans le conseil de la reine crotté et éperonné ?
On a discuté avec talent et avec chaleur, dans les salons et dans les feuilles quotidiennes, la question littéraire qui succède aujourd’hui à la question oubliée de la musique italienne. On n’a sans doute rien prouvé entièrement.
Il est certain que la plupart de nos anciennes pièces de théâtre, à défaut de grands acteurs, demeurent sans intérêt; Molière seul, inimitable, est resté amusant.
Le moule de Racine a été brisé ; c’est là le principal grief; car, pour cet adultère tant discuté du fou et du sérieux, il nous est familier. Les règles de la trinité de l’unité, établies par Aristote, ont été outrepassées. En un mot, les chastes Muses ont été, je crois, violées.
La pédanterie a exercé de grands ravages; plus d’une perruque s’est dédaigneusement ébranlée, pareille à celle de Haendel qui battait la mesure des oratorios.
Le genre historique toutefois est assez à la mode, et nous a valu bien des Mémoires. A Dieu ne plaise que je veuille décider s’ils sont véridiques on apocryphes!
De nobles essais ont été faits; plus d’un restera comme monument. Qu’importe le reste? La sévère et impartiale critique est celle du temps. Elle seule a voix délibératrice, et ne repousse jamais un siècle pour en élever un autre; elle se souvient, en lisant Dante et Shakespeare, que l’héroïne du premier roman du monde, Clarisse Harlowe, portait des paniers.
1830.
CHANSONS A METTRE EN MUSIQUE ET FRAGMENTS
A Madame B...
Quand je t’aimais, pour toi j’aurais donné ma vie. Mais c’est toi, de t’aimer, toi, qui m’ôtas l’envie. A tes pièges d’un jour on ne me prendra plus; Tes ris sent maintenant et tes pleurs superflus. Ainsi, lorsque a l’enfant la vieille salle obscure Fait peur, il va tout nu décrocher quelque armure;
Il s’enferme, il revient, tout palpitant d’effroi, Dans sa chambre bien noire et dans son lit bien froid Et puis, lorsque au matin le jour vient à paraître, Il trouve son fantôme aux plis de sa fenêtre, Voit son arme inutile, il rit et, triomphant, S’écrie: «Oh! que j’ai peur! oh! que je suis enfant!»
1828.
VENISE
Dans Venise la rouge, Pas un bateau qui bouge, Pas un pêcheur dans l’eau, Pas un falot.
Seul, assis a la grève, Le grand lion soulève, Sur l’horizon serein, Son pied d’airain.
Autour de lui, par groupes, Navires et chaloupes, Pareils a des hérons Couches en ronds,
Dorment sur l’eau qui fume, Et croisent dans la brume, En légers tourbillons, Leurs pavillons.
La lune qui s’efface Couvre son front qui passe D’un nuage étoilé Demi-voilé.
Ainsi, la dame abbesse De Sainte-Croix rabaisse Sa cape aux vastes plis Sur son surplis.
Et les palais antiques, Et les graves portiques, Et les blancs escaliers Des chevaliers,
Et les ponts, et les rues, Et les mornes statues, Et le golfe mouvant Qui tremble au vent,
Tout se tait, fors les gardes Aux longues hallebardes, Qui veillent aux créneaux Des arsenaux.
Ah! — maintenant plus d’une Attend, au clair de lune, Quelque jeune muguet, L’oreille au guet.
Pour le bal qu’on prépare Plus d’une qui se pare Met devant son miroir Le masque noir.
Sur sa couche embaumée, La Vanina pâmée Presse encor son amant, En s’endormant,
Et Narcisa, la folle, Au fond de sa gondole, S’oublie en un festin Jusqu’au matin.
Et qui, dans l’Italie, N’a son grain de folie? Qui ne garde aux amours Ses plus beaux jours?
Laissons la vieille horloge, Au palais du vieux doge, Lui compter de ses nuits Les longs ennuis.
Comptons plutôt ma belle, Sur ta bouche rebelle Tant de baisers donnés... Ou pardonnés.
Comptons plutôt tes charmes, Comptons les douces larmes Qu’a nos yeux a coûté La volupté !
1828.
STANCES
Que j’aime a voir, dans la vallée Désolée, Se lever comme un mausolée Les quatre ailes d’un noir moutier! Que j’aime a voir, près de l’austère Monastère, Au seuil du baron feudataire, La croix blanche et le bénitier!
Vous, des antiques Pyrénées Les aînées, Vieilles églises décharnées, Maigres et tristes monuments, Vous que le temps n’a pu dissoudre, Ni la foudre, De quelques grands monts mis en poudre N’êtes-vous pas les ossements?
J’aime vos tours a tête grise, Où se brise L’éclair qui passe avec la brise. J’aime vos profonds escaliers Qui, tournoyant dans les entrailles Des murailles, A l’hymne éclatant des ouailles Font répondre tous les piliers!
Oh! lorsque l’ouragan qui gagne La campagne Prend par les cheveux la montagne Que le temps d’automne jaunit, Que j’aime, dans le bois qui crie Et se plie, Les vieux clochers de l’abbaye, Comme deux arbres de granit!
Que j’aime à voir, dans les vesprées. Empourprées, Jaillir en veines diaprées Les rosaces d’or des couvents! Oh! que j’aime, aux voûtes gothiques Des portiques, Les vieux saints de pierre athlétiques Priant tout bas pour les vivants!
1828.
L’ANDALOUSE
Avez-vous vu, dans Barcelone, Une Andalouse au sein bruni? Pale comme un beau soir d’automne! C’est ma maîtresse, ma lionne! La marquesa d’Amaëgui.
J’ai fait bien des chansons pour elle; Je me suis battu bien souvent. Bien souvent j’ai fait sentinelle, Pour voir le coin de sa prunelle, Quand son rideau tremblait au vent.
Elle est a moi, moi seul au monde. Ses grands sourcils noirs sont a moi, Son corps souple et sa jambe ronde, Sa chevelure qui l’inonde, Plus longue qu’un manteau de roi!
C’est a moi son beau col qui penche Quand elle dort dans son boudoir, Et sa basquina sur sa hanche, Son bras dans sa mitaine blanche, Son pied dans son brodequin noir!
Vrai Dieu! lorsque son œil pétille Sous la frange de ses réseaux, Rien que pour toucher sa mantille, De par tous les saints de Castille, On se ferait rompre les os.
Qu’elle est superbe en son désordre, Quand elle tombe, les seins nus, Qu’on la voit, béante, se tordre Dans un baiser de rage, et mordre En criant des mots inconnus!
Et qu’elle est folle dans sa joie, Lorsqu’elle chante le matin, Lorsqu’en tirant son bas de soie Elle fait, sur son flanc qui ploie, Craquer son corset de satin!
Allons, mon page, en embuscades! Allons! la belle nuit d’été ! Je veux ce soir des sérénade, A faire damner les alcades De Tolose au Guadalété !
LE LEVER
Assez dormir, ma belle! Ta cavale isabelle Hennit sous tes balcons. Vois tes piqueurs alertes, Et sur leurs manches vertes Les pieds noirs des faucons.
Vois écuyers et pages, En galants équipages, Sans rochet ni pourpoint, Têtes chaperonnées, Traîner les haquenées, Leur arbalète au poing.
Vois bondir dans les herbes Les lévriers superbes, Les chiens trapus crier. En chasse, et chasse heureuse! Allons, mon amoureuse, Le pied dans l’étrier!
Et d’abord, sous la moire, Avec ce bras d’ivoire Enfermons ce beau sein, Dont la forme divine, Pour que l’œil la devine, Reste aux plis du coussin.
Oh! sur ton front qui penche, J’aime à voir ta main blanche Peigner tes cheveux noirs; Beaux cheveux qu’on rassemble Les matins, et qu’ensemble Nous défaisons les soirs!
Allons, mon intrépide, Ta cavale rapide Frappe du pied le sol, Et ton bouffon balance, Comme un soldat sa lance, Son joyeux parasol!
Mets ton écharpe blonde Sur ton épaule ronde, Sur ton corsage d’or, Et je vais, ma charmante, T’emporter dans ta mante, Comme un enfant qui dort!
MADRID
Madrid, princesse des Espagnes, Il court par tes mille campagnes Bien des yeux bleus, bien des yeux noirs. La blanche ville aux sérénades, Il passe par tes promenades Bien des petits pieds tous les soirs.
Madrid, quand tes taureaux bondissent, Bien des mains blanches applaudissent, Bien des écharpes sont en jeux. Par tes belles nuits étoilées Bien des señoras long voilées Descendent tes escaliers bleus.
Madrid, Madrid, moi je me raille De tes dames à fine taille Qui chaussent l’escarpin étroit! Car j’en sais une par le monde, Que jamais ni brune ni blonde N’ont valu le bout de son doigt!
J’en sais une, et certes la duègue Qui la surveille et qui la peigne N’ouvre sa fenêtre qu’à moi;Certes, qui veut qu’on le redresse N’a qu’à l’approcher à la messe, Fût-ce l’archevêque ou le roi.
Car c’est ma princesse andalouse! Mon amoureuse! ma jalouse! Ma belle veuve au long réseau! C’est un vrai démon! c’est un ange! Elle est jaune comme une orange, Elle est vive comme un oiseau!
Oh! quand sur ma bouche idolâtre Elle se pâme, la folâtre, Il faut voir, dans nos grands combats, Ce corps si souple et si fragile, Ainsi qu’une couleuvre agile, Fuir et glisser entre mes bras!
Or, si d’aventure on s’enquête Qui m’a valu telle conquête, C’est l’allure de mon cheval, Un compliment sur sa mantille, Puis des bonbons a la vanille, Par un beau soir de carnaval.
MADAME LA MARQUISE
Vous connaissez que j’ai pour mie Une Andalouse a l’œil lutin, Et sur mon cœur, tout endormie, Je la berce jusqu’au matin.
Voyez-la, quand son bras m’enlace, Comme le col d’un cygne blanc, S’enivrer, oublieuse et lasse, De quelque rêve nonchalant.
Gais chérubins! veillez sur elle. Planez, oiseaux, sur notre nid; Dorez du reflet de votre aile Son doux sommeil, que Dieu bénit!
Car toute chose nous convie D’oublier tout, fors notre amour; Nos plaisirs, d’oublier la vie; Nos rideaux, d’oublier le jour.
Pose ton souffle sur ma bouche, Que ton âme y vienne passer! Oh! restons ainsi dans ma couche, Jusqu’a l’heure de trépasser!
Restons! l’étoile vagabonde Dont les sages ont peur de loin, Peut-être, en emportant le monde, Nous laissera dans notre coin.
Oh! viens! dans mon âme froissée, Qui saigne encore d’un mal bien grand, Viens verser ta blanche pensée, Comme un ruisseau dans un torrent!
Car sais-tu seulement, pour vivre, Combien il m’a fallu pleurer? De cet ennui qui désenivre, Combien en mon cœur dévorer?
Donne-moi, ma belle maîtresse, Un beau baiser, car je te veux Raconter ma longue détresse, En caressant tes beaux cheveux.
Or, voyez qui je suis, ma mie, Car je vous pardonne pourtant De vous être hier endormie Sur mes lèvres, en m’écoutant.
Pour ce, madame la marquise, Dès qu’à la ville il fera noir, De par le roi sera requise De venir en notre manoir;
Et sur mon cœur, tout endormie, La bercerai jusqu’au matin. Car on connaît que j’ai pour mie Une Andalouse a l’œil lutin.
1829.
A LA JUNG-FRAU
Jung-Frau, le voyageur qui pourrait sur ta tête S’arrêter, et poser le pied sur sa conquête, Sentirait en son cœur un noble battement, Quand son âme, au penchant de ta neige éternelle, Pareille au jeune aiglon qui passe et lui tend l’aile, Glisserait et fuirait sous le clair firmament.
Jung-Frau, je sais un cœur qui, comme toi, se cache. Revêtu, comme toi, d’une robe sans tache, Il est plus près de Dieu que tu ne l’es du ciel. Ne t’étonne donc point, ô montagne sublime, Si, la première fois que j’en ai vu la cime, J’ai cru le lieu trop haut pour être d’un mortel.
1829.
A ULRIC GUTTINGUER
Ulric, nul œil des mers n’a mesuré l’abîme, Ni les hérons plongeurs, ni les vieux matelots. Le soleil vient briser ses rayons sur leur cime, Comme un soldat vaincu brise ses javelots.
Ainsi, nul œil, Ulric, n’a pénétré les ondes De tes douleurs sans borne, ange du ciel tombé. Tu portes dans ta tête et dans ton cœur deux mondes, Quand le soir, près de moi, tu vas triste et courbé.
Mais laisse-moi du moins regarder dans ton âme, Comme un enfant craintif se penche sur les eaux; Toi si plein, front pâli sous des baisers de femme, Moi si jeune, enviant ta blessure et tes maux.
Juillet 1829.
SONNET
Que j’aime le premier frisson d’hiver! le chaume Sous le pied du chasseur refusant de ployer! Quand vient la pie aux champs que le foin vert embaume, Au fond du vieux château s’éveille le foyer;
C’est le temps de la ville. — Oh! lorsque l’an dernier J’y revins, que je vis ce bon Louvre et son dôme, Paris et sa fumée, et tout ce beau royaume (J’entends encore au vent les postillons crier),
Que j’aimais ce temps gris, ces passants, et la Seine Sous ses mille falots assise en souveraine! J’allais revoir l’hiver. — Et toi, ma vie, et toi,
Oh! dans tes longs regards, j’allais tremper mon âme; Je saluais tes murs. — Car, qui m’eût dit, madame, Que votre coeur si tôt avait changé pour moi?
Août 1829.
BALLADE A LA LUNE
C’était, dans la nuit brune, Sur le clocher jauni, La lune, Comme un point sur un i.
Lune, quel esprit sombre Promène au bout d’un fil, Dans l’ombre, Ta face et ton profil?
Es-tu l’œil du ciel borgne? Quel chérubin cafard Nous lorgne Sous ton masque blafard?
N’es-tu rien qu’une boule? Qu’un grand faucheux bien gras Qui roule Sans pattes et sans bras?
Es-tu, je t’en soupçonne, Le vieux cadran de fer Qui sonne L’heure aux damnés d’enfer?
Sur ton front qui voyage, Ce soir ont-ils compté Quel âge A leur éternité ?
Est-ce un ver qui te ronge, Quand ton disque noirci S’allonge En croissant rétréci?
Qui t’avait éborgnée L’autre nuit? T’étais-tu Cognée A quelque arbre pointu?
Car tu vins, pâle et morne, Coller sur mes carreaux Ta corne, A travers les barreaux.
Va, lune moribonde, Le beau corps de Phœbé La blonde Dans la mer est tombé.
Tu n’en es que la face, Et déjà tout ridé S’efface Ton front dépossédé.
Rends-nous la chasseresse, Blanche, au sein virginal, Qui presse Quelque cerf matinal!
Oh! sous le vert platane, Sous les frais coudriers, Diane, Et ses grands lévriers!
Le chevreau noir qui doute, Pendu sur un rocher, L’écoute, L’écoute s’approcher.
Et, suivant leurs curées, Par les vaux, par les blés, Les prées, Ses chiens s’en sont allés.
Oh! le soir, dans la brise, Phœbé, sœur d’Apollo, Surprise A l’ombre, un pied dans l’eau!
Phœbé, qui la nuit close, Aux lèvres d’un berger Se pose, Comme un oiseau léger.
Lune, en notre mémoire, De tes belles amours L’histoire L’embellira toujours.
Et, toujours rajeunie, Tu seras du passant Bénie, Pleine lune ou croissant.
T’aimera le vieux pâtre, Seul, tandis qu’à ton front D’albâtre Ses dogues aboieront.
T’aimera le pilote Dans son grand bâtiment Qui flotte Sous le clair firmament!
Et la fillette preste Qui passe le buisson, Pied leste, En chantant sa chanson.
Comme un ours à la chaîne, Toujours sous tes yeux bleus Se traîne L’Océan montueux.
Et, qu’il vente ou qu’il neige, Moi-même, chaque soir, Que fais-je, Venant ici m’asseoir?
Je viens voir à la brune, Sur le clocher jauni, La lune Comme un point sur un i.
Peut-être quand déchante Quelque pauvre mari, Méchante, De loin tu lui souris.
Dans sa douleur amère, Quand au gendre bénit La mère Livre la clef du nid,
Le pied dans sa pantoufle, Voilà l’époux tout prêt Qui souffle Le bougeoir indiscret.
Au pudique hyménée La vierge qui se croit Menée Grelotte en son lit froid.
Mais monsieur, tout en flamme, Commence à rudoyer Madame Qui commence à crier.
«Ouf! dit-il, je travaille, Ma bonne, et ne fais rien Qui vaille; Tu ne te tiens pas bien.»
Et vite il se dépêche. Mais quel démon caché L’empêche De commettre un péché ?
«Ah! dit-il, prenons garde. Quel démon curieux Regarde Avec ses deux grands yeux?»
Et c’est, dans la nuit brune, Sur son clocher jauni, La lune Comme un point sur un i.
1829.
DON PAEZ
I
Je n’ai jamais aime, pour ma part, ces bégueules Qui ne sauraient aller au Prado toutes seules, Qu’une duègne toujours de quartier en quartier Talonne, comme fait sa mule un muletier; Qui s’usent, à prier, les genoux et la lèvre, Se courbant sur le grès, plus pales, dans leur fièvre, Qu’un homme qui, pieds nus, marche sur un serpent, Ou qu’un faux monnayeur au moment qu’on le pend. Certes, ces femmes-là, pour mener cette vie, Portent un cœur châtré de toute noble envie; Elles n’ont pas de sang et pas d’entrailles. — Mais, Sur ma tête et mes os, frère, je vous promets Qu’elles valent encor quatre fois mieux que celles Dont le temps se dépense en intrigues nouvelles. Celles-là vont au bal, courent les rendez-vous, Savent dans un manchon cacher un billet doux, Serrer un ruban noir sur un beau flanc qui ploie, Jeter d’un balcon d’or une échelle de soie, Suivre l’imbroglio de ces amours mignons, Poussés en une nuit comme des champignons; Si charmantes, d’ailleurs! aimant en enragées Les moustaches, les chiens, la valse et les dragées. Mais, oh! la triste chose et l’étrange malheur, Lorsque dans leurs filets tombe un homme de cœur! Frère, mieux lui vaudrait, comme ce statuaire Qui pressait dans ses bras son amante de pierre, Réchauffer de baisers un marbre; mieux vaudrait Une louve affamée en quelque âpre forêt.
Ce que je dis ici, je le prouve en exemple. J’entre donc en matière, et, sans discours plus ample, Ecoutez une histoire:
Un mardi, cet été,
Vers deux heures de nuit, si vous aviez été Place San-Bernardo, contre la jalousie D’une fenêtre en brique, à frange cramoisie, Et que, le cerveau mû de quelque esprit follet, Vous eussiez regardé par le trou du volet, Vous auriez vu, d’abord, une chambre tigrée, De candélabres d’or ardemment éclairée; Des marbres, des tapis montant jusqu’aux lambris; Çà et la, des flacons d’un souper en débris; Des vins, mille parfums; à terre, une mandore Qu’on venait de quitter, et frémissant encore, De même que le sein d’une femme frémit Après qu’elle a dansé. — Tout était endormi; La lune se levait; sa lueur souple et molle, Glissant aux trèfles gris de l’ogive espagnole, Sur les pales velours et le marbre changeant, Mêlait aux flammes d’or ses longs rayons d’argent. Si bien que, dans le coin le plus noir de la chambre, Sur un lit incrusté de bois de rose et d’ambre, En y regardant bien, frère, vous auriez pu, Dans l’ombre transparente, entrevoir un pied nu. — Certes, l’Espagne est grande, et les femmes d’Espagne Sont belles; mais il n’est château, ville, ou campagne, Qui, contre ce pied-là, n’eût en vain essayé (Comme dans Cendrillon), de mesurer un pied. Il était si petit, qu’un enfant l’eût pu prendre Dans sa main. — N’allez pas, frère, vous en surprendre; La dame dont ici j’ai dessein de parler Etait de ces beautés qu’on ne peut égaler: Sourcils noirs, blanches mains, et pour la petitesse De ses pieds, elle était Andalouse et comtesse.
Cependant les rideaux, autour d’elle tremblant, La laissaient voir pâmée aux bras de son galant; Œil humide, bras morts, tout respirait en elle Les langueurs de l’amour, et la rendait plus belle. Sa tête avec ses seins roulait dans ses cheveux; Pendant que sur son corps mille traces de feux, Que sa joue empourprée, et ses lèvres arides, Qui se pressaient encor, comme en des baisers vides, Et son cœur gros d’amour, plus fatigué qu’éteint, Tout d’une folle nuit vous eût rendu certain. Près d’elle, son amant, d’un œil plein de caresse, Cherchant l’œil de faucon de sa jeune maîtresse, Se penchait sur sa bouche, ardent à l’apaiser, Et pour chaque sanglot lui rendait un baiser. Ainsi passait le temps. — Sur la place moins sombre, Déjà le blanc matin faisant grisonner l’ombre, L’horloge d’un couvent s’ébranla lentement; Sur quoi le jouvenceau courut, en un moment, D’abord à son habit, ensuite à son épée; Puis, voyant sa beauté de pleurs toute trempée: «Allons, mon adorée, un baiser, et bonsoir. — Déjà partir, méchant! — Bah! je viendrai vous voir Demain, midi sonnant: adieu, mon amoureuse! — Don Paez! don Paez! Certe, elle est bien heureuse, La galante pour qui vous me laissez si tôt! — Mauvaise! vous savez qu’on m’attend au château, Ma galante, ce soir, mort-Dieu! c’est ma guérite. — Eh! pourquoi donc alors l’aller trouver si vite? Par quel serment d’enfer êtes-vous donc lié ? — Il le faut. Laisse-moi baiser ton petit pied! — Mais regardez un peu, qu’un lit de bois de rose, Des fleurs, une maîtresse, une alcôve bien close, Tout cela ne vaut pas, pour un fin cavalier, Une vieille guérite au coin d’un vieux pilier! — La belle épaule blanche, ô ma petite fée! Voyons, un beau baiser! — Comme je suis coiffée! Vous êtes un vilain! — La paix! Adieu, mon cœur; Là, là, ne faites pas ce petit air boudeur. Demain c’est jour de fête! un tour de promenade, Veux-tu? — Non, ma jument anglaise est trop malade. — Adieu done; que le diable emporte ta jument! — Don Paez! mon amour, reste encor un moment. — Ma charmante, allez-vous me faire une querelle? Ah! je m’en vais si bien vous décoiffer, ma belle, Qu’à vous peigner, demain, vous passerez un jour! — Allez-vous-en, vilain! — Adieu, mon seul amour!»
Il jeta son manteau sur sa moustache blonde, Et sortit; l’air était doux, et la nuit profonde; Il détourna la rue à grands pas, et le bruit De ses éperons d’or se perdit dans la nuit.
Oh! dans cette saison de verdeur et de force, Où la chaude jeunesse, arbre à la rude écorce, Couvre tout de son ombre, horizon et chemin, Heureux, heureux celui qui frappe de la main Le col d’un étalon rétif, ou qui caresse Les seins étincelants d’une folle maîtresse!
II
Don Paez, l’arme au bras, est sur les arsenaux; Seul, en silence, il passe au revers des créneaux; On le voit comme un point; il fume son cigare En route, et d’heure en heure, au bruit de la fanfare, Il mêle sa réponse au qui-vive effrayant Que des lansquenets gris s’en vont partout criant. Près de lui, çà et là, ses compagnons de guerre, Les uns, dans leurs manteaux, s’endormant sur la terre, D’autres jouant aux dés. — Propos, récits d’amours, Et le vin (comme on pense), et les mauvais discours N’y manquent pas. — Pendant que l’un fait, après boire, Sur quelque brave fille une méchante histoire, L’autre chante à demi, sur la table accoudé. Celui-ci, de travers examinant son dé, A chaque coup douteux grince dans sa moustache. Celui-là, relevant le coin de son panache, Fait le beau parleur, jure; un autre, retroussant Sa barbe à moitié rouge, aiguisée en croissant, Se verse d’un poignet chancelant, et se grise A la santé du roi, comme un chantre d’église. Pourtant un maigre suif, allumé dans un coin, Chancelle sur la nappe à chaque coup de poing. Voici donc qu’au milieu des rixes, des injures, Des bravos, des éclats qu’allument les gageures, L’un d’eux: «Messieurs, dit-il, vous êtes gens du roi, Braves gens, cavaliers volontaires. — Bon. — Moi, Je vous déclare ici trois fois gredin et traître Celui qui ne va pas proclamer, reconnaître, Que les plus belles mains qu’en ce chien de pays On puisse voir encor de Burgos à Cadix Sont celles de doña Cazalès, de Séville, Laquelle est ma maîtresse, au dire de la ville!»
Ces mots, à peine dits, causèrent un haro Qui du prochain couvent ébranla le carreau. Il n’en fut pas un seul qui de bonne fortune Ne se dit passé maître, et n’en vantât quelqu’une: Celle-ci pour ses pieds, celle-là pour ses yeux; L’autre c’était la taille et l’autre les cheveux. Don Paez cependant, debout et sans parole, Souriait; car, le sein plein d’une ivresse folle, Il ne pouvait fermer ses paupières sans voir Sa maîtresse passer, blanche avec un œil noir!
«Messieurs, cria d’abord notre moustache rousse, La petite Inésille est la peau la plus douce Où j’aie encor frotté ma barbe jusqu’ici. — Monsieur, dit un voisin rabaissant son sourcil, Vous ne connaissez pas l’Arabelle; elle est brune Comme un jais. — Quant à moi, je n’en puis citer une, Dit quelqu’un, j’en ai trois. — Frères, cria de loin Un dragon jaune et bleu qui dormait dans du foin, Vous m’avez éveillé ; je rêvais à ma belle. — Vrai, mon petit ribaud! dirent-ils, quelle est-elle?» Lui, bâillant à moitié : «Par Dieu! c’est l’Orvado, Dit-il, la Juana, place San-Bernardo.»
Dieu fit que don Paez l’entendit; et, la fièvre Le prenant aux cheveux, il se mordit la lèvre: «Tu viens là de lâcher quatre mots imprudents, Mon cavalier, dit-il, car tu mens par tes dents! La comtesse Juana d’Orvado n’a qu’un maître, Tu peux le regarder, si tu veux le connaître. — Vrai? reprit le dragon; lequel de nous ici Se trompe? Elle est à moi, cette comtesse, aussi. — Toi? s’écria Paez; mousqueton d’écurie, Prendras-tu ton épée, ou s’il faut qu’on t’en prie? Elle est à toi, dis-tu? Don Étur! sais-tu bien Que j’ai suivi quatre ans son ombre comme un chien? Ce que j’ai fait ainsi, penses-tu que le fasse Ce peu de hardiesse empreinte sur ta face, Lorsque j’en saigne encore, et qu’à cette douleur J’ai pris ce que mon front a gardé de pâleur? — Non; mais je sais qu’en tout, bouquets et sérénades, Elle m’a bien coûté deux ou trois cents cruzades. — Frère, ta langue est jeune et facile à mentir. — Ma main est jeune aussi, frère, et rude à sentir. — Que je la sente done, et garde que ta bouche Ne se rouvre une fois, sinon je te la bouche Avec ce poignard, traître, afin d’y renfoncer Les faussetés d’enfer qui voudraient y passer. — Oui-da! celui qui parle avec tant d’arrogance, A défaut de son droit, prouve sa confiance; Et quand avons-nous vu la belle? Justement Cette nuit?
— Ce matin.
— Ta lèvre sûrement
N’a pas de ses baisers si tôt perdu la trace?... — Je vais te les cracher, si tu veux, à la face! — Et ceci, dit Étur, ne t’est pas inconnu?»
Comme, à cette parole, il montrait son sein nu, Don Paez, sur son cœur, vit une mèche noire Que gardait sous du verre un médaillon d’ivoire; Mais, dès que son regard, plus terrible et plus prompt Qu’une flèche, eut atteint le redoutable don, Il recula soudain de douleur et de haine, Comme un taureau qu’un fer a piqué dans l’arène: «Jeune homme, cria-t-il, as-tu dans quelque lieu Une mère, une femme? ou crois-tu pas en Dieu? Jure-moi par ton Dieu, par ta mère et ta femme, Par tout ce que tu crains, par tout ce que ton âme Peut avoir de candeur, de franchise et de foi, Jure que ces cheveux sont à toi, rien qu’à toi! Que tu ne les as pas volés à ma maîtresse, Ni trouvés, — ni coupés par derrière à la messe! — J’en jure, dit l’enfant, ma pipe et mon poignard! — Bien! reprit don Paez, le traînant à l’écart, Viens ici, je te crois quelque vigueur à l’âme. En as-tu ce qu’il faut pour tuer une femme? — Frère, dit don Étur, j’en ai trois fois assez Pour donner leurs paiements à tous serments faussés. — Tu vois, prit don Paez, qu’il faut qu’un de nous meure. Jurons donc que celui qui sera dans une heure Debout, et qui verra le soleil de demain, Tuera la Juana d’Orvado, de sa main. — Tope, dit le dragon, et qu’elle meure, comme Il est vrai qu’elle va causer la mort d’un homme!»
Et sans vouloir pousser son discours plus avant, Comme il disait ce mot, il mit la dague au vent. Comme on voit dans l’été, sur les herbes fauchées, Deux louves, remuant les feuilles desséchées, S’arrêter face à face, et se montrer la dent; La rage les excite au combat; cependant Elles tournent en rond lentement, et s’attendent; Leurs mufles amaigris l’un vers l’autre se tendent. Tels, et se renvoyant de plus sombres regards, Les deux rivaux, penchés sur le bord des remparts, S’observent; — par instants, entre leur main rapide, S’allume sous l’acier un éclair homicide. Tandis qu’à la lueur des flambeaux incertains, Tous viennent à voix basse agiter leurs destins, Eux, muets, haletants vers une mort hâtive, Pareils à des pêcheurs courbés sur une rive, Se poussent à l’attaque, et, prompts à riposter, Par l’injure et le fer tâchent de s’exciter. Étur est plus ardent, mais don Paez plus ferme. Ainsi que sous son aile un cormoran s’enferme, Tel il s’est enfermé sous sa dague; — le mur Le soutient; à le voir, on dirait à coup sûr Une pierre de plus dans les pierres gothiques Qu’agitent les falots en spectres fantastiques. Il attend. — Pour Étur, tantôt d’un pied hardi, Comme un jeune jaguar, en criant il bondit; Tantôt calme à loisir, il le touche et le raille, Comme pour l’exciter à quitter la muraille.
Le manège fut long. — Pour plus d’un coup perdu, Plus d’un bien adresse fut aussi bien rendu, Et déjà leurs cuissards, où dégouttaient des larmes, Laissaient voir clairement qu’ils saignaient sous leurs armes. Don Paez le premier, parmi tous ces débats, Voyant qu’à ce métier ils n’en finissaient pas: «A toi, dit-il, mon brave! et que Dieu te pardonne!» Le coup fut mal porté, mais la botte était bonne; Car c’était une botte à lui rompre du coup, S’il l’avait attrapé, la tête avec le cou. Étur l’évita donc, non sans peine, et l’épée Se brisa sur le sol, dans son effort trompée. Alors, chacun saisit au corps son ennemi, Comme après un voyage on embrasse un ami. — Heur et malheur! On vit ces deux hommes s’étreindre Si fort, que l’un et l’autre ils faillirent s’éteindre, Et qu’à peine leur cœur eut pour un battement Ce qu’il fallait de place en cet embrassement. — Effroyable baiser! — où nul n’avait d’envie Que de vivre assez long pour prendre une autre vie; Où chacun, en mourant, regardait l’autre, et si, En le faisant râler, il râlait bien aussi: Où pour trouver au cœur les routes les plus sûres, Les mains avaient du fer, les bouches des morsures. — Effroyable baiser! — Le plus jeune en mourut. Il blêmit tout à coup comme un mort, et l’on crut, Quand on voulut après le tirer à la porte, Qu’on ne pourrait jamais, tant l’étreinte était forte, Des bras de l’homicide ôter le trépassé. — C’est ainsi que mourut Étur de Guadassé.
Amour, fléau du monde, exécrable folie, Toi qu’un lien si frêle à la volupté lie, Quand par tant d’autres nœuds tu tiens à la douleur, Si jamais, par les jeux d’une femme sans cœur, Tu peux m’entrer au ventre et m’empoisonner l’âme, Ainsi que d’une plaie on arrache une lame, Plutôt que comme un lâche on me voie en souffrir, Je t’en arracherai, quand j’en devrais mourir!