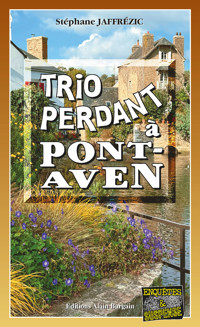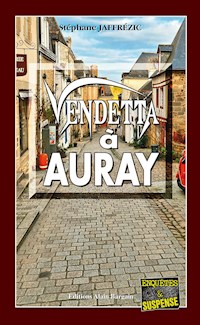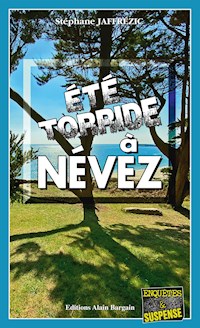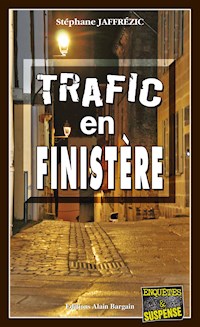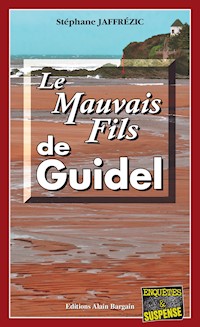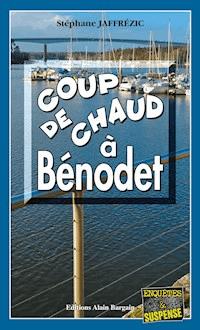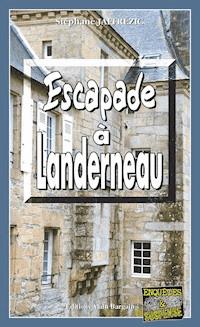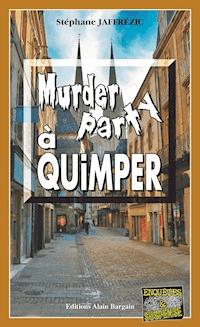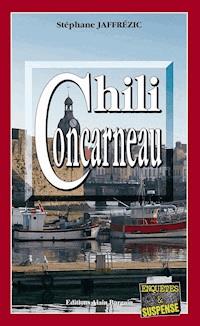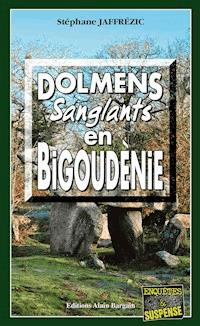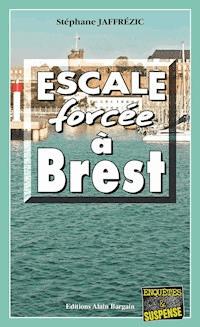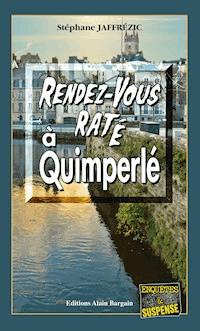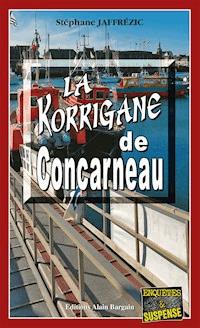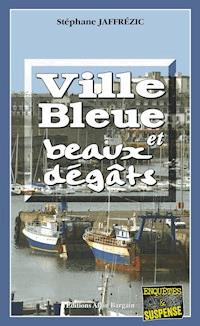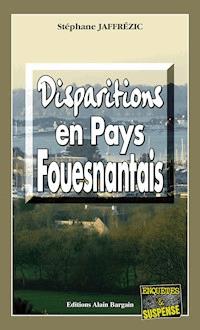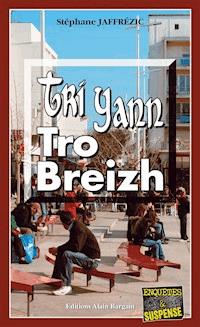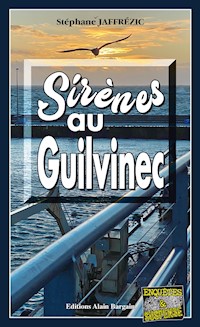
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alain Bargain
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Les enquêtes de Maxime Moreau
- Sprache: Französisch
Une famille bien comme il faut visée par une attaque... Ses membres sont-ils aussi irréprochables qu'ils ne paraissent ?
Au beau milieu de la nuit, des coups de feu sur une voiture inoccupée réveillent les habitants d’une rue tranquille de Quimper. Certes, il n’y a pas de victime, et c’est heureux, mais pour quelle raison un ou plusieurs inconnus ont-ils agi ainsi ? Est-ce un message à destination de la famille visée ou de l’un de ses membres ? Mais alors, lequel ? Le père mareyeur au Guilvinec et à Penmarc’h, la mère esthéticienne à Pont-l’Abbé, le fils lycéen ou la fille collégienne ? Et si la vérité était tout autre ?
Confrontés à des non-dits et des secrets, Maxime Moreau et ses équipiers de la police judiciaire vont aller de surprise en rebondissement, avant que la vérité n’éclate, aussi imprévisible que diabolique.
Laissez-vous surprendre par cette quinzième enquête de Maxime Moreau dans le Pays bigouden !
EXTRAIT
"La voiture se gara le long du trottoir. Le conducteur n’en descendit pas tout de suite. Il observa les abords, à la recherche du coupé BMW blanc dont il connaissait la plaque d’immatriculation par cœur, alors qu’il ne se souvenait jamais de celles de ses propres véhicules. Il le vit, à une cinquantaine de mètres, impeccablement parqué le long du muret sur lequel, aux beaux jours, beaucoup s’asseyaient pour se repaître du panorama. Tourmentées ou calmes, les eaux de l’océan Atlantique le passionnaient lui aussi, et invariablement le ramenaient vers elles. Comme les sirènes de L’Odyssée, leurs chants l’attiraient. Que ce soit le doux murmure des vagues léchant le sable, le clapotis contre la coque d’un bateau, ou les assourdissantes déflagrations lorsqu’elles explosent contre un quai ou des rochers, il aimait la mer. Il fallait qu’elle soit là, toute proche. Il ne parvenait toujours pas à comprendre pourquoi il n’habitait pas une ville du bord de mer. Si, finalement, avec du recul, il comprenait pourquoi : un temps, l’amour avait été le plus fort. L’amour avait décidé à sa place. À l’époque, l’idylle n’était pas naissante puisque lui et son épouse se connaissaient depuis quatre ans lorsqu’ils avaient emménagé dans la grande maison héritée par sa femme, au décès de sa mère. Jour après jour, le temps avait fait son œuvre, imposant de nouvelles habitudes auxquelles il s’était plié de bonne grâce, trouvant un équilibre en partageant son existence entre les avantages d’une ville de taille moyenne, et la mer que pour son travail il voyait quotidiennement.
Au deuxième étage du petit immeuble résidentiel, cachée derrière le rideau d’une porte-fenêtre, la femme guettait celui qu’elle attendait. Il était pile à l’heure. Mais que faisait-il ? Pourquoi n’ouvrait-il pas la portière ?"
À PROPOS DE L'AUTEUR
Natif de Concarneau, Stéphane Jaffrézic habite et travaille à Quimper. Une conversation avec un ami sur un nouveau phénomène de société lui a inspiré son quinzième roman policier. Il est par ailleurs organisateur de murder parties et président du collectif d’auteurs “L’assassin habite dans le 29”.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
REMERCIEMENTS
À Dominique Quéroué et Pascal Tanguy, pour leurs compétences techniques qui donnent du crédit à mes intrigues.
À Élisabeth Mignon, pour le sérieux de son travail de relecture.
À toute l’équipe des Éditions Alain Bargain.
PROLOGUE
Il n’y avait pas un chat dans la rue. Tous devaient être au travail, ou confortablement installés chez eux, au chaud, à l’abri des bourrasques glaciales qui régnaient depuis trois jours. On en venait à regretter la pluie, et surtout le redoux qui en découlait. Ici, en Bretagne, on ne se formalisait pas d’une averse, mais le froid, même sec, n’emportait pas l’adhésion de la majorité. Comble de l’horreur, y compris au moment le plus propice de la journée, le thermomètre n’atteignait pas le zéro, ce qui était mal vécu et devenait le principal, voire l’unique, sujet de conversation. Des températures négatives couvraient toute la région, et, fait extrêmement rare, hormis sur une fine bande côtière, il avait neigé. Une épaisseur de cinq à huit centimètres, qui collait aux semelles des chaussures et aux pneumatiques, paralysant la population. Parce que ici, à l’ouest de la France, loin des Alpes, des Pyrénées ou du Massif central, nul véhicule ou presque était équipé de pneus neige ou de chaînes. Alors, on limitait les déplacements, en attendant des jours meilleurs, quand la pluie salvatrice ferait grimper le mercure en positif.
La voiture se gara le long du trottoir. Le conducteur n’en descendit pas tout de suite. Il observa les abords, à la recherche du coupé BMW blanc dont il connaissait la plaque d’immatriculation par cœur, alors qu’il ne se souvenait jamais de celles de ses propres véhicules. Il le vit, à une cinquantaine de mètres, impeccablement parqué le long du muret sur lequel, aux beaux jours, beaucoup s’asseyaient pour se repaître du panorama. Tourmentées ou calmes, les eaux de l’océan Atlantique le passionnaient lui aussi, et invariablement le ramenaient vers elles. Comme les sirènes de L’Odyssée, leurs chants l’attiraient. Que ce soit le doux murmure des vagues léchant le sable, le clapotis contre la coque d’un bateau, ou les assourdissantes déflagrations lorsqu’elles explosent contre un quai ou des rochers, il aimait la mer. Il fallait qu’elle soit là, toute proche. Il ne parvenait toujours pas à comprendre pourquoi il n’habitait pas une ville du bord de mer. Si, finalement, avec du recul, il comprenait pourquoi : un temps, l’amour avait été le plus fort. L’amour avait décidé à sa place. À l’époque, l’idylle n’était pas naissante puisque lui et son épouse se connaissaient depuis quatre ans lorsqu’ils avaient emménagé dans la grande maison héritée par sa femme, au décès de sa mère. Jour après jour, le temps avait fait son œuvre, imposant de nouvelles habitudes auxquelles il s’était plié de bonne grâce, trouvant un équilibre en partageant son existence entre les avantages d’une ville de taille moyenne, et la mer que pour son travail il voyait quotidiennement.
Au deuxième étage du petit immeuble résidentiel, cachée derrière le rideau d’une porte-fenêtre, la femme guettait celui qu’elle attendait. Il était pile à l’heure. Mais que faisait-il ? Pourquoi n’ouvrait-il pas la portière ?
Dans sa voiture, l’homme enfonça la casquette sur sa tête, remonta le col de son blouson, avant de s’assurer du résultat dans le miroir du pare-soleil. S’avouant qu’il était évident que l’on ne pouvait le reconnaître, il posa la main sur la poignée de la portière. Il sortit en souplesse ; du moins, tout est relatif, de façon plus souple qu’il ne le faisait d’ordinaire. Connaissait-il une seconde jeunesse, ou était-ce en prélude au rendez-vous galant qu’il se voulait léger comme l’air ? Il entrevoyait la réponse, et comme un adolescent certain de retrouver sa petite copine avec laquelle, en s’y blottissant ou en la prenant dans ses bras, il allait redécouvrir l’indicible bonheur de ressentir la chaleur d’un corps près du sien. Il sentit un frisson parcourir son corps tout entier.
Il avait envie de courir, mais il ne pouvait se permettre de se faire remarquer, alors il s’obligea à marcher. Curieusement, de penser à ne pas accélérer le pas lui donnait l’impression de ne pas marcher normalement, de manquer de naturel.
L’entrée de la résidence était commandée par un digicode. À aucun moment il n’avait pensé à demander le code, et celle qui l’attendait n’avait pas non plus pensé à le lui donner. De la dernière phalange de son index, il appuya sur le bouton du seul logement qui ne possédait pas une étiquette comportant le nom du ou des propriétaires.
— Oui ! fit une voix féminine.
— Je suis là.
— Vas-y, monte, je t’attends.
Négligeant l’ascenseur qui lui aurait fait perdre un temps précieux, car bien entendu il n’était pas au bon niveau, il embouqua l’escalier. Il aurait voulu franchir les marches deux à deux, mais la crainte de parvenir essoufflé deux étages plus haut le retint. Pour ce rendez-vous, il s’était mis à son avantage, se douchant, se rasant de près, se parfumant d’une eau de toilette au prix mirobolant, s’habillant avec goût. Il n’allait pas tout gâcher en arrivant époumoné, une goutte de sueur sur le front…
Il y avait deux portes sur le palier. Pour éviter toute méprise, l’une était entrebâillée. Sans sonner ou frapper, il repoussa lentement la porte du dos de la main. Elle pivota sur ses gonds, découvrant un couloir qui menait à deux chambres et à la salle de bains. Il entra, referma la porte, et tourna la clé dans la serrure. Cette formalité accomplie, sans hésiter, il prit à droite, vers la pièce à vivre. Elle était là, debout, de dos, nue, totalement nue.
Aussitôt, il en éprouva de la déception, car il aurait voulu la déshabiller lui-même, procédant par étapes, tout en l’embrassant et en la caressant. Sa contrariété fut de courte durée. Il en fallait plus, beaucoup plus, pour éteindre l’envie de la posséder qui soudain l’envahit.
Les longs cheveux noirs de la femme étaient retenus par un chouchou, qu’elle défit d’un geste rond, souple, élégant. Mi-homme mi-bête, il laissa tomber sa casquette, s’approcha, l’enlaça et l’embrassa à la limite du cou et de la nuque. Plus excité que jamais, il soufflait. Il en avait conscience, alors intérieurement il s’exhorta au calme, mais son instinct animal prenait le dessus.
Comme toutes les autres, la pièce était vide de tout mobilier. Pas un lit pour recevoir leur délire amoureux, pas une table ou même une chaise, seulement le sac à main de la femme et ses vêtements. Qu’à cela ne tienne, il l’emmena vers le sol, se débarrassa de ses vêtements sans y accorder autant de soin qu’il en avait mis pour les enfiler. Sur le plancher vitrifié, il la prit.
I
— Salut, Simon, c’est Max. Je vais être en retard, ce matin. J’ai un pneu à plat sur ma bagnole. Le temps de mettre la roue de secours et de passer déposer l’autre pneu à un garage pour qu’on retire la pointe que j’ai vue, et j’arrive.
— Pas de souci. Je viens d’arriver au bureau, là, mais depuis cinq heures et demie ce matin, j’étais avec Maela.
Maela Gourriou est une sympathique trentenaire qui dépend de l’antenne de police judiciaire de Brest. Elle a pour avantage de parler le breton, ce qui est un atout non négligeable lorsqu’elle doit interroger des personnes qui pratiquent cette langue. L’avantage pour cette polyglotte est que le lien peut se faire plus facilement, et amener à divulguer de précieuses informations.
— Comment va la jeune brigadière-chef ?
— Elle n’était pas à prendre avec des pincettes. Elle était furax de venir si tôt depuis Plouzané. Je ne dirais pas qu’elle fume clope sur clope mais, à ce régime-là, elle ne fera pas la matinée avec son paquet.
— C’est du lourd, ce qui a motivé sa venue ?
— Ce matin, à quatre heures trente, une voiture a essuyé des coups de feu. Ça s’est déroulé ici à Quimper, à quelques centaines de mètres du tribunal, rue Louis-Hémon. Tout le voisinage a été réveillé. La BAC* était sur place quelques minutes plus tard. La BSU** a isolé le site et a prévenu le permanent du parquet, la vice-procureure Juliette Trodat, qui à son tour a saisi le permanent de la PJ, cette chère Maela. Elle m’a réveillé pour me demander de l’aider à procéder aux premières constatations, et elle a requis le concours du SRIJ***. Ils sont trois sur place, depuis une petite heure.
— Laissons-les bosser avec Maela jusqu’à ce que j’arrive, on verra ce qu’ils pourront nous apprendre. Pour ce matin, on ne change pas le dispositif d’hier. Tu dis à Justin et Suzy de planquer, et toi, tu planches sur les écoutes.
— Entendu. À tout à l’heure !
C’est bien ma veine. De l’équipe du matin à l’hôpital Laennec de Quimper, Murielle est partie depuis près de deux heures ; sinon, j’aurais pris sa voiture et j’aurais requis un garage local pour réparer le pneu, et le tour était joué. Je pose mon portable et mon blouson sur le siège conducteur, referme la portière, et vais prendre le cric et la croix démonte-roue dans le coffre. Allez, au boulot !
La roue de secours en place, un passage par la maison est obligatoire pour me laver les mains, tant l’enjoliveur était sale de résidus de freinage ou de je-ne-sais-quoi. Je suis en train de me savonner les mains quand mon portable fait entendre les premières notes de Whole lotta love, le méga-tube du groupe Led Zeppelin que j’ai choisi pour sonnerie depuis un bon moment, sans m’en lasser. Me déhanchant pour lire le nom de l’appelant, je constate qu’il s’agit de Simon. Il va attendre une minute, il n’y a pas urgence. Lorsque j’ai les mains sèches, je le rappelle.
— Tu as cherché à me joindre ou tu as fait une mauvaise manip’ ?
— J’ai bien tenté de t’avoir en ligne. Juliette Trodat a appelé, elle te veut au plus tôt dans son bureau.
— Eh bien, elle va patienter. Elle t’a dit ce qu’elle me voulait ?
— Oui, dessaisir Maela et nous confier l’affaire des coups de feu. Je lui ai dit de ne pas compter sur toi avant une bonne demi-heure.
— En gros, c’est le temps qu’il va me falloir pour rappliquer. Je me mets au volant, et je vais directement au tribunal. Tu as vu avec Suzy et Justin ?
— Oui, ils viennent de partir.
— OK. À plus tard !
Sept à huit minutes pour sortir de Concarneau et emprunter la bretelle d’accès à la voie express, autant sur celle-ci avant la bretelle de Troyalac’h, un peu plus pour, après tout un jeu de ronds-points, me diriger vers le centre-ville de Quimper, encore deux ou trois pour trouver un stationnement et revenir à pied, et je suis au tribunal de grande instance à peu près dans le créneau horaire indiqué.
À l’entrée, un agent de sécurité m’invite à déposer dans une bannette en plastique les objets métalliques en ma possession. Ma carte professionnelle m’évite le portique, et la sonnerie qui n’aurait manqué de retentir car, outre mon portable et mon trousseau de clés, j’ai mon arme de service dans son holster, et une paire de menottes dans son étui.
Au rez-de-chaussée, la porte du bureau de la vice-procureure est entrouverte. Assise derrière son bureau, la femme de loi est occupée à signer un document que sa secrétaire a glissé dans un parapheur. Quand c’est fait, cette dernière revient vers la porte, arbore un sourire à croquer, et après un regard vers sa supérieure hiérarchique, qui acquiesce en opinant du menton car elle aussi m’a aperçu, elle s’efface pour me céder le passage, puis sans bruit referme la porte.
— Bonjour, capitaine Moreau. Asseyez-vous. Alors, un problème de voiture, ce matin ?
— Une crevaison, ce qui entraîne un léger retard. Je m’en tire bien, il a commencé à pleuvoir juste quand je resserrais le dernier boulon.
C’est sans ambages qu’après cette précision elle entre dans le vif du sujet :
— Avez-vous été avisé des coups de feu de cette nuit ?
— Oui, par l’un de mes équipiers, celui à qui la brigadière-chef Maela Gourriou a demandé un coup de main.
— Sitôt prévenue, je suis allée sur les lieux. Je n’en sais pas énormément pour l’instant, sinon que le propriétaire de la voiture canardée travaille dans le Pays bigouden et réside à Quimper. Maela Gourriou va rester avec vous aujourd’hui, avant de repartir vers le Finistère nord.
Inutile d’objecter quoi que ce soit, sa décision est prise.
Il faut croire qu’involontairement j’ai grimacé ou que mon regard a trahi mon abattement, car elle s’empresse d’opposer :
— Abandonnez momentanément le dossier de stupéfiants sur lequel vous travaillez, ou confiez-le à un seul de vos agents, et concentrez vos forces sur cette affaire. Vous savez aussi bien que moi que lorsque les dealers seront arrêtés, aussi important soit leur trafic, d’autres prendront leur place, et tout sera à recommencer. Alors…
Le reste de sa phrase se perd dans un silence lourd de signification.
— Mes chefs veulent des résultats, Madame la procureure. Du produit, encore du produit, toujours du produit.
— Je connais leurs exigences, mais ils doivent bien comprendre que nous ne parviendrons jamais à éradiquer les trafics. Il s’en trouvera toujours pour reprendre le flambeau. Le marché des stupéfiants est bien trop lucratif. Pour l’affaire qui désormais vous concerne, il y a eu usage d’une arme, et cela est bien plus grave. Je m’accommoderai avec votre hiérarchie, s’il le faut. Pour l’instant, vous êtes chargé d’une enquête de flagrance. Si d’ici deux semaines vous n’obtenez pas de résultat, je nommerai un juge d’instruction.
Elle se lève et marche vers la porte, signe que l’entretien est terminé.
— Vous avez fait du bon boulot, lors de votre dernière grosse affaire. Et en un temps limité, qui plus est. Si vous travaillez à la même vitesse, il n’y aura vraisemblablement pas de raison d’en nommer un. Au revoir, capitaine Moreau. Bon courage !
Pour clore le rendez-vous et motiver les troupes, le coup de brosse à reluire qui va bien. Une éternelle coutume, chez les membres du parquet, à laquelle je ne me ferai jamais. Son comportement n’est pas détestable, à l’inverse de celui du procureur Colinet, il est même un brin amical, et apporte une certaine détente à nos rencontres.
Le temps de notre entrevue, la pluie a cessé, laissant de belles flaques et remplissant les caniveaux. Je n’ai pas envie de découvrir les lieux de la fusillade, pourtant proches. Pas maintenant. Ma priorité est de me procurer les premiers éléments recueillis par la BAC et la BSU, les premiers à être intervenus. Cela ne me prendra pas beaucoup de temps avant d’aller retrouver Maela.
Au commissariat de la rue Théodore-Le Hars, quelques serrements de main aux collègues du rez-de-chaussée, puis je rejoins Simon dans son bureau, au troisième étage.
— Comment ça va, Max ?
— Une seconde, j’arrive, dis-je en allant à mon bureau allumer mon ordinateur. Pas génial, mon début de journée : d’abord un pneu crevé, et maintenant la proc’ qui nous refile du taf supplémentaire, comme si on n’avait que ça à faire. Et toi, ça baigne ?
— Oui, ça va. Comme convenu, Suzy et Justin sont en planque, et moi je retranscris les SMS et appels d’hier soir et de la nuit. Coup de bol, il n’y en a pas des masses.
— Tant mieux, parce qu’on laisse momentanément tomber ce dossier ! Oh, avant d’en parler, je voudrais te féliciter.
Interloqué, il retient la main qu’il me tendait pour me saluer, maintenant que je suis dans son antre.
— Me féliciter ! Et pourquoi donc ? Qu’est-ce que j’ai bien pu faire qui puisse mériter tes félicitations ?
— Ce ne sont pas seulement les miennes, de félicitations. Attention, roulement de tambour : brigadier-chef Simon Jaouen, vous êtes nommé au grade de major de la police nationale.
— Non ! Tu déconnes ! Je l’ai, ma promo ?
— Je suis très sérieux. J’ai appris ça hier soir. Te sachant émotif, mon biquet, je ne t’ai pas prévenu, sinon tu n’aurais pas fermé l’œil de la nuit. Or, j’ai besoin d’agents parfaitement reposés et disposant de toutes leurs facultés pour mener à bien les missions dont nous sommes chargés.
— T’es con, Max ! Tu aurais dû me bigophoner.
— Pour que tu fêtes ça à l’apéro avec Madame ? Ce qui m’a retenu, c’est que tu n’aurais pas été frais et dispo ce matin.
Devant son air indécis, je me dois de le rassurer :
— Mais non, je rigole ! Ça m’a effleuré, mais je me suis dit que ce serait bien de le faire avec les collègues.
Nouveau regard soupçonneux du major.
— Là encore, ce n’était qu’une plaisanterie. Pour dire la vérité, je n’ai pas pris le temps quand j’ai eu l’info, et en arrivant chez moi j’ai complètement zappé.
— Dommage, sinon, j’aurais prévu un truc pour aujourd’hui. J’aurais pris des croissants.
— Partie remise, mon ami. Allez, on se met au boulot : que peux-tu me dire sur les coups de feu de cette nuit ?
— Très peu. Il y a trois bastos dans la carrosserie et une autre dans le pare-brise d’une Mercedes. Un gros modèle.
— Je vais récupérer des infos chez Bruno Céramit. Il en sait peut-être plus.
À l’étage en dessous, le capitaine responsable de la BSU est attablé derrière son bureau, les yeux rivés sur l’écran de son ordinateur. Ayant entendu le bruit de mes pas, il lève une paupière.
— Ah, je t’attendais ! annonce-t-il en tendant une main, que je serre. Je me doutais que j’allais avoir ta visite.
— Salut, Bruno. Note bien que je m’en serais passé. On n’avait pas besoin de ça, on ne sait déjà plus où donner de la tête.
— Ne te tracasse pas, j’ai l’habitude.
Cela est dit sans animosité, Céramit ne vivant pas mal la décision du procureur.
— Qu’est-ce que vous avez pu gratter ?
— Rien. Mes gars ont discuté avec le proprio de la bagnole en attendant que la permanente de la PJ arrive, mais ils n’ont pris aucune déposition.
— Et que dit le propriétaire ?
— Il n’a pas d’ennemi, il ne voit pas qui pourrait lui vouloir du mal. Selon lui, ce n’est pas sa voiture qui était ciblée. Ce serait un hasard.
— Ils le croient ?
— Pour l’instant, rien n’interdit de lui faire confiance.
— Merci, Bruno, à plus tard.
*
Accompagné de Simon, à qui j’ai relaté mon court entretien avec le patron de la BSU, je quitte le commissariat pour rallier la rue Louis-Hémon. Le palais de justice est en bordure de l’Odet, la rivière qui traverse la ville avant de suivre son cours jusqu’à Bénodet, où elle se mêle à l’océan Atlantique. Derrière le palais de justice, des rues calmes abritent de splendides demeures bourgeoises construites pour la plupart dans la première moitié du XXe siècle. En temps normal, il n’est pas évident de dénicher une place pour se garer. Mais aujourd’hui, tant que les techniciens du SRIJ n’ont pas terminé de photographier les lieux sous tous les angles et de procéder à toutes sortes de relevés et constatations, une voiture de police barre la rue et interdit la circulation. Un vent léger fait danser la rubalise jaune sur lequel il est inscrit « Police nationale — Zone interdite ». Pour nous laisser accéder, un policier en uniforme récemment affecté au commissariat la soulève bien haut pour éviter qu’elle ne s’accroche sur l’antenne. Nous sortons de la voiture, et attendons que Maela s’aperçoive de notre arrivée, demeurant derrière un cavalier numéroté posé au sol près d’une douille pour ne pas polluer la scène. Il y a d’autres cavaliers, une bonne dizaine qui chacun porte un chiffre, sur le macadam ou le trottoir.
Les spécialistes de la police technique et scientifique ont déployé les grands moyens en termes d’effectifs. Ils sont trois, en combinaison blanche et capuche, gantés et masqués. L’un fouille précautionneusement l’habitacle de la Mercedes, les deux autres, le coffre. La brigadière-chef est près d’eux.
Lorsque les deux techniciens délaissent le coffre pour aller vers leur véhicule chercher un instrument quelconque ou un sachet en guise de scellé, le regard de la jeune femme balaie l’ensemble de la scène et, pour le coup, elle se rend compte que nous sommes là. Un signe de la main nous invite à les rejoindre. Une bise pour elle, une poignée de main pour les hommes en blanc.
— Le proc’ nous a refilé le dossier. Je me serais bien passée de venir dans votre secteur.
Elle fouille dans le petit cartable en cuir qu’elle tient à la main, et en sort un procès-verbal d’audition, sur lequel je lis qu’il concerne un certain Anthony Trégunc. Sans être sollicitée, elle délivre les renseignements en sa possession.
— Le propriétaire de la voiture est mareyeur à Penmarc’h et au Guilvinec. Il terminait son petit-déjeuner quand il a entendu les coups de feu. Il est sorti en prenant ses précautions, mais n’a rien vu qui pourrait nous mettre sur la trace du tireur.
— D’autres voitures ont morflé ?
— Non, seulement la sienne, ce qui pourrait définir qu’elle était ciblée.
— Ou lui-même, ou un membre de sa famille. Il est marié ?
— Oui. Marié, deux enfants.
— Je crois qu’on va rapidement faire connaissance avec cette famille. Tu as autre chose ?
— Non. Pour le PV, c’est le minimum. Il faut avouer que je n’ai pas vraiment eu le temps d’enquêter.
— On peut le voir, ce bonhomme ?
— Il n’est pas à la maison. Sitôt l’audition achevée, il a pris la route du Pays bigouden. Il ne voulait pas rater la vente à la criée du Guilvinec.
— Tu l’as laissé partir ? Tu aurais peut-être dû le garder au chaud, non ?
— Je n’allais pas le menotter, objecte Maela après s’être mordu les lèvres, soudain consciente qu’elle a sans doute commis une boulette. Lui, c’est la victime, pas le coupable.
— Oui, mais si un gazier s’est cru à un stand de tir en mitraillant sa bagnole, on peut craindre qu’il soit en danger. Je crois que tôt ou tard nous allons prendre la même direction que lui.
Dans l’intervalle, les techniciens sont revenus près de la voiture.
— C’est vous qui reprenez l’affaire ? interroge le plus grand, un type que je connais depuis des années, car il est maintes fois intervenu à ma demande sur des scènes de crime.
— C’est Maela qui est intervenue la première car c’est elle qui est de permanence, mais oui, c’est la PJ de Quimper qui récupère le bébé, car elle vient du nord du département. Ce sera plus facile pour nous qui sommes sur place. Quelles sont vos premières constatations ?
— Nous avons dénombré quatre impacts, dit-il. Il semble que ce soit la même arme qui ait servi, mais il faudra attendre l’étude balistique pour pouvoir l’affirmer avec certitude. Venez voir… Une ici, dans le pare-brise.
— À l’emplacement du visage du conducteur, souffle Simon.
— Tout à fait ! Une autre ici dans la portière avant, côté gauche.
— Portière côté conducteur, émet le nouveau major.
— Oui, et une là, dans l’aile avant, et la dernière dans la portière arrière. Elles sont toutes du même côté, côté rue et non trottoir, ce qui donnerait à penser que le tireur, si tant est qu’il n’y ait qu’un seul tireur, a défouraillé une fois dans le pare-brise à l’emplacement du conducteur, comme tu le disais Simon, et qu’il ait arrosé le côté gauche de la carrosserie avant de déguerpir. Ou alors, il a commencé par la carrosserie et a terminé par le pare-brise. Dans les deux cas, l’intervention était rapide.
— À mon avis, ce n’est pas gratuit. La façon de procéder me fait penser à une mission expéditive, un peu comme s’il y avait un message à faire passer.
— Complètement d’accord avec toi, Maxime, approuve l’autre technicien, un homme proche de la retraite et que j’ai également croisé à de multiples reprises. Ce ne sont pas juste des coups de feu sur une bagnole, il y a une menace derrière.
— Comme pour définir qu’il ne faut surtout pas prendre le tireur ou les tireurs à la légère, hasarde Maela.
— Oui… je vois ça comme ça. La mise en scène me paraît plus réfléchie que ce que j’ai eu l’occasion de voir en certaines occasions, quand les auteurs des coups de feu étaient des individus au casier judiciaire blindé comme un camion de transport de fonds. Ou alors des manouches, pour intimider une autre famille. Mais pas dans le cas présent. Ce ne sont pas des coups de feu tirés à l’aveuglette : il y a un message.
— Hum, hum… Intimidation ou provocation. Ce sera au proprio de nous le dire.
Dans le Finistère, et plus largement en Bretagne, hormis à la campagne le dimanche matin, en période de chasse, rares sont les coups de feu qui défrayent la chronique.
Il y a quelques années, sur le parking d’une zone commerciale brestoise, ou encore sur le parking d’un centre commercial d’Ergué-Gabéric, commune voisine de Quimper, ils étaient le fait de gens du voyage qui voulaient en découdre avec une autre famille avec laquelle ils étaient en conflit. Ceci n’est pas équivalent aux mortelles expéditions punitives marseillaises à coups de Kalachnikov, qui ont pour but de faire respecter un territoire pour écouler de la came, mais ces informations en avaient sidéré plus d’un. Il y en a eu plus récemment, à Brest, quartier de Kerourien, puis une semaine plus tard au lycée Dupuy-de-Lôme de cette même ville, ou encore quartier de Kerangoff, faisant trois blessés, mais ici, à Quimper la belle endormie, ce n’est pas monnaie courante. Pour revendiquer la mainmise sur le trafic de stupéfiants, on n’en est pas encore à sortir les calibres, même si les Tchétchènes ayant œuvré sur Brest ont aussi des attaches dans la ville préfecture.
— Pour nous aiguiller, avez-vous découvert des indices, ou des traces ?
— Je vous fais un état des lieux : vous tombez bien, maintenant que toutes les photos sont terminées, opine le plus âgé, dont l’aspect rougeaud du visage est plus frappant qu’en temps normal, car enserré dans la capuche blanche. On termine d’inspecter la voiture, et tout à l’heure un camion-plateau l’emportera à un dépôt, pour qu’on l’examine sous toutes ses coutures et qu’on récupère les balles. Nous avons isolé les douilles. Ça nous donnera au moins le type d’arme utilisée. Il y a aussi quelques mégots dans la rue ou sur le trottoir, mais rien ne dit que le tireur ait fumé une clope tout en arrosant la bagnole. Il y a aussi un papier de bonbon, mais c’est peut-être une rafale qui l’a amené jusqu’ici.
Pas folichon. On est à mille lieues de la pléthore d’indices d’une scène de crime d’une série télévisée.
— On y va, pour les scellés ? interroge le plus grand. Ce sera rapide, il y en a douze en tout.
— Si le collègue découvre des trucs intéressants dans la caisse, complète l’autre en balançant un pouce par-dessus son épaule en direction de la Mercedes et des deux techniciens, il nous prévient.
— Eh bien, allons-y, pour les scellés. En nous y mettant à trois…
J’étais en train de sortir un stylo de la poche intérieure de mon blouson pour inscrire les mentions légales sur la fiche du premier scellé, quand la sonnerie de mon téléphone m’interrompt. Je m’éloigne pour répondre, pendant qu’ils préparent le matériel nécessaire.
— Allô !
— Max, c’est Bruno. Anthony Trégunc est dans nos murs. Il a pu se libérer plus tôt qu’il ne le pensait.
— Ah ! Bon ben… j’arrive. Dis-lui que je suis là dans cinq à dix minutes.
Ramassant mon portable et rempochant mon stylo, je préviens Maela et Simon :
— Le mareyeur m’attend au commissariat. Je vais enregistrer son témoignage. Il aura peut-être quelque chose à ajouter à ton premier PV, Maela. Selon le temps que ça prendra, je reviens, ou alors on se retrouve au bureau. Je prends la voiture. À tout à l’heure.
*
À l’accueil du commissariat, un adjoint de sécurité m’indique un homme qui patiente dans l’espace salle d’attente, assis sur une chaise. La quarantaine alerte, le mareyeur est un costaud, au cheveu châtain épais sous un visage avenant. Pantalon de jean et pull-over rendu informe par les années, on devine que l’homme ne se soucie guère de sa tenue vestimentaire. Ceci pourrait trancher, dans le quartier bourgeois dans lequel il réside, mais il ne faut pas perdre de vue que lorsqu’il s’est habillé ce matin, c’était pour aller travailler. Dans son univers professionnel, on ne s’embarrasse pas de ces détails. Nul doute cependant que le week-end, il doit se mettre à la page.
— Bonjour, monsieur Trégunc, dis-je amicalement pour le mettre en confiance. Je suis le capitaine Moreau.
— Bonjour, dit-il en se levant.
— Je suis ravi que vous ayez pu vous rendre disponible. Venez, nous allons à mon bureau, dis-je en ouvrant la porte du rez-de-chaussée qui cache un escalier.
Parce que le lieu et le moment sont mal choisis pour discuter de choses sérieuses, nous montons les trois étages en échangeant quelques mots sur la météo, sujet bateau s’il en est. En haut des marches, il marque un temps devant l’écusson de la police judiciaire, qui illustre en noir la gueule d’un tigre toutes dents dehors, et en blanc le profil de Georges Clemenceau, président du Conseil et ministre de l’Intérieur sous la Troisième République. Un tantinet mal à l’aise, Trégunc pose sur moi deux yeux bleus empreints de timidité, tandis que j’explique tout en tenant la porte qui mène à nos bureaux :
— Je dirige l’antenne locale de police judiciaire. Des coups de feu, même en direction d’une voiture sans passager, sont des faits suffisamment pris au sérieux pour que nous soyons saisis du dossier. Vous ne pouviez pas vous libérer plus tôt ?
— Il fallait absolument que je sois à la vente à la criée. Je suis venu dès que j’ai pu.
— Ce n’était pas possible de déléguer ?
— Oh non, impossible. Il faut s’y connaître, pour sauter sur les bonnes affaires. C’est un métier qui ne s’improvise pas : on sait le faire, ou on ne sait pas. Si on se plante, on peut perdre beaucoup d’argent.
— Allez-y, asseyez-vous… Avec un peu d’habitude, il me semble qu’on peut savoir au premier coup d’œil si le poisson est frais ou pas, non ?
— Oui, bien sûr, mais ce n’est pas si simple. Il y a plusieurs critères qui entrent en jeu, comme la connaissance des clients. Quand je vais à la vente, j’ai en tête les commandes qu’ils m’ont passées la veille, et je sais donc sur quelles espèces de poissons je dois axer mon choix. Mais si l’occasion se présente, je peux aussi acheter d’autres marchandises, qu’ils ne refuseront pas si le prix est correct.
Mes cils levés soulignent qu’un développement s’impose.
— Par exemple, la semaine dernière, j’ai eu l’occasion d’acheter des encornets pour une somme dérisoire. Ils étaient à trente centimes le kilo, et personne n’en voulait. Je les ai pris. Pour cent quatre-vingts euros, j’ai eu six cents kilos d’encornets. Une aubaine ! Après la vente, quand je suis revenu au magasin, j’ai appelé tous mes clients, les uns après les autres, et pendant que mes employés les préparaient, j’ai vendu la totalité dans la matinée. Rien que sur ce produit, j’ai fait une opération comptable très confortable. Et mes clients n’ont pas regretté, parce qu’ils ont pu proposer à leurs clients un poisson de qualité, facile à cuisiner, et qui plus est sans arête.
Le temps de son explication, j’ai tapé son prénom et son nom sur le clavier de mon ordinateur, pour consulter le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires. L’homme n’est pas connu de nos services. Dommage, j’espérais par ce biais obtenir un levier pour l’amener à divulguer des informations.
Véhiculée par les vêtements du mareyeur, une odeur de poisson s’est installée dans la pièce. Si cela pourrait en déranger certains, ce n’est pas mon cas, car je suis habitué à traîner sur le port de Concarneau quand je ne rentre pas trop tard du boulot, ou dans d’autres ports comme Le Guilvinec ou Douarnenez, lorsque nous nous baladons le week-end avec Murielle.
Certes, les magasins de marée sont fermés le dimanche, mais les senteurs persistent, et pour être franc, elles ont plutôt tendance à me mettre en appétit qu’à me le couper. Je tape de nouveau son prénom et son nom, mais cette fois sur une feuille vierge, pour un acte administratif.
Quand je suis prêt, j’expose ce que nous allons faire :
— J’ai lu le rapport d’audition que ma collègue a rédigé avec vous ce matin. Notre enquête n’en est qu’à son début, et pour nous donner plus de chances de coincer l’auteur des tirs, il importe que vous fournissiez un maximum d’éléments sur votre vie, tant sur le plan professionnel que personnel, car il est clair que votre voiture n’a pas été choisie au hasard. Depuis ce matin, avez-vous eu le temps de réfléchir à tout cela, ou de vous remémorer un incident au demeurant sans réelle gravité, mais qui aurait pu amener un individu à passer à l’acte ?
— J’y ai pensé toute la matinée, mais je ne vois rien qui pourrait vous mettre sur la voie. J’ai une vie bien tranquille, mon travail accapare la plus grande partie de mon temps, et lorsque je ne travaille plus, je ne sors pratiquement pas de chez moi.
— Il y a pourtant quelqu’un qui vous en veut. À vous, à votre épouse ou à l’un de vos enfants. Le fait qu’une arme ait été utilisée est à prendre au sérieux. Il n’y a pas eu de blessé, cette fois, mais qu’en sera-t-il par la suite ? Car rien n’interdit d’envisager qu’il y ait une suite.
L’argument porte. La tête sur le côté, les yeux baissés vers le sol au carrelage qui n’est pas sans rappeler les années soixante ou soixante-dix, il se creuse la cervelle pendant un instant.
— Non, vraiment, je ne vois pas.
— Nous allons chercher à deux, peut-être que cela vous aidera. Mais tout d’abord, racontez-moi ce que vous avez vu. Racontez-moi ce que vous faisiez, ce que vous avez constaté.
Il se dandine sur sa chaise, comme s’il était en mal d’équilibre.
Un répit pour mettre de l’ordre dans ses idées, structurer son discours, et il se lance :
— Mon réveil a sonné à quatre heures et quart, comme tous les matins. Je venais de remplir mon bol de café, quand j’ai entendu quatre détonations. Ça venait de la rue. Au début, j’ai cru que c’étaient des pétards, et je me suis demandé qui étaient les abrutis qui faisaient péter des pétards à quatre heures et demie du matin, en plus en semaine. J’ai ouvert la fenêtre pour les engueuler, et j’ai alors vu une voiture démarrer sur les chapeaux de roues. J’ai juste remarqué qu’elle était blanche. Je suis incapable de préciser le modèle ni même la marque. Il y avait une drôle d’odeur, qui n’était pas celle des pétards, ou celle que l’on sent lors d’un feu d’artifice. Comme j’étais habillé, je suis sorti.
— Pourquoi ? Vous aviez le pressentiment que vous étiez visé ?
— Non ! Non, mais, c’était quand même bizarre. Des détonations, une voiture qui part à fond la caisse…
— Justement, ça aurait pu être dangereux pour vous.
— Ben non, vu qu’elle était partie.
Ce n’est pas faux. N’empêche qu’il ne faut pas être peureux pour aller aux nouvelles. Beaucoup se seraient contentés d’un coup de fil au commissariat. Une pression du doigt sur les touches 1 et 7 du téléphone, et il suffisait d’attendre les reflets bleutés du gyrophare pour sortir sans risque.
— Donc, vous êtes sorti. Après ?
— Je ne suis pas sorti sans prendre mes précautions. J’ai allumé l’éclairage extérieur, et j’ai observé les abords avant de m’aventurer sur le trottoir. Il n’y avait personne dans la rue. J’ai failli repartir vers la maison et, je ne sais pas pourquoi, je suis sorti pour faire le tour de ma voiture. Il me semblait qu’elle n’avait aucun dégât, quand soudain j’ai vu le trou dans le pare-brise.
— À l’emplacement de votre visage, quand vous êtes au volant.
— Oui…
Il n’ajoute rien.
— Dans votre métier, comme dans bien d’autres, je suppose que la concurrence est rude. Y a-t-il un ou plusieurs mareyeurs à qui vous faites de l’ombre ?
— Non, bien sûr que non. Chacun à sa clientèle, et ça marche bien comme cela.
— Eh bien, justement, la clientèle ! On peut aussi chercher sur ce sujet : avez-vous piqué un bon client à un autre mareyeur ?
— Non… pas récemment.
— Pas récemment, ça veut dire que c’est déjà arrivé. À quand remonte la dernière fois ?
De nouveau, ses prunelles filent vers le sol carrelé, tandis qu’il passe une main dans ses cheveux.
— Trois ou quatre mois, peut-être. Mais il continue à s’approvisionner chez mon collègue. Il se ravitaille aussi chez moi, en fonction des prix pratiqués.
Collègue, alors qu’ils sont concurrents. Le terme est-il mal choisi ?
— Il le sait, votre… collègue ?
— Je l’ignore. Et même s’il le savait, il ne sortirait pas un flingue pour dézinguer ma voiture.
— Il y a parfois des réactions qui vont bien au-delà de ce que l’on peut imaginer. Quelle est son identité ?
— Oh, n’allez pas l’inquiéter. Je suis sûr qu’il n’y est pour rien.
— Nous lui poserons quelques questions. Nous verrons alors s’il est totalement blanc. Quel est son nom ?
Comprenant que je n’abdiquerai pas, il soupire pesamment avant d’articuler :
— Philippe Cristali. Ne perdez pas de temps à l’interroger. C’est ça, le commerce : on perd un client, on en trouve un autre… Si on devait dégainer chaque fois, les casses de voitures seraient pleines. Nous avons des rapports courtois, parfois on rigole ensemble, en particulier quand on boit un verre.
— Nous lui rendrons une petite visite de courtoisie. Se peut-il que d’autres mareyeurs aient le même grief à vous opposer ?
Il répond par un nouveau soupir, comme s’il était soucieux de sous-entendre par là que je fais fausse route, avant d’asséner :
— Oui, sûrement. Au Guil’, ou ailleurs. C’est de bonne guerre, mais aucun ne réagirait de cette manière. On se connaît tous, je suis persuadé que personne ne sortirait l’artillerie pour ça.
Je serais assez enclin à le croire, même s’il est évident que cette piste devra être travaillée.
— Pour continuer dans le registre de la clientèle, y a-t-il un client qui pourrait vous reprocher de l’avoir mal servi, ou de l’avoir arnaqué ? Il pourrait avoir reçu du poisson à la fraîcheur ou à la qualité contestable.
— Non ! s’exclame-t-il. C’est impossible. Nous achetons le poisson sitôt débarqué ou sorti des containers. Il est travaillé dans la matinée, et expédié en début d’après-midi sous une épaisse couche de glace, le tout dans des camions isothermes. La chaîne du froid ne s’interrompt jamais.
Un silence suit sa tirade, ce qui n’est jamais bon lors d’un entretien… ou d’un interrogatoire. Dans ce deuxième cas, je laisse un ange passer, seulement à bon escient, lorsque je veux que le suspect qui me fait face pèse le pour et le contre, avant de s’apercevoir qu’il a tout intérêt à balancer sa vérité, la vérité. Bien calé contre le dossier de ma chaise, durant quelques secondes je relis les dernières phrases du procès-verbal, avant de lentement ramener mon corps en avant.
— Soit ! Éloignons-nous de cette piste, sans pour cela abandonner votre milieu professionnel. Avez-vous des employés, et si oui, combien ?
— Nous sommes neuf, en tout. Il y a deux femmes secrétaires-comptables, une au magasin de marée du Guilvinec et l’autre à celui de Saint-Guénolé, qui assurent aussi le standard, l’accueil physique, et accessoirement l’encaissement lorsque des clients lambda se présentent au magasin, plus six hommes et femmes qui travaillent le poisson et les crustacés, et moi. Deux employés et une secrétaire sont à Saint-Gué’, les autres au Guil’.
— Jolie entreprise. Aucun ou aucune employé ne vous complique l’existence ?
— Non, il n’y… Si, une fois, mais ça n’a pas duré longtemps.
Ne proférant pas une parole pour ne pas le brusquer, je plisse les yeux pour l’encourager à poursuivre. Ce qu’il finit par faire, après avoir basculé d’une fesse sur l’autre sur sa chaise.
— Ça remonte à au moins trois ans. Un de mes gars me la faisait à l’envers. Il avait trouvé une astuce pour piquer du poisson. Sur les quantités achetées et travaillées, jamais je ne l’aurais su si un copain ne m’avait pas dit l’avoir vu approvisionner un restaurant de Pont-l’Abbé.
— Que volait-il, et en quelle quantité ?
— Du poisson noble, c’est évident. De la lotte, du saint-pierre, de la sole, des rougets… Trois, quatre ou cinq kilos presque tous les jours.
— Vous ne vous en étiez pas rendu compte ?
— Absolument pas ! Certains jours, je vends des centaines de kilos, alors trois ou quatre sur l’ensemble, ça ne se remarque pas.
— Et cela à votre nez et à votre barbe. Comment faisait-il pour les sortir du magasin ? Il avait un complice ?
— Le poisson acheté à la criée est livré par les employés de la CCI, la chambre de commerce et d’industrie. Ces caisses sont empilables, lorsqu’elles sont vides, ou superposables quand il y a des langoustines ou du poisson dedans. Il faut les alterner côté mâle côté femelle pour ne pas abîmer la marchandise. Ce petit rigolo avait pigé la combine. Il s’était acoquiné avec un copain d’enfance qui bossait à la CCI, pour que celui-ci, quand il venait récupérer les caisses vides pour qu’elles soient lavées pour être utilisables le soir même, mette de côté le poisson que mon gars cachait dans le fond d’une caisse qu’il prenait garde de superposer avec une autre. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, leur cinéma, mais en tout cas le gars de la CCI a été viré.
— Et votre salarié ?