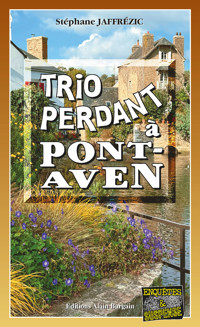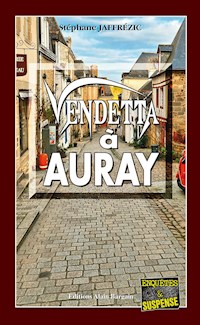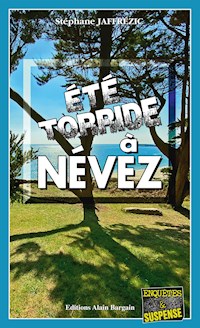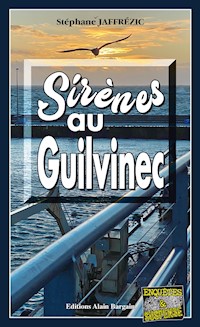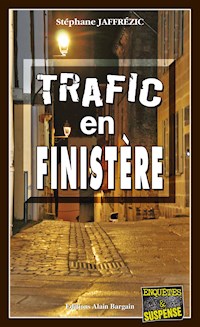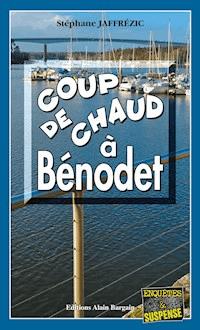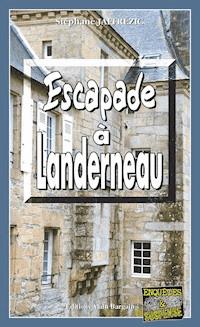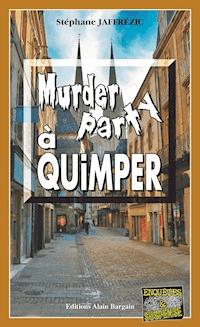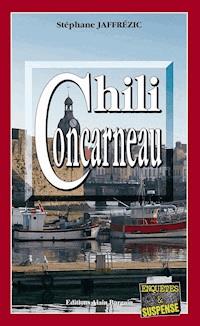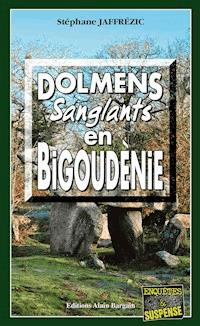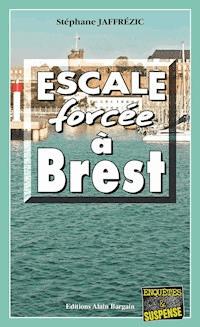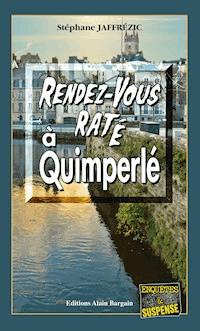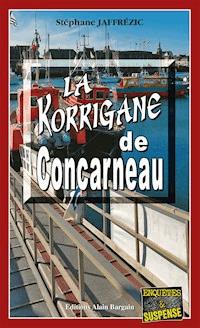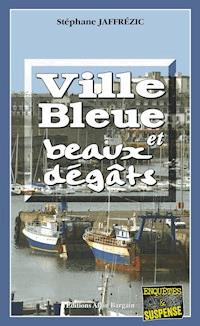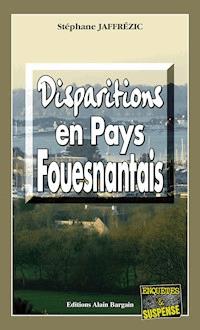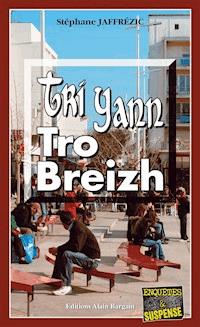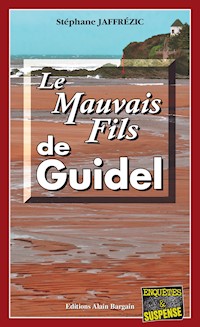
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Maxime Moreau
- Sprache: Französisch
Un héritage très convoité...
Une jeune femme distinguée insiste pour rencontrer le capitaine Maxime Moreau : à la suite d’un conflit familial, elle craint que les jours de sa mère qui vit à Guidel, ne soient en danger à cause de l’important héritage qu’elle détient depuis le décès de son mari. Quel crédit apporter à ses allégations et que faire à part une mise en garde du mauvais fils de la fortunée légataire ? Mais cette dernière est assassinée. Dès lors, à l’équipe de Moreau de démasquer le coupable de ce crime…
Découvrez le 9e volet des enquêtes trépidantes du capitaine Maxime Moreau !
EXTRAIT
—Madame Ricordel. Véronique Ricordel. Voilà… ce n’est pas facile à dire. Je ne sais pas par où commencer.
—Prenez le temps de mettre de l’ordre dans vos idées. Je ne suis pas super-débordé.
—C’est gentil. Je ne sais pas si je frappe à la bonne porte, mais pour une affaire aussi importante, il m’a paru logique de m’adresser à la Police Judiciaire. C’est bien ce service qui s’occupe des meurtres ?
J’avais commencé à légèrement m’affaisser sur mon siège, cherchant une position confortable pour écouter ses propos et, au besoin, prendre quelques notes. Je me ressaisis, soudainement intéressé. Il est des mots qui font tilt à l’oreille d’un flic.
—Tout à fait. Vous avez découvert un corps ?
— Non ! s’exclame-t-elle en portant une main manucurée à sa joue. Heureusement, sinon je crois que je serais morte de peur en faisant pareille découverte. Pour le coup, ce ne serait pas un mais deux corps qu’il y aurait eus !
—Je peux comprendre votre crainte rétrospective. Nous avons tous une étrange relation avec la mort, et ce n’est pas donné à tout le monde de conserver son sang-froid. Si je peux me permettre ce jeu de mots douteux. Alors ? Qu’avez-vous découvert ?
—Rien. Rien encore, mais je sais que, tôt ou tard, il y aura un décès.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Editions Bargain, le succès du polar breton. –
Ouest France
À PROPOS DE L'AUTEUR
Stéphane Jaffrézic est né en 1964 à Concarneau. Il habite et travaille à Quimper. Dans son cinquième roman de la collection Enquêtes et Suspense, nous retrouvons son personnage récurrent, le capitaine Maxime Moreau.
Il est également auteur de deux romans dans la collection Pol'Art.
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -
Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
À Janine, lectrice émérite de romans policierset, par ailleurs, créatrice, présidente,et seul membre de mon virtuel fan-club.Avec toute mon affection.
REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier les personnes qui m’ont aidé, en particulier en m’apportant des renseignements ou en effectuant une efficace relecture :
– Lorette, de l’Office de Tourisme de Guidel
– Monsieur Dominique Quéroué
– Hélène et Benoît
– Delphine Kergourlay.
I
— Bonjour Monsieur. Je vous suis reconnaissante de me recevoir sans rendez-vous.
J’accorde à peine une quarantaine d’années à la femme aux longs cheveux châtains frisés que j’accueille dans le couloir. Pour lutter contre les années qui ont débuté leur long mais continuel travail de vieillissement, elle est maquillée avec soin. L’absence de rides et de pattes-d’oie aux commissures des yeux laisse à penser que, même si l’issue du combat est inéluctable, elle investit des sommes rondelettes dans la chirurgie esthétique ou les injections de botox. Ses vêtements, même s’ils ne nécessitent pas de se ruiner, ne proviennent pas d’un magasin franchisé. Sans traduire l’opulence, ceci dénote d’une enviable situation financière.
— Entrez, Madame, je vous en prie.
M’effaçant pour la laisser passer, je constate que son sillage est marqué d’un délicat parfum aux accents mêlés de vanille et de fleurs que je n’identifie pas. J’approche du bureau une chaise jusqu’alors rangée contre un mur, avant de contourner le meuble pour m’asseoir à mon tour. Au passage, je surprends son regard lorsqu’il tombe en arrêt sur les boucles fixées au sol et dans le mur, boucles auxquelles on attache une menotte lors de l’audition d’un suspect trop agité ou dont on redoute une réaction physique.
— Je doute que vous en ayez besoin. C’est seulement à usage des enfants terribles, dis-je avec un sourire rassurant, avant de redevenir plus professionnel. Je n’ai pas bien compris le motif de votre visite, Madame…
Une minute plus tôt, l’ADS1 en charge de l’accueil au rez-de-chaussée du commissariat m’a appelé pour annoncer qu’une femme souhaitait rencontrer un membre de la Police Judiciaire. Elle ne voulait pas exposer l’objet de sa visite, mais, estimant qu’elle semblait digne d’intérêt, il a respecté sa demande et l’a dirigée vers mon antre.
— Madame Ricordel. Véronique Ricordel. Voilà… ce n’est pas facile à dire. Je ne sais pas par où commencer.
— Prenez le temps de mettre de l’ordre dans vos idées. Je ne suis pas super-débordé.
— C’est gentil. Je ne sais pas si je frappe à la bonne porte, mais pour une affaire aussi importante, il m’a paru logique de m’adresser à la Police Judiciaire. C’est bien ce service qui s’occupe des meurtres ?
J’avais commencé à légèrement m’affaisser sur mon siège, cherchant une position confortable pour écouter ses propos et, au besoin, prendre quelques notes. Je me ressaisis, soudainement intéressé. Il est des mots qui font tilt à l’oreille d’un flic.
— Tout à fait. Vous avez découvert un corps ?
— Non ! s’exclame-t-elle en portant une main manucurée à sa joue. Heureusement, sinon je crois que je serais morte de peur en faisant pareille découverte. Pour le coup, ce ne serait pas un mais deux corps qu’il y aurait eus !
— Je peux comprendre votre crainte rétrospective. Nous avons tous une étrange relation avec la mort, et ce n’est pas donné à tout le monde de conserver son sang-froid. Si je peux me permettre ce jeu de mots douteux. Alors ? Qu’avez-vous découvert ?
— Rien. Rien encore, mais je sais que, tôt ou tard, il y aura un décès. Je préfère anticiper, parce que je suis persuadée que la vie de ma maman est en danger.
Un silence suit cette affirmation. L’inconnue, je peux l’appeler ainsi puisque, pour l’instant, je ne connais d’elle que son nom et son prénom, semble posséder toutes ses facultés. Ce n’est pas qu’une question de look et d’attitude, même s’il est vrai qu’en d’autres circonstances – selon le personnage qui avancerait une telle allégation – je pourrais douter du bienfondé de sa démarche. Dans le cas présent, je suis disposé à accorder une écoute particulière à la suite de ses propos.
— Vous allez m’expliquer la situation. Avant cela, voulez-vous boire un café ?
— Volontiers. Je pense que nous en avons pour un bon moment.
*
L’arabica n’est pas indispensable, mais c’est un artifice propice à conférer à notre entretien un contexte plus détendu, et à la laisser s’épancher peut-être davantage qu’elle ne le ferait si une certaine atmosphère n’était de rigueur. Le commissariat n’étant pas le boudoir de Madame la baronne, il n’y a pas de soucoupe ici. Je pose une tasse de part et d’autre du bureau, puis je referme la porte avant de retourner m’asseoir à ma place en m’excusant :
— Je suis désolé, mais pour le sucre, nous sommes en rupture de stock. Mettez-vous à l’aise, madame Ricordel.
— Ce n’est pas grave, je n’en prends pas.
Elle pose son sac à main sur le sol carrelé et retire sa veste légère qu’elle enfile sur le dossier de la chaise. Un fade sourire sur ses lèvres rehaussées de rouge indique qu’elle est prête. Elle n’attend que mon bon vouloir.
— Vous allez pouvoir commencer. La nouvelle étant certainement d’importance, vous comprendrez que j’enregistre la conversation, dis-je en préparant mon dictaphone.
— Ah bon ! Enfin, c’est logique, oui, mais je ne voudrais pas que par la suite cela me pose problème.
— Cette conversation ne devrait pas vous nuire, mais le sujet abordé étant on ne peut plus sérieux, il est indispensable que j’en conserve une trace.
J’ai adopté ce procédé depuis peu. Lorsque je rédige un procès-verbal, je tape directement sur le clavier de mon ordinateur mes questions et les réponses des prévenus ou des témoins, mais un enregistrement des conversations peut se révéler utile.
— Après tout, vous avez sûrement raison, c’est sans doute mieux ainsi…
Petit doigt levé, elle porte la tasse à ses lèvres qui laissent un dessin vermillon sur le rebord. Elle ne la vide pas d’un trait mais la garde à la main. Puis elle toussote dans l’autre, fermée sur un petit poing orné d’une bague dont les diamants jettent mille feux. Enfin, elle est prête à se lancer. Je lui demande de commencer l’audition par son état-civil, puis appuie sur la touche enregistrement du dictaphone.
— Je m’appelle Véronique Ricordel. J’ai grandi dans le Morbihan, près de Lorient plus exactement. J’y ai toujours des attaches, puisque maman et mes deux frères vivent à Guidel ou aux alentours. Pour ma part, j’habite Quimper depuis une dizaine d’années, ce qui explique que je vienne vous voir plutôt que de m’adresser à vos collègues lorientais.
Elle vide la tasse qu’elle repose délicatement sur la surface du bureau.
— Papa est décédé il y a deux mois. Même si sa maladie nous y avait préparés, ce fut une épreuve, surtout pour maman et moi. Je ne veux pas dire que mes frères sont des êtres insensibles, mais je pense que les hommes savent se forger une carapace derrière laquelle ils se réfugient pour masquer leur tristesse. Ou peut-être qu’ils attendent d’être seuls pour pleurer.
Sa manière de s’exprimer est complètement décalée avec la place qu’elle occupe, sur cette chaise qui reçoit habituellement des durs à cuire, trafiquants, voleurs ou assassins de tout poil, dont le langage est moins élaboré. Je lui demanderais bien d’accélérer le débit, pour en arriver aux choses sérieuses, mais ce serait maladroit et risquerait de la bloquer. D’un hochement de tête, je traduis que je capte le message qu’elle fait passer. Ainsi encouragée, elle promène un petit bout de langue rose sur ses lèvres et poursuit :
— La vie a repris son cours, comme on dit. Pendant les premiers jours et les premières semaines, ce malheur nous a rapprochés, tous les quatre, mais peu à peu, les visites et les coups de téléphone se sont espacés. Pas pour maman, puisque je prends tous les jours ou presque de ses nouvelles, mais entre mes frères et moi-même. Avant-hier, c’est elle qui m’a appelée. L’un de mes frères sortait de chez elle, il était venu s’enquérir de la part d’héritage qu’il pensait toucher à la mort de papa. Maman n’a pas tout de suite compris où il voulait en venir. Elle l’a alors questionné sur ce qu’il désirait. Elle était anéantie quand il a dit qu’il réclamait un sixième de ses biens.
— Un sixième ? Pourquoi cette fraction ?
— Je vous explique : il avait calculé que maman conservait la moitié des biens, immobiliers ou autres, soit trois sixièmes de la totalité, et que l’autre moitié, soit les trois autres sixièmes qui correspondaient à la moitié de notre père, devaient être équitablement partagés entre les trois enfants.
— Ces trois enfants, ce sont vos deux frères et vous ?
— C’est tout à fait cela. C’est bien, je vois que vous suivez.
Je jugerais cette réflexion offensante si elle émanait de la bouche d’une autre personne. Pas de la sienne. Le ton n’est pas arrogant et ses paroles ont pour unique objectif de s’assurer que j’accroche à son discours.
— Selon maman, il paraissait sûr de son fait. Elle n’a d’abord pas voulu le contredire, ce qui n’a pu que le renforcer dans ce qu’il disait. Quand il a eu terminé, elle lui a appris que, lorsqu’ils se sont mariés, papa et maman avaient établi un contrat de mariage.
— Un contrat qui accordait la totalité des biens au dernier vivant ?
— C’est bien cela. Je constate que vous connaissez le sujet.
— Pas vraiment, n’étant pas marié et ne l’ayant jamais été. Disons que j’en ai entendu parler dans les grandes lignes, mais je n’en connais pas les exactes dispositions.
— En clair, maman conserve la totalité des biens immobiliers et financiers. Ce n’est qu’à son décès, que je souhaite le plus tardif possible, que l’ensemble sera partagé entre les enfants, après le règlement des frais de succession.
— D’accord. Je suppose que ceci est conforme à ce qui se passe habituellement…
— Oui, mais pas toujours, ce qui peut apporter une cascade de problèmes et diviser les familles. En découvrant qu’il lui faudrait patienter, mon frère est alors entré dans une colère folle. Je n’en ai pas été témoin, mais selon ma mère, il n’était plus dans son état normal. Elle n’a pas eu peur qu’il se jette sur elle pour la frapper ou la tuer, mais elle a vu sur ses traits qu’il comprenait que la situation lui échappait. Je dois préciser que mon frère, il s’agit de l’aîné, n’a jamais été très à l’aise financièrement. Sans doute espérait-il voir la fin du tunnel en touchant cette manne providentielle.
Je délaisse mon clavier pour me pencher en avant, afin que mes paroles soient captées par le dictaphone qui est placé près d’elle.
— Est-ce cet incident qui vaut votre présence dans mon bureau ?
— Oui. Quand ma mère m’a appelée, j’ai décelé une grande inquiétude dans sa voix. L’algarade remontait à la veille, mais elle n’avait pas fermé l’œil de la nuit tant cela l’avait travaillée. J’ai immédiatement téléphoné à mon frère, pour connaître sa version. Il m’a raccroché au nez. J’ai alors sauté dans ma voiture et je suis allée jusqu’à chez lui. Il a tenté de nier la dispute, jusqu’à ce que mes questions finissent par le déstabiliser. De guerre lasse, il a avoué qu’il avait un urgent besoin d’argent et qu’il avait entrevu dans ce pactole l’occasion de régler quelques dettes. Je l’ai regardé, les yeux dans les yeux, et je lui ai demandé si la mort de notre mère serait une forme de délivrance pour lui. Il s’est empressé de répondre oui, avant de se rendre compte de l’importance de ses paroles et d’essayer d’en minimiser la portée. Un dixième de seconde, j’ai vu dans son regard fiévreux une lueur qui m’a fait froid dans le dos.
Elle attrape son sac à main et y pioche un mouchoir en papier.
Elle s’en tapote la pointe du nez, puis le bord des paupières, avant de le rouler en boule.
— Il était près de midi, hier, lorsque je suis revenue de Guidel. J’hésitais sur la conduite à tenir. Je suis passée au bureau de mon mari et je lui ai tout raconté. Il a tenté de me tranquilliser, mais rien n’y a fait : j’ai passé une après-midi horrible. Et que dire de cette nuit ! Je n’ai pas fermé l’œil. Alors, ce matin, je me suis dit qu’il fallait que j’en parle à quelqu’un qui comprendrait la gravité de la situation et qui, surtout, pourrait empêcher que le pire arrive. Ce quelqu’un c’est vous.
D’un doigt, j’enfonce la touche stop du dictaphone. Je finis de taper ses paroles et me laisse lentement glisser au fond de mon siège, avant de me redresser de manière plus énergique. Coude en appui sur le bureau, menton sur la main droite qui est elle-même sur la gauche, je réfléchis tout en la fixant. Quel crédit faut-il accorder à son récit ou plus exactement à l’interprétation qu’elle donne au comportement de son frère et à quelques phrases malheureuses, peut-être même confuses, mais auxquelles elle attribue une gravité qu’elles n’ont sans doute pas ? Quel genre de fils se féliciterait du décès de sa mère ? Il faudrait être le dernier des derniers pour s’en réjouir.
Je suis face à un cas de conscience : que dois-je faire ? Embastiller le fils maudit avant qu’il ne commette l’irréparable ? Il serait rapidement libre, puisque nous n’avons rien de concret à lui reprocher. À l’inverse, ne pas l’importuner, car il est plausible que sa sœur Véronique se soit fait un film dans lequel elle lui attribue le mauvais rôle ? S’il mettait à exécution la menace rapportée par sa sœur, je serais moi aussi coupable d’une certaine façon, vu que je n’aurais rien fait pour prévenir le crime. Difficile de trancher. Dans le doute…
— Voici un papier et un crayon. Je vais m’absenter quelques minutes pour résumer votre déclaration à mon supérieur. Profitez-en pour inscrire les coordonnées de votre maman et celles de vos frères, il se peut que je leur rende visite.
Je sors dans le couloir et referme la porte. Usant de mon portable, je suis rapidement en ligne avec le commandant Claude Tammet qui a depuis quelques semaines remplacé le commandant Pascal Denjoy à la tête de l’antenne de la PJ de Brest, et sous les ordres duquel mes collègues quimpérois et moi-même sommes. Mis au courant des propos qui m’ont été tenus, lui aussi préfère se couvrir. Il me demande de patienter, le temps qu’il en réfère à son supérieur, au Service Régional de la Police Judiciaire de Rennes. Je reviens dans le bureau pour attendre la réponse. Le parfum de ma visiteuse confère à la pièce une atmosphère printanière. On se croirait chez une fleuriste.
Véronique Ricordel attend que je sois assis pour me rendre la feuille qui comporte trois noms et autant d’adresses. La maman et l’un des fils vivent à Guidel, l’autre fils à Larmor-Plage, une commune proche de la première.
Un silence gênant s’installe, que finit par troubler la sonnerie de mon téléphone.
— Maxime ? Rennes est d’accord. Vous avez les coudées franches pour vous livrer à des investigations. Si vous estimez que votre contact est digne de confiance, ce serait dommage de négliger son témoignage.
— Merci. Je vous ferai un rapport dès que possible.
On ne se connaît pas vraiment, Tammet et moi, aussi le vouvoiement est-il de rigueur. Cela ne durera pas, on le sait, mais tant qu’aucun des deux ne fait le premier pas, on garde une certaine distance. Ayant raccroché, je me tourne vers ma visiteuse :
— Bon, je vais commencer par rencontrer votre mère. Mais avant cela, je vous demande de signer le procès-verbal d’audition reprenant vos affirmations.
1 Adjoint de sécurité.
II
Dans ma voiture qui file sur la voie express RN165, les touches florales et vanillées du parfum de Véronique Ricordel emplissent rapidement l’habitacle. Car, n’ayant rien d’autre à faire, elle a tenu à m’accompagner. J’ai bien tenté d’opposer deux ou trois arguments qu’elle a balayés en justifiant que sa mère ne consentirait pas à me recevoir si je me présentais seul. Si je me suis avoué vaincu, c’est uniquement parce que mon intervention, tout officielle qu’elle soit, n’a pas de caractère d’urgence ni ne compromet sa sécurité.
Nous parlons peu durant le trajet, principalement de ses parents. J’apprends ainsi qu’avant de décéder il y a deux mois, le lorientais Hubert Ricordel avait été un heureux gagnant du Loto. Il avait eu la chance de cocher les bons numéros, il y a vingt-six ans de cela. Il avait aussitôt démissionné de son poste d’obscur employé de bureau à la mairie de sa ville natale. Terminés le travail, la vie dans un immeuble du quartier de Keryado et les fins de mois difficiles ! Viviane, la maman, est quant à elle issue d’une famille de la région d’Hennebont, une autre ville du Morbihan. Les tourtereaux se sont rencontrés il y a quarante-cinq ans, lors d’une fête sur le port de pêche de Lorient. Elle était secrétaire médicale. Quand le pactole de la Française des Jeux avait été déposé sur un compte bancaire, elle aussi avait démissionné du jour au lendemain.
Parcourant les communes alentours, ils s’étaient mis en quête d’un terrain proche de la mer. Leur choix s’était porté sur Guidel, et plus précisément sur le lieu-dit Guidel-Plages, où, à faible distance de l’embouchure de la Laïta, ils s’étaient fait construire une somptueuse villa.
C’est dans cette direction que nous roulons, car c’est de la mère que j’entends en priorité faire la connaissance.
Après la bretelle de sortie de la voie express, alors que je me fie aux panneaux, la jeune femme dit :
— Tout à l’heure, je n’ai pas eu peur, dans votre bureau. Pourtant, l’inscription qui domine la porte est impressionnante.
Je sais à quel texte elle fait allusion : « Vous qui entrez, abandonnez toute espérance. »
— Savez-vous d’où je la tiens ?
— Oui. De la Divine Comédie, de Dante !
— Bravo ! Habituellement, la plupart de mes hôtes sont plutôt limités, culturellement. Je l’ai écrite il y a un mois seulement, mais vous êtes la première à en connaître l’origine.
— Je n’ai pas grand mérite : j’ai visité le musée Rodin, il y a quelques années, et j’y ai vu l’un des moulages du bronze “La porte de l’Enfer”.
Au centre du giratoire des Cinq-Chemins, une machine agricole stylisée par le sculpteur Marc Le Gurun illustre l’attachement de Guidel à son passé agricole. Je prends vers Guidel-centre.
— Si je suis la première à en connaître l’origine, d’autres en comprennent-ils le sens ?
— Pas tout de suite. En réalité, mon bureau serait une sorte de purgatoire, puisque si ceux qui y pénètrent, finissent par confier leurs péchés ou fautes, cela ne les absout pas. Le purgatoire que constitue mon bureau n’est pas une étape avant le paradis, mais avant l’enfer. Lorsqu’ils entrent dans ma tanière, ils font tous les caïds au départ. Mais s’ils y sont, c’est que je dispose d’un faisceau de preuves ou que j’en sais suffisamment sur eux pour les inquiéter ou les envoyer derrière les barreaux.
Quelques ronds-points, puis le clocher à quatre pans de l’église se détache sur un magnifique ciel bleu. Sur le tableau de bord, le témoin de température apprend que nous avons gagné trois degrés depuis Quimper. Souvent évoquée, la différence météorologique entre le Finistère et le Morbihan n’est pas une légende.
— Vos explications me terrorisent plus encore que ne l’a fait mon imagination en lisant cette sentence.
— Sans doute est-ce, et c’est heureux, parce que vous n’avez rien à vous reprocher.
Un petit sourire puis, alors que nous sommes parvenus à proximité de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, elle dit :
— Prenez la direction de Guidel-Plages.
La bien nommée rue de l’Océan, une longue ligne droite bordée d’une piste cyclable, se présente. Ma passagère se tait, son regard courant au hasard la campagne, avant de revenir vers un champ de maïs qui, faute d’un soleil généreux lors des dernières semaines, peine à sortir de terre. Nous roulons en silence sur environ trois kilomètres, avant de descendre sur Guidel-Plages, aussi surnommé le Pouldu-Morbihan, en opposition au Pouldu-Finistère que l’on découvre sur l’autre rive de l’embouchure de la Laïta.
Véronique Ricordel n’avait pas exagéré en qualifiant la maison de ses parents de « somptueuse villa ». Quartier de la Falaise, au fond d’une impasse, à l’abri des curieux derrière un haut mur de pierres de bonne facture, hérissé de tessons de bouteilles pour en interdire l’escalade, on aperçoit les fenêtres du premier étage et le toit aux coûteuses ardoises rustiques. Véronique dispose de la clé du portail, ainsi que de celle de la porte d’entrée, mais elle préfère annoncer notre arrivée par le biais de l’interphone. Quelques secondes, puis le portail commandé à distance s’ouvre sur un jardin de près de deux hectares, magnifiquement entretenu. La villa a la forme d’un U, dans le sens où deux ailes en tous points symétriques viennent à la rencontre du visiteur, alors que l’on accède à la partie centrale longue de près d’une trentaine de mètres par une accueillante terrasse. Remontant en voiture l’allée qui y mène, je jette un œil, sur la droite, vers une piscine aux dimensions exceptionnelles et, sur la gauche, vers un garage qui, au bas mot, pourrait héberger quatre voitures.
Sortant par l’une des multiples portes-fenêtres qui percent la façade, la propriétaire des lieux nous regarde approcher, puis nous extraire de la voiture. Si j’estime l’âge de Véronique à une petite quarantaine d’années, il est acquis que sa mère devrait en avoir au moins soixante ou soixante-cinq. Or, celle-ci en paraît à peine plus de cinquante. C’est encore une belle femme, au corps svelte et élancé. L’agréable température de ce mois de juin l’a incitée à enfiler une robe légère qui met en valeur des jambes et des bras affermis par la pratique du sport, à moins que ce ne soit par un travail physique, mais de cela je ne pense pas qu’il soit question.
Ses cheveux, d’une teinte tirant sur le blond, sont coiffés de façon à renforcer l’impression de jeunesse qui se dégage de cette pétillante sexagénaire. À ses oreilles, ses doigts, ses poignets et son cou, la somme des bijoux en or sertis de pierres précieuses totalise une petite fortune.
— Ma chérie ! Quel bon vent t’amène ?
Le ton n’est pas badin, mais souligne une profonde affection de la mère pour sa fille. Elles se saluent tendrement en se prenant mutuellement par les épaules et en s’embrassant sur chaque joue Sans attendre la réponse, elle se tourne vers moi puis revient vers Véronique :
— Tu me présentes ?
— Bien sûr. Maman, voici le capitaine Maxime Moreau, de la Police Judiciaire de Quimper.
À l’énoncé de mon grade et de ma fonction, le visage de la mère s’est assombri. Jusqu’alors rieurs, ses petits yeux bleus se font interrogateurs, tandis qu’elle s’exclame d’un air contrarié :
— Ne me dis pas que tu l’as amené ici pour cette stupide impression ? Ce n’est pas vrai, n’est-ce pas ? Ce n’est pas pour cela ?
— Maman ! Tu ne vas pas…
— Si, Véronique, je vais recommencer. Ou plutôt, c’est toi qui recommences ! Je croyais pourtant avoir été claire, l’autre jour. Comment faudra-t-il te le dire ? Il n’y a aucun problème dans notre famille ! Tu m’entends ? Aucun problème !
Voilés par la colère, les yeux bleus ont perdu de leur éclat. De même, c’est de manière abrupte qu’elle accuse physiquement le coup, prenant dix ans en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Ce n’est plus une sémillante quinquagénaire qui nous fait face, mais une sexagénaire, voire une septuagénaire, usée par la déception.
— Tu veux bien me laisser parler ? Le ton de Véronique est limite implorant. Maman, s’il te plaît !
— Cela ne servira à rien. Tu connais ma position sur ce sujet. Je refuse de croire à tes élucubrations. Tu mélanges tout, ma pauvre Véro ! fait-elle en secouant négativement la tête.
— Asseyons-nous pour discuter, veux-tu, et laissons le capitaine Moreau se forger une opinion. Il lui appartiendra de décider de la suite à donner. D’accord ?
— Si tu insistes… Voulez-vous boire quelque chose, Capitaine ? Un café, par exemple ?
— Je préférerais un verre d’eau, si cela ne vous dérange pas.
Je n’ai pas vraiment soif, mais, si j’accepte une libation, c’est parce que je n’ignore rien des vertus conviviales d’un verre siroté sur une terrasse ensoleillée.
Comme le café partagé tout à l’heure avec Véronique dans mon bureau, il importe de créer une ambiance détendue, pour apporter plus de sérénité au débat.
— Et toi, Véronique ?
— J’aimerais boire un thé. Attends, je vais aller préparer les boissons.
— Non, reste assise, je vais demander à Anaïs de nous apporter un plateau.
Véronique et moi profitons de son absence pour échanger nos points de vue.
— Elle ferme les yeux ! s’indigne la fille de la maison. Son cœur de maman lui interdit de douter de la parfaite moralité de son fils, alors qu’avant-hier, elle était terrorisée. Comment peut-on être aveugle à ce point-là ? Cela frise l’entêtement.
— D’un autre côté, c’est parfaitement compréhensible. La nature humaine est compliquée et particulièrement insondable lorsqu’on est soi-même confronté à une situation qui nous dépasse ou dont on n’aurait jamais imaginé qu’elle puisse un jour nous éclater à la figure. Comment votre mère qui a donné le jour à votre frère et l’a élevé en lui donnant tout l’amour dont elle était capable, peut-elle digérer qu’il lui en veuille au point de la supprimer ? Je peux comprendre qu’elle n’assimile pas cette menace ou en néglige la portée.
Mon regard se perd vers la piscine couverte d’un toit vitré propice à accumuler la chaleur. Plus proche de nous, un cabanon censé abriter des outils et dont les dimensions me suffiraient pour en faire une maison de vacances. Dans un coin du jardin, des rosiers en fleur rivalisent de couleurs, alors qu’un peu plus loin, des têtes d’hortensias bleu ardoise remuent selon les humeurs d’un vent léger venu de l’océan voisin.
Il convient de mettre Véronique en garde :
— Vous comprendrez néanmoins que je me dois de conserver une certaine neutralité dans cette affaire, puisque, pour le moment, je n’ai que votre version. Je vais écouter votre mère et je verrai ensuite s’il est nécessaire ou non que je fasse le tour de la famille et, en particulier, que je m’intéresse à votre frère aîné.
Le retour de la maîtresse de maison clôt le sujet. Un pâle sourire est revenu illuminer ses traits. Des lunettes aux verres fumés sont maintenant posées au-dessus de son front, sur ses cheveux qui, pour le coup, forment comme une vague.
— Anaïs nous servira dans quelques minutes. Alors, capitaine Moreau, qu’attendez-vous de moi ? Que vous a raconté Véronique, qui mérite que vous vous déplaciez de Quimper ?
J’ouvre à peine la bouche qu’elle ajoute à sa liste une nouvelle interrogation :
— Mais j’y pense, comment se fait-il que vous veniez de Quimper, dans le Finistère, alors que nous sommes dans le Morbihan, et que nous disposons ici aussi de forces de police ou de gendarmerie ?
— L’explication est très simple, madame Ricordel : vous concernant, je ne suis, pour l’heure, chargé d’aucune investigation quelconque, aussi est-ce purement pour nourrir ma curiosité et rassurer votre fille que j’interviens. Elle est venue me narrer des menaces qui pèsent sur vous et auxquelles elle accorde, à tort ou à raison, une évidente importance. Parce qu’il vaut mieux prévenir que guérir, j’ai accepté ce rendez-vous pour me forger un avis.
L’arrivée par une autre porte-fenêtre d’une femme brune un peu boulotte et âgée d’environ trente ans, que je suppose être Anaïs, l’employée de maison, m’oblige à temporiser. Elle prononce un discret bonjour auquel nous répondons, et pose sur la table un plateau comportant verres et tasses, bouteilles de jus d’orange et d’eau fraîche, du sucre en morceaux et une odorante théière. J’attends qu’elle disparaisse par le même chemin pour reprendre :
— Je souligne le caractère plus ou moins officieux de cet entretien. En conséquence, vous n’avez aucunement l’obligation de répondre à mes questions ni de me livrer votre version. Je vous encourage toutefois à le faire, ne serait-ce que pour rassurer Véronique. Et peut-être pour vous rassurer, vous aussi.
Je n’ai usé ni du ton ni du vocabulaire que je réserve aux malfrats ou autres trafiquants que je passe habituellement à la moulinette. Elle y est sensible. Toute tension semble l’abandonner tandis qu’elle fait le service.
— Exposé sous cette forme… Que voulez-vous savoir ?
— Véronique m’a rapporté les récriminations de votre fils aîné. Acceptez-vous de m’en parler ?
— S’il n’y a que cela. Vous allez voir, il n’y a rien de terrible. Lundi dernier…
— Attendez une petite seconde : avec votre accord, je vais vous enregistrer, dis-je en préparant mon dictaphone jusque-là caché dans une poche de ma veste que j’ai posée sur le dossier de ma chaise. J’apprécie d’enregistrer les conversations pour pouvoir ensuite les réécouter si cela est nécessaire.
— Grand bien vous fasse ! Quand j’en aurai terminé, vous conviendrez qu’il n’y a pas de quoi fouetter un chat et vous effacerez mes paroles.
— Ce serait souhaitable. Cela signifierait qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter, et ce serait le mieux pour tout le monde. Je vous écoute, madame Ricordel, dis-je en enfonçant la touche enregistrement.
— Lundi après-midi, soit avant-hier, Sébastien, mon fils aîné, est passé me voir. Je le sentais tracassé, nerveux. Il n’avait pas l’air dans son assiette. Nous avons bu un café sur la terrasse, tout en regardant les jardiniers travailler.
C’est beau, la vie de gagnant du Loto ! Une lampée de thé, et elle reprend :
— Nous avons parlé de choses et d’autres, de banalités en somme, mais plutôt que de le questionner, j’attendais qu’il livre l’objet de sa visite.
— Il vous rend souvent visite ?
— Oui et non. Sébastien est artiste peintre. Il est artiste dans l’âme. Il mène une vie de bohème, ne se fixant aucune obligation et n’ayant pour toute attache que son métier auquel il peut consacrer des journées ou des semaines entières sans sortir de chez lui ni échanger le moindre mot avec quiconque. À d’autres moments, après avoir pondu une ou plusieurs œuvres, ou lorsqu’il est en quête d’inspiration, il est beaucoup plus libre et ressent alors le besoin de rencontrer des amis ou des proches. Il peut donc venir me voir deux fois dans la même semaine, comme se tenir éloigné durant deux ou trois semaines. Un mois, parfois, mais plus rarement maintenant. C’était surtout avant que mon mari décède.
— Maman ! interrompt Véronique dans un soupir. Arrête de le mettre sur un piédestal. Cette vie de bohème, comme tu l’appelles, n’a rien de vagabonde puisqu’il ne quitte pas la région. Il ne quitte même pas Guidel, ou alors pour un faire un saut à Quéven chez sa femme avec qui il a la paresse de vivre normalement comme le font tous les couples mariés. J’espère au moins qu’il met un peu d’énergie à la satisfaire sexuellement…
C’est en sursautant que la mère se tourne vers sa fille, le rose aux joues et les lèvres pincées, et dans les yeux, une lueur indiquant sa vexation à ce qu’une telle conversation se déroule en la présence d’un étranger, fût-il policier. Pour camoufler son trouble, elle abaisse les lunettes de soleil sur ses yeux.
— Véro ! Il n’est pas nécessaire d’être vulgaire ! Tu n’as pas à tenir de tels propos sur ton frère.
Surprise par le ton utilisé, l’interpellée promène deux mains tremblantes dans sa belle chevelure frisée.
— Bon, je te demande de m’excuser. Je me suis un peu emballée, mais il faut reconnaître qu’il se complaît dans la fainéantise et la débauche, et qu’il a trouvé le prétexte de la vie d’artiste pour ne pas travailler.
— Ne sois pas aussi tranchante ! Sébastien a beaucoup de talent. Malheureusement, la période est difficile et il peine à écouler sa production.
— Tu parles, qu’il a du talent ! s’esclaffe-t-elle. À part une exposition il y a deux ans, chez un copain galeriste de Lorient, où il a péniblement vendu deux toiles de petit format à un ami de la famille, il n’a jamais fait parler de lui.
Viviane Ricordel néglige sa fille d’un léger haussement des épaules et, en orientant sa chaise dans ma direction, semble prendre le parti de s’adresser uniquement à moi.
— J’en viens au sujet de sa visite, car autant, le plus souvent, il passe dire un simple bonjour, le temps d’une tasse de café ou d’un apéritif, autant ce lundi, il avait à cœur de m’exposer un grave problème qui le rend malheureux. Il n’en a pas parlé tout de suite, mais une maman sait lorsque son enfant est tourmenté. Et cela, même si son enfant a quarante-trois ans. À force de patience, je l’ai amené à me confier ses problèmes. Voilà, ses tableaux ne se vendent pas ! Reflet de notre société en crise, le marché de l’art s’effondre. Lorsqu’auparavant, il vendait trois toiles pour une période donnée, il n’en vend maintenant plus qu’une seule. Voire aucune. Il traverse une mauvaise période et, par conséquent, il connaît des soucis d’argent.
Nous allons arriver dans le dur. Elle se vote une gorgée de thé, constate qu’il a refroidi et est à peine tiède. Elle décide alors de vider la tasse tant qu’il est encore buvable, et la repose élégamment d’un geste à la rondeur calculée.
— J’ignore si on le lui a soufflé ou s’il s’en est fait la réflexion, mais il s’est dit qu’il existait un moyen de régler ses dettes qui, selon lui, s’élèveraient à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Tout de go, il a avoué que le but de sa visite, en fait, était de se renseigner sur sa part d’héritage. Nous… mon mari et moi avons gagné à un jeu de hasard une très importante somme, il y a très longtemps. Cette somme est tellement colossale que nous avons toujours vécu avec seulement les intérêts de celle-ci. Nous n’avons quasiment pas touché au capital, puisque nos besoins et nos plaisirs étaient limités. Maintenant qu’il est parti, je vais pouvoir voyager.
— J’ai oublié de vous le préciser, coupe Véronique à mon intention, mais, à la suite d’un accident de voiture, papa était lourdement handicapé depuis une douzaine d’années. Il était aussi suivi médicalement, car on lui avait diagnostiqué une maladie orpheline dont le traitement interdisait tout départ de plus de deux jours. C’est cette maladie qui l’a emporté.
— Pauvre Hubert, fait Viviane en essuyant une larme au coin de l’œil, il n’aura pas eu une fin de vie heureuse… Bref, Sébastien escomptait toucher sa part, et cela assez rapidement, si j’ai bien compris. Il était de plus en plus nerveux. Je comprenais bien que ce n’était pas facile pour lui de révéler la misère dans laquelle il vivait. Il me faisait pitié. J’ai proposé qu’il apporte ses factures pour que je paie ses dettes, mais ce n’était pas ce qu’il souhaitait. Et moi, je ne voulais pas signer un chèque en blanc pour qu’il en dispose à sa guise. Je le connais, il aurait dilapidé cette somme dans… dans des… dans rien de bon, en somme.
Elle prend le temps d’une profonde aspiration avant de continuer :
— Il a fini par lâcher le morceau : il voulait le sixième de mon capital, mobilier et immobilier. Ce sixième correspond à un tiers de la part de mon époux décédé, étant entendu que trois sixièmes, soit la moitié du capital constitué au fil des décennies de notre vie commune, me revenaient. Selon lui, un autre tiers de la part d’Hubert était pour Véronique et le dernier, pour Nicolas.
Le calcul est le même que celui de sa fille, une heure plus tôt dans mon bureau.
Elle rejette la tête en arrière, lisse des deux mains ses cheveux auxquels elle donne ensuite du volume au niveau des oreilles en les arrangeant de ses doigts en pince.
— Je l’ai laissé parler. Quand il a terminé, je lui ai annoncé l’existence d’un contrat au dernier vivant, qu’Hubert et moi avions souscrit lors de notre mariage. Il s’est d’abord tu, puis il s’est emporté et s’est montré odieux. J’étais d’autant plus gênée que les jardiniers assistaient à sa colère. Il a répété qu’il traversait une « grosse galère », comme il disait, et qu’il fallait absolument l’aider sinon il ne voyait d’autre échappatoire que le suicide pour fuir ses créanciers.
— Qui sont-ils, ses créanciers ?
Je saisis à la réaction de Véronique qui se redresse sur sa chaise que cette question lui brûlait les lèvres, à elle aussi, et qu’elle me sait gré de l’avoir posée.
— Je ne sais pas vraiment. Il ne s’est pas attardé à m’en parler. Cela lui coûtait, veuillez excuser le jeu de mots, déjà suffisamment de relater sa détresse financière, il n’allait pas non plus me renseigner sur ce point.
Comme elle marque un silence, j’en profite pour éclaircir une zone d’ombre.
— A-t-il été agressif ? Avez-vous eu peur qu’il s’en prenne physiquement à vous ?
— Non. Enfin… non, parce que les jardiniers étaient là et ne l’auraient pas laissé faire, mais si j’avais été seule avec lui, je ne sais pas comment je me serais tirée de ce mauvais pas…
— Croyez-vous qu’il vous aurait frappée ?
— Allez savoir, fait-elle après un nouveau silence, en gardant la bouche ouverte pour accentuer son indécision. Il semblait compter tellement sur cet argent qu’il ne pouvait masquer sa déception. Pire encore, je pense qu’il voyait anéantis ses espoirs de vie meilleure.
— L’avez-vous revu depuis lundi ?
— Non. Je présume qu’il va lui falloir du temps pour encaisser la nouvelle du contrat de mariage. Il va sûrement se rendre invisible pendant un moment, histoire de démontrer à quel point cela lui reste en travers de la gorge.
— Pas d’appel téléphonique, non plus ?
— Non. Ce n’est pas dans ses habitudes de téléphoner. Comme beaucoup d’artistes, il est dans son monde et n’en sort que lorsque cela est nécessaire.
— Cet incident, ou cette algarade, selon l’importance qu’il convient de lui donner, a-t-elle une incidence sur votre sommeil ? Ou, plus généralement, vivez-vous la situation avec détachement ou, au contraire, vous pourrit-elle la vie ?
— Ce n’est pas facile à vivre, c’est certain. La nuit de lundi à mardi, je n’ai pas fermé l’œil. Et la nuit dernière, j’ai pris une belle dose de somnifère pour pouvoir me reposer.
— Tu vois qu’il te fait peur, assène Véronique.
Je sirote le contenu de mon verre d’eau pour prendre le temps de réfléchir. Véronique Ricordel a-t-elle raison de craindre pour la vie de sa mère ou se fait-elle un film en imaginant le pire ?
— Voyez-vous une objection à ce que je le rencontre ?
— Je ne sais pas si ce serait judicieux. Comment interpréterait-il cela ?