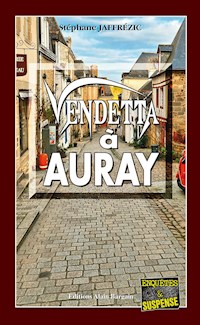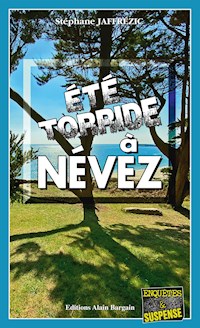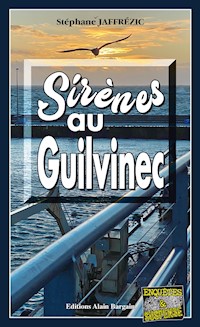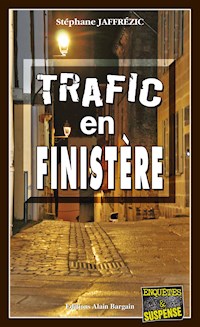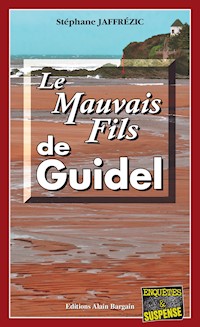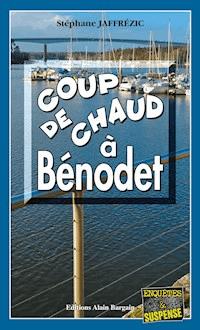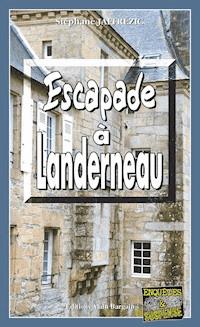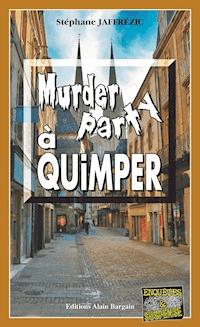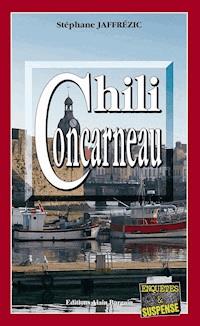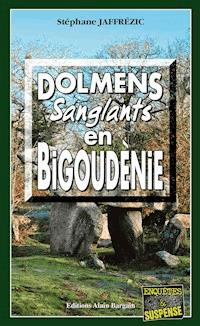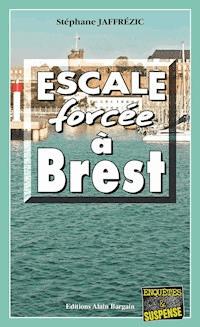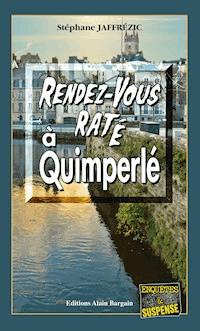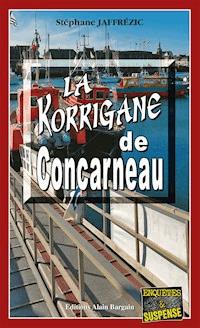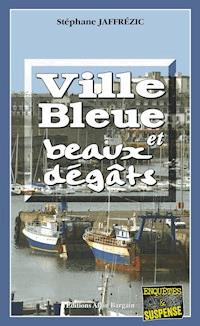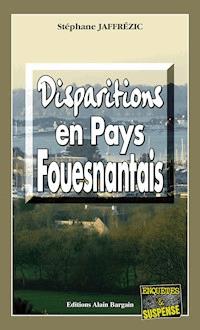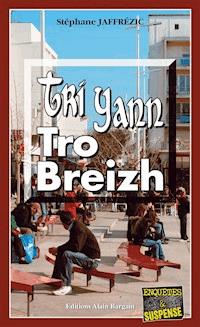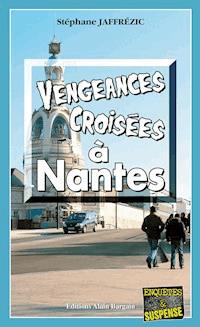Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Dans la Bretagne des années 1890, une rixe entre peintres et marins dégénère...
25 mai 1894.
Une bagarre éclate sur le quai Pénéroff opposant des artistes peintres à des marins de Concarneau.
Victime d’une fracture de la jambe, Paul Gauguin n’entend pas en rester là.
La découverte, le lendemain matin, du corps de l’un des marins, amène le maréchal des logis Clet Moreau à enquêter dans le milieu artistique.
Les témoignages de Théophile Deyrolle et Alfred Guillou l’aideront dans sa mission.
Il va découvrir un univers qui lui était jusqu’ici inconnu.
Dans ce premier roman policier, l'auteur nous plonge dans le milieu artistique du XIXe siècle en compagnie de Paul Gauguin !
EXTRAIT
26 mai 1894.
Clet Moreau achevait de s’habiller. Dans la pièce à côté, sa femme et ses deux fils dormaient. Après un rapide petit déjeuner, un café clair et du pain sec, il
s’était rasé impeccablement à la lumière vacillante d’une bougie. « Dès que la solde arrivera, je remplace rai la lampe » se promit-il. Léon, le cadet, avait brisé la lampe à pétrole en jouant avec son frère Jean. Clet sourit à l’évocation du visage honteux de l’enfant lorsqu’il lui avait raconté les circonstances de l’incident. Prenant en compte la franchise de son fils, il s’était contenté de le sermonner et lui interdit de sortir pendant deux jours.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Éditions Bargain, le succès du polar breton. -
Ouest France
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né en 1964 à Concarneau (Finistère),
Stéphane Jaffrézic travaille au musée des Beaux-Arts de Quimper. Dans ce roman, son premier, il s’est attaché à reconstituer fidèlement l’époque et à truffer son récit d’anecdotes et de faits réels.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nous remercions tout particulièrement le Musée des Beaux-Arts de Quimper pour le prêt de la photo de couverture. Tableau de Théophile Deyrolle : Portrait du peintre Alfred Guillou - 1901
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
REMERCIEMENTS
- À Monsieur Michel Guéguen.
- Service historique de la Gendarmerie Nationale.
- Centre Kelenn.
- Monsieur Hervé Andro.
- Archives Départementales du Finistère.
- Madame Nolwenn Berthelot.
I
26 mai 1894.
Clet Moreau achevait de s’habiller. Dans la pièce à côté, sa femme et ses deux fils dormaient. Après un rapide petit déjeuner, un café clair et du pain sec, il s’était rasé impeccablement à la lumière vacillante d’une bougie. « Dès que la solde arrivera, je remplacerai la lampe » se promit-il. Léon, le cadet, avait brisé la lampe à pétrole en jouant avec son frère Jean. Clet sourit à l’évocation du visage honteux de l’enfant lorsqu’il lui avait raconté les circonstances de l’incident. Prenant en compte la franchise de son fils, il s’était contenté de le sermonner et lui interdit de sortir pendant deux jours.
Pour le gamin, cette sanction était la pire punition : il eût sûrement préféré une correction à l’obligation de rester enfermé deux longues journées durant. En cette fin du mois de mai, après un hiver long, froid et ennuyeux, le soleil de printemps se révélait synonyme de jeux et de plaisir et tous les enfants de la ville trouvaient aisément à occuper leur temps libre : bains de mer, courses sur les rochers, plongeons et sauts dans l’eau depuis la digue, pêche, ramassage de berniques et autres bigorneaux… Pour peu que le ciel ne soit pas de la partie, l’observation de l’incessante activité portuaire suffisait à combler les garçons qui, le soir, dans leur lit clos, rêvaient de départs émouvants, de pêches miraculeuses et de retours héroïques.
« Bah, se dit Clet en enfilant sa veste de drap bleu foncé, quel gosse n’a jamais rien cassé ? Je lèverai la punition à midi s’il s’est bien conduit. »
Il boutonna les neuf boutons de sa veste sur lesquels figurait une grenade à dix flammes, et attrapa son ceinturon lesté seulement de l’étui à revolver. Aucune visite officielle n’étant programmée, nul risque d’émeute n’étant prévisible, les martingales mobiles pour la giberne, les bretelles de fusil et les bélières pour le port du sabre restaient dans l’armoire. Il ajusta sur le dernier bouton la plaque en cuivre du ceinturon, ornée en son centre d’une grenade à onze flammes et surmontée du mot « Gendarmerie. » Dans le bas de la plaque, on lisait en biais à gauche « Ordre » et à droite, « Public », le tout étant en relief.
Il lissa de la main les trèfles des poignets et prit son chapeau, dit “à trois cornes”, par la courbure supérieure de la corne du milieu, et le posa réglementairement sur sa tête : le bouton au-dessus de l’œil gauche, le côté droit légèrement incliné sans couvrir le sourcil. Avant de sortir, selon un rituel qui datait de ses débuts dans la gendarmerie, soit dix-huit années, il voulut juger du résultat. Le miroir lui renvoya le visage d’un homme aux traits peu marqués, aux yeux vifs et intelligents et au menton volontaire. Du pouce et de l’index droit, il caressa sa moustache taillée selon la dernière décision ministérielle. Il se sourit : « Pas trop mal pour un gars de trente-sept ans ! »
Il referma la porte du deux-pièces et descendit l’escalier qu’il connaissait par cœur : la huitième marche, la treizième en montant, craquait et il l’enjamba. Arrivé en bas, il consulta sa montre-gousset. Elle indiquait sept heures trente. Il extirpa de son pantalon en drap satin bleu clair, paré d’une bande de drap bleu foncé de cinquante millimètres de large, un trousseau de clefs et déverrouilla la porte de droite qui abritait son bureau puis procéda de même avec la porte de gauche. Il entra dans l’office des quatre gendarmes qui, avec lui, constituaient la brigade de gendarmerie de Concarneau. Il ouvrit les volets et laissa la fenêtre entrebâillée. Le ciel bleu, l’absence de vent et le soleil déjà chaud annonçaient une belle journée.
— Quand il le faut, il le faut ! soupira-t-il.
Cette nuit, il avait vécu ce moment une bonne dizaine de fois et c’est sans plaisir qu’il glissa une clef dans la serrure de la chambre de sûreté, au fond de la pièce.
— Allez, vous pouvez sortir !
Assis côte à côte sur le bat-flanc, les deux hommes ne se le firent pas répéter. Clet remarqua les couvertures soigneusement pliées et supposa qu’ils n’avaient pas fermé l’œil de la nuit. Tandis que le plus âgé recoiffait de la main ses cheveux vers l’arrière et ajustait son large béret, le plus jeune se dirigea vers la fenêtre et consulta le ciel.
Un silence gêné s’installa. Dans cette petite ville d’un peu plus de six mille âmes, tous se connaissaient, et il n’était, par conséquent, pas toujours facile pour les forces de l’ordre de se faire respecter. Les trois hommes se regardaient sans haine ni hostilité, ne sachant simplement que dire.
— Alors… on est libre ? demanda enfin Sauban, le plus âgé.
— Bien sûr ! Vous ne pensez tout de même pas que je vais vous offrir indéfiniment le gîte et le couvert pour une simple bagarre. J’accorde ce régime de faveur seulement aux gredins d’envergure !
— C’est quoi la suite, alors ?
Clet Moreau soupira avant de répondre, pour montrer qu’il ne faisait qu’obéir à un règlement.
— Comme j’ai été appelé, j’ai dressé un procès-verbal. Maintenant reste à savoir si la partie adverse dépose ou non une plainte. Ça, je le saurai dans la journée, et je vous tiendrai au courant.
— Et si je portais plainte moi aussi, fit René Sauban, il a frappé mon gosse, ce…
— Et si, lui, portait plainte, coupa Moreau, pour violences, insultes et outrage… Il ne faut pas perdre de vue que ce sont les gosses qui ont commencé !
— Tu parles, rigola Pierre Montfort. Faut les comprendre, ces ces “pitits” : ils n’ont jamais vu de noir. Pour eux, une négresse et un singe, c’était tellement inattendu qu’ils s’en sont moqués. Y’avait pas de quoi les gifler !
— Écoutez, je vais adresser une copie du procès-verbal à la brigade de Pont-Aven. Le gendarme qui l’y apportera, ira prendre des nouvelles du blessé, et nous en saurons alors plus.
René Sauban rentra le cou dans les épaules et Clet le trouva soudain vieilli. De taille moyenne, les yeux bleus sous un front haut, la barbe bien taillée sur un menton large, il offrait un visage plein. Ses amis le savaient d’humeur joviale, amateur de jeux de mots et de fines plaisanteries. Il avait la réputation de rigoler tout le temps sauf, bien entendu, lorsqu’il prenait la mer, que ce soit pour pêcher ou pour diriger la manœuvre d’un navire à l’entrée ou à la sortie du port. En effet, il cumulait l’emploi de pilote et le métier de pêcheur. Mais ce matin, ce n’était plus le même homme : âgé de quarante-cinq années, dont trente-trois passées plus souvent sur mer que sur terre, il en paraissait subitement vingt de plus. La perspective de soucis futurs avait raison du brave homme. Pierre Montfort prit son ami par l’épaule et dit :
— Allez viens, je t’emmène retrouver ta femme et tes gosses.
Ils sortirent de la gendarmerie et tournèrent rue Jean-Bart, pour rejoindre le quartier de la Croix. Clet Moreau quitta l’office et ouvrit la porte située en face ; « Maréchal des Logis » annonçaient de grandes lettres noires sur une plaque de cuivre. Il s’assit à son bureau et, sur une feuille à en-tête de la brigade, recopia le procès-verbal. Avant la formule de politesse, il demandait une enquête de proximité sur les personnes impliquées dans l’échauffourée de la veille. Comme il terminait, il entendit dans l’escalier les brodequins des quatre gendarmes. Comme leur supérieur, ils bénéficiaient d’un logement dans la grande maison de pierre qui abritait la brigade, rue Colbert.
— J’espère que vous avez bien dormi car le travail ne manque pas, fit Clet, après avoir répondu à leur salut. Eugène, va seller Skouarn Treuz1. Tu porteras cette lettre à la brigade de Pont-Aven, puis tu iras à la pension Gloanec, c’est sur la place, voir monsieur Gauguin. Demande également des nouvelles de la dame qui se plaignait des côtes. Tâche de minimiser l’affaire, cela m’embêterait qu’elle prenne une importance disproportionnée. Ensuite, tu repasseras à la brigade chercher une réponse avant de rentrer.
Eugène Le Berre claqua les talons et sortit. Clet se tourna alors vers Corentin Dervout, trente-cinq ans, une taille et des épaules imposantes :
— Corentin, tu te promènes un peu partout en ville, au contact de la population, et tu ouvres les oreilles. Alexis, tu restes à la brigade. Nettoie la chambre de sûreté si c’est nécessaire, mais j’en doute.
Alexis Prigent aurait préféré la balade en ville, ou l’excursion à Pont-Aven, mais il n’en laissa rien paraître. La prochaine fois, ce serait son tour.
Il ne restait qu’Arsène Bourhis dans le bureau de Clet. Un an plus jeune que le maréchal des logis, il possédait les qualités d’un bon gendarme et connaissait son travail sur le bout des doigts. Respectueux envers ses supérieurs, obéissant, il était prêt à tout pour faire régner l’ordre, la loi et la discipline. Pour l’anecdote, Clet le savait, il était le seul de la brigade à porter sa plaque d’identité militaire sur une chaîne en argent autour du cou.
— Quant à nous, Arsène, nous allons questionner les peintres de la ville. Peut-être glanerons-nous des renseignements sur les visiteurs d’hier.
Comme Montfort et Sauban quelques minutes plus tôt, Clet et Arsène empruntèrent côte à côte la rue Jean-Bart, et ceci en dépit du règlement qui voulait que les gendarmes se tiennent en retrait de leur supérieur hiérarchique. Arrivés à son extrémité, ils s’arrêtèrent, silencieux. Une fois de plus, la magie opérait : délimitée à droite par la pointe de Beg-Meil, à gauche par la pointe du Cabellou, la baie offrait un spectacle toujours différent, selon le soleil, les nuages, le coefficient de marée, un léger brouillard ou une vue dégagée montrant nettement les îles Glénan, les bateaux entrant ou sortant, leurs voiles brunes gonflées par le vent.
Un peu plus sur la droite, une digue commencée en 1885 et prolongée en 1890 tendait son bras vers le large avant de le ramener vers le Cabellou. Construite initialement pour protéger les chaloupes sardinières venant débarquer leur pêche, elle s’était vite révélée inutile et fut baptisée le quai Nul. Après cette digue, se trouvait la plage de Malabri, un nom révélateur.
Un paysan menant sa charrette tirée par un solide cheval de trait breton salua les gendarmes. Il se dirigeait vers la plage pour y ramasser du goémon qu’il étendrait sur son champ comme engrais. Les deux hommes attendirent qu’il passe et repartirent vers le quartier de la Croix.
— Je ne crois pas me tromper en disant que ça va cogner dur cet après-midi, fit Arsène Bourhis en désignant le soleil.
Clet n’ajouta rien, d’ailleurs qu’ajouter ? Depuis une semaine, les magnifiques journées se suivaient, incitant à la rêverie. Pourtant personne ne prenait le temps de rêver. Après un hiver catastrophique, comme le précisait le commissaire de police dans ses rapports mensuels au Préfet, l’activité usinière reprenait. La fierté de ramener un salaire à la fin de la semaine faisait oublier la honte des mois précédents lorsqu’il avait fallu, pour de nombreuses familles, aller, le samedi, au Bureau de Bienfaisance. Pour ne plus vivre ces moments, toutes et tous avaient trouvé un emploi dans les usines de la ville : ferblantier, ouvrier pour les hommes, saleuse, friteuse pour les femmes.
Ils se signèrent deux fois à quelques dizaines de mètres d’intervalle : devant l’ancienne croix dont on avait oublié à quelle date elle fut érigée, puis devant la croix de mission installée en 1887. Toutes deux faisaient face à l’océan, implorant la miséricorde divine pour les marins-pêcheurs de la cité.
Un peu plus loin devant eux, deux religieuses de la congrégation des Filles du Saint-Esprit, installée rue de l’Alma, entraient dans la chapelle Notre-Dame de Bon Secours, appelée plus communément par les Concarnois : « Chapelle de la Croix. » Ils longèrent la criée, puis les viviers exploités par madame Deyrolle et les chercheurs et scientifiques du Laboratoire de biologie marine. Même s’ils ignoraient le type de recherches effectuées, les Concarnois et Concarnoises n’étaient pas peu fiers de cet établissement, le premier au monde de ce type, créé en 1859 par le professeur Coste.
Sur la petite place, des hommes et des femmes en tenue de travail vaquaient à leurs occupations.
Clet fit signe à un cocher de s’arrêter, et l’homme sauta à bas de son attelage. Âgé d’environ trente-cinq à quarante ans, il était le dernier à Concarneau à porter le bragou braz, le gilet et le chapeau rond. Lorsqu’il marchait, ses sabots heurtaient violemment les pavés.
— Alors, monsieur Rannou, comment s’est passé le trajet jusqu’à Pont-Aven hier après-midi ? demanda Clet.
— Ça a été, répondit le cocher après avoir enlevé son korn-butun2 de ses lèvres surmontées d’une épaisse moustache. À un moment, celui qui avait la jambe cassée a commencé à m’engueuler, comme si c’était de ma faute si la route était pleine d’ornières. Oh, j’ui ai dit : « Si t’es pas content, t’as qu’à aller à pied ! » J’l’ai plus entendu après. J’avais du goût de lui avoir rabattu son caquet, à çui-là.
Il sourit, puis continua, les mains dans les poches : — Si y’avait pas eu la dame qui se plaignait des côtes, j’aurais roulé dans toutes les ornières, rien que pour le “faire chier”.
Il lança un clin d’œil complice et Clet et Arsène masquèrent difficilement leur hilarité.
— Ils n’ont rien dit d’autre ?
— Si, au début ils disaient qu’à Concarneau, on était des barbares et des… comment déjà ? Ah oui, des primitifs ! J’me suis pas laissé démonter, j’lui ai répondu en breton. Mais comme y’en a un qui parle breton, ils ont su le fond de ma pensée. Ça a toussé un peu, mais j’ai laissé corner.
— C’était plus sage, monsieur Rannou. En tout cas, je vous remercie d’avoir accepté de transporter ces personnes.
— Ben, c’est mon travail. Je passerai chez monsieur Satre me faire payer dans l’après-midi. Pour l’instant, j’vais chercher du goémon pour un paysan de Beuzec. Mirabelle et Framboise devront tirer dur pour envoyer ça là-bas. Allez, j’vous laisse, j’ai du maille.
Rannou remit sa pipe éteinte entre ses lèvres et monta prestement sur sa charrette. Les deux gendarmes se rangèrent pour le laisser passer et avisèrent alors Suzanne Deyrolle. Élégante, débordante de vitalité, elle paraissait dix ans de moins que ses quarante-huit effectifs.
— Bonjour madame Deyrolle, aborda Clet, nous allions justement chez vous.
— Chez moi ! fit-elle, en portant la main à son cœur. Que se passe-t-il ?
— Rien de grave, rassurez-vous. Hier, une bagarre a opposé des marins à des peintres venus de Pont-Aven pour la journée. Un de ces marins est votre voisin, René Sauban. J’aimerais que vous m’en parliez. Quel type d’homme est-ce ?
— René ? La gentillesse même. Bon mari, bon père. Et courageux avec ça ! S’il n’y avait que des hommes comme lui, les trois-quarts des cafés de la ville pourraient fermer.
— S’emporte-t-il facilement ? A-t-il un tempérament bagarreur ?
— Absolument pas ! Je ne l’ai jamais entendu élever la voix ! Alors, se battre ! J’ai du mal à croire qu’il ait été mêlé à une bagarre.
Suzanne Deyrolle s’approcha et posa sa main sur le bras de Clet.
— René, je le connais depuis tout le temps : il ne ferait pas de mal à une mouche.
— Je suis tout disposé à vous croire, Madame Deyrolle. Pouvez-vous me parler de Pierre Montfort ?
— Pierre Montfort ? Celui qui habite en Ville-close ?
— Oui, il fait partie de l’équipage de René Sauban, sur “La Sœur des Trois Frères”.
— “La Sœur des Trois Frères” ! C’est digne de René ça ! Vous savez pourquoi il a appelé son bateau comme ça ?
Les deux hommes haussèrent les épaules, attendant la réponse.
— René avait un bateau, “Le Richelieu”, une belle chaloupe qu’il a revendue à un gars d’Auray, je crois que c’était fin février. Mais il avait un autre bateau et, lorsqu’il a fallu lui donner un nom, René n’a pas hésité : il a voulu lui donner le prénom de sa femme. Toutefois, comme il adore plaisanter, il l’a finalement appelé “La Sœur des Trois Frères”. Mais, pour revenir à votre question, non, je ne connais pas personnellement Pierre Montfort.
— Ça ne fait rien. Connaissez-vous quelques peintres qui fréquentent Pont-Aven ?
— À vrai dire, non. Nous recevons souvent des amis peintres, mais ils ne fréquentent pas Pont-Aven.
— Bien, fit Clet. Je vous remercie madame Deyrolle. Où pouvons-nous trouver votre mari ou votre frère ?
— Ils ne sont pas là, ils sont partis de bonne heure à Quimper. Ils devaient examiner des tableaux ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus ce que m’a dit mon mari…
— Ce n’est pas grave. Monsieur Satre semblait les connaître : il nous donnera les renseignements qui nous intéressent. Sinon nous repasserons.
— Je vous en prie. Au revoir, messieurs.
Elle repartit de son pas rapide et souple en direction des viviers, saluant au passage les deux religieuses quand elle les croisa.
*
— On n’a pas avancé, dit Arsène.
— Non. Allons sur le quai. Peut-être y verrons-nous un peintre.
À ce moment, un gamin déboucha en courant près de la criée et traversa la petite place en appelant son père. Reconnaissant Jean, son fils aîné, Clet sut à son visage affolé qu’il s’était passé quelque chose d’anormal.
— Papa, il faut que tu reviennes vite. C’est Alexis qui m’envoie te chercher. Il ne m’a pas donné la raison, il m’a juste dit que c’était très important.
1 “Oreilles de travers”, en breton.
2 Pipe ou “brûle-gueule”.
II
— Voilà… Merci Marie. Verse-moi donc une bolée.
La domestique s’en fut chercher un pichet de cidre et une bolée pendant que l’homme dévisageait les clients de l’auberge. Quelques-uns se retournaient et reprenaient leur conversation en breton là où ils l’avaient laissée quand il avait descendu avec moult précautions l’escalier de bois. D’autres, pour se donner une contenance, regardaient par les fenêtres ou la porte grande ouverte. Sur la demi-douzaine de consommateurs, aucun ne soutenait son regard.
— As-tu vu Rodéric ce matin ? demanda-t-il de sa voix rauque, tandis que la domestique le servait.
— Oui. Monsieur O’Conor est sorti depuis une bonne heure déjà. Il a dit qu’il ne serait pas long.
Il bougonna une grossièreté et posa sa canne sculptée sur la table. Avec des gestes lents et calculés, il sortit d’une poche de son gilet une superbe pipe et un paquet de tabac. Comme il exhalait une première bouffée, un homme entra et se dirigea droit vers lui. Pas très grand, légèrement ventru, il portait des lunettes rondes, une épaisse moustache et, sur la tête, un étrange et pittoresque chapeau surmonté d’un pompon.
— Paul ! J’avais peur d’arriver trop tard et que vous soyez déjà parti travailler.
— Salut Maxime, fit Gauguin à voix basse. Vous ne risquiez pas de me rater. Regardez ! Il désignait sa jambe droite bandée et reposant sur un petit tabouret.
— Oh ! Que vous est-il arrivé ? Une chute de barrique ?
— Non, mon pauvre ami. Remarquez, j’aurais préféré ! Je ne m’en serais pris qu’à moi-même, je me serais insulté… Je me suis battu, figurez-vous !
D’un geste explicite, Maufra demanda une bolée à la servante et questionna :
— Et avec qui vous êtes-vous battu ?
— C’est toute une histoire !
Il parlait fort, maintenant, afin que nul dans la salle n’en perde une parole. Les conversations avaient cessé, mais personne ne fit face au peintre de peur d’essuyer une grimace ou une remarque cinglante.
Marie porta à la cuisine les pommes de terre qu’elle avait épluchées : elle connaissait par cœur ce récit pour l’avoir déjà entendu une bonne dizaine de fois la veille.
— Hier, nous nous sommes rendus à Concarneau. Cette visite était prévue depuis quelque temps déjà, et nous sommes partis de bon matin. Il y avait Armand et son amie, Émile et sa femme, Rodéric, Annah, Taoa la guenon et moi. Nous voulions visiter la Ville-close et, à l’occasion, rencontrer deux ou trois amis. Trinquons, Maxime, ce cidre est une merveille !
Tout en buvant, il vérifia de ses yeux gris-vert que tous attendaient la suite. Il reposa sa bolée d’une main tremblante et essuya son front où perlaient quelques gouttes de sueur.
— Dès les premières maisons de la ville, deux ou trois gamins nous ont suivis. Au début, ils semblaient s’amuser de notre petite troupe. Nous les ignorions, pensant qu’ils allaient se lasser. Ce fut tout le contraire ! Arrivés sur le quai, c’est une quinzaine de gosses qui nous suivait. Enhardis par leur nombre, ils ont commencé à jeter des cailloux sur Annah et Taoa. À chaque fois qu’une pierre atteignait l’une d’entre elles, ils applaudissaient et félicitaient le lanceur. N’y tenant plus, Armand s’est soudain retourné et en a attrapé un. Il lui a tiré l’oreille pour le punir et lui a fait promettre de ne plus recommencer. Les cris du gosse ont attiré du monde, et voilà que son père arrive et frappe Armand d’un coup de poing d’une violence inouïe. Voyant cela, je riposte et l’envoie rouler sur le sol. Mais ça ne s’arrête pas là !
Il se passa de nouveau la main sur le front, et reprit :
— Oh ! La, la. Imaginez : il va chercher son équipage et ce sont quinze hommes qui me tombent dessus. Je me suis dit : « Paul, c’est le moment de mettre en application les conseils de Bouffar1. » Je reprends le combat, toujours maître du terrain et de moi. Je les maintiens à distance et les expédie sur le pavé s’ils s’approchent de trop.
Il mimait son combat, ce qui lui arracha un cri. Les hommes au comptoir se retournèrent de surprise, mais reprirent leur position initiale, offrant leurs cheveux longs et les rubans de leurs chapeaux au regard haineux du peintre. Derrière ses petites lunettes rondes, les yeux de Maxime Maufra ne perdaient pas une miette de la simulation.
— Armand saute à l’eau tout habillé, sinon ces fous vont le massacrer, et Émile et Roderic font ce qu’ils peuvent. Bordel de Dieu, quelle bagarre ! Je pense que je les aurais tous vaincus si la malchance ne s’était mise de la partie. J’esquive, je frappe, je feinte, je repousse, je cogne et, soudain, mon pied bute dans un trou. En tombant, je me casse la jambe, et là, ça a été ma fête ; ces couilles-molles se sont vengés et une pluie de coups de sabots m’est tombée dessus.
Haletant, il arrêta son récit et but une longue gorgée. Atteint d’une forte fièvre, les yeux vitreux et le front trempé, il semblait en transe. Quand sa respiration se fut calmée, il poursuivit.
— Je me suis protégé du mieux que j’ai pu et j’ai laissé passer l’orage. J’entendais les gamins qui encourageaient leurs pères. C’était affreux, ce moment. J’aurais voulu hurler, me débattre, me relever et les assommer tous à tour de rôle. Je ne pouvais rien faire, cette satanée jambe refusant de bouger. Lorsqu’ils ont enfin arrêté de cogner, Émile m’a aidé à m’asseoir. Ces bâtards s’étaient dispersés et il ne restait plus qu’un marin, le père du gosse qu’Armand avait corrigé, plus des femmes et des enfants. Les gendarmes sont arrivés et ont envoyé chercher le docteur.
Il passa sa main sur ses tempes pour essuyer la sueur qui lui descendait jusqu’au menton, finit sa bolée de cidre et cria :
— Marie, remets-nous ça ! Imaginez la situation, Maxime, dans cette ville hostile : Armand est remonté sur le quai et dégouline de partout. Son amie se plaint des côtes. Annah et la femme d’Émile tentent de rassurer la pauvre Taoa. Roderic, énervé comme jamais je ne l’avais vu, donne des explications en français mêlé d’anglais. Émile, les bras le long du corps, ne sait plus à quel saint se vouer. Et moi, allongé par terre, j’ai la jambe cassée au ras de la cheville, la peau toute traversée par l’os… Des gamins et des femmes font cercle autour de nous, se bousculant pour ne pas rater une miette du spectacle. Le docteur se fraye un chemin et me triture la jambe, pendant que les gendarmes relèvent nos identités. Et là, scandale ! Figurez-vous que j’avais laissé mes papiers ici, à l’hôtel… Je cherche dans la foule un visage connu, quelqu’un qui pourrait attester de mon identité… En vain. Des gens bien habillés ont rejoint les ouvrières d’usine et je me dis qu’il y a sûrement parmi eux un peintre, même un “saloneux”, qui me connaît. Avant que la bagarre ne commence, j’avais vu au lointain toute une rangée de chevalets et, sur les vêtements de certains, j’aperçois des marques de peinture. Mais non ! Pas un ne me connaissait, pas un ne savait qui j’étais. Sur leurs visages je ne voyais que de l’hostilité, parfois de la pitié, mais nulle trace de sympathie. Émile, le plus calmement possible expose aux gendarmes les circonstances de la bagarre et, soudain, miracle, un homme s’agenouille près de moi. Ah la la, quelle chance ! Frédéric Satre, vous savez, le mari d’Angèle ! Il est entrepreneur à Concarneau et n’habite pas très loin de la gendarmerie. Grâce à lui, tout a ensuite été très rapide. Enfin, façon de parler. Il s’est porté garant de moi et a assuré le maréchal des logis que je ne pouvais en aucun cas être accusé d’avoir déclenché une bagarre. Tandis que le docteur finissait de me soigner, Armand s’est rendu à la gendarmerie signer son témoignage, puis Frédéric a fait venir un huissier, maître Morvan, afin qu’il enregistre ma plainte. Car ça ne va pas s’arrêter là. Je vais tout faire pour que ces abrutis de marins payent le plus cher possible leur férocité. Sans compter le manque à gagner qui va résulter de mon immobilisation ! Ils n’ont pas fini d’entendre parler de moi.
— Que dit le docteur ? demanda Maufra. Quand pourrez-vous travailler ?
Gauguin soupira et passa une main dans ses cheveux à reflets roux avant de répondre :
— Je ne sais pas. Le docteur parle de deux mois, autant dire une éternité. Et dire que je suis venu ici pour travailler et que… J’en deviens fou.
— Bah ! Vous pourrez toujours sculpter ou… Salut Roderic, comment vas-tu ?
Grand, les moustaches noires et broussailleuses sur un éternel sourire moqueur, l’Irlandais O’Conor serra les mains tendues et s’assit.
— Ça va, répondit-il. Enfin, mieux que Paul ! Seul mon nez est amoché. Marie, apporte-nous à boire, please !
Son accent trahissait ses origines anglo-saxonnes, mais il s’exprimait dans un excellent français.
La servante apporta une bolée. Comme elle allait remplir celle de Gauguin, un éclat de voix la fit sursauter.
— Qu’est-ce que vous faites, malheureuse ! Vous voulez le tuer ? Et vous, que faites-vous donc ici ?
Le docteur Grias, une sacoche à la main, venait d’entrer et semblait stupéfait de découvrir son patient attablé dans l’auberge.
— Vous êtes inconscient, mon ami ! Il me semble vous avoir interdit l’alcool. Je suis sûr que vous avez de la température, en plus. Allez, vous deux, montez-le dans sa chambre, que j’examine sa blessure…
Gauguin n’avait jamais permis à quiconque de lui parler ainsi, mais la véhémence et la justesse des propos du jeune médecin lui clouèrent le bec. Il se laissa guider précautionneusement vers l’escalier, se mordant la lèvre supérieure pour taire sa douleur. Chaque marche était une épreuve, et ce fut les larmes aux yeux et le visage congestionné qu’il parvint à l’étage. Le docteur Grias chassa Annah et Taoa de la chambre et attendit que Maufra et O’Conor sortent pour se pencher sur son patient.
En bas les conversations avaient repris et les paysans présents jetaient de curieux et discrets regards à la guenon et à Annah, surnommée la “Javanaise” bien qu’elle fut originaire du Sri Lanka. L’arrivée de cette femme de couleur à Pont-Aven avait suscité un vif intérêt parmi la population, et la nouvelle s’était répandue rapidement jusque dans les fermes alentour.
L’intrusion d’un gendarme, inconnu car ne faisant pas partie de la brigade locale, généra un nouveau silence. Eugène Le Berre avait laissé Skouarn Treuz à la gendarmerie et était descendu à pied au centre-ville, l’âme de Pont-Aven. Cela faisait plusieurs années qu’il n’y était pas venu, aussi s’était-il d’abord présenté à l’ancienne pension Gloanec. Une femme l’avait renseigné et lui avait indiqué le nouvel hôtel, cinquante mètres plus haut sur la place.
Un peu intimidé par les lieux, Eugène s’approcha de la table occupée par Maufra, O’Conor, Annah et Taoa.
— Bonjour, je suis venu prendre des nouvelles de monsieur Gauguin. Comment va-t-il ?
Émanant de l’étage, un cri de souffrance répondit à sa question. Eugène fronça les sourcils. « Tâche de minimiser l’affaire, ça m’embêterait qu’elle prenne trop d’importance… », avait dit Clet.
1 Peintre qui donna à Gauguin, à Pont-Aven, ses premières leçons de boxe anglaise.
III
Clet et Arsène entrèrent en trombe dans le bureau. L’air soucieux d’Alexis ne leur dit tout de suite rien qui vaille. D’ailleurs, la raison devait être importante pour qu’il ait amené Jean les chercher.
— Ah, vous voilà !
— Alors, que se passe-t-il ? demanda Clet.
— Le commis d’une ferme de Lambell vient de partir. Ce matin, ils ont trouvé le corps d’un homme à l’entrée d’un champ. Son patron nous attend dans les plus bref délais.
Un pli barra le front de Clet.
— Allons bon ! Et en quoi est-ce si urgent ?
— C’est que… Il semblerait que ce citoyen soit décédé d’une mort violente.
— Voilà qui change tout, fit Clet après un silence. J’avais espéré un instant que ce citoyen soit décédé de sa bonne mort… Arsène, file chez Rannou et demande deux chevaux à sa femme. Passe avant chez le docteur afin qu’il nous accompagne. Son diagnostic nous sera peut-être utile.
Plus d’une demi-heure fut nécessaire pour parcourir au trot la distance séparant la brigade de la ferme. Une ou deux fois, ils durent attendre la carriole du médecin, moins manœuvrable que leurs montures.
Leur départ précipité suscita de nombreuses interrogations, et déjà, certains racontaient au plus large auditoire possible, une histoire abracadabrante, truffée de détails effrayants.
Une jeune fille, un panier d’œufs à la main, leur indiqua le lieu de la macabre découverte : ils devaient revenir sur la route de Trévignon et tourner dans le premier vinojenn1 à droite. En fait, un homme les attendait un peu plus loin en compagnie du Maire de Trégunc, Jean Marie Le Mat, que les trois hommes connaissaient déjà.
— Merci d’être venus si vite, dit le maire. Moi-même, je suis accouru sitôt prévenu. Je vous présente monsieur Le Bris, c’est lui qui a découvert le corps.
Le paysan tendait une main énorme et calleuse que serrèrent les trois arrivants.
— Bonjour, monsieur Le Bris, fit Clet. Où se trouve le corps ?
Il avait parlé lentement, car dans les campagnes ils étaient encore nombreux à ne parler que le breton, et il ignorait si tel était le cas.
— Là, à dix mètres. À l’entrée du champ, répondit le paysan dans un français correct et aux intonations lourdes.
Ils avancèrent vers l’endroit indiqué, le médecin en tête. Celui-ci s’agenouilla entre deux larges taches de sang sur l’herbe et entreprit un léger examen de la dépouille mortelle. Les yeux ouverts semblaient questionner les nuages, un rictus tordait les lèvres pâles.
— J’imagine que vous voulez connaître les causes du décès ? demanda le docteur Galzain en se tournant vers Clet.
Le maréchal acquiesça et Galzain poursuivit :
— La victime de sexe masculin, semble âgée d’environ vingt-cinq à trente ans. Les yeux marron, taille moyenne, assez maigre. Autant que je puisse en juger par la vareuse pleine de sang, le décès serait dû à des coups de couteau. Au moins cinq coups.
Clet s’agenouilla et prit la main droite du mort.
— Regardez, il a aussi reçu un coup de couteau au poignet. Ces écailles renforcent l’idée que je m’étais faite en voyant ses vêtements : cet homme était marin.
— Oui, fit le médecin. Attendez… C’est curieux ça ! Il semblerait qu’il ait eu le nez cassé juste avant de mourir. Son assassin l’a sûrement frappé au visage avant de le tuer.
Le maire de Trégunc s’éloigna pour vomir. Le Bris s’approcha pour l’aider de la parole dans cette épreuve, tandis qu’Arsène Bourhis furetait à droite, à gauche, à la recherche d’indices.
— Je pense également qu’il y a eu combat, renchérit Clet Moreau, comme en attestent les traces de terre sur son pantalon.
— Oui. Vous voyez ces petites égratignures sur les articulations des doigts ? Je ne serais pas étonné qu’il ait touché son meurtrier d’un bon coup de poing, voire de plusieurs. La rigidité cadavérique s’étant opérée, je présume que le décès a pu avoir lieu hier, en fin de journée, au plus tard en début de nuit. Seule une autopsie plus détaillée nous renseignerait…
— Faites-la ! coupa Clet, nous ne devons rien négliger pour attraper le meurtrier. Finissez ce premier examen, puis nous vous aiderons à le charger dans votre carriole.
— Dans ma carriole ! s’écria le médecin, mais elle est trop petite !
— Mais non, mais non.
Assis sur le talus, Jean Marie Le Mat reprenait quelques couleurs. À ses côtés, le paysan attendait, les mains dans les poches.
— Monsieur Le Bris, s’il vous plaît, expliquez-moi les circonstances de votre… découverte.
— Oh ! C’est bien simple. J’allais relever mes collets, rapport aux lapins qu’il y a par ici et qui bouffent tout, quand j’l’ai vu. J’ai couru jusqu’à la ferme et j’ai envoyé mon commis vous chercher. Après j’ai dit à mon fils d’aller prévenir le maire et je suis revenu ici.
— Bien… Y a-t-il d’autres hommes à la ferme ?
— Non. Y’a que mon fils, mon commis et moi. Plus ma femme et ma fille.
— Connaissiez-vous la victime ?
— Gast2, non. C’est un marin.
La réponse n’étonna pas Clet. Les pegsans et les martolod s’ignoraient, chaque corporation considérant l’autre comme un ramassis de moins que rien. Cette ignorance toute relative cessait lors des rassemblements populaires. En effet, le premier regard ou la première parole de travers déclenchaient de mémorables bagarres opposant ces deux confréries.
— D’accord, mais même sans le connaître, disons intimement, l’aviez-vous déjà vu ?
— Oui. Il passait par-là toutes les semaines, le dimanche soir ou le lundi matin de bonne heure, en direction de Concarneau, et le samedi après-midi dans l’autre sens, sans doute pour rentrer chez lui.
— Hum ! fit le maréchal des logis, nous étions pourtant vendredi, hier.
— Ah ! Ben j’en sais rien moi, pourquoi il est passé hier à la place d’aujourd’hui, se défendit Le Bris. Tout ce que j’sais, c’est qu’il est là.
— Oui, bien sûr. Et vous, monsieur le Maire, vous le connaissiez ?
Le Mat se racla la gorge avant de répondre.
— Non. Du reste je ne connais pas tous mes administrés. La commune est assez étendue.
Le maréchal des logis se tourna vers Le Bris :
— Dites-moi, vous n’avez rien remarqué ? des rôdeurs, des inconnus…
— Non. Il ne passe pas grand monde par ici.
Profitant d’un instant de silence, Arsène Bourhis prit la parole :
— Il n’y a qu’une chose qui m’étonne ; visiblement, il rentrait chez lui retrouver les siens, sa semaine de travail terminée. Il me vient alors une question : où est son panier ?
— Devant les regards interrogateurs des trois hommes, Arsène dut s’expliquer :
— Les marins ont tous un petit panier rond en osier, dans lequel ils mettent leur godaille, le poisson qu’ils ramènent chez eux pour leur famille. Or, je ne le trouve pas, ce panier.
— Venez voir, appela le médecin.
Les deux gendarmes s’approchèrent.
— J’ai entendu ce que vous disiez, et j’ai suivi votre raisonnement : si cet homme rentrait d’une semaine de travail, ses poches devraient contenir de l’argent. Mais regardez : elles sont vides.
Clet retira son couvre-chef et du pouce et de l’index joua avec la cocarde en tissu de poil de chèvre.
— Le vol serait le mobile… Pourquoi pas ? J’en doute cependant. Cet homme ne devait pas avoir une fortune au fond de ses poches et, Dieu merci, on ne tue pas pour quelques poissons.
Il remit son chapeau et se tourna vers Arsène.
— Tu n’as pas retrouvé l’arme ?
— Le gendarme se contenta de secouer la tête, en proie à la réflexion, le visage fermé. Puis, ses yeux semblèrent s’illuminer.
— Et le couteau ! Tous les marins ont un couteau pour ouvrir et vider les poissons.
Le paysan qui, par nature, ne mangeait jamais de poisson, sentit son estomac se soulever à cette évocation. Tuer une poule, un lapin ou même un cochon, ne l’émouvait pas, mais l’idée d’extraire les entrailles d’un poisson lui était insupportable. Il cracha et dit :
— Erk, menergues3 ! Ça doit puer là-dedans !
— J’en ai terminé, messieurs, fit le docteur Galzain en se levant. Où puis-je me laver les mains ? demanda-t-il au paysan.
— Venez jusqu’à la ferme.
Le paysan, le médecin et le maire s’éloignèrent tandis que les gendarmes chargeaient le corps du marin dans la carriole. Restés seuls, ils en profitèrent pour échanger leurs impressions.
— Pas d’indices, pas de témoins, pas de mobile apparent, voilà une enquête qui promet d’être longue et difficile. Qu’est-ce que cela t’inspire, Arsène ?
— À vrai dire, rien du tout, fit ce dernier après un silence. Le vol semble le mobile, mais qui tuerait un homme pour quelques poissons, un peu d’argent et un couteau ? Ce qui peut nous aider, c’est le constat du médecin selon lequel il a frappé son agresseur lors de la bagarre.
— Et que penses tu de Le Bris ?
— Je le crois innocent, bien sûr ! D’ailleurs il ne présente aucune trace de coups.
— Bien analysé et observé, Arsène. Récapitulons : nous avons un mort, décédé de cinq coups de couteau, et détroussé de ce qu’il possédait. Autant qu’on puisse en juger, le meurtre a été précédé d’une bagarre, et le corps n’a pas été déplacé, comme en atteste le sang sur l’herbe. L’homme était marin et passait par ici deux fois par semaine, le dimanche ou le lundi pour aller à Concarneau et le samedi en sens inverse pour rentrer chez lui. Que peut-on ajouter ?
— Je crois que c’est tout, et c’est bien peu.
— Tu l’as dit ! Allons jusqu’à la ferme.
Venant de la cour inondée de soleil, les gendarmes mirent quelques secondes pour s’accoutumer à la pénombre de la pièce. Les trois hommes buvaient du cidre attablés à une table de chêne. Madame Le Bris, une solide quadragénaire, remuait le contenu d’un chaudron. Tandis qu’ils la saluaient, son mari leur servit deux bolées.
Il devait être midi, car deux jeunes hommes, vraisemblablement le fils du paysan et le commis, entrèrent, aussitôt suivis de la jeune fille rencontrée plus tôt dans la matinée. Clet Moreau et Arsène Bourhis échangèrent un regard fugace : aucun des jeunes hommes ne portaient d’ecchymoses sur le visage. D’un tacite accord, les hommes vidèrent leurs bolées et sortirent.
*
Tandis que le médecin montait dans sa carriole près de son macabre passager, Clet ordonna :
— Arsène, tu continues vers Trévignon. Arrête-toi dans chaque hameau et décris la victime. Tu ne rentreras que lorsque tu connaîtras son identité et que tu auras averti sa famille. Pose des questions sur ses habitudes, ses ennemis, s’il en avait, enfin tout ce qui est susceptible de nous intéresser. Je rentre avec le docteur Galzain et je préviens immédiatement le commandant de compagnie de Quimper.
— Quimper ! répéta Le Bris.
— Oui. Je ne suis que maréchal des logis et, par conséquent, je ne suis pas habilité à mener une enquête criminelle. Je dois donc en référer à mes supérieurs afin qu’un officier soit chargé de résoudre cette affaire. Il viendra vraisemblablement vous interroger sous peu… à moins que la brigade de Quimper ne souffre de sous-effectif comme c’est arrivé une fois. Auquel cas, cette mission me sera confiée. Au revoir, messieurs.
1 De “gwenodenn”, sentier.
2 Littéralement : “Putain”, femme de mauvaise vie. Ce mot est également utilisé pour renforcer une affirmation ou traduire une émotion.
3 Beurk, dégoûtant !
IV
— Salut les artistes !
Le nouvel arrivant arborait un immense sourire, ses dents blanches semblant jaillir de son visage hâlé. Comme en attestaient ses vêtements maculés de peinture, Émile Péron était peintre, plus précisément peintre en bâtiment.
Il connaissait la plupart des artistes peintres fréquentant Pont-Aven et ne ratait aucune occasion de les asticoter, aimant dire et répéter que, lui, au moins, vivait de sa peinture. Ses propos en irritèrent plus d’un au début, mais il s’avéra qu’il s’agissait d’un jeu et chacun y participa. Ainsi, certains jours, ou plutôt certains soirs, il n’était pas rare d’entendre crier, sur un mode gouailleur :
« Peinturlureur ! Barbouilleur ! Colorieur ! Badigeonneur ! Gribouilleur ! Barioleur… »
D’immenses éclats de rire concluaient ces échanges. Quiconque non averti du caractère amical de ces joutes verbales, croyait y voir les prémices d’un pugilat.
On aimait d’ailleurs se rappeler l’histoire de ce coiffeur de passage à Pont-Aven qui courut, après un discret signe à Marie-Jeanne Gloanec, chercher les gendarmes pour calmer les esprits. Lorsque les forces de l’ordre arrivèrent, timidement suivies du coiffeur, tous s’amusèrent de la farce et trinquèrent.
Il alla au comptoir, commanda du cidre et entama une conversation avec ses voisins. Âgé de trente-trois ans, il était doté d’une force peu commune. Cette force, ajoutée à une souplesse féline, lui permettait de remporter la majeure partie des concours de lutte organisés lors des pardons.
La sacoche à la main, le docteur Grias descendit rapidement l’escalier et s’avança à grandes enjambées vers la table.
— Votre ami est très, très fatigué. Il lui faut du repos. Je compte sur vous pour l’aider. Je lui ai interdit la position debout, et je ne veux pas qu’il quitte son lit. La guérison de sa jambe passe par le repos. Je lui ai donné de la morphine pour apaiser la douleur.
Puis, s’adressant plus particulièrement à Annah, dont le parfum de patchouli avait empli la pièce :
— Demandez une autre chambre à madame Gloanec ou à défaut un autre lit. La blessure est encore fraîche et le simple contact de la couverture le gêne. Alors, imaginez un coup de pied en dormant.
— D’accord, Docteur.
— Je repasserai demain matin. Si cela est nécessaire, faites-moi prévenir et je viendrai aussi vite que possible.
Le docteur Grias sortit, le gendarme sur les talons. Ils discutèrent quelques minutes, puis Eugène Le Berre revint dans l’auberge. Il se força à sourire et déclara en s’asseyant :
— En voilà de bonnes nouvelles ! Votre ami est presque guéri.
Les deux hommes et la femme le regardèrent avec de grands yeux ronds.
— Guéri ! fit Annah.
— Presque… Enfin, disons que la guérison est en bonne voie.
Maxime Maufra reposa le verre qu’il allait porter à ses lèvres.
— Il me semble que vous ne réalisez pas les conséquences de cette blessure : cela signifie qu’il ne pourra pas travailler. Tout au plus, il sculptera ! Mais peindre ! Il s’écoulera de longues semaines avant qu’il ne puisse monter dans son atelier chez Lezaven, ou mieux encore sortir pour peindre sur le motif.
Derrière les lunettes, ses yeux lançaient des éclairs. Il retrouva un peu son calme et continua.
— Les beaux jours arrivent et Paul va devoir garder le lit. Comme si sa situation financière le lui permettait ! C’est une catastrophe… Une catastrophe pour lui et pour l’art en général !
Le Berre, que ces considérations artistiques n’atteignaient pas, répliqua :
— Une catastrophe, n’exagérons pas ! Comme me le disait le docteur Grias, si monsieur Gauguin observe la période de repos nécessaire, il se remettra vite et cet incident ne sera plus qu’un mauvais souvenir.
— Croyez-vous ? demanda Annah, un bras posé sur les épaules de la guenon. Sans être âgé, il n’est plus vraiment jeune : il aura quarante-six ans dans moins de deux semaines.
— En tout cas, fit l’Irlandais O’Conor, j’espère que la justice fera son travail, et dédommagera Paul à hauteur du manque à gagner.
— Justement, coupa le gendarme. Je suis également venu à ce sujet : je ne vous cache pas qu’un procès serait gênant pour tout le monde et que le verdict ne serait peut-être pas favorable.
— Pas favorable ! Êtes-vous sérieux ? ironisa Maxima Maufra. Je ne crois pas la justice capable de condamner les victimes et d’acquitter les agresseurs.
— Paul a déposé une plainte chez Maître Morvan à Concarneau, dit O’Conor. Il demande dix mille francs de dommages et intérêts.
Eugène encaissa la nouvelle sans ciller et répondit sur un mode ironique :
— Dix mille francs ! Eh bien, il ne doute de rien, votre ami ! Où croit-il qu’un marin puisse trouver une somme pareille ? Au fond de ses filets ?
— Ça, c’est un autre problème, fit Maufra. Notre ami De Chamaillard, lorsqu’il sera averti, se fera un plaisir de défendre Paul. Ceci avec l’assistance de son père et de son frère, avocats au barreau de Quimper.
Voyant que la situation lui échappait, Eugène Le Berre se leva et ajusta son chapeau.
— Messieurs-Dames, j’ai à faire… Dès que la plainte nous sera transmise, nous adresserons un rapport au juge. D’ici là, je souhaite que votre ami se remette au plus tôt de sa blessure. Au revoir.
Sur la place, deux jeunes enfants couraient après des oies qui se dispersèrent en criaillant. Eugène se dirigea sans se presser vers la gendarmerie, rue du Gac.
Roderic O’Conor brisa le silence qui suivit la sortie du gendarme, tandis qu’Annah se levait et, donnant la main à la guenon, montait rejoindre Gauguin.
— Et toi, Maxime, qu’est-ce qui t’amène à Pont-Aven ?
Maufra retira ses lunettes et se lissa les ailes du nez. Pour ménager son effet, il les remit lentement avant de répondre, les yeux pétillants de jubilation.
— Ce qui m’amène, mon cher Roderic ? Une excellente nouvelle. Quand je vois le malheur qui frappe Paul, je culpabilise d’avoir une chance pareille. En mars, j’avais laissé deux tableaux à la galerie Durand-Ruel, tu sais, le marchand parisien des impressionnistes. Je n’en ai pas parlé lors du repas chez Wladislaw au Pouldu, fin avril, car, à l’époque, je n’en savais pas plus. Mais il se trouve que Durand-Ruel vient de m’acheter deux autres tableaux le dix mai.
L’Irlandais siffla d’admiration.
— Oh, oh, Maxime ! Si je comprends bien, la fortune et la notoriété t’attendent.
Maufra claqua des mains pour écraser un moustique et objecta :
— La fortune et la notoriété peut-être pas, mais tout au moins la fin des soucis matériels. Écoute : Paul Durand-Ruel me propose l’achat et la promotion de mes toiles si je lui assure l’exclusivité de ma production.
— Great ! J’espère que tu as accepté ?
— Bien sûr ! Mais attends, je n’ai pas fini. Il s’engage à régler mes factures, que ce soit le loyer ou l’achat des toiles et des couleurs, mais aussi les impôts, les assurances, les transports, etc. Tout ceci dans la mesure où la qualité et la quantité de mes créations justifient de telles dépenses.
— C’est extraordinaire ! Je suis heureux pour toi.
— Il n’y a rien de signé, Roderic. Il s’agit d’un accord verbal qui peut être rompu à tout moment. Cependant Durand-Ruel est un homme admirable et il n’a qu’une parole. Si je lui fournis régulièrement des œuvres de qualité, il en sera terminé des préoccupations financières, et je pourrai travailler sereinement.
O’Conor fixa Maufra quelques secondes puis demanda malicieusement :
— Dis, tu n’es pas venu de Moëlan juste pour nous annoncer cette nouvelle à Paul et à moi ? Même s’il y a peu de kilomètres, il doit y avoir une autre raison à ta venue…
— En effet, il se trouve que je n’ai plus de toiles et je…
— Je parle d’une autre raison, une raison plus forte que les autres, une raison qui nous ferait escalader des montagnes et traverser à la nage des océans…
— Je ne vois pas, fit Maxime Maufra en se caressant le menton, le regard dans le vide. Pour quelle autre raison serais-je venu à Pont-Aven ? Ah, à moins que tu veuilles parler de…
Ses yeux se plantèrent dans ceux de l’Irlandais et les deux hommes éclatèrent de rire, un rire franc, preuve de l’amitié qui les liait. Les clients au comptoir se retournèrent brusquement mais, réalisant qu’aucun d’entre eux n’était l’objet d’une moquerie, ils reprirent leurs discussions. Même Émile Péron s’abstint de tout commentaire.
— Eh oui, Roderic tu as deviné juste ! Je peux enfin envisager l’avenir et, tel que tu me vois, je viens demander à Céline de m’épouser.
— Toutes mes félicitations, Maxime. Nul doute qu’elle va accepter. À quand la noce ?
— Ça, je ne sais pas encore. J’ai écrit à ma mère pour l’informer de ma décision et lui proposer de venir ici rencontrer Céline au mois de juillet. D’ici là, je compte me rendre à Plougasnou peindre et graver les sites à l’entour. Puis j’irai à Nantes chercher ma mère.
Les deux hommes se détournèrent pour accueillir un nouvel arrivant. Il bredouilla un timide bonjour à l’assistance, s’approcha en claudiquant légèrement et serra les deux mains tendues.
Mesurant un mètre quatre-vingt, âgé de vingt-cinq ans, il était d’une pâleur maladive. Ses mains aux doigts longs et secs trahissaient sa nervosité intérieure.
— Bonjour Armand, fit Maufra. Assieds-toi, c’est ma tournée.
Seguin posa sur la table une demi-douzaine de livres et questionna :
— Comment va Paul ?
— Le docteur vient de partir. Il faut que Paul se repose.
— Je lui ai apporté de la lecture. J’ai pris ce que j’ai trouvé : Swedenborg et Edgar Poe.
— C’est gentil. Le pauvre aura malheureusement le temps de les lire. Et toi, comment vas-tu ?
— Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit. Je m’en veux car c’est de ma faute si Paul est couché. Si je ne m’étais pas énervé, hier, si je n’avais pas attrapé ce gamin…
— Allons, rassura Maufra. Tu n’y es pour rien, tu ne pouvais pas imaginer que cela déclencherait une bagarre.
— Non, bien sûr, mais j’aurais dû ignorer les sarcasmes. Rien de tout cela ne serait arrivé.
— Certes mais, d’un autre côté, et je le dis pour ta conscience, tu ne pouvais laisser ces gosses insulter Annah. Tu as bien agi, Armand.
À son tour, l’Irlandais le tranquillisa. Pour ce faire, il utilisa l’anglais. Maxime Maufra suivit le dialogue tout en bourrant sa pipe. Il captait quelques mots, souvenirs de voyages en Écosse et au Pays de Galles, mais il se garda bien de s’immiscer dans la conversation. La pipe aux lèvres, les mains sur le ventre, il écoutait, admiratif. Derrière les lunettes rondes, ses yeux allaient de O’Conor à Seguin, puis de Seguin à O’Conor.
Lorsqu’ils cessèrent de parler, il dit :
— Eh bien Armand, j’ignorais que tu parlais aussi bien l’anglais.
— Je n’ai aucun mérite, souffla Armand. Avec un père français et une mère anglaise, je suis bilingue de naissance.
Les trois hommes vidèrent leurs verres de cidre et Maufra se leva.
— Messieurs, j’ai à faire. Roderic te racontera, fit-il en adressant un clin d’œil à l’Irlandais.
Comme il se dirigeait vers le comptoir pour payer les consommations, il se ravisa et revint vers la table.
— Au fait, j’allais oublier. Armand, il faut que je te félicite : j’ai lu ta préface et j’ai vu tes illustrations pour le catalogue de Donaldson. C’est parfait. Il semble que tu as tout compris de cet artiste. Et tes illustrations sont superbes. C’est vraiment un bel ouvrage.
Un peu de rouge monta aux joues de Seguin qui se tortilla sur sa chaise. Il balbutia un merci gêné et suivit du regard la sortie de Maufra.
*
Eugène glissa dans son portefeuille de correspondance le pli que lui remit le maréchal des logis, Blaise Furic, qui dirigeait la brigade de Pont-Aven. Celui-ci le raccompagna à son cheval. Comme il se mettait en selle, un homme arriva, mi-marchant mi-courant, un bébé d’environ un an dans les bras. Sans un regard pour le maréchal des logis, il interpella le gendarme.
— J’avais peur que vous soyez déjà parti. Je me présente : Émile Jourdan. Le docteur Grias m’a averti de votre passage à l’hôtel Gloanec.
L’enfant dodelinait de la tête et geignait, paraissant peu à l’aise dans les bras paternels.
— Oui, Marthe, attends un peu. Je voulais vous signaler que ma femme se remet difficilement des émotions d’hier après-midi. J’ignore encore si je vais porter plainte mais, si je le fais, croyez bien que je mettrai tout en œuvre pour que les fautifs soient punis.
Le ton de sa voix révélait plus d’exaspération que de fureur. Sans un mot de plus, il s’en retourna, les épaules voûtées. Comme si elle ressentait la détresse morale de son papa, la petite fille se mit à pleurer.