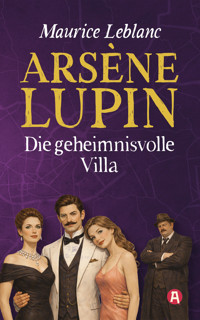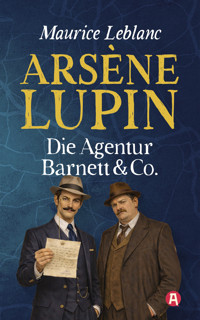3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ALEMAR S.A.S.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
- Cette édition est unique;
- La traduction est entièrement originale et a été réalisée pour l'Ale. Mar. SAS;
- Tous droits réservés.
813 est un roman policier de l'auteur français Maurice Leblanc, publié pour la première fois en 1910. Il s'agit du quatrième livre de la série Arsène Lupin. Lorsque le diamantaire sud-africain Rudolf Kesselbach est retrouvé mort dans un hôtel, Lupin est suspecté car sa carte est épinglée sur le défunt. Après deux autres meurtres dans le même hôtel, notre fidèle détective décide de mener l'enquête pour se disculper. Le mystère dans lequel il s'engage implique la découverte d'un paquet de lettres, la localisation d'une horloge sur laquelle le chiffre 813 a une signification, ainsi que l'obligation pour un empereur en titre de faire plusieurs voyages incognito.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Table des matières
Chapitre 1. La tragédie du Palace Hotel
Chapitre 2. Le label à bords bleus
Chapitre 3. M. Lenormand ouvre sa campagne
Chapitre 4. Le prince Sernine au travail
Chapitre 5. M. Lenormand au travail
Chapitre 6. M. Lenormand succombe
Chapitre 7. Parbury-Ribeira Altenheim
Chapitre 8. La redingote vert olive
Chapitre 9. "Le palais de Sante
Chapitre 10. Le grand projet de Lupin
Chapitre 11. Charlemagne
Chapitre 12. Les lettres de l'empereur
Chapitre 14. L'homme en noir
Chapitre 15. La carte de l'Europe
Chapitre 16. Les trois meurtres d'Arsène Lupin
Épilogue. Le Suicide
813
Maurice Leblanc
Chapitre 1. La tragédie du Palace Hotel
M. Kesselbach s'arrêta net sur le seuil du salon, prit le bras de son secrétaire et, d'une voix inquiète, chuchota :
"Chapman, quelqu'un est encore venu ici."
"Certainement pas, monsieur, protesta le secrétaire. "Vous venez d'ouvrir vous-même la porte du hall et la clé n'a pas quitté votre poche pendant que nous déjeunions au restaurant.
"Chapman, quelqu'un est encore venu ici", répéta M. Kesselbach. Il montra un sac de voyage sur la cheminée. "Regardez, je peux le prouver. Ce sac était fermé. Il est maintenant ouvert."
Chapman a protesté.
"Vous êtes bien sûr de l'avoir fermé, monsieur ? D'ailleurs, le sac ne contient que des bricoles sans valeur, des vêtements. . . ."
"Il ne contient rien d'autre, car j'ai sorti mon carnet de poche avant de descendre, par précaution. . . . Mais pour cela. . . . Non, Chapman, je vous le dis, quelqu'un est venu ici pendant que nous déjeunions."
Il y avait un téléphone sur le mur. Il décroche le combiné :
"Hallo ! . . . Je suis M. Kesselbach. . . . Suite 415 . . . C'est bien ça. . . . Mademoiselle, pourriez-vous me passer la préfecture de police... ... le service de police judiciaire. . . . Je connais le numéro... une seconde... Ah, le voilà ! Le numéro 822.48. . . . Je garde la ligne."
Quelques instants plus tard, il poursuit :
"Vous êtes le 822.48 ? Je voudrais dire un mot à M. Lenormand, le chef du service des détectives. Je m'appelle Kesselbach. . . . Bonjour ! . . Oui, le chef des détectives sait de quoi il s'agit. Il m'a autorisé à l'appeler. . . . . Oh, il n'est pas là ? ... A qui je m'adresse ? ... Le sergent-détective Gourel ? . . . Vous étiez là hier, n'est-ce pas, quand j'ai appelé M. Lenormand ? Eh bien, la même chose que j'ai dite hier à M. Lenormand s'est reproduite aujourd'hui. . . . Quelqu'un est entré dans la suite que j'occupe. Et, si vous venez tout de suite, vous pourrez peut-être découvrir quelques indices. . . . Dans une heure ou deux ? D'accord, merci. . . . Vous n'avez qu'à demander la suite 415. . . . Merci encore."
* * * * *
Rudolf Kesselbach, surnommé alternativement le Roi des Diamants et le Seigneur du Cap, possédait une fortune estimée à près de vingt millions de livres sterling. Depuis une semaine, il occupait la suite 415, au quatrième étage du Palace Hotel, composée de trois pièces, dont les deux plus grandes, à droite, le salon et la chambre principale, donnaient sur l'avenue ; tandis que l'autre, à gauche, dans laquelle dormait Chapman, le secrétaire, donnait sur la rue de Judée.
Attenante à cette chambre, une suite de cinq pièces avait été réservée pour Mme Kesselbach, qui devait quitter Monte-Carlo, où elle séjournait actuellement, et rejoindre son mari dès qu'elle aurait des nouvelles de lui.
Rudolf Kesselbach se promena de long en large pendant quelques minutes d'un air pensif. C'était un homme de grande taille, au teint rougeaud, encore jeune, et ses yeux rêveurs, d'un bleu pâle à travers ses lunettes cerclées d'or, lui donnaient une expression de douceur et de timidité qui contrastait curieusement avec la force de son front carré et de ses mâchoires puissamment développées.
Il alla à la fenêtre : elle était fermée. D'ailleurs, comment quelqu'un aurait-il pu entrer par là ? Le balcon privé qui faisait le tour de l'appartement s'interrompait à droite et était séparé à gauche, par une rigole de pierre, des balcons de la rue de Judée.
Il se rend dans sa chambre à coucher : elle ne communique pas avec les pièces voisines. Il se rend dans la chambre de sa secrétaire : la porte qui donne sur les cinq pièces réservées à Mme Kesselbach est fermée à clé et au verrou.
"Je ne comprends pas du tout, Chapman. J'ai toujours remarqué des choses ici. ... de drôles de choses, comme vous devez l'admettre. Hier, mon bâton de marche a été déplacé. . . . La veille, mes papiers avaient certainement été touchés. . . . Et pourtant, comment est-ce possible ? . . .
"Ce n'est pas possible, monsieur ! s'écria Chapman, dont les traits honnêtes et placides n'exprimaient aucune inquiétude. "Vous vous imaginez des choses, c'est tout. . . . Vous n'avez aucune preuve, rien que des impressions. . . . D'ailleurs, regardez : il n'y a pas d'autre moyen d'entrer dans cette suite que par le vestibule. Très bien. Vous avez fait faire une clé spéciale le jour de notre arrivée, et votre homme, Edwards, en a le seul double. Vous lui faites confiance ?"
"Bien sûr que je le fais ! . . . Il est avec moi depuis dix ans ! . . . Mais Edwards va déjeuner en même temps que nous, et c'est une erreur. Il ne doit plus descendre à l'avenir jusqu'à ce que nous revenions."
Chapman haussa légèrement les épaules. Il n'y avait pas à en douter, le seigneur du Cap devenait un peu excentrique, avec ses craintes incompréhensibles. Quel risque peut-on courir dans un hôtel, surtout quand on n'a sur soi ou avec soi aucun objet de valeur, aucune somme d'argent importante ?
Ils entendent la porte du hall s'ouvrir. C'était Edwards. M. Kesselbach l'a appelé :
"Êtes-vous habillé, Edwards ? Ah, c'est vrai ! . . . Je n'attends pas de visiteurs aujourd'hui, Edwards... ou plutôt un seul visiteur, M. Gourel. En attendant, restez dans le hall et surveillez la porte. M. Chapman et moi avons du pain sur la planche."
Le travail sérieux dura quelques minutes, pendant lesquelles M. Kesselbach parcourut sa correspondance, lut trois ou quatre lettres et donna des instructions sur la façon d'y répondre. Mais, soudain, Chapman, qui attendait, la plume en équilibre, s'aperçut que M. Kesselbach pensait à tout autre chose qu'à sa correspondance. Il tenait entre ses doigts et examinait attentivement une épingle, une épingle noire recourbée comme un hameçon :
"Chapman, dit-il, regarde ce que j'ai trouvé sur la table. Cette épingle tordue signifie manifestement quelque chose. C'est une preuve, un élément de preuve matériel. Vous ne pouvez pas prétendre maintenant que personne n'est entré dans cette pièce. Car, après tout, cette épingle n'est pas venue ici d'elle-même."
"Certainement pas", répond le secrétaire. "Il est arrivé ici par mon intermédiaire."
"Qu'est-ce que tu veux dire ?"
"C'est une épingle que j'utilisais pour attacher ma cravate à mon col. Je l'ai retirée hier soir, pendant que vous lisiez, et je l'ai tordue mécaniquement."
M. Kesselbach se leva de sa chaise, d'un air contrarié, fit quelques pas et s'arrêta.
"Vous vous moquez de moi, Chapman, je le sens... et vous avez raison... . . Je ne le nie pas, j'ai été plutôt... bizarre, depuis mon dernier voyage au Cap. C'est parce que... eh bien... vous ne connaissez pas le nouveau facteur dans ma vie... un plan énorme... ... une chose énorme... Je ne le vois encore que dans la brume de l'avenir... mais il prend forme malgré tout... et ce sera quelque chose de colossal. . . . Ah, Chapman, tu ne peux pas imaginer. . . . L'argent, je m'en moque éperdument : J'ai de l'argent, j'ai trop d'argent. . . . Mais cela, cela signifie beaucoup plus ; cela signifie le pouvoir, la puissance, l'autorité. Si la réalité est à la hauteur de mes espérances, je serai non seulement le seigneur du Cap, mais aussi le seigneur des autres royaumes. . . . Rudolf Kesselbach, le fils du ferronnier d'Augsbourg, sera sur un pied d'égalité avec de nombreuses personnes qui, jusqu'à présent, le méprisaient. ... . . Il les supplantera même, Chapman ; il les supplantera, croyez-moi... et si jamais je...".
Il s'interrompt, regarde Chapman comme s'il regrettait d'en avoir trop dit et, néanmoins, emporté par son excitation, conclut :
"Vous comprenez maintenant les raisons de mon anxiété, Chapman. . . . Ici, dans ce cerveau, il y a une idée qui vaut beaucoup... et cette idée est peut-être suspectée... et je suis espionné. . . . J'en suis convaincu. . . ."
Une cloche retentit.
"Le téléphone", dit Chapman.
"Kesselbach murmura : "Serait-ce par hasard... ? ?" Il décroche l'instrument. "Bonjour ! . . Qui ? Le colonel ? Ah, c'est bien ! Oui, c'est moi... . . Des nouvelles ? . . C'est bien ! . . . Alors je vous attends. . . . Vous viendrez avec un de vos hommes ? Très bien. . . . Qu'est-ce qu'il y a ? Non, nous ne serons pas dérangés. . . . Je donnerai les ordres nécessaires. . . . C'est aussi grave que cela, n'est-ce pas ? . . . Je vous le dis, mes instructions seront positives. ... mon secrétaire et mon homme garderont la porte, et personne ne sera autorisé à entrer... . . Vous connaissez le chemin, n'est-ce pas ? . . . Alors ne perdez pas une minute."
Il a raccroché le combiné et a dit :
"Chapman, deux messieurs arrivent. Edwards va les faire entrer. . . . ."
"Mais M. Gourel... le sergent-détective... . . ?"
"Il viendra plus tard... dans une heure... . . Et même dans ce cas, il n'y a pas de mal à ce qu'ils se rencontrent. Envoyez donc immédiatement Edwards au bureau pour les prévenir. Je ne suis chez personne... sauf deux messieurs, le colonel et son ami, et M. Gourel. Il doit leur faire noter les noms."
Chapman fit ce qu'on lui demandait. Lorsqu'il revint dans la chambre, il trouva M. Kesselbach tenant à la main une enveloppe, ou plutôt un petit étui de poche, en maroquin noir, apparemment vide. Il semblait hésiter, comme s'il ne savait pas quoi en faire. Doit-il la mettre dans sa poche ou la déposer ailleurs ? Finalement, il se dirigea vers la cheminée et jeta l'enveloppe de cuir dans son sac de voyage :
"Finissons le courrier, Chapman. Il nous reste dix minutes. Ah, une lettre de Mme Kesselbach ! Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé, Chapman ? Vous n'avez pas reconnu l'écriture ?"
Il n'essaya pas de dissimuler l'émotion qu'il ressentit en touchant et en contemplant ce papier que sa femme avait tenu entre ses doigts et auquel elle avait ajouté un regard, un atome de son parfum, une suggestion de ses pensées secrètes. Il en respira le parfum et, après l'avoir décachetée, il lut lentement la lettre à voix basse, par bribes qui parvenaient aux oreilles de Chapman :
"Un peu de fatigue. . . . Je garderai ma chambre aujourd'hui. . . . Je m'ennuie beaucoup. . . . Quand pourrai-je venir vous voir ? Je me languis de votre fil... . ."
"Vous avez télégraphié ce matin, Chapman ? Alors Mme Kesselbach sera là demain, mercredi."
Il semblait tout à fait gai, comme si le poids de ses affaires avait été soudainement allégé et qu'il était libéré de toute anxiété. Il se frottait les mains et respirait profondément, comme un homme fort et sûr de son succès, comme un homme chanceux qui possédait le bonheur et qui était assez grand pour se défendre.
"Quelqu'un sonne, Chapman, quelqu'un sonne à la porte du hall. Va voir qui c'est."
Mais Edwards entra et dit :
"Deux messieurs vous demandent, monsieur. Ce sont eux. . . ."
"Je sais. Ils sont là, dans le hall ?"
"Oui, monsieur.
"Fermez la porte du hall et ne la rouvrez qu'à M. Gourel, le sergent-détective. Vous allez faire entrer ces messieurs, Chapman, et vous leur direz que je voudrais d'abord parler au colonel, au colonel seul."
Edwards et Chapman quittèrent la pièce, refermant la porte derrière eux. Rudolf Kesselbach s'approcha de la fenêtre et appuya son front contre la vitre.
A l'extérieur, juste sous ses yeux, les wagons et les voitures roulent dans des sillons parallèles, marqués par la double ligne de refuges. Un grand soleil de printemps faisait briller à nouveau les cuivres et les vernis. Les arbres poussaient leurs premières pousses vertes et les bourgeons des grands marronniers commençaient à déployer leurs feuilles naissantes.
"Que diable fait Chapman ? murmura Kesselbach. "Le temps qu'il perd à palabrer ! . . ."
Il prend une cigarette sur la table, l'allume et tire quelques bouffées. Une faible exclamation lui échappa. Tout près de lui se tenait un homme qu'il ne connaissait pas.
Il a commencé à reculer :
"Qui êtes-vous ?
L'homme - c'était un individu bien habillé, plutôt élégant, avec des cheveux noirs, une moustache sombre et des yeux durs - fit une grimace :
"Qui suis-je ? Le colonel !"
"Non, non. . . Celui que j'appelle le Colonel, celui qui m'écrit sous cette signature... adoptée... n'est pas vous !"
"Oui, oui... l'autre n'était que... Mais, mon cher monsieur, tout cela, vous le savez, n'a pas la moindre importance. L'essentiel, c'est que je sois moi-même. Et ça, je vous assure que je le suis !"
"Mais votre nom, monsieur ? . ."
"Le colonel... jusqu'à nouvel ordre."
M. Kesselbach est pris d'une peur grandissante. Qui était cet homme ? Que lui voulait-il ?
Il a appelé :
"Chapman !
"Quelle drôle d'idée que d'appeler à l'aide ! Ma compagnie ne vous suffit-elle pas ?"
"Chapman ! s'écria encore M. Kesselbach. "Chapman ! Edwards !"
"Chapman ! Edwards !" répéta l'étranger à son tour. "Qu'est-ce que vous faites ? On vous cherche !"
"Monsieur, je vous demande, je vous ordonne de me laisser passer".
"Mais, mon cher monsieur, qui vous en empêche ?"
Il a poliment cédé sa place. M. Kesselbach se dirigea vers la porte, l'ouvrit et fit un brusque bond en arrière. Derrière la porte se tenait un autre homme, pistolet à la main. M. Kesselbach balbutie :
"Edwards ... . Chap..."
Il n'a pas terminé. Dans un coin du hall, il aperçoit son secrétaire et son domestique allongés côte à côte sur le sol, bâillonnés et ligotés.
M. Kesselbach, malgré sa nature nerveuse et excitable, n'était pas dépourvu de courage physique ; et le sentiment d'un danger certain, au lieu de le déprimer, lui rendit toute son élasticité et sa vigueur. Feignant la consternation et la stupéfaction, il recula lentement jusqu'à la cheminée et s'appuya contre le mur. Sa main chercha la sonnette électrique. Il la trouva et appuya sur le bouton sans retirer son doigt.
"Alors ?" demande l'étranger.
M. Kesselbach n'a pas répondu et a continué à appuyer sur le bouton.
"Alors ? Vous pensez qu'ils vont venir, que tout l'hôtel est en émoi, parce que vous appuyez sur cette sonnette ? Mais, mon cher monsieur, regardez derrière vous et vous verrez que le fil est coupé !"
M. Kesselbach se retourna vivement, comme s'il voulait s'en assurer, mais au lieu de cela, d'un geste rapide, il saisit le sac de voyage, y plongea la main, saisit un revolver, le braqua sur l'homme et appuya sur la gâchette.
"Ouf !" dit l'étranger. "Vous chargez donc vos armes avec de l'air et du silence ?"
Le robinet a cliqué une deuxième fois, puis une troisième, mais il n'y a pas eu de rapport.
"Trois coups de plus, Seigneur du Cap ! Je ne serai pas satisfait tant que tu n'auras pas logé six balles dans ma carcasse. Quoi ! Vous abandonnez ? C'est dommage... tu t'entraînais très bien !"
Il saisit une chaise par le dossier, la fit tourner, s'assit à califourchon et, montrant un fauteuil, dit :
"Vous ne voulez pas vous asseoir, mon cher monsieur, et vous mettre à l'aise ? Une cigarette ? Pas pour moi, merci : Je préfère un cigare."
Il y avait une boîte sur la table : il choisit un Upmann, de couleur claire et de forme impeccable, l'alluma et, avec une révérence :
"Merci ! C'est un cigare parfait. Et maintenant, discutons un peu."
Rudolf Kesselbach l'écoute avec étonnement. Qui peut bien être cet étrange personnage ? . . . Pourtant, à la vue de son visiteur assis là, si calme et si bavard, il se rassure peu à peu et commence à penser que la situation pourrait s'arranger sans qu'il soit nécessaire de recourir à la violence ou à la force brute.
Il sortit un carnet de poche, l'ouvrit, montra une respectable liasse de billets de banque et demanda :
"Combien ?
L'autre le regarda d'un air perplexe, comme s'il avait du mal à comprendre ce que Kesselbach voulait dire. Puis, au bout d'un moment, il appela :
"Marco !
L'homme au revolver s'avance.
"Marco, ce monsieur a la gentillesse de t'offrir quelques bouts de papier pour ta jeune femme. Prends-les, Marco."
Tout en pointant son revolver de la main droite, Marco sort la main gauche, prend les billets et se retire.
"Maintenant que cette question est réglée selon vos désirs, reprit l'étranger, venons-en à l'objet de ma visite. Je serai bref et précis. Je veux deux choses. En premier lieu, une petite pochette en maroquin noir, en forme d'enveloppe, que vous portez généralement sur vous. Deuxièmement, une petite boîte en ébène, qui se trouvait hier dans votre sac de voyage. Procédons dans l'ordre. L'étui en maroquin ?"
"Brûlé".
L'étranger fronça les sourcils. Il devait avoir une vision du bon vieux temps où il existait des méthodes péremptoires pour faire parler les contumaces :
"Très bien. Nous verrons cela. Et le coffret d'ébène ?"
"Brûlé".
"Ah, grogna-t-il, c'est à moi que tu t'en prends, mon bonhomme ! Il tordit le bras de son interlocuteur d'une main impitoyable. "Hier, Rudolf Kesselbach, vous êtes entré au Crédit Lyonnais, boulevard des Italiens, en cachant un paquet sous votre pardessus. Vous avez loué un coffre-fort... soyons exacts : le coffre-fort n° 16, dans la niche n° 9. Après avoir signé le registre et payé votre loyer, vous êtes descendu au sous-sol ; et, lorsque vous êtes remonté, vous n'aviez plus votre colis sur vous. Est-ce exact ?"
"Tout à fait".
"Alors la boîte et la mallette sont au Crédit Lyonnais ?"
"Non.
"Donnez-moi la clé de votre coffre-fort."
"Non.
"Marco !
Marco est arrivé en courant.
"Regarde bien, Marco ! Le quadruple nœud !"
Avant même qu'il n'ait eu le temps de se mettre sur la défensive, Rudolf Kesselbach est ligoté dans un réseau de cordes qui lui entaillent la chair à la moindre tentative de lutte. Ses bras sont fixés dans son dos, son corps est attaché à la chaise et ses jambes sont liées comme celles d'une momie.
"Fouille-le, Marco".
Marco le fouille. Deux minutes plus tard, il remet à son chef une petite clé plate, nickelée, portant les chiffres 16 et 9.
"Capital. Pas de pochette en maroquin ?"
"Non, monsieur le gouverneur".
"Il est dans le coffre-fort. M. Kesselbach, pouvez-vous me donner le code secret qui permet d'ouvrir la serrure ?"
"Non.
"Vous refusez ?"
"Oui.
"Marco !
"Oui, monsieur le gouverneur.
"Placez le canon de votre revolver contre la tempe du monsieur."
"C'est là."
"Maintenant, mettez votre doigt sur la gâchette."
"Prêt".
"Eh bien, Kesselbach, mon vieux, avez-vous l'intention de parler ?"
"Non.
"Je te donne dix secondes, pas une de plus. Marco !"
"Oui, monsieur le gouverneur.
"Dans dix secondes, faites-lui sauter la cervelle."
"Vous avez raison, monsieur le gouverneur".
"Kesselbach, je compte. Un, deux, trois, quatre, cinq, six..."
Rudolph Kesselbach a fait un signe.
"Vous voulez parler ?"
"Oui.
"Vous arrivez juste à temps. Eh bien, le cryptogramme... le mot pour la serrure ?"
"Dolor".
"Dolor .... Dolor... Mme Kesselbach s'appelle Dolorès, je crois ? Mon cher garçon ! . . . Marco, va faire ce que je t'ai dit. . . . Pas d'erreur, voyons ! Je te le répète : retrouve Jérôme au bureau des omnibus, donne-lui la clé, dis-lui le mot : Dolor. Puis, tous les deux, allez au Crédit Lyonnais. Jérôme entrera seul, signera le registre, descendra au sous-sol et emportera tout ce qu'il y a dans le coffre. Vous avez bien compris ?"
"Oui, monsieur le gouverneur. Mais si le coffre ne s'ouvre pas, si le mot Dolor..."
"Silence, Marco. Quand tu sortiras du Crédit Lyonnais, tu devras quitter Jérôme, aller chez toi et me téléphoner le résultat de l'opération. Si par hasard le mot Dolor n'ouvrait pas le coffre, nous (mon ami Rudolf Kesselbach et moi) aurons une... dernière... entrevue. Kesselbach, vous êtes sûr de ne pas vous tromper ?"
"Oui.
"Cela signifie que vous comptez sur la futilité des recherches. Nous verrons bien. Va-t'en, Marco !"
"Et vous, gouverneur ?"
"Je resterai. Oh, je n'ai pas peur ! Je n'ai jamais été autant en danger qu'en ce moment. Vos ordres concernant la porte étaient positifs, Kesselbach, n'est-ce pas ?"
"Oui.
"Le plus important, c'est que tu avais l'air très pressé de le dire ! Pouvez-vous essayer de gagner du temps ? Si c'est le cas, je devrais être pris au piège comme un imbécile. . . ." Il s'arrête pour réfléchir, regarde son prisonnier et conclut : "Non... ce n'est pas possible... nous ne serons pas dérangés..."
Il n'avait pas fini de parler que la sonnette retentit. Il pressa violemment sa main sur la bouche de Rudolf Kesselbach :
"Oh, vieux renard, tu attendais quelqu'un !"
Les yeux du captif brillent d'espoir. On peut l'entendre glousser sous la main qui l'étouffe.
L'étranger tremble de rage :
"Tiens ta langue, ou je t'étrangle ! Tiens, Marco, bâillonne-le ! Vite ! . . . C'est ça !"
La cloche retentit à nouveau. Il cria, comme s'il était lui-même Kesselbach et comme si Edwards était encore là :
"Pourquoi n'ouvrez-vous pas la porte, Edwards ?"
Puis il est entré doucement dans le hall d'entrée et, désignant le secrétaire et le valet, il a chuchoté :
"Marco, aide-moi à déplacer ces deux-là dans la chambre... là-bas... ... pour qu'ils ne soient pas vus."
Il a soulevé le secrétaire. Marco porte le domestique.
"C'est bien ! Maintenant, retourne dans le salon."
Il le suivit à l'intérieur et retourna immédiatement dans le hall d'entrée en disant, d'un ton fort et étonné :
"Votre homme n'est pas là, M. Kesselbach. . . . Non, ne bougez pas... Finissez votre lettre. . . . Je vais y aller moi-même."
Et il ouvrit discrètement la porte du hall.
"M. Kesselbach ?"
Il se retrouve face à une sorte de géant jovial, aux yeux brillants, qui se balance d'un pied sur l'autre et fait tourner le bord de son chapeau entre ses doigts. Il répondit :
"Oui, c'est vrai. Qui dirai-je. . . ?"
"M. Kesselbach a téléphoné. . . . Il m'attend... . ."
"Oh, c'est toi. . . . Je lui dirai. . . . . Pouvez-vous attendre une minute ? ... M. Kesselbach va vous parler."
Il eut l'audace de laisser le visiteur debout sur le seuil du petit hall d'entrée, à un endroit d'où il pouvait voir une partie du salon par la porte ouverte, et, lentement, sans même se retourner, il entra dans la pièce, s'approcha de son confrère à côté de M. Kesselbach et chuchota :
"C'est fini ! C'est Gourel, le détective. . . ."
L'autre tire son couteau. Il l'attrape par le bras :
"Pas de bêtises ! J'ai une idée. Mais, pour l'amour de Dieu, Marco, comprends-moi et parle à ton tour. Parle comme si tu étais Kesselbach. . . . Tu entends, Marco ! Tu es Kesselbach."
Il s'exprima avec un tel sang-froid, une telle force et une telle autorité que Marco comprit, sans autre explication, qu'il allait lui-même jouer le rôle de Kesselbach. Marco dit, pour être entendu :
"Vous devez vous excuser pour moi, mon cher ami. Dites à M. Gourel que je suis terriblement désolé, mais que je suis débordé de travail. . . . Je le verrai demain matin, à neuf... oui, à neuf heures précises."
"Bien !" murmura l'autre. "Ne bougez pas."
Il retourne dans le hall d'entrée, trouve Gourel qui l'attend et lui dit :
"M. Kesselbach vous prie de l'excuser. Il termine un travail important. Pourriez-vous revenir demain matin à neuf heures ?"
Il y a eu une pause. Gourel semblait surpris, plus ou moins gêné et indécis. La main de l'autre homme serra le manche d'un couteau au fond de sa poche. Au premier mouvement suspect, il était prêt à frapper.
Enfin, Gourel a dit :
"Très bien. . . . Demain, à neuf heures. . . . Mais, tout de même... Mais je serai là demain à neuf heures. . . ."
Et, mettant son chapeau, il disparut dans le passage de l'hôtel.
Marco, dans le salon, éclate de rire :
"C'était très intelligent de votre part, gouverneur ! Oh, comme vous l'avez bien ridiculisé !"
"Regarde bien, Marco, et suis-le. S'il quitte l'hôtel, laisse-le, retrouve Jérôme au bureau des omnibus comme convenu... et téléphone."
Marco est parti rapidement.
L'homme prit alors une bouteille d'eau sur la cheminée, s'en versa un gobelet qu'il avala d'un trait, mouilla son mouchoir, tamponna son front couvert de sueur, puis s'assit à côté de son prisonnier et, avec une affectation de politesse, lui dit :
"Mais je dois vraiment avoir l'honneur, M. Kesselbach, de me présenter à vous."
Et, tirant une carte de sa poche, il dit : "Permettez-moi... . . Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur."
* * * * *
Le nom du célèbre aventurier parut faire sur M. Kesselbach la meilleure des impressions. Lupin ne manqua pas de s'en apercevoir et s'exclama :
"Aha, mon cher monsieur, vous respirez à nouveau ! Arsène Lupin est un cambrioleur délicat et dégoûté. Il a horreur du sang versé, il n'a jamais commis de crime plus grave que celui de s'approprier le bien d'autrui... une simple peccadille, hein ? Et ce que vous vous dites, c'est qu'il ne va pas charger sa conscience d'un meurtre inutile. C'est vrai. . . . Mais votre destruction sera-t-elle si inutile que cela ? Tout dépend de la réponse. Et je vous assure que je ne plaisante pas en ce moment. Allez, mon vieux !"
Il s'installa à côté du fauteuil, enleva le bâillon du prisonnier et, s'exprimant très clairement :
"Monsieur Kesselbach, dit-il, le jour où vous êtes arrivé à Paris, vous êtes entré en relation avec un certain Barbareux, directeur d'une agence de renseignements confidentiels ; et comme vous agissiez à l'insu de votre secrétaire, Chapman, il a été convenu que ledit Barbareux, lorsqu'il communiquerait avec vous par lettre ou par téléphone, s'appellerait lui-même "le colonel". Je m'empresse de vous dire que Barbareux est un homme parfaitement honnête. Mais j'ai la chance de compter un de ses commis parmi mes amis particuliers. C'est ainsi que j'ai découvert le motif de votre demande à Barbareux et que j'en suis venu à m'intéresser à vous et à faire une ou deux recherches ici, avec l'aide d'un trousseau de fausses clés ... au cours de cette ou ces recherches, autant vous le dire, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais".
Il baisse la voix et, les yeux fixés sur ceux de son prisonnier, observant son expression, fouillant ses pensées secrètes, il prononce ces mots :
"Monsieur Kesselbach, vos instructions à Barbareux étaient qu'il devait trouver un homme caché quelque part dans les bas-fonds de Paris qui porte ou a porté le nom de Pierre Leduc. L'homme répond à cette brève description : taille, 1,80 m ; cheveux et teint clairs ; moustache. Signe particulier : l'extrémité du petit doigt de la main gauche est manquante, suite à une coupure. Il a également une cicatrice presque imperceptible sur la joue droite. Vous semblez attacher une grande importance à la découverte de cet homme, comme s'il pouvait en résulter un grand avantage pour vous. Qui est cet homme ?"
"Je ne sais pas."
La réponse est positive, absolue. Savait-il ou ne savait-il pas ? Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il est déterminé à ne pas parler.
"Très bien, dit son adversaire, mais vous avez sur lui des renseignements plus complets que ceux que vous avez fournis à Barbareux.
"Je ne l'ai pas fait".
"Vous mentez, Monsieur Kesselbach. Par deux fois, en présence de Barbareux, vous avez consulté les papiers contenus dans le coffret en maroquin."
"Je l'ai fait".
"Et l'affaire ?"
"Brûlé".
Lupin frémit de rage. La pensée de la torture et des facilités qu'elle offrait autrefois lui revenait manifestement à l'esprit.
"Brûlé ? Mais la boîte ? . . Allez, avouez... avouez que la boîte est au Crédit Lyonnais."
"Oui.
"Et qu'est-ce qu'il y a dedans ?"
"Les 200 plus beaux diamants de ma collection privée."
Cette déclaration ne semble pas déplaire à l'aventurier.
"Aha, les deux cents plus beaux diamants ! Mais, dis-je, c'est une fortune ! . . . Oui, cela fait sourire. . . . C'est une bagatelle pour vous, sans doute. . . . Et votre secret vaut plus que ça. . . . Pour toi, oui... mais pour moi ?..."
Il prit un cigare, alluma une allumette qu'il laissa s'éteindre machinalement, et resta quelque temps à réfléchir, immobile.
Le procès-verbal est adopté.
Il se met à rire :
"J'ose dire que vous espérez que l'expédition n'aboutira à rien et qu'ils n'ouvriront pas le coffre-fort ? . . . C'est très probable, mon vieux ! Mais, dans ce cas, il faudra me payer pour ma peine. Je ne suis pas venu ici pour voir quelle figure vous faites dans un fauteuil... . . Les diamants, puisqu'il y en a... ou bien l'étui en maroquin. . . . Voilà le dilemme." Il regarde sa montre. "Une demi-heure. . . Pendez tout ! . . . Le destin avance très lentement. . . . Mais il n'y a pas de quoi faire la grimace, M. Kesselbach. Je ne rentrerai pas les mains vides, ne vous y trompez pas ! . . . Enfin !"
C'était la sonnette du téléphone. Lupin saisit le combiné et, changeant le son de sa voix, imita l'accent rude de son prisonnier :
"Oui, Rudolf Kesselbach... vous lui parlez... . . Oui, s'il vous plaît, mademoiselle, passez-moi. . . . C'est toi, Marco ? ... C'est bien. . . . Ça s'est bien passé ? . . . Excellent ! . . . Pas de problème ? ... Mes meilleurs compliments ! . . . Alors, qu'avez-vous ramassé ? . . . Le coffret en ébène ? . . . Rien d'autre ? . . . Pas de papiers ? . . . Tut, tut ! . . . Et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? . . Ce sont des diamants fins ? ... Capital, capital ! . . . Une minute, Marco, pendant que je réfléchis. . . . Tu vois, tout ça. . . . Si je te disais mon opinion. . . . Attendez, ne partez pas... tenez bon. . . ."
Il se retourne.
"M. Kesselbach, vous tenez à vos diamants ?"
"Oui.
"Vous me les rachèteriez ?"
"Peut-être".
"Pour combien ? Cinq cent mille francs ?"
"Cinq cent mille... oui."
"Seulement, voilà : comment faire l'échange ? Un chèque ? Non, vous m'escroqueriez... ou bien je vous escroquerais. . . . Ecoutez. Après-demain, allez au Crédit Lyonnais le matin, tirez vos cinq cents billets de mille chacun et allez vous promener dans le Bois, du côté d'Auteuil... . . J'aurai les diamants dans un sac : c'est plus pratique. . . . La boîte en montre trop. . . ."
Kesselbach sursaute :
"Non, non... la boîte aussi. . . . Je veux tout... . ."
"Ah, s'écrie Lupin en riant aux éclats, tu es tombé dans le piège ! . . . Les diamants dont vous vous moquez... on peut les remplacer. . . . Mais vous vous accrochez à cette boîte comme à votre peau... . . Très bien, vous aurez votre boîte... sur la parole d'Arsène... ...tu l'auras demain matin, par colis postal !"
Il retourne au téléphone :
"Marco, as-tu la boîte devant toi ? . . . Y a-t-il quelque chose de particulier ? . . . Ebène incrusté d'ivoire... . . Oui, je sais ce que c'est. . . . . Japonais, du Faubourg Saint-Antoine. . . . Pas de marque ? ... Ah, une petite étiquette ronde, avec un bord bleu et un numéro ! . . . Oui, une marque de magasin... pas d'importance. Et le fond de la boîte est-il épais ? ... Pas très épais. . . Mais non ! Pas de faux fond, donc ? ... Regarde, Marco : examine la marqueterie d'ivoire à l'extérieur... ou plutôt, non, le couvercle". Il se réjouit. "Le couvercle ! C'est ça, Marco ! Kesselbach vient de cligner des yeux. . . . On brûle ! . . . Ah, Kesselbach, mon vieux, tu ne m'as pas vu loucher sur toi ? Espèce d'imbécile !" Et à Marco : "Eh bien, qu'est-ce que tu vois ? . . Une lunette à l'intérieur du couvercle ? . . Est-ce qu'il glisse ? . . Est-il sur charnières ? . . . Non ! . . . Alors, casse-la. . . . Oui, oui, je te dis de le casser... . . Ce verre ne sert à rien. ... il a été rajouté depuis !" Il perd patience. "Occupe-toi de tes affaires, idiot ! . . Fais ce que je te dis ! . . ."
Il a dû entendre le bruit que Marco a fait à l'autre bout du fil en brisant la vitre, car il a crié, triomphant.
"Ne vous avais-je pas dit, M. Kesselbach, que nous allions trouver quelque chose ? ... Bonjour ! L'avez-vous fait ? . . . Alors ? ... Une lettre ? La victoire ! Tous les diamants du Cap et le secret du vieux Kesselbach en prime !"
Il décroche le second récepteur, place soigneusement les deux disques sur ses oreilles et continue :
"Lisez-moi, Marco, lisez-moi lentement... . . L'enveloppe d'abord. . . . La bonne. . . . Maintenant, répétez." Il répète lui-même : "Copie de la lettre contenue dans l'étui en maroquin noir. Et ensuite ? Déchire l'enveloppe, Marco. . . . Ai-je votre permission, M. Kesselbach ? Ce n'est pas très correct, mais... Vas-y, Marco, M. Kesselbach te donne la permission... . . C'est fait ? . . . Alors, lis-le."
Il a écouté et, avec un petit rire :
"Le diable ! Ce n'est pas aussi clair qu'un bâton de pique ! Écoutez. Je répète : une simple feuille de papier pliée en quatre, les plis étant apparemment très frais. . . . Bon... . . . En haut de la page, à droite, ces mots : "Un mètre quatre-vingt-dix, l'auriculaire gauche coupé". Et ainsi de suite. . . . Oui, c'est la description de Maître Pierre Leduc. C'est l'écriture de Kesselbach, je suppose ? . . . C'est bien. . . . Et, au milieu de la page, ce mot en majuscules d'imprimerie : "APOON" Marco, mon garçon, laisse le papier tel quel et ne touche ni à la boîte ni aux diamants. J'en aurai fini avec notre ami ici présent dans dix minutes et je serai avec vous dans vingt. . . . . Oh, à propos, avez-vous renvoyé le moteur pour moi ? Capitale ! Au revoir !"
Il replace l'instrument, passe dans le hall et dans la chambre, s'assure que la secrétaire et le valet n'ont pas desserré leurs liens et, d'autre part, qu'ils ne risquent pas d'être étouffés par leurs bâillons. Puis il revint vers son prisonnier principal.
Il arborait un regard déterminé et implacable :
"Nous avons fini de plaisanter, Kesselbach. Si vous ne parlez pas, ce sera pire pour vous. Avez-vous pris votre décision ?"
"De quoi s'agit-il ?"
"Pas de bêtises, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous savez."
"Je ne sais rien."
"Vous mentez. Que signifie ce mot 'APOON' ?"
"Si je l'avais su, je ne l'aurais pas écrit.
"Très bien ; mais de qui ou de quoi s'agit-il ? Où l'avez-vous copié ? Où l'avez-vous trouvée ?"
M. Kesselbach ne répondit pas. Lupin, qui parlait maintenant d'une voix nerveuse et saccadée, reprit :
"Ecoutez, Kesselbach, j'ai une proposition à vous faire. Homme riche, grand homme que vous êtes, il n'y a pas tant de différence entre nous. Le fils du ferronnier d'Augsbourg et Arsène Lupin, prince des cambrioleurs, peuvent s'entendre sans honte de part et d'autre. Je fais mes vols à l'intérieur, vous faites les vôtres à la Bourse. Ce n'est pas grand-chose. Alors voilà, Kesselbach. Soyons partenaires dans cette affaire. J'ai besoin de vous, car je ne sais pas de quoi il s'agit. Tu as besoin de moi, parce que tu ne pourras jamais y arriver seul. Barbareux est un con. Je suis Lupin. C'est un marché ?"
Pas de réponse. Lupin persiste, d'une voix tremblante d'intensité :
"Réponse, Kesselbach, c'est une affaire ? Si oui, je vous trouve votre Pierre Leduc dans quarante-huit heures. Car c'est lui que vous cherchez, hein ? N'est-ce pas là l'affaire ? Allez, répondez ! Qui est cet homme ? Pourquoi le cherchez-vous ? Que savez-vous de lui ?"
Il se calma soudain, posa la main sur l'épaule de Kesselbach et, d'un ton dur, lui dit : "Je n'ai pas le droit de me plaindre, je ne peux pas me plaindre :
"Un seul mot. Oui ou non ?"
"Non !
Il tira du pommeau de Kesselbach une magnifique montre en or et la posa sur les genoux du prisonnier. Il déboutonna le gilet de Kesselbach, ouvrit sa chemise, découvrit sa poitrine et, prenant un poignard d'acier, au manche incrusté d'or, qui se trouvait sur la table à côté de lui, il en appliqua la pointe à l'endroit où les pulsations du cœur faisaient palpiter la chair nue :
"Pour la dernière fois ?"
"Non !
"M. Kesselbach, il est trois heures moins huit. Si vous ne répondez pas dans les huit minutes, vous êtes un homme mort !"
* * * * *
Le lendemain matin, le sergent Gourel entre au Palace Hotel à l'heure prévue. Sans s'arrêter, dédaignant de prendre l'ascenseur, il monte les escaliers. Au quatrième étage, il tourna à droite, suivit le passage et sonna à la porte du 415.
N'entendant rien, il sonne à nouveau. Après une demi-douzaine de tentatives infructueuses, il se rend au bureau de l'étage. Il y trouve un maître d'hôtel :
"M. Kesselbach n'a pas dormi ici la nuit dernière. Nous ne l'avons pas vu depuis hier après-midi".
"Mais son serviteur ? Son secrétaire ?"
"Nous ne les avons pas vus non plus".
"Ils n'ont donc pas non plus dormi à l'hôtel ?"
"Je suppose que non".
"Vous pensez que non ? Mais vous devriez en être certain."
"Pourquoi ? M. Kesselbach ne séjourne pas à l'hôtel, il est chez lui, dans son appartement privé. Il n'est pas attendu par nous, mais par son propre homme, et nous ne savons rien de ce qui se passe à l'intérieur."
"C'est vrai. . . C'est vrai. . . . ."
Gourel semble très perplexe. Il était venu avec des ordres positifs, une mission précise, dans les limites desquelles son esprit pouvait s'exercer. En dehors de ces limites, il ne savait pas trop comment agir :
"Si le chef était là", murmure-t-il, "si le chef était là". . . ."
Il a montré sa carte et indiqué sa qualité. Puis il a dit, à tout hasard :
"Vous ne les avez donc pas vus entrer ?"
"Non.
"Mais vous les avez vus sortir ?"
"Non, je ne peux pas dire que je l'ai fait".
"Dans ce cas, comment savez-vous qu'ils sont sortis ?"
"D'un monsieur qui a appelé hier après-midi."
"Un gentleman avec une moustache foncée ?"
"Oui. Je l'ai rencontré alors qu'il s'en allait, vers trois heures. Il m'a dit : 'Les gens du 415 sont sortis. M. Kesselbach va rester à Versailles cette nuit, aux Réservoirs, vous pourrez lui envoyer ses lettres là-bas".
"Mais qui était ce monsieur ? De quel droit parlait-il ?"
"Je ne sais pas."
Gourel se sent mal à l'aise. Tout cela lui paraissait un peu bizarre.
"Vous avez la clé ?"
"Non. M. Kesselbach a fait fabriquer des clés spéciales."
"Allons voir".
Gourel sonne à nouveau furieusement. Rien n'y fait. Il s'apprête à partir quand, soudain, il se penche et colle son oreille au trou de la serrure :
"Écoutez. . . . Il me semble entendre... Oui... c'est très net. . . . J'entends des gémissements. . . ."
Il donne un grand coup de poing sur la porte.
"Mais, monsieur, vous n'avez pas le droit..."
"Oh, accrochez-vous à droite !"
Il frappa la porte avec une force redoublée, mais avec si peu d'effet qu'il abandonna immédiatement sa tentative :
"Vite, vite, un serrurier !"
L'un des serveurs partit au pas de course. Gourel, fanfaron et indécis, va et vient. Les domestiques des autres étages se regroupent. Des gens du bureau, du service du directeur arrivèrent. Gourel pleure :
"Mais pourquoi ne pas passer par les chambres adjacentes ? Est-ce qu'elles communiquent avec cette suite ?"
"Oui, mais les portes de communication sont toujours verrouillées des deux côtés.
"Alors je vais téléphoner au bureau des détectives", dit Gourel, pour qui il n'y avait manifestement pas de salut sans son chef.
"Et au commissaire de police", observe quelqu'un.
"Oui, si vous voulez", répondit-il, sur le ton d'un gentleman qui ne s'intéresse pas ou peu à cette formalité.
Lorsqu'il revint du téléphone, le serrurier avait presque fini d'essayer les clés. La dernière fit sauter la serrure. Gourel entra d'un pas vif.
Il se précipita aussitôt dans la direction d'où provenaient les gémissements et se heurta aux corps de Chapman, le secrétaire, et d'Edwards, le valet. L'un d'eux, Chapman, avait réussi, à force de patience, à desserrer un peu son bâillon et poussait de brefs gémissements étouffés. L'autre semblait dormir.
Ils sont libérés. Mais Gourel est inquiet :
"Où est M. Kesselbach ?"
Il entre dans le salon. M. Kesselbach était assis, attaché au dossier du fauteuil, près de la table. Sa tête pendait sur sa poitrine.
"Il s'est évanoui", dit Gourel en s'approchant de lui. "Il a dû faire un effort au-dessus de ses forces.
Rapidement, il coupe les cordes qui attachent les épaules. Le corps tomba en avant en une masse inerte. Gourel le saisit dans ses bras et recula en poussant un cri d'horreur :
"Pourquoi, il est mort ! Sens... ... ses mains sont glacées ! Et regardez ses yeux !"
Quelqu'un s'est risqué à émettre cette opinion :
"Une attaque apoplectique, sans doute... ou un arrêt cardiaque."
"C'est vrai, il n'y a pas de trace de blessure... c'est une mort naturelle."
Ils déposent le corps sur le canapé et détachent les vêtements.
Mais des taches rouges apparurent aussitôt sur la chemise blanche ; et, lorsqu'ils la repoussèrent, ils virent que, près du cœur, la poitrine portait une petite éraflure par laquelle avait coulé un mince filet de sang.
Sur la chemise est épinglée une carte. Gourel se penche en avant.
C'est la carte d'Arsène Lupin, tachée de sang comme les autres.
Puis Gourel se redressa, autoritaire et tranchant :
"Assassiné ! . . . Arsène Lupin ! . . . Quittez l'appartement. . . . Quittez l'appartement, tous ! . . . Personne ne doit rester ici ou dans la chambre. . . . Qu'on emmène les deux hommes et qu'on aille les chercher ailleurs ! . . . Quittez l'appartement... et ne touchez à rien...
"Le chef est en route ! . . ."
Chapitre 2. Le label à bords bleus
"Arsène Lupin !
Gourel répéta ces deux mots fatidiques d'un air absolument pétrifié. Ils résonnaient en lui comme un glas. Arsène Lupin ! Le grand, le formidable Arsène Lupin. Le roi des cambrioleurs, le grand aventurier ! Était-ce possible ?
"Non, non, murmura-t-il, ce n'est pas possible, car il est mort !
Mais ce n'était que ça... était-il vraiment mort ?
Arsène Lupin !
Debout à côté du cadavre, il reste morne et stupéfait, tournant et retournant la carte avec un certain effroi, comme si un fantôme l'avait interpellé. Arsène Lupin ! Que doit-il faire ? Agir ? Prendre le terrain avec ses moyens ? Non, non... Mieux vaut ne pas agir... . Il ne pouvait que se tromper en entrant dans les listes avec un adversaire de cette trempe. D'ailleurs, le chef arrivait !
Le chef est en route ! Toute la philosophie intellectuelle de Gourel est résumée dans cette courte phrase. Officier capable, persévérant, plein de courage et d'expérience, doté d'une force herculéenne, il était de ceux qui n'avancent qu'en obéissant aux ordres et qui ne font du bon travail que lorsqu'on le leur ordonne. Et ce manque d'initiative s'était encore accentué depuis que M. Lenormand avait pris la place de M. Dudouis dans le service des détectives. M. Lenormand, c'est un chef ! Avec lui, on était sûr d'être sur la bonne voie. Si sûr, même, que Gourel s'arrête dès que l'incitation du chef n'est plus derrière lui.
Mais le chef est en route ! Gourel sortit sa montre et calcula l'heure exacte de son arrivée. Si seulement le commissaire de police n'arrivait pas le premier, si seulement le juge d'instruction, sans doute déjà nommé, ou le chirurgien divisionnaire, ne venaient pas faire des découvertes inopportunes avant que le chef n'ait eu le temps de fixer dans son esprit les points essentiels de l'affaire !
"Eh bien, Gourel, à quoi rêves-tu ?"
"Le chef !
M. Lenormand était encore un jeune homme, si l'on s'en tenait à l'expression de son visage et à ses yeux qui brillaient à travers ses lunettes ; mais c'était presque un vieillard quand on voyait son dos courbé, sa peau sèche et jaune comme de la cire, ses cheveux et sa barbe crépus, toute son apparence décrépite, hésitante, malsaine. Il avait passé sa vie laborieusement dans les colonies comme commissaire du gouvernement, dans les postes les plus dangereux. Il y avait acquis une série de fièvres, une énergie indomptable, malgré sa fatigue physique, l'habitude de vivre seul, de parler peu et d'agir en silence, une certaine misanthropie et, soudain, à l'âge de cinquante-cinq ans, à la suite de la fameuse affaire des trois Espagnols de Biskra, une grande notoriété bien méritée.
L'injustice fut alors réparée, et il fut aussitôt transféré à Bordeaux, puis nommé adjoint à Paris, et enfin, à la mort de M. Dudouis, chef du service des détectives. Dans chacun de ces postes, il fit preuve d'une si curieuse faculté d'invention dans ses démarches, d'une telle ingéniosité, de tant de qualités nouvelles et originales ; et surtout, il obtint des résultats si corrects dans la conduite des quatre ou cinq dernières affaires qui avaient ému l'opinion publique, que son nom fut cité en même temps que ceux des détectives les plus célèbres.
Gourel, lui, n'hésite pas. Lui-même favori du chef, qui l'aimait pour sa franchise et son obéissance passive, il plaçait le chef au-dessus de tous. Le chef est pour lui une idole, un dieu infaillible.
M. Lenormand semblait plus fatigué que d'habitude ce jour-là. Il s'assit d'un air las, écarta les pans de sa redingote - une vieille redingote, célèbre par sa coupe vieillotte et sa teinte vert olive - dénoua son foulard - un foulard tout aussi célèbre, de couleur bordeaux -, appuya ses deux mains sur son bâton, et dit :
"Parlez !
Gourel raconta tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait appris, et le raconta brièvement, selon l'habitude que lui avait donnée le chef.
Mais, lorsqu'il produisit la carte de Lupin, M. Lenormand eut un sursaut :
"Lupin !
"Oui, Lupin. La brute est remontée."
"C'est très bien, c'est très bien, dit M. Lenormand, après un moment de réflexion.
"C'est très bien, bien sûr, dit Gourel, qui aimait ajouter un mot de son cru aux rares discours d'un supérieur dont le seul défaut à ses yeux était une réticence exagérée. "C'est bien, car enfin tu vas mesurer ta force à un adversaire digne de toi. . . . Et Lupin rencontrera son maître. . . . Lupin cessera d'exister. . . . Lupin..."
"Furet ! dit M. Lenormand, le coupant court.
C'était comme un ordre donné par un sportif à son chien. Et Gourel furetait à la manière d'un bon chien, d'un animal vif et intelligent, travaillant sous les yeux de son maître. M. Lenormand pointait son bâton vers un coin, vers un fauteuil, comme on pointe un buisson ou une touffe d'herbe, et Gourel battait le buisson ou la touffe d'herbe avec une consciencieuse minutie.
"Rien", dit le sergent lorsqu'il eut terminé.
"Rien pour vous", grogne M. Lenormand.
"C'est ce que je voulais dire. . . . Je sais que pour vous, chef, il y a des choses qui parlent comme des êtres humains, de vrais témoins vivants. Pour autant, voilà un meurtre bien ajouté à notre score contre Maître Lupin."
"Le premier, observe M. Lenormand.
"Le premier, oui... . . Mais cela devait arriver. On ne peut pas mener ce genre de vie sans être, tôt ou tard, poussé par les circonstances à commettre des crimes graves. M. Kesselbach a dû se défendre. . . ."
"Non, parce qu'il était ligoté".
"C'est vrai, répondit Gourel, un peu déconcerté, et c'est assez curieux aussi. . . . Pourquoi tuer un adversaire qui n'existe pratiquement plus ? ... Mais, peu importe, si je l'avais arrêté hier, quand nous étions face à face à la porte du hall..."
M. Lenormand était sorti sur le balcon. Puis il se rendit dans la chambre de M. Kesselbach, à droite, et essaya les fermetures des fenêtres et des portes.
"Les fenêtres des deux pièces étaient fermées lorsque je suis entré", dit Gourel.
"Enfermé, ou juste poussé à le faire ?"
"Personne n'y a touché depuis. Et ils sont fermés, chef."
Un bruit de voix les ramène dans le salon. Ils y trouvent le chirurgien divisionnaire, occupé à examiner le corps, et M. Formerie, le magistrat. M. Formerie s'exclame :
"Arsène Lupin ! Je suis heureux qu'un heureux hasard m'ait enfin permis de renouer avec cette canaille ! Je vais lui montrer ce que je sais faire ! . . . Et cette fois, c'est un meurtre ! . . . C'est un combat entre vous et moi maintenant, Maître Lupin !"
M. Formerie n'avait pas oublié l'étrange aventure du diadème de la princesse de Lamballe, ni la merveilleuse façon dont Lupin l'avait piégé quelques années auparavant. L'affaire était restée célèbre dans les annales des tribunaux. On en riait encore, et elle avait laissé chez M. Formerie un juste sentiment de rancune, mêlé au désir d'une vengeance éclatante.
"La nature du crime est évidente", a-t-il déclaré avec un grand air de conviction, "et nous n'aurons aucune difficulté à en découvrir le mobile. Tout va donc bien. . . . M. Lenormand, comment allez-vous ? . . . Je suis ravi de vous voir. . . ."
M. Formerie n'était pas le moins du monde ravi. Au contraire, la présence de M. Lenormand ne lui plaisait guère, le détective en chef ne prenant guère la peine de dissimuler le mépris dans lequel il le tenait. Cependant, le magistrat se redressa et, de son ton le plus solennel :
"Alors, docteur, vous considérez que la mort a eu lieu il y a une douzaine d'heures, peut-être plus ! . . . C'est d'ailleurs ce que j'avais imaginé. . . . Nous sommes tout à fait d'accord. . . . Et l'instrument du crime ?"
"Un couteau à lame très fine, Monsieur le Juge d'Instruction", répond le chirurgien. "Regardez, la lame a été essuyée sur le propre mouchoir du mort. . . ."
"Juste pour que... juste pour que... vous puissiez voir la marque. . . . Et maintenant, allons interroger la secrétaire et le domestique de M. Kesselbach. Je ne doute pas que leur interrogatoire nous éclairera davantage sur l'affaire."
Chapman, qui, avec Edwards, avait été installé dans sa propre chambre, à gauche du salon, s'était déjà remis de ses expériences. Il décrivit en détail les événements de la veille, l'agitation de M. Kesselbach, la visite attendue du colonel et, enfin, l'attaque dont ils avaient été victimes.
"Aha ! s'écrie M. Formerie. "Il y a donc un complice ! Et vous avez entendu son nom ! . . . Marco, vous dites ? ... C'est très important. Quand nous aurons le complice, nous serons bien plus avancés. . . ."
"Oui, mais nous ne l'avons pas ", se permet de dire M. Lenormand.
"Nous verrons. . . . Une chose à la fois. . . . Et alors, M. Chapman, ce Marco est parti immédiatement après que M. Gourel ait sonné la cloche ?"
"Oui, nous l'avons entendu partir."
"Et après qu'il soit parti, n'avez-vous rien entendu d'autre ?"
"Oui... de temps en temps, mais vaguel. . . . La porte était fermée."
"Et quels types de bruits avez-vous entendus ?"
"Des éclats de voix. L'homme..."
"Appelez-le par son nom, Arsène Lupin."
"Arsène Lupin a dû téléphoner."
"Capital ! Nous allons examiner la personne de l'hôtel qui s'occupe du central téléphonique communiquant avec l'extérieur. Et, par la suite, l'avez-vous entendu sortir, lui aussi ?"
"Il est entré pour voir si nous étions toujours liés et, un quart d'heure plus tard, il est parti en fermant la porte du hall après lui.
"Oui, dès que son crime a été commis. Bien. . . . Bien. . . . Tout s'emboîte... . . Et après ça ?"
"Après cela, nous n'avons plus rien entendu. . . . La nuit passa. . . . Je me suis endormi de fatigue. . . . Edwards aussi. . . . Et ce n'est que ce matin..."
"Oui, je sais. . . . Là, ça ne va pas mal... tout s'emboîte... . ."
Et, marquant les étapes de son enquête, d'un ton qui semblait énumérer autant de victoires sur l'étranger, il murmura pensivement :
"Le complice... le téléphone... l'heure du meurtre... les bruits entendus. . . . Bien. . . . Très bons... . . Il nous reste à établir le mobile du crime. . . . Dans ce cas, comme nous avons affaire à Lupin, le mobile est évident. M. Lenormand, avez-vous remarqué le moindre signe d'effraction ?"
"Non.
"Alors le vol a dû être commis sur la personne même de la victime. A-t-on trouvé son portefeuille ?"
"Je l'ai laissé dans la poche de sa veste", a déclaré M. Gourel.
Ils passent tous dans le salon, où M. Formerie découvre que le carnet de poche ne contient que des cartes de visite et des papiers établissant l'identité de l'homme assassiné.
"C'est curieux. M. Chapman, pouvez-vous nous dire si M. Kesselbach avait de l'argent sur lui ?"
"Oui. La veille, c'est-à-dire lundi, avant-hier, nous sommes allés au Crédit Lyonnais, où M. Kesselbach a loué un coffre-fort...".
"Un coffre-fort au Crédit Lyonnais ? C'est bien. . . . Il faut voir ça."
"Et, avant notre départ, M. Kesselbach a ouvert un compte et en a tiré cinq ou six mille francs en billets de banque".
"Excellent . ... qui nous dit exactement ce que nous voulons savoir".
Chapman a poursuivi :
"Il y a un autre point, Monsieur le Juge d'Instruction. M. Kesselbach, qui depuis quelques jours était très inquiet dans son esprit - je vous en ai dit la raison : un projet auquel il attachait la plus grande importance - M. Kesselbach semblait particulièrement préoccupé par deux choses. Il y avait, d'abord, un petit coffret d'ébène, qu'il mettait en sûreté au Crédit Lyonnais, et, ensuite, un petit porte-notes en maroquin noir, dans lequel il conservait quelques papiers."
"Et où est-ce ?"
"Avant l'arrivée de Lupin, il l'a mis, en ma présence, dans ce sac de voyage."
M. Formerie a pris le sac et l'a fouillé. L'étui à billets n'y était pas. Il se frotta les mains :
"Ah, tout s'emboîte ! . . . Nous connaissons le coupable, les conditions et le mobile du crime. Cette affaire ne sera pas longue. Sommes-nous bien d'accord sur tout, M. Lenormand ?"
"Sur pas une seule chose".
Il y eut un moment de stupeur. Le commissaire de police était arrivé et, derrière lui, malgré les gendarmes qui gardaient la porte, une troupe de journalistes et le personnel de l'hôtel avaient forcé le passage et se tenaient dans le hall d'entrée.
Réputé pour son franc-parler, qui n'était pas dénué de courtoisie et qui lui avait déjà valu quelques réprimandes en haut lieu, la brusquerie de cette réponse décontenança tout le monde. Et M. Formerie en particulier paraissait tout à fait déconcerté :
"Pourtant, dit-il, je ne vois rien qui ne soit pas tout à fait simple. Lupin est le voleur. . . ."
"Pourquoi a-t-il commis le meurtre ? lui lance M. Lenormand.
"Pour commettre le vol".
"Je vous demande pardon ; le récit des témoins prouve que le vol a eu lieu avant le meurtre. M. Kesselbach a d'abord été ligoté et bâillonné, puis volé. Pourquoi Lupin, qui n'a jamais eu recours au meurtre, choisirait-il cette fois de tuer un homme qu'il a rendu impuissant et qu'il a déjà volé ?".
Le juge d'instruction caresse ses longues moustaches blondes, avec le geste qui lui est habituel lorsqu'une question lui paraît sans solution. Il répondit d'un ton pensif :
"Il y a plusieurs réponses à cette question. . . ."
"Qu'est-ce que c'est ?
"Cela dépend... cela dépend d'un certain nombre de faits encore inconnus. . . . Et, de plus, l'objection ne s'applique qu'à la nature des motifs. Nous sommes d'accord sur le reste".
"Non.
Cette fois encore, la dénégation fut plate, brutale, presque impolie ; si bien que le magistrat, absolument décontenancé, n'osa même pas élever une protestation, et resta abasourdi en présence de cet étrange collaborateur. Enfin, il dit :
"Nous avons tous nos théories. J'aimerais connaître les vôtres".
"Je n'en ai pas."
Le détective en chef se lève et, s'appuyant sur sa canne, fait quelques pas dans la pièce. Toutes les personnes qui l'entourent sont silencieuses. . . Et il était assez curieux, dans un groupe où, après tout, sa position n'était que celle d'un auxiliaire, d'un subordonné, de voir cet homme malade, décrépit, âgé, dominer les autres par la seule force d'une autorité qu'ils devaient sentir, même s'ils ne l'acceptaient pas. Après une longue pause, il dit :
"J'aimerais inspecter les chambres qui jouxtent cette suite."
Le directeur lui montra le plan de l'hôtel. La chambre de droite, qui était celle de M. Kesselbach, ne pouvait sortir que par le petit hall d'entrée de la suite. Mais la chambre de gauche, celle du secrétaire, communiquait avec un autre appartement.
"Inspectons-le, dit M. Lenormand.
M. Formerie ne peut s'empêcher de hausser les épaules et de grogner :
"Mais la porte de communication est verrouillée et la fenêtre fermée à clé."
"Inspectons-le, répète M. Lenormand.
Il a été introduit dans l'appartement, qui était la première des cinq pièces réservées à Mme Kesselbach. Puis, à sa demande, on le conduit dans les pièces qui en sortent. Toutes les portes de communication étaient verrouillées des deux côtés.
"Aucune de ces chambres n'est occupée ?" demande-t-il.
"Non.
"Où sont les clés ?
"Les clés sont toujours conservées dans le bureau.
"Personne n'a donc pu entrer ? . . ."
"Personne, sauf le garçon d'étage qui aère et époussette les chambres."
"Faites-le venir, s'il vous plaît."
L'homme, qui s'appelle Gustave Beudot, répond qu'il a fermé les fenêtres de cinq pièces la veille, conformément à ses instructions générales.
"A quelle heure ?
"A six heures du soir."
"Et vous n'avez rien remarqué ?"
"Non, monsieur".
"Et ce matin... ?"
"Ce matin, j'ai ouvert les fenêtres à huit heures précises.
"Et vous n'avez rien trouvé ?"
Il hésite. Pressé de questions, il finit par admettre :
"J'ai ramassé un étui à cigarettes près de la cheminée au 420. . . . J'avais l'intention de l'apporter au bureau ce soir."
"Vous l'avez sur vous ?"
"Non, elle est dans ma chambre. C'est un étui en métal armé. Il y a un espace pour le tabac et les papiers à cigarettes d'un côté et pour les allumettes de l'autre. Il y a deux initiales en or : un L et un M. . . ."
"Qu'est-ce que c'est ?"
Chapman s'était avancé. Il parut très surpris et, interrogeant le serviteur :
"Un étui à cigarettes en métal armé, vous dites ?"
"Oui.
"Avec trois compartiments pour le tabac, les papiers à cigarettes et les allumettes. . . . Du tabac russe, n'est-ce pas, très fin et léger ?"
"Oui.
"Va le chercher. . . . Je voudrais le voir de mes propres yeux... pour m'en assurer. . . ."
Sur un signe du détective en chef, Gustave Beudot quitte la pièce.
M. Lenormand s'assit et examina de ses yeux vifs le tapis, les meubles et les rideaux. Il demande :
"C'est la chambre 420, n'est-ce pas ?"
"Oui.
Le magistrat sourit :
"J'aimerais beaucoup savoir quel lien vous établissez entre cet incident et la tragédie. Cinq portes verrouillées nous séparent de la pièce dans laquelle M. Kesselbach a été assassiné."
M. Lenormand n'a pas condescendu à répondre.
Le temps passe. Gustave ne revient pas.
"Où dort-il ?", demande le détective en chef.
"Au sixième étage", répond le gérant. "La chambre est du côté de la rue de Judée : au-dessus, donc. C'est curieux qu'il ne soit pas encore rentré."
"Auriez-vous la gentillesse d'envoyer quelqu'un voir ?"
Le directeur s'y rendit lui-même, accompagné de Chapman. Quelques minutes plus tard, il revint seul, en courant, avec toutes les marques de consternation sur le visage.
"Alors ?"
"Mort !"
"Assassiné ?"
"Oui.
"Oh, par le tonnerre, que ces canailles sont intelligentes ! rugit M. Lenormand, partez avec vous, Gourel, et faites verrouiller les portes de l'hôtel... . . Surveillez toutes les sorties. . . . Et vous, monsieur le directeur, veuillez nous conduire à la chambre de Gustave Beudot."
Le directeur ouvrit la marche. Mais au moment où ils quittaient la pièce, M. Lenormand se baissa et ramassa un tout petit bout de papier rond, sur lequel ses yeux s'étaient déjà fixés.
Il s'agit d'une étiquette entourée d'un liseré bleu et portant le numéro 813. Il la met dans sa poche, au hasard, et rejoint les autres. . . .
* * * * *
Une petite blessure dans le dos, entre les omoplates. . . .
"Exactement la même blessure que celle de M. Kesselbach", déclare le médecin.
"Oui, dit M. Lenormand, c'est la même main qui a porté le coup et c'est la même arme qui a été utilisée.
À en juger par la position du corps, l'homme avait été surpris alors qu'il était à genoux devant le lit et qu'il cherchait sous le matelas l'étui à cigarettes qu'il y avait caché. Son bras était encore coincé entre le matelas et le lit, mais l'étui à cigarettes était introuvable.
"Cet étui à cigarettes a dû être diablement compromettant", suggère timidement M. Formerie, qui n'ose plus émettre d'avis tranché.
"Bien sûr, dit le détective en chef.
"En tout cas, nous connaissons les initiales : un L et un M. Et avec cela, ainsi que ce que M. Chapman semble savoir, nous allons facilement apprendre. . . ."
M. Lenormand sursaute :
"Chapman ! Mais où est-il ?"
Ils regardèrent dans le passage parmi les groupes de personnes entassées. Chapman n'y était pas.
"M. Chapman est venu avec moi", dit le directeur.
"Oui, oui, je sais, mais il n'est pas revenu avec vous."
"Non, je l'ai laissé avec le cadavre."
"Tu l'as quitté ! . . . Seul ?"
Je lui ai dit : "Reste ici. ne bouge pas".
"Et il n'y avait personne ? Vous n'avez vu personne ?"
"Dans le passage ? Non."
"Mais dans les autres greniers ? . . Ou alors, regardez ici, au coin de la rue : personne ne s'y cachait-il ?"
M. Lenormand semble très excité. Il marchait de long en large, il ouvrait les portes des chambres. Et, soudain, il partit au pas de course, avec une agilité dont personne ne l'aurait cru capable. Il descendit en trombe les six étages, suivi de loin par le directeur et le juge d'instruction. En bas, il trouva Gourel devant la porte principale.
"Personne n'est sorti ?
"Non, chef".
"Et l'autre porte, dans la rue Orvieto ?"
"J'y ai posté Dieuzy."
"Avec des ordres fermes ?"
"Oui, chef.