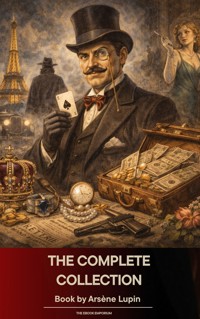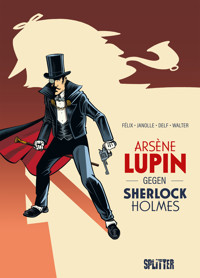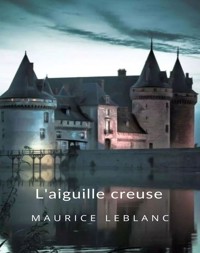
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ALEMAR S.A.S.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
L'Aiguille creuse est le troisième livre de la série Arsène Lupin de l'auteur français Maurice Leblanc. Outre Lupin, le livre met en scène Isidore Beautrelet, un jeune détective amateur très doué, qui pense avoir percé le secret du trésor caché par les rois de France au fil des siècles.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Table des matières
CHAPITRE 1. LA PRISE DE VUE
CHAPITRE 2. ISIDORE BEAUTRELET, COLLÉGIEN EN SIXIÈME
CHAPITRE 3. LE CORPS
CHAPITRE 4. FACE À FACE
CHAPITRE 5. SUR LA PISTE
CHAPITRE 6. UN SECRET HISTORIQUE
CHAPITRE 7. LE TRAITÉ DE L'AIGUILLE
CHAPITRE 8. DE CÉSAR À LUPIN
CHAPITRE 9. OUVERT, SÉSAME !
CHAPITRE 10. LES TRÉSORS DES ROIS DE FRANCE
L'aiguille creuse
Maurice Leblanc
CHAPITRE 1. LA PRISE DE VUE
Raymonde écouta. Le bruit se répétait deux fois, assez clairement pour être distingué du mélange de sons vagues qui formaient le grand silence de la nuit, et cependant trop faiblement pour lui permettre de dire s'il était proche ou lointain, entre les murs de la grande maison de campagne, ou à l'extérieur, dans les recoins troubles du parc.
Elle se leva doucement. Sa fenêtre était entrouverte : elle l'écarta. Le clair de lune s'étendait sur un paysage paisible de pelouses et de taillis, sur lequel les ruines de l'ancienne abbaye se détachaient en silhouettes tragiques, colonnes tronquées, arcs mutilés, fragments de porches et lambeaux d'arcs-boutants. Une brise légère planait sur la face des choses, glissant sans bruit entre les branches nues et immobiles des arbres, mais secouant les petites feuilles bourgeonnantes des arbustes.
Et, soudain, elle entendit à nouveau le même bruit. C'était à gauche et à l'étage en dessous d'elle, dans les salons, donc, qui occupaient l'aile gauche de la maison. Toute courageuse qu'elle était, la jeune fille eut peur. Elle enfila sa robe de chambre et prit les allumettes.
"Raymonde-Raymonde !
Une voix basse comme un souffle l'appelait de la chambre voisine, dont la porte n'était pas fermée. Elle s'y dirigeait à tâtons, lorsque Suzanne, sa cousine, sortit de la chambre et tomba dans ses bras :
"Raymonde, c'est toi ? Tu as entendu... ?"
"Oui. Vous ne dormez donc pas ?"
"Je suppose que le chien m'a réveillé, il y a quelque temps. Mais il n'aboie pas maintenant. Quelle heure est-il ?"
"Environ quatre".
"Écoutez ! Il y a bien quelqu'un qui marche dans le salon !"
"Il n'y a pas de danger, ton père est en bas, Suzanne."
"Mais il y a un danger pour lui. Sa chambre est à côté du boudoir."
"M. Daval est là aussi..."
"A l'autre bout de la maison. Il ne pouvait jamais entendre."
Ils hésitent, ne sachant que faire. Doivent-ils crier ? Appeler à l'aide ? Elles n'osaient pas, elles avaient peur du son de leur voix. Mais Suzanne, qui s'était approchée de la fenêtre, réprima un cri :
"Regardez ! un homme ! près de la fontaine !"
Un homme s'éloigne à vive allure. Il portait sous le bras un fardeau assez volumineux, dont ils ne purent distinguer la nature : il cognait contre sa jambe et le gênait dans sa progression. Ils le virent passer près de l'ancienne chapelle et se tourner vers une petite porte dans le mur. La porte devait être ouverte, car l'homme disparut brusquement et ils n'entendirent pas le grincement habituel des gonds.
"Il est venu du salon, murmura Suzanne.
"Non, les escaliers et le hall l'auraient fait sortir plus à gauche... Sans..."
La même idée les frappe tous les deux. Ils se penchèrent. Au-dessous d'eux, une échelle se dressait contre la façade de la maison, s'appuyant sur le premier étage. Une lueur éclaira le balcon de pierre. Et un autre homme, qui portait lui aussi quelque chose, enjamba le balustre, se laissa glisser le long de l'échelle et s'enfuit par le même chemin que le premier.
Suzanne, effrayée au point de se pâmer, tombe à genoux en bégayant :
"Appelons à l'aide... appelons à l'aide..."
"Qui viendrait ? Ton père - et s'il en reste d'autres - et qu'ils se jettent sur lui ?"
"Alors, nous pourrions appeler les domestiques... Votre cloche sonne à leur étage."
"Oui, oui, peut-être, c'est mieux. Si seulement ils arrivent à temps !"
Raymonde chercha le bouton électrique près de son lit et le pressa du doigt. Elles entendirent la cloche sonner à l'étage et eurent l'impression que son son strident devait aussi atteindre quelqu'un en bas.
Ils ont attendu. Le silence devient terrifiant et la brise même ne secoue plus les feuilles des arbustes.
"J'ai peur, j'ai peur, dit Suzanne.
Et, soudain, de l'obscurité profonde au-dessous d'eux, vint le bruit d'une lutte, un fracas de meubles renversés, des mots, des exclamations et puis, horrible et sinistre, un gémissement rauque, le gargouillis d'un homme que l'on assassine...
Raymonde bondit vers la porte. Suzanne s'accroche désespérément à son bras :
"Non, non, ne me laisse pas, j'ai peur..."
Raymonde l'écarta et s'élança dans le couloir, suivie par Suzanne qui titubait d'un mur à l'autre en poussant des cris. Raymonde atteignit l'escalier, le dévala, se jeta sur la porte du grand salon et s'arrêta net, enracinée sur le seuil, tandis que Suzanne s'écroulait à ses côtés. En face d'elles, à trois pas, se tenait un homme, une lanterne à la main. Il la tourna vers les deux jeunes filles, les aveuglant de sa lumière, fixa longuement leurs visages pâles, puis, sans se presser, avec les mouvements les plus calmes du monde, il prit sa casquette, ramassa un bout de papier et deux brins de paille, effaça quelques traces de pas sur le tapis, se dirigea vers le balcon, se tourna vers les jeunes filles, leur fit une profonde révérence et disparut.
Suzanne fut la première à courir vers le petit boudoir qui séparait le grand salon de la chambre de son père. Mais, à l'entrée, un spectacle hideux la consterne. Aux rayons obliques de la lune, elle aperçut deux corps apparemment sans vie, étendus l'un contre l'autre sur le plancher. Elle se penche sur l'un d'eux :
"Père!--Père!-C'est vous ? Que t'est-il arrivé ?" s'écria-t-elle distraitement.
Au bout d'un moment, le comte de Gesvres bouge. D'une voix cassée, il dit :
"N'ayez pas peur, je ne suis pas blessé... Daval... Est-il vivant... Le couteau... Le couteau..."
Deux serviteurs arrivent alors avec des bougies. Raymonde se jeta devant l'autre corps et reconnut Jean Daval, le secrétaire particulier du comte. Un petit filet de sang coulait de son cou. Son visage portait déjà la pâleur de la mort.
Puis elle se leva, retourna au salon, prit un fusil accroché au mur dans un trophée d'armes et sortit sur le balcon. Il ne s'était pas écoulé plus de cinquante ou soixante secondes depuis que l'homme avait posé le pied sur le premier barreau de l'échelle. Il ne devait donc pas être très loin, d'autant plus qu'il avait pris la précaution d'enlever l'échelle, afin d'empêcher les habitants de la maison de s'en servir. Et bientôt elle le vit longer les restes de l'ancien cloître. Elle mit l'arme à l'épaule, visa calmement et tira. L'homme tombe.
"C'est fait ! C'est fait !" dit l'un des serviteurs. "Nous avons celui-là. Je vais descendre."
"Non, Victor, il se lève.... Tu ferais mieux de descendre par l'escalier et d'aller tout droit vers la petite porte dans le mur. C'est la seule façon pour lui de s'échapper."
Victor se précipite, mais avant d'atteindre le parc, l'homme s'écroule à nouveau. Raymonde appela l'autre domestique :
"Albert, tu le vois là-bas ? Près du cloître principal ?
"Oui, il rampe dans l'herbe. Il est fini pour..."
"Surveillez-le d'ici."
"Il n'y a pas d'échappatoire pour lui. Sur la droite des ruines, il y a une pelouse ouverte..."
"Et, Victor, est-ce que vous gardez la porte, à gauche ?" dit-elle en prenant son arme.
"Mais vous n'allez tout de même pas descendre, mademoiselle ?"
"Oui, oui, dit-elle avec un accent résolu et des mouvements brusques, laissez-moi, il me reste une cartouche, s'il s'agite...
Elle sort. Un instant plus tard, Albert la voit se diriger vers les ruines. Il l'appelle par la fenêtre :
"Il s'est traîné derrière le cloître. Je ne le vois pas. Soyez prudente, mademoiselle..."
Raymonde fit le tour des vieux cloîtres, pour couper la retraite à l'homme, et Albert la perdit bientôt de vue. Au bout de quelques minutes, comme il ne la voyait pas revenir, il se sentit mal à l'aise et, gardant l'œil sur les ruines, au lieu de descendre par l'escalier, il s'efforça d'atteindre l'échelle. Quand il y fut parvenu, il descendit en rampant et courut tout droit vers le cloître près duquel il avait vu l'homme pour la dernière fois. Trente pas plus loin, il trouva Raymonde, qui cherchait avec Victor.
"Alors ?", demande-t-il.
"Il n'est pas question de mettre la main sur lui", répond Victor.
"La petite porte ?"
"Je suis passé par là, voici la clé".
"Il doit quand même..."
"Oh, nous l'avons mis en sécurité, cette canaille - il sera à nous dans dix minutes."
Le fermier et son fils, réveillés par le coup de feu, sortent alors des bâtiments de la ferme, qui se trouvent à une certaine distance sur la droite, mais à l'intérieur du périmètre des murs. Ils n'avaient rencontré personne.
"Bien sûr que non, dit Albert. "Le bandit ne peut pas avoir quitté les ruines. Nous le sortirons d'un trou ou d'un autre."
Ils ont organisé une fouille méthodique, battant chaque buisson, écartant les lourdes masses de lierre enroulées autour des fûts des colonnes. Ils s'assurent que la chapelle est bien fermée et qu'aucune vitre n'est cassée. Ils firent le tour des cloîtres et en examinèrent chaque recoin. Les recherches sont infructueuses.
Une seule découverte : à l'endroit où l'homme était tombé sous les balles de Raymonde, ils ont ramassé une casquette de chauffeur, en cuir chamois très souple ; à part cela, rien.
********************************************************
La gendarmerie d'Ouville-la-Rivière, prévenue à six heures du matin, se rendit aussitôt sur les lieux, après avoir envoyé un exprès aux autorités de Dieppe avec une note décrivant les circonstances du crime, la capture imminente du chef criminel et "la découverte de son couvre-chef et du poignard avec lequel le crime avait été commis".
A dix heures, deux voitures de louage descendent la pente douce qui mène à la maison. L'un d'eux, une vieille calèche, contenait le substitut du procureur et le juge d'instruction, accompagné de son greffier. Dans l'autre, une humble mouche, étaient assis deux reporters, représentant le Journal de Rouen et un grand journal de Paris.
Le vieux château apparaît, ancienne résidence abbatiale des prieurs d'Ambrumesy, mutilée sous la Révolution, restaurée par le comte de Gesvres, qui en est propriétaire depuis une vingtaine d'années. Il se compose d'un bâtiment principal, surmonté d'une tour d'horloge à pinacle, et de deux ailes, chacune entourée d'une volée de marches avec une balustrade en pierre. De l'autre côté des murs du parc, au-delà du plateau soutenu par les hautes falaises normandes, on aperçoit la ligne bleue de la Manche entre les villages de Sainte-Marguerite et de Varengeville.
Le comte de Gesvres y vivait avec sa fille Suzanne, une jolie créature délicate aux cheveux clairs, et sa nièce Raymonde de Saint-Veran, qu'il avait emmenée vivre avec lui deux ans auparavant, lorsque la mort simultanée de son père et de sa mère avait laissé Raymonde orpheline. La vie au château est paisible et régulière. Quelques voisins viennent de temps en temps. En été, le comte emmène les deux filles presque tous les jours à Dieppe. C'est un homme de grande taille, au beau visage sérieux et aux cheveux grisonnants. Très riche, il gère lui-même sa fortune et s'occupe de ses vastes domaines avec l'aide de son secrétaire, Jean Daval.
Dès son arrivée, le juge d'instruction prend note des premières observations du sergent Quevillon de la gendarmerie. La capture du criminel, pour imminente qu'elle soit, n'était pas encore réalisée, mais toutes les issues du parc étaient tenues. La fuite est impossible.
La petite troupe traverse ensuite la salle capitulaire et le réfectoire, tous deux situés au rez-de-chaussée, et monte au premier étage. Ils remarquèrent tout de suite l'ordre parfait qui régnait dans le salon. Pas un meuble, pas un ornement ne semblait occuper sa place habituelle ; il n'y avait pas non plus de vide parmi les ornements ou les meubles. Sur les murs de droite et de gauche étaient suspendues de magnifiques tapisseries flamandes à figures. Sur les panneaux du mur faisant face aux fenêtres se trouvaient quatre belles toiles, dans des cadres contemporains, représentant des scènes mythologiques. Il s'agit des célèbres tableaux de Rubens qui avaient été légués au comte de Gesvres, avec les tapisseries flamandes, par son oncle maternel, le marquis de Bobadilla, un grand d'Espagne.
M. Filleul a fait remarquer :
"Si le motif du crime était le vol, ce salon, en tout cas, n'en était pas l'objet.
"On ne peut pas savoir", dit le député, qui parle peu, mais qui, lorsqu'il le fait, s'oppose invariablement au point de vue du magistrat.
"Mais, mon cher monsieur, la première idée d'un cambrioleur serait d'emporter ces tableaux et ces tapisseries, qui sont universellement réputés."
"Peut-être que nous n'avons pas eu le temps".
"Nous verrons bien."
A ce moment, le comte de Gesvres entre, accompagné du médecin. Le comte, qui ne semblait pas ressentir les effets de l'attaque qu'il avait subie, accueillit les deux fonctionnaires. Puis il ouvrit la porte du boudoir.
Cette pièce, où personne n'avait pu pénétrer depuis la découverte du crime, se distinguait du salon par le plus grand désordre qui y régnait. Deux chaises étaient renversées, une des tables était brisée et plusieurs objets - une pendule, un portefeuille, une boîte de papier à lettres - gisaient sur le sol. Il y avait du sang sur quelques feuilles de papier éparpillées.
Le médecin retourna le drap qui recouvrait le cadavre. Jean Daval, vêtu de son habituel costume de velours, une paire de bottes cloutées aux pieds, est étendu sur le dos, un bras replié sous lui. Son col et sa cravate ont été enlevés et sa chemise ouverte, révélant une large blessure à la poitrine.
"La mort a dû être instantanée", déclare le médecin. "Un seul coup de couteau a suffi.
"C'est sans doute le couteau que j'ai vu sur la cheminée du salon, à côté d'une casquette en cuir...", dit le juge d'instruction.
"Oui, dit le comte de Gesvres, le couteau a été ramassé ici. Il provient du même trophée du salon où ma nièce, Mlle de Saint-Veran, a arraché le pistolet. Quant à la casquette du chauffeur, elle appartient évidemment à l'assassin."
M. Filleul examina quelques détails supplémentaires dans la pièce, posa quelques questions au médecin et demanda ensuite à M. de Gesvres de lui raconter ce qu'il avait vu et entendu. Le comte a formulé son récit comme suit :
"Jean Daval m'a réveillé. Je dormais mal, d'ailleurs, avec des lueurs de conscience où il me semblait entendre des bruits, quand, ouvrant brusquement les yeux, je vis Daval debout au pied de mon lit, sa bougie à la main et tout habillé - comme il l'est maintenant, car il travaillait souvent tard dans la nuit. Il semblait très excité et dit à voix basse : "Il y a quelqu'un dans le salon". J'ai moi-même entendu du bruit. Je me suis levé et j'ai poussé doucement la porte donnant sur ce boudoir. Au même moment, la porte là-bas, qui donne sur le grand salon, fut rejetée en arrière et un homme apparut qui bondit sur moi et m'assomma d'un coup de poing sur la tempe. Je vous raconte cela sans détails, Monsieur le Juge d'Instruction, pour la simple raison que je ne me souviens que des faits principaux, et que ces faits se sont enchaînés avec une rapidité extraordinaire."
"Et après cela ?"
"Après cela, je ne sais pas, je me suis évanoui. Quand je suis revenu à moi, Daval était étendu à mes côtés, mortellement blessé."
"A première vue, vous ne soupçonnez personne ?"
"Personne".
"Vous n'avez pas d'ennemi ?"
"Je n'en connais aucun."
"Ni M. Daval non plus ?"
"Daval ! Un ennemi ? C'est la meilleure créature qui ait jamais existé. M. Daval a été mon secrétaire pendant vingt ans et, si je puis dire, mon confident ; et je ne l'ai jamais vu entouré que d'amour et d'amitié."
"Pourtant, il y a eu un cambriolage et un meurtre : il doit y avoir un motif pour tout cela".
"Le motif ? C'est du vol pur et simple".
"Un vol ? On vous a volé quelque chose, alors ?"
"Non, rien.
"Dans ce cas..."
"Dans ce cas, s'ils n'ont rien volé et si rien ne manque, ils ont au moins emporté quelque chose.
"Quoi ?"
"Je n'en sais rien. Mais ma fille et ma nièce vous diront, avec une certitude absolue, qu'elles ont vu deux hommes traverser successivement le parc et que ces deux hommes portaient des charges assez lourdes".
"Les jeunes femmes..."
"Les jeunes femmes ont peut-être rêvé, pensez-vous ? Je serais tenté de le croire, car je me suis épuisé en enquêtes et en suppositions depuis ce matin. Cependant, il est assez facile de les interroger."
On fait venir les deux cousines dans le grand salon. Suzanne, encore toute pâle et tremblante, pouvait à peine parler. Raymonde, plus énergique, plus virile, plus belle aussi, avec l'éclat doré de ses yeux bruns, décrivit les événements de la nuit et le rôle qu'elle y avait joué.
"J'en déduis donc, mademoiselle, que votre témoignage est positif ?"
"Absolument. Les hommes qui ont traversé le parc emportaient des objets avec eux."
"Et le troisième homme ?"
"Il est parti d'ici les mains vides.
"Pouvez-vous nous le décrire ?"
"Il n'arrêtait pas de nous éblouir avec la lumière de sa lanterne. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est grand et bien bâti".
"C'est ainsi qu'il vous est apparu, mademoiselle ? demande le magistrat en se tournant vers Suzanne de Gesvres.
"Oui, ou plutôt non, dit Suzanne en réfléchissant. "Je le croyais de taille moyenne et élancé."
M. Filleul sourit ; il était habitué aux divergences d'opinion et de vue chez les témoins d'un même fait :
"Nous avons donc affaire, d'une part, à un homme, celui du salon, qui est à la fois grand et petit, costaud et mince, et, d'autre part, à deux hommes, ceux du parc, qui sont accusés d'avoir emporté de ce salon des objets - qui sont toujours là !
M. Filleul était un magistrat de l'école ironique, comme il le disait lui-même. C'était aussi un magistrat très ambitieux, qui ne rechignait ni à l'audience, ni à l'occasion de montrer en public ses ressources de tact, comme le montrait le nombre croissant de personnes qui se pressaient maintenant dans la salle. Les journalistes avaient été rejoints par le fermier et son fils, le jardinier et sa femme, les domestiques du château et les deux chauffeurs de taxi qui avaient amené les mouches de Dieppe.
M. Filleul poursuit :
"Il s'agit aussi de s'entendre sur la façon dont la troisième personne a disparu. Est-ce l'arme que vous avez tirée, mademoiselle, et de cette fenêtre ?"
"Oui. L'homme a atteint la pierre tombale qui est presque enterrée sous les ronces, à gauche du cloître.
"Mais il s'est relevé ?"
"A moitié seulement. Victor est descendu immédiatement pour garder la petite porte et je l'ai suivi, laissant le deuxième valet de pied, Albert, monter la garde ici."
Albert a alors fait sa déposition et le magistrat a conclu :
"Ainsi, selon vous, le blessé n'a pas pu s'échapper par la gauche, car votre serviteur surveillait la porte, ni par la droite, car vous l'auriez vu traverser la pelouse. Logiquement, il se trouve donc, à l'heure actuelle, dans l'espace relativement restreint qui s'offre à nos yeux".
"J'en suis sûr."
"Et vous, mademoiselle ?"
"Oui.
"Et moi aussi", dit Victor.
Le substitut du procureur s'exclame, l'air narquois :
"Le champ d'investigation est assez étroit. Il nous suffit de poursuivre les recherches entamées il y a quatre heures."
"Nous avons peut-être plus de chance."
M. Filleul prit sur la cheminée la casquette de cuir, l'examina et, faisant signe au sergent de gendarmerie, murmura :
"Sergent, envoyez immédiatement un de vos hommes à Dieppe. Dites-lui de se rendre chez Maigret, le chapelier, rue de la Barre, et de demander à M. Maigret de lui dire, si possible, à qui cette casquette a été vendue."
Le "champ d'investigation", selon l'expression du député, se limite à l'espace compris entre la maison, la pelouse de droite et l'angle formé par le mur de gauche et le mur opposé à la maison, soit un quadrilatère d'une centaine de mètres de part et d'autre, dans lequel se détachent à intervalles réguliers les ruines d'Ambrumesy, le célèbre monastère médiéval.
Ils remarquent aussitôt les traces laissées par le fugitif dans l'herbe piétinée. En deux endroits, des marques de sang noirci, aujourd'hui presque séché, ont été observées. Après le virage au bout du cloître, il n'y a plus rien à voir, la nature du sol, ici couvert d'aiguilles de pin, ne se prêtant pas à l'empreinte d'un corps. Mais, dans ce cas, comment le blessé avait-il pu échapper aux yeux de Raymonde, de Victor et d'Albert ? Il n'y avait que quelques freins, que les domestiques et les gendarmes avaient battus à maintes reprises, et quelques pierres tombales, sous lesquelles ils avaient exploré. Le juge d'instruction fit ouvrir par le jardinier, qui avait la clef, la chapelle, véritable bijou de sculpture, sanctuaire de pierre respecté par le temps et les révolutionnaires, et qui, avec le délicat travail de sculpture de son porche et sa population de statuettes en miniature, a toujours été regardé comme un merveilleux spécimen du style normand-gothique. La chapelle, très simple à l'intérieur, sans autre ornement que son autel de marbre, n'offrait pas de cachette. D'ailleurs, le fugitif aurait dû s'y faire admettre. Et par quel moyen ?
L'inspection les amène à la petite porte dans le mur qui sert d'entrée aux visiteurs des ruines. Elle s'ouvre sur un chemin creux qui court entre le mur du parc et un taillis contenant quelques carrières abandonnées. M. Filleul se pencha en avant : la poussière du chemin portait des traces de pneumatiques antidérapants. Raymonde et Victor se souvinrent qu'après le coup de feu, il leur avait semblé entendre le bruit d'une voiture.
Le magistrat a suggéré :
"L'homme a dû rejoindre ses confédérés."
"Impossible ! s'écrie Victor. "J'étais là quand Mademoiselle et Albert l'avaient encore en vue.
"C'est absurde, il doit bien être quelque part ! Dehors ou dedans : nous n'avons pas le choix !"
"Il est là", insistent les domestiques, obstinément.
Le magistrat haussa les épaules et retourna à la maison d'une humeur plus ou moins maussade. Il n'y a pas de doute que l'affaire n'est pas prometteuse. Un vol dans lequel rien n'avait été volé, un prisonnier invisible : quoi de moins satisfaisant ?
Il est tard. M. de Gesvres demande aux fonctionnaires et aux deux journalistes de rester déjeuner. Ils mangent en silence, puis M. Filleul retourne au salon, où il interroge les domestiques. Mais le bruit des sabots d'un cheval vient de la cour et, un instant après, le gendarme envoyé à Dieppe entre.
"Eh bien, avez-vous vu le chapelier ? s'exclama le magistrat, désireux d'obtenir enfin une information positive.
"J'ai vu M. Maigret. La casquette a été vendue à un chauffeur de taxi."
"Un chauffeur de taxi !"
"Oui, un chauffeur qui a arrêté sa voiture devant le magasin et a demandé qu'on lui fournisse une casquette de chauffeur en cuir jaune pour l'un de ses clients. C'était la seule qui restait. Il l'a payée, sans se préoccuper de la taille, et il est parti. Il était très pressé.
"Quelle sorte de mouche était-ce ?"
"Une calèche".
"Et quel jour cela s'est-il produit ?"
"Quel jour ? Aujourd'hui, à huit heures du matin."
"Ce matin ? De quoi parlez-vous ?"
"La casquette a été achetée ce matin.
"Mais c'est impossible, car on l'a trouvé hier soir dans le parc. S'il a été trouvé là, c'est qu'il devait être là ; et, par conséquent, il devait avoir été acheté auparavant."
"Le chapelier m'a dit qu'elle avait été achetée ce matin."
Il y eut un moment de perplexité générale. Le magistrat, déconcerté, s'efforce de comprendre. Soudain, il sursaute, comme frappé par une lueur :
"Allez chercher le chauffeur de taxi qui nous a amenés ici ce matin ! L'homme qui a conduit la calèche ! Allez le chercher tout de suite !"
Le brigadier de gendarmerie et son subordonné s'enfuient vers les écuries. Au bout de quelques minutes, le sergent revient seul.
"Où est le chauffeur de taxi ?"
"Il a demandé de la nourriture dans la cuisine, a mangé son déjeuner et ensuite...
"Et puis... ?"
"Il est parti.
"Avec sa braguette ?"
"Non. Prétextant vouloir aller voir une relation à Ouville, il a emprunté la bicyclette du marié. Voici son chapeau et son pardessus."
"Mais est-il parti tête nue ?"
"Non, il a pris une casquette dans sa poche et l'a mise".
"Une casquette ?"
"Oui, une casquette en cuir jaune, semble-t-il."
"Une casquette en cuir jaune ? Mais non, nous l'avons ici !"
"C'est vrai, Monsieur le Juge d'Instruction, mais le sien est tout à fait semblable.
L'adjoint ricane :
"Très drôle ! Très amusant ! Il y a deux casquettes : l'une, la vraie, qui constituait notre seule preuve, s'est envolée sur la tête de l'imposteur ! L'autre, la fausse, est entre vos mains. Oh, il nous a bien eus !"
"Attrapez-le ! Ramenez-le !" s'écrie M. Filleul. "Deux de vos hommes à cheval, sergent Quevillon, et à toute vitesse !"
"Il est déjà loin à l'heure qu'il est", a déclaré l'adjoint.
"Il peut aller aussi loin qu'il le souhaite, mais nous devons quand même l'attraper.
"Je l'espère, mais je pense, Monsieur le Juge d'Instruction, que c'est surtout ici qu'il faut concentrer vos efforts. Voulez-vous lire ce bout de papier que je viens de trouver dans la poche du manteau ?"
"Quel manteau ?"
"Celle du chauffeur".
Et le substitut du procureur tend à M. Filleul un papier, plié en quatre, contenant ces quelques mots écrits au crayon, d'une main plus ou moins commune :
"Malheur à la jeune femme, si elle a tué le gouverneur !"
L'incident a suscité un certain émoi.
"Un conseil à suivre, murmure le député. "Nous sommes maintenant prévenus."
"Monsieur le Comte, dit le juge d'instruction, je vous prie de ne pas vous alarmer. Ni vous non plus, mademoiselle. Cette menace n'a aucune importance puisque la police est sur place. Nous prendrons toutes les précautions et je répondrai de votre sécurité. Quant à vous, messieurs. Je compte sur votre discrétion. Vous avez assisté à cette enquête, grâce à ma trop grande gentillesse envers la presse, et ce serait me faire un mauvais retour..."
Il s'interrompit, comme si une idée l'avait frappé, regarda les deux jeunes gens, l'un après l'autre, et, s'approchant du premier, demanda :
"Quel journal représentez-vous, monsieur ?"
"Le Journal de Rouen
"Avez-vous vos papiers ?"
"Tenez."
La carte était en ordre. Il n'y a plus rien à dire. M. Filleul se tourne vers l'autre journaliste :
"Et vous, monsieur ?"
"I ?"
"Oui, vous : à quel journal appartenez-vous ?"
"Pourquoi, Monsieur le Juge d'Instruction, j'écris pour un certain nombre de journaux, un peu partout..."
"Vos références ?"
"Je n'en ai pas."
"Oh ! Comment cela se fait-il ?"
"Pour qu'un journal vous donne une carte, il faut que vous fassiez partie de son personnel permanent.
"Alors ?"
"Je ne suis qu'un collaborateur occasionnel, un free-lance. J'envoie des articles à tel ou tel journal. Ils sont publiés ou refusés selon les circonstances."
"Dans ce cas, quel est votre nom ? Où sont vos papiers ?"
"Mon nom ne vous dira rien. Quant aux papiers, je n'en ai pas."
"Vous n'avez aucun papier pour prouver votre profession !"
"Je n'ai pas de profession".
"Mais écoutez, monsieur, s'écria le magistrat avec une certaine aspérité, vous ne pouvez pas espérer conserver votre incognito après vous être introduit ici par une ruse et avoir surpris les secrets de la police !
"Je vous fais remarquer, Monsieur le Juge d'Instruction, que vous ne m'avez rien demandé lorsque je suis entré, et que je n'avais donc rien à dire. D'ailleurs, il ne m'a jamais semblé que votre enquête était secrète, puisque tout le monde était admis - y compris même l'un des criminels !"
Il parlait doucement, sur un ton d'infinie politesse. C'était un homme assez jeune, très grand, très mince, vêtu sans la moindre recherche de mode d'une veste et d'un pantalon trop petits pour lui. Il avait un visage rose comme celui d'une fille, un front large surmonté de cheveux taillés à ras, une barbe blonde broussailleuse et mal taillée. Ses yeux clairs brillaient d'intelligence. Il ne semblait pas gêné le moins du monde et arborait un sourire agréable, sans aucune nuance de badinage.
M. Filleul le regarde avec un air de méfiance agressive. Les deux gendarmes s'avancent. Le jeune homme s'exclama gaiement :
"Monsieur le Juge d'Instruction, vous me soupçonnez manifestement d'être complice. Mais, dans ce cas, ne me serais-je pas éclipsé au bon moment, en suivant l'exemple de mon compagnon d'infortune ?"
"Vous auriez pu espérer..."
"Tout espoir aurait été absurde. Un instant de réflexion, Monsieur le Juge d'Instruction, vous fera convenir avec moi que, logiquement parlant..."
M. Filleul le regarda droit dans les yeux et lui dit d'un ton sec :
"Plus de blagues ! Ton nom ?"
"Isidore Beautrelet."
"Votre profession ?"
"Élève de sixième au lycée Janson-de-Sailly.
M. Filleul ouvrit des yeux effarés.
"Qu'est-ce que tu racontes ? Élève de sixième année..."
"Au lycée Janson, rue de la Pompe, numéro-"
"Oh, regardez, s'écria M. Filleul, vous essayez de me prendre au piège ! Ce n'est pas possible, vous savez ; une plaisanterie peut aller trop loin !"
"Je dois dire, Monsieur le Juge d'Instruction, que votre étonnement me surprend. Qu'est-ce qui m'empêche d'être élève de sixième au lycée Janson ? Ma barbe, peut-être ? Rassurez-vous : ma barbe est fausse !".
Isidore Beautrelet arracha les quelques boucles qui ornaient son menton, et son visage imberbe parut encore plus jeune et plus rose, un vrai visage d'écolier. Et, avec un rire d'enfant, il dévoile ses dents blanches :
"Vous êtes convaincu maintenant ? demande-t-il. "Voulez-vous d'autres preuves ? Tenez, vous pouvez lire l'adresse sur ces lettres de mon père : 'A Monsieur Isidore Beautrelet, élève de l'intérieur, Lycée Janson-de-Sailly'.
Convaincu ou non, M. Filleul n'a pas l'air d'apprécier l'histoire. Il demanda, d'un ton bourru :
"Que faites-vous ici ?"
"Pourquoi ? Je suis en train d'améliorer mon esprit."
"Il y a des écoles pour cela : la vôtre, par exemple."
"Vous oubliez, Monsieur le Juge d'Instruction, que nous sommes le 23 avril et que nous sommes en plein dans les vacances de Pâques.
"Alors ?"
"J'ai le droit de passer mes vacances comme je l'entends."
"Ton père..."
"Mon père habite à l'autre bout du pays, en Savoie, et c'est lui-même qui m'a conseillé de faire un petit voyage sur la côte nord.
"Avec une fausse barbe ?"
"Oh, non ! C'est mon idée. A l'école, on parle beaucoup d'aventures mystérieuses, on lit des romans policiers où les gens se déguisent, on imagine toutes sortes d'affaires terribles et compliquées. Je me suis donc dit que j'allais m'amuser et j'ai mis cette fausse barbe. Et puis, j'avais l'avantage d'être pris au sérieux et je me suis fait passer pour un reporter de Paris. C'est ainsi qu'hier soir, après plus d'une semaine sans histoire, j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de mon collègue de Rouen ; et ce matin, quand il a appris le meurtre d'Ambrumesy, il m'a très gentiment proposé de l'accompagner et de partager les frais d'une mouche".
Isidore Beautrelet disait tout cela avec une simplicité franche et sans art dont il était impossible de ne pas sentir le charme. M. Filleul lui-même, tout en gardant une réserve méfiante, prenait un certain plaisir à l'écouter. Il lui demanda, d'un ton moins peevish :
"Et êtes-vous satisfait de votre expédition ?"
"Ravi ! D'autant plus que je n'avais jamais assisté à une affaire de ce genre et que je trouve que celle-ci ne manque pas d'intérêt."
"Ni dans cette mystérieuse complexité que vous appréciez tant..."
"Et qui est si stimulant, Monsieur le Juge d'Instruction ! Je ne connais rien de plus excitant que de voir tous les faits sortir de l'ombre, se regrouper, pour ainsi dire, et former peu à peu la vérité probable."
"La vérité probable ! Vous allez plutôt vite, jeune homme ! Vous suggérez de préparer votre petite solution à l'énigme ?"
"Oh, non ! répond Beautrelet en riant.
"Seulement, il me semble qu'il y a des points sur lesquels il n'est pas impossible de se faire une opinion ; et d'autres, même, sont si précis qu'ils justifient une conclusion".
"Oh, mais cela devient très curieux et je vais enfin pouvoir savoir quelque chose ! Car j'avoue, à mon grand désarroi, que je ne sais rien."
"C'est parce que vous n'avez pas eu le temps de réfléchir, Monsieur le Juge d'Instruction. L'important, c'est de réfléchir. Il est très rare que les faits ne s'expliquent pas d'eux-mêmes !"
"Et, selon vous, les faits que nous venons de constater s'expliquent d'eux-mêmes ?"
"Vous ne le pensez pas vous-même ? En tout cas, je n'ai rien trouvé d'autre que ce qui est écrit dans le rapport officiel".
"Bien ! Ainsi, si je vous demandais quels sont les objets volés dans cette pièce..."
"Je devrais répondre que je sais."
"Bravo ! Mon monsieur en sait plus que le propriétaire lui-même. M. de Gesvres a tout prévu : Pas M. Isidore Beautrelet. Il lui manque une bibliothèque en trois parties et une statue grandeur nature que personne n'a jamais remarquée. Et si je vous demandais le nom de l'assassin ?"
"Je dois à nouveau répondre que je le sais."
Toutes les personnes présentes sursautent. Le député et le journaliste s'approchent. M. de Gesvres et les deux jeunes filles, impressionnés par l'assurance tranquille de Beautrelet, écoutent attentivement.
"Vous connaissez le nom du meurtrier ?"