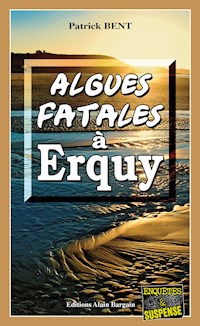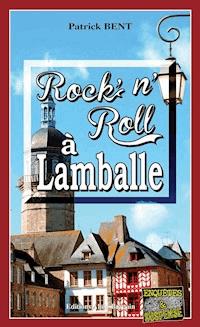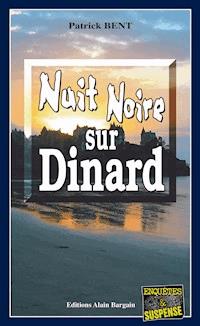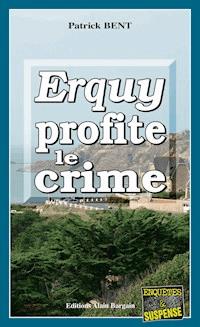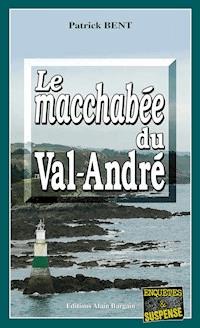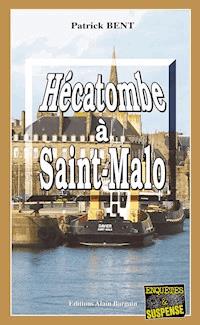
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Les enquêtes du commissaire Marie-Jo Beaussange
- Sprache: Französisch
Partie de Montparnasse, une série de meurtres se répand comme une traînée de poudre vers le Pays de Rance.
Personne n'est épargné, pas même les vieillards. De Saint-Malo à Saint-Suliac, on tremble au seul nom d'Apollon, l'auteur de ces tueries. N'annonce-t-il pas en effet le Crépuscule des Vieux ?
Bientôt Apollon obsède toutes les polices de France. Qui se cache derrière cette appellation non contrôlée ? Une secte ? Un groupe terroriste ? Un désaxé ?
La commissaire Marie-Jo Beaussange, ex-professeur des collèges devenue flic, prend les rênes d'une enquête difficile. La Miss doit composer avec une bande de retraités retors, une troupe de comédiens libertaires, une croisière en goguette et le démarrage de la saison touristique dans la cité corsaire.
Les intuitions fulgurantes de la commissaire, son look de mannequin et son énergie suffiront-ils à démasquer les assassins dissimulés derrière la divine signature ?
Plongez-vous dans le 4e tome des enquêtes du commissaire Marie-Jo Beaussange, un récit haletant déconseillé aux grands cardiaques !
EXTRAIT
Au-dessus de ma tête, des oiseaux ricanent dans le vent. Ce sont des mouettes rieuses, mes préférées avec leur figure de carnaval, masque noir et bec rouge. Je lève les yeux pour les observer, ravi de partager avec elles cet instant de liberté quand, soudain, le ciel bascule. Tout se met à tourner autour de moi ; le manège infernal se met en branle. Je cherche à fixer l’horizon qui refuse d’obtempérer. Il devient guimauve et se tortille comme une danseuse de lambada. J’avance la jambe droite pour rétablir mon équilibre mais le sol se dérobe à son tour. L’univers disparaît, cotonneux. En dépit de mes efforts pour rester debout, je suis irrésistiblement attiré vers le bas. Ma chute paraît durer un siècle avant le choc. La loi de la pesanteur est dure, le sol de la digue également. Il faudra que j’éduque mon col du fémur avant qu’il ne soit trop tard.
Que m’arrive-t-il encore ? Il ne s’agit pas d’une attaque cardiaque cette fois-ci, plus probablement de mon arthrose cervicale ou de mes otolythes qui reprennent du service.
Au contact du bitume froid, le tourbillon ralentit. Je parviens à m’asseoir sur mes fesses et à retrouver un semblant d’équilibre vite démenti par la nuée d’étoiles qui m’entoure. Le visage enseveli au creux de mes mains, je ferme les yeux pour me protéger. Dans cette bulle noire, des éclairs zèbrent mon champ de vision, mes rétines saturent, un violent mal de tête m’envahit. L’inquiétude aussi.
À PROPOS DE L'AUTEUR
À Erquy, Patrick Bent partage son temps entre les copains, la navigation, l’écriture ou la pêche au gré des saisons littéraires… Voyageur étonné, sa curiosité et sa gourmandise le conduisent occasionnellement à parcourir le monde. Auteur de nombreux articles scientifiques et techniques, puis d’un premier roman à compte d’auteur, Patrick a rejoint l'équipe des Éditions Alain Bargain en 2003. Patrick Bent apprécie les rencontres, la cuisine asiatique, le roman noir, les BD tendance Tardi-Pratt-Franquin, le haut médoc, la pêche au bar… Parmi ses auteurs “noirs” fétiches il admire particulièrement les regrettés Thierry Jonquet et Pascal Garnier. Côté cinéma James Gray, Roman Polanski, Pedro Almodovar, Joel et Ethan Cohen, Stanley Kubrick sans oublier l’immense Tarantino, tiennent la corde. Sa musique c’est le blues et certains compositeurs de jazz (Duke, Miles, Coltrane, et tout ce qui vient de la Nouvelle Orléans…).
Patrick est venu au monde en 1947. En dépit d’un lourd passé de physicien et d’une carrière consacrée aux lasers, c’est dans l’écriture qu’il s’épanouit aujourd’hui.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
REMERCIEMENTS
Un grand merci à Luce pour ses lectures éclairées et à l’équipe des Éditions Alain Bargain pour leur amicale collaboration.
« Les veuves vivent plus longtemps que leurs conjoints. »
Jean-Pierre Raffarin
I
Ce matin, le soleil flemmarde sous sa couette de nuages, un lavis pisseux barbouille le ciel. Le vent frais caresse mon visage. Les gouttelettes de bruine virevoltent et constellent ma parka de perles brillantes. Là-bas, au-delà de la citadelle et du Fort National, la mer commence à moutonner.
Je marche sur la digue, la tête dans la grisaille. Sur la plage en contrebas, pas une âme en maraude, pas davantage de voiture circulant sur la chaussée du Sillon. Je suis seul. Les stationnements vides et les maisons aux volets clos – belles endormies – attendent des jours meilleurs. Les bourrasques soulèvent sur la route les quelques gravillons rescapés des tempêtes de l’hiver. La mer remonte, furieuse. Les vagues frappent le sable avec fracas. Le vent a emporté le rire des gamins, l’espace d’une saison. Ils reviendront à l’été, insouciants. Jusque-là, le temps semble suspendu et le baromètre coincé vers les basses pressions.
Unique signe de vie, vers le large, un ferry assurant la liaison avec l’Angleterre affronte la grande houle de la Manche.
Je m’appelle Christian Le Droff.
Voilà trois ans que j’ai choisi de m’installer à Saint-Malo avec Jeanne, ma nouvelle compagne. Aujourd’hui, nous savourons ensemble notre retraite active, elle depuis un an, moi depuis 6 mois. Ce matin, à l’image du soleil, Jeanne est restée blottie sous l’édredon alors que je m’extirpais des draps sans bruit et sortais de la chambre à pas feutrés. Je suis devenu un étonnant lève-tôt depuis que rien ne m’y contraint hormis mon désir quotidien de croquer la vie.
Je flâne d’un pas incertain sur la digue, m’arrêtant çà ou là en appui sur ma canne. Dans le ciel, les oiseaux marins jouent avec les courants d’air, ils luttent face au vent, immobiles, avant de glisser sur l’aile et disparaître, réjouissants funambules.
Aujourd’hui, ma promenade matinale m’a conduit jusqu’au distributeur automatique de billets. En avançant dans la vie, je deviens précautionneux, je ressens le besoin de faire le plein sitôt que je suis en panne de liquide. Mon portefeuille enfle la poche intérieure de ma veste juste au-dessus de mon cœur, l’usine marémotrice qui irrigue tant bien que mal ma carcasse.
On a parcouru un sale bout de chemin, mon organe et moi. Après autant d’années de cohabitation, nous en avons vu de toutes les couleurs mais, jusqu’à présent, nous tenons tant bien que mal.
Au-dessus de ma tête, des oiseaux ricanent dans le vent. Ce sont des mouettes rieuses, mes préférées avec leur figure de carnaval, masque noir et bec rouge. Je lève les yeux pour les observer, ravi de partager avec elles cet instant de liberté quand, soudain, le ciel bascule. Tout se met à tourner autour de moi ; le manège infernal se met en branle. Je cherche à fixer l’horizon qui refuse d’obtempérer. Il devient guimauve et se tortille comme une danseuse de lambada. J’avance la jambe droite pour rétablir mon équilibre mais le sol se dérobe à son tour. L’univers disparaît, cotonneux. En dépit de mes efforts pour rester debout, je suis irrésistiblement attiré vers le bas. Ma chute paraît durer un siècle avant le choc. La loi de la pesanteur est dure, le sol de la digue également. Il faudra que j’éduque mon col du fémur avant qu’il ne soit trop tard.
Que m’arrive-t-il encore ? Il ne s’agit pas d’une attaque cardiaque cette fois-ci, plus probablement de mon arthrose cervicale ou de mes otolythes qui reprennent du service.
Au contact du bitume froid, le tourbillon ralentit. Je parviens à m’asseoir sur mes fesses et à retrouver un semblant d’équilibre vite démenti par la nuée d’étoiles qui m’entoure. Le visage enseveli au creux de mes mains, je ferme les yeux pour me protéger. Dans cette bulle noire, des éclairs zèbrent mon champ de vision, mes rétines saturent, un violent mal de tête m’envahit. L’inquiétude aussi. Mon souffle se fait plus rapide et j’appréhende une réaction côté cœur. Les conseils de mon toubib refont surface, inspirer avec le ventre, maîtriser l’expiration et recommencer en souhaitant qu’il ne s’agisse pas du dernier soupir. Après quelques minutes d’exercice, le calme revient.
Ouf ! Ce ne sera pas encore pour aujourd’hui. Un sursis supplémentaire m’est offert. Toujours ça de gagné.
Soudain, un bruit de pas. On s’approche de moi.
Avant que j’aie pu lever la tête, les mains chaleureuses d’un homme me saisissent sous les aisselles et me transportent sur le parapet où je m’assois dos à la mer.
— Ça va ? questionne le jeune homme vêtu d’un survêtement gris.
— Bof, ça va moyen.
— Je peux vous aider ?
— Ça va aller, merci. Le temps de récupérer mon souffle et retrouver ma vue, et je pense que ça ira.
— Je peux appeler des secours, propose-t-il en agitant son téléphone portable, ma voiture est garée un peu plus loin, à l’esplanade Saint-Vincent.
— N’en faites rien. Je me sens déjà mieux, je commence à récupérer.
— Vraiment ? Ce n’est pas très raisonnable dans votre état.
— Vous avez peut-être raison. Soyez gentil d’appeler ma compagne, elle viendra me chercher et s’occupera de moi, lui demandé-je en sortant une carte de visite de mon portefeuille. Tenez, voici le numéro. Son prénom est Jeanne.
L’homme se saisit du rectangle de bristol, y jette un coup d’œil, avant de braquer son regard sur le portefeuille joufflu posé sur mes genoux.
— Désolé Papy, s’exclame-t-il en s’emparant de mon fric. C’est pour la bonne cause, ajoute-t-il avant de filer à l’anglaise.
— Salopard ! m’entends-je murmurer le souffle court.
* * *
Étendu bien au chaud, je reprends mes esprits avec peine. Tout bouge encore autour de moi, à nouveau des lasers découpent mon espace. J’ouvre un œil craintif puis deux pour découvrir le sourire de ma compagne penchée à mon chevet. Un flot de tendresse m’inonde aussitôt. Peu à peu, je prends la mesure de mon environnement et je réalise que nous nous trouvons dans un véhicule roulant à vive allure. À mon poignet droit, un goutte-à-goutte distille des liqueurs réconfortantes. Sédatif, calmant, élixir ? Debout vers l’avant de la camionnette, l’infirmier contrôle des écrans lumineux. Je suis sous haute surveillance, en de bonnes mains, puisque ma chère Jeanne se tient à mes côtés. Rien de grave ne peut plus m’arriver.
Bercé par le roulis de l’ambulance, je me laisse aller, confiant, pareil à un bébé qui s’endort.
Et le visage d’Edna apparaît… La revoilà ! Une lumière dorée caresse son visage angélique. Sa chevelure blonde brille comme un métal précieux. Ah ! Elle n’en rate pas une, celle-là ! Bientôt cinquante ans que j’essaie de m’en débarrasser, or ce n’est pas son genre. Chassé par la porte, son souvenir revient par la fenêtre, tenace, pugnace, sans céder un pouce de terrain. Son fantôme se manifeste à chacun des virages de ma vie, semblable à lui-même. Chaque fois, son image réapparaît à l’identique, celle de la jeune fille nimbée de la grâce de ses dix-sept ans. Le temps n’a pas de prise sur les icônes.
J’ai rencontré Edna en 1965, à Rennes, au lycée. Les établissements mixtes d’alors connaissaient leurs premiers balbutiements. Nous étions en classe terminale tous les deux, dans des sections différentes, et nous partagions la responsabilité du foyer culturel du lycée, un espace mis à la disposition des élèves pour des expositions, des jeux ou des tribunes de discussion ; un endroit aussi où les “terminales” pouvaient se retrouver en toute liberté après la cantine, pendant l’heure de permanence. Nous avions même obtenu de haute lutte le droit d’y fumer. Edna et moi-même assurions la bonne tenue des lieux et la programmation culturelle. Pour ma part, j’animais le ciné-club, Edna quant à elle, organisait des conférences et un atelier de peinture sur soie le mercredi après-midi.
Hormis ces activités, notre rôle consistait à représenter les élèves auprès de l’administration. À l’occasion de ces réunions bimensuelles, nous préparions nos argumentaires avec complicité. Lorsqu’il fallait convaincre le censeur ou le surgé, l’aplomb d’Edna me fascinait autant que ses yeux, sa silhouette gracile ou sa délicatesse. On ne savait rien lui refuser. Pour tout dire, comme la plupart des garçons du lycée, j’étais amoureux d’elle. En secret cependant, car je n’osais me déclarer de peur de la froisser. Timide.
En juin, Edna avait décroché son bac philo. Avec la mention très bien, s’il vous plaît ! Moi, je me contentais de mon diplôme “Sciences Ex”, mention “ras les pâquerettes”, pour cause d’overdose de cinéma en période de révisions. Le précieux diplôme en poche, nous préparions nos vacances en toute sérénité.
Parmi nos victoires, Edna et moi avions obtenu d’organiser une boum pour fêter les nouveaux bacheliers, nos adieux au lycée en quelque sorte. Le jour dit, le foyer serait à notre disposition – sous haute surveillance – jusqu’à minuit, pas une minute de plus. Les mœurs se libéraient pianissimo. Depuis la fin des oraux, mes copains et moi avions travaillé d’arrache-pied pour décorer et sonoriser la salle. Tout était fin prêt pour accueillir le bal.
La fameuse soirée est arrivée. Les filles avaient troqué leurs sempiternelles blouses au profit de tenues plus affriolantes. Rivalisant de séduction, certaines s’étaient même discrètement maquillées. Parmi elles, Edna resplendissait dans son corsage rouge et sa jupe blanche. Côté garçons, les panoplies minets et yé-yé se mélangeaient, blazers croisés pour les uns, pantalons patte d’eph et Clarks pour les autres. Conscients d’avoir franchi une étape, nous n’avions que la fête en tête et l’euphorie pour avenir.
Sitôt arrivée, Edna m’a accaparé, refusant de danser avec les autres garçons. Au premier rock, j’atteignais des sommets de maladresse, tétanisé au contact de son corps. Et puis je me suis décrispé, décidé à saisir ma chance. Nous avons dansé comme des fous, sans nous quitter des yeux. Le grand prix de l’Eurovision passait en boucle, France Gall ponctuait chaque série de rocks avec Poupée de cire, Poupée de son. Enfin, plus tard dans la soirée, à l’heure du slow, nous avons tamisé les lumières et j’ai entraîné Edna à l’écart. Dans un coin de la salle, à l’ombre d’un poteau de béton, nous sommes tombés dans les bras l’un de l’autre. Un premier baiser long, doux, savoureux, inoubliable, sous les exhortations des Platters Only You… Une première secousse tellurique dans mon corps d’adolescent.
Nous avons flirté jusqu’à la fermeture, puis, la mort dans l’âme, nous avons dû nous séparer. Les parents d’Edna, des bourgeois bon teint, veillaient sur leur fille unique comme sur le Saint Sacrement. Ainsi lui avaient-ils accordé la permission de minuit et demi, si, et seulement si elle se faisait raccompagner. Sa famille logeait à une quinzaine de kilomètres du lycée. Vu l’heure tardive, les transports en commun ne circulaient plus. Edna avait donc manigancé de rentrer en voiture avec Luc, un élève de ma classe qui venait d’obtenir son permis de conduire et qui, pour l’occasion, disposait de la 404 familiale. Il ne manquait que cela à sa panoplie de play-boy en herbe. Fier comme Artaban, au volant de la Peugeot, Luc emporta ma belle vers d’autres horizons dans la nuit d’été. Le lendemain en effet, Edna partait en Angleterre, et moi aux Glénans pour un stage de voile. Cette cruelle parenthèse devait se refermer en septembre quand on se reverrait à la rentrée. Juré, promis, cochon qui s’en dédie !
Affalé sur mon vélo, les yeux embués de larmes, je scrutais la nuit dans laquelle les feux de la 404 venaient de disparaître, le regard résolument braqué vers l’automne. Une énorme boule étreignait mon estomac. Aujourd’hui encore, la seule évocation de cette soirée me met à mal car, depuis, la saveur des baisers d’Edna circule toujours dans mes veines, pareille à une drogue. Voilà quarante-six ans que je suis en manque. Le poison inoculé n’a jamais faibli. C’est plus fort que moi, son parfum resurgit à la moindre occasion, il s’est inscrit dans ma chaîne ADN.
Pourtant on ne peut pas dire qu’Edna m’ait facilité l’existence. Fascinée par l’Angleterre et sa nouvelle vie, elle a décidé d’y poursuivre ses études. Moi scotché en France, je rongeais mon frein en classe préparatoire. Mais à quoi me préparais-je en vérité ? Séparé d’Edna, la vie fuyait, inodore et sans saveur. Cependant, je n’ai pas eu le courage de m’enfuir pour la rejoindre ; pudeur d’adolescent ou masochisme romantique ? J’ai probablement commis là la plus grosse bêtise de ma petite vie.
Et puis, le temps a passé, cannibale. Nous nous sommes revus épisodiquement, à Londres, à Paris ou ailleurs. Mais son cœur n’y était plus, contrairement au mien qui battait toujours la chamade à chaque rencontre sans obtenir le moindre écho. Enveloppée dans sa beauté, Edna survolait le siècle, légère comme une bulle blonde, insouciante. À chacune de nos conversations, elle évoquait immanquablement notre confiance mutuelle, m’en remerciait et m’offrait son amitié. J’ai accepté sans y croire un instant. Tout ce qui venait d’elle me ravissait. Faute de grives, on mange des merles.
Puis mai 68 est arrivé. Comme des milliers d’étudiants, j’ai participé à la grande kermesse, oubliant mes déconvenues amoureuses aux bras d’insatiables hétaïres. Notre génération découvrait de nouveaux espaces. Sous les pavés est apparue la plage, fugace, puis la fête a fait long feu. L’entracte terminé, en septembre, avec la rentrée, mes carences d’Edna se sont à nouveau manifestées.
Je l’ai contactée. Nous nous sommes rencontrés une fois encore. Pénible souvenir, car, fidèle à ses engagements, Edna se confiait à moi comme à une bonne copine, n’hésitant pas à s’épancher sur sa dernière conquête, un mec sérieux et plein d’humour – so british – avec qui elle envisageait de bâtir quelque chose. Moi, comme un con, je l’écoutais attendri au lieu de lui sauter au cou !
Avec le temps, le silence a momifié notre relation. Ce mutisme convenu n’a pour autant pas cicatrisé ma blessure. Un matin, j’ai découvert dans ma boîte aux lettres un faire-part de naissance. Il provenait d’Australie. Edna m’annonçait la venue au monde de sa fille Pivoine. Un nom de fleur pour ce bébé de 3,2 kilogrammes, précisait-elle dans son courrier. Longue et heureuse vie, chère Pivoine, puisses-tu posséder la grâce de ta maman.
Pourquoi le bonheur n’arrive-t-il qu’aux autres ? Cette naissance scellait mon destin. Elle m’administrait la preuve par neuf qu’Edna existait loin de moi. Sans l’accepter, je devais l’admettre. Je suis un garçon obstiné, certes, mais pas totalement stupide : à l’évidence, il me fallait faire mon deuil. Âgé alors d’une trentaine d’années, je plongeai tête baissée dans mon travail, au point de m’y noyer 15 à 16 heures par jour, y compris le dimanche. Délaissant toute vie sociale ou culturelle, j’imaginais que cette apnée de stakhanoviste aurait raison de mes fantasmes.
J’ai maintenu le nez dans le guidon sans parvenir à mes fins. Dans mes rêves, mes cauchemars, mes angoisses, mes dépressions ou mes prières, Edna réapparaissait inexorablement, souriante comme aux plus beaux jours, ses cheveux blonds voletant dans la brise. Constante, toujours vêtue de sa minijupe blanche et de son chemisier rouge, décolleté en “V”, immortalisée dans la tenue qu’elle portait le soir du bac. Son image, figée dans la splendeur de ses dix-huit ans, m’a accompagné au quotidien, prête à prendre vie au premier coup de baguette magique. Chimère, mauvaise fée m’acculant à une impasse.
Un jour cependant, un éclair de lucidité a illuminé ma chambre. Au mur, au-dessus de la table de nuit, je découvrais la photo du calendrier. Elle représentait un paysage auquel je n’avais jamais prêté attention jusque-là, une île grecque, Sifnos selon la légende. Planté au sommet d’une colline, un moulin blanc à la toiture bleu schtroumpf dominait la mer Égée. Heureux qui comme Ulysse…
Et moi ? Où en étais-je de mes pérégrinations ? Au-dessus de la photographie, une date en forme de rappel à l’ordre : Juin 2005 ! Voilà cinquante-huit ans que ma mère m’avait mis au monde. Si je dressais un bilan personnel de ce demi-siècle, le premier mot qui me venait à l’esprit sonnait comme un glas : stérile ! Enferré dans ma période glaciaire, je n’avais guère avancé alors qu’à l’extrémité de la ligne droite, le bout de la vie pointe déjà son nez.
Je traînais derrière moi des tombereaux de regrets, reniant cette existence de sauvage. Le temps pressait aujourd’hui pour me réinventer un art de vivre. Toutes ces années perdues à attendre un ectoplasme s’avéraient enfin vaines. Si Edna m’avait empoisonné l’existence, j’étais fermement décidé à vivre différemment mon solde d’avenir. Challenge difficile, remise en question notoire que je me sentais l’énergie d’affronter. Restait à transférer mon trop-plein de frustration pour réintégrer le monde, renouveler mon contrat social. Pour commencer, je participai à plusieurs associations, sportives et culturelles, de façon à rencontrer des êtres humains. Je retournai au cinéma, délaissé depuis des lustres, et je m’investissai à nouveau dans un ciné-club. Mes connaissances encyclopédiques des films des années 60-70 palliaient mon ignorance d’œuvres plus récentes. Peu à peu, je reprenais une place dans l’agora et dans ses réseaux. À l’occasion de dîners en ville et au contact de plusieurs couples rencontrés au ciné-club, l’idée de ne plus vivre solitaire faisait son chemin. Partager mon temps avec quelqu’un ne m’avait jamais effleuré l’esprit jusqu’à présent tant mes chimères m’aveuglaient. Aujourd’hui, l’échange et la complicité m’apparaissaient comme besoins vitaux. La tendresse suivrait et plus, si affinités…
Ma décision prise, je me lançai à la recherche de l’âme sœur. Ma quête du Graal prit des allures de parcours tortueux. De clubs de rencontres en sites Internet, de petites annonces en rendez-vous, je découvrais un univers rempli de solitudes. Après quelques mois de recherches, d’espoirs, de déconvenues, je rencontrai Jeanne.
Le courant est passé immédiatement, nous nous sommes vus cinq ou six fois avant de nous tester en vraie grandeur au cours d’un voyage probatoire. Rien de tel que deux semaines dans la Creuse pour éprouver la solidité d’une relation. À notre retour nous avons cherché un endroit où vivre ensemble. À l’unanimité, nous avons jeté notre dévolu sur Saint-Malo.
Jeanne a exercé son métier d’institutrice dans divers pays francophones. Afrique, Asie, Océanie, Europe, une bourlingueuse. Comblée par l’éducation des enfants, elle n’a jamais éprouvé le besoin de “faire” les siens. Aujourd’hui, après une carrière de nomade, elle souhaite se fixer au pays. L’air de la Manche lui convient à merveille.
Moins âgée que moi, Jeanne masque sa cinquantaine confirmée derrière un physique agréable. Bien proportionnée, athlétique, elle pratique la randonnée, la natation et n’a jamais cessé son entraînement d’aïkido. Une ceinture noire impose un certain entretien et beaucoup de respect.
Jeanne et moi avons établi un pacte secret, celui de ne pas questionner l’autre sur son passé pour mieux vivre notre présent. En revanche, si l’un d’entre nous souhaite évoquer sa vie antérieure, libre à lui. Bien entendu, je n’ai jamais mentionné le nom d’Edna devant elle. Je le réserve aux plus intimes de mes oubliettes.
Notre appartement domine la plage, à deux pas des thermes marins, sur la chaussée du Sillon, une étroite langue de terre balayée par les vents, coincée entre le port et la mer. La digue érigée jusqu’à Rochebonne, le long de la plage, suffit à peine à contenir les marées. Plantés dans le sable au pied du quai, des brise-lames en rang d’oignons protègent l’édifice contre les vagues. On ne plaisante pas avec des marnages supérieurs à douze mètres. Ici, les flots les plus importants d’Europe charrient quotidiennement des masses d’eau impressionnantes. Jadis, avant la construction de la digue, l’accès pédestre à la ville fortifiée n’était possible qu’à marée basse et les bassins portuaires communiquaient avec la pleine mer. Les hommes ont peu à peu domestiqué la nature et aujourd’hui une succession de villas, d’immeubles cossus et de grands hôtels s’aligne sur la promenade du Sillon. Ces constructions abritent des vents dominants le port et le bassin Duguay-Trouin.
J’ai choisi de nous installer ici pour de multiples raisons : le besoin de grands espaces après une vie de citadin, le calme du quartier malgré sa proximité du tumulte de l’intra-muros, enfin les couchers de soleil sur les îles et la citadelle. Nous logeons dans un quatre-pièces lumineux au deuxième étage d’un immeuble 1950. Le séjour double est éclairé par une baie vitrée dont les portes coulissantes s’effacent dans les cloisons. Notre chambre commune et le bureau adjacent donnent sur une cour intérieure à l’opposé du front de mer. Ainsi disposons-nous de plusieurs espaces où chacun peut s’isoler sans gêner l’autre. Face à la plage, notre balcon permet de profiter des belles journées d’été alors qu’à la morte saison, les triples vitrages et le chauffage central nous protègent des tempêtes. Face à nous, la mer, insaisissable, rythme nos vies. Marée après marée, toujours recommencée, elle habille et déshabille les îlots et les grèves.
Les jours de fort noroît, la promenade jusqu’aux remparts devient plus que vivifiante, terrifiante même aux marées d’équinoxe lorsque les lames décoiffent la digue au point de gifler notre immeuble, de l’autre côté de la rue. Ces jours-là, inutile de rivaliser avec les éléments, nous nous réfugions au cœur de la cité, à l’intérieur des murs. Là, à l’abri des hautes façades de granit, nous flânons au cœur de l’austérité malouine. Peu à peu, au fil des venelles serpentines, cette rigueur devient grandiose, sa beauté et sa fierté s’imposent. La main dans la main, nous arpentons le pavé avec délice, complices. Les traits d’Edna s’effacent derrière le sourire de Jeanne grâce à qui je maintiens ma tête hors de l’eau. Je suis un rescapé du XXe siècle.
Dans l’ambulance brinquebalante, sa présence me rassure, son affection m’enveloppe comme une couverture de survie.
Quelques chaos plus loin, le véhicule ralentit puis s’arrête. Les portes claquent. À la lueur orangée du gyrophare, je décrypte les lettres géantes bleues, étalées verticalement : URGENCES.
On roule mon brancard vers le bâtiment, quelques gouttes de bruine humectent mon visage. Je souris, je suis vivant.
II
Yannick n’appréciait pas l’eau, surtout dans un verre. Par-dessus tout, il détestait la glace pilée qui détruisait le goût sur son passage. Pour lui, le Margarita se dégustait on the rocks. Pas de concession possible, songeait-il en faisant tinter les cubes de glace dans son verre. William, son barman de prédilection réalisait comme nul autre l’alchimie Cointreau-tequila-citron et sel. Lors de ses séjours à Paris, Yannick descendait toujours dans ce petit palace, un trois étoiles, dont il appréciait le calme, le confort et l’ambiance cosy du bar américain.
Il s’enfonça davantage dans le fauteuil de cuir puis détendit ses jambes pour mieux s’adonner à la contemplation du liquide. Le choc du glaçon sur la paroi lui évoqua un autre drame : la collision et le naufrage du Titanic en 1912. À la pensée du géant silencieux gisant dans les abysses, une larme perla sur sa joue, puis ruissela sur son visage avant de se détacher pour s’écraser sur la bordure du verre. Là, une fraction de la gouttelette se mêla au breuvage, l’autre franchit sans encombre la barrière de sel déposée sur le rebord en y laissant la trace de son passage, pareille à une limace.
Sous l’effet de la gravité, le reliquat de la larme d’origine poursuivrait sa course vers le sol puis, d’infiltration en évaporation puis en condensation, elle rejoindrait finalement la nappe phréatique. Alors, de pompage en écoulement, elle atteindrait l’océan où quelques molécules pourraient un jour folâtrer dans l’épave du Titanic. La boucle serait bouclée.
Yannick prisait ces raccourcis signant son appartenance au monde, de l’intime au collectif. Et si, divaguait-il, l’océan n’était que le produit des larmes humaines depuis l’aube des temps ? Tant de guerres, tant de souffrances accumulées, un déluge de pleurs qui avait gonflé les torrents, inondé les vallées, grossi les océans. Après tout, les larmes, l’eau de mer et le Margarita possèdent un goût commun, celui du sel…
Il consulta sa montre et commanda un cinquième cocktail.
— On the rocks ? s’enquit le serveur.
— Vous êtes nouveau ici ? tempêta Yannick en le fusillant du regard.
Il était en pétard. Quarante-cinq minutes déjà qu’il attendait Jack Daniel, son correspondant !
À ce rythme, il serait bientôt ivre. De trois choses l’une, ou l’Américain se foutait de lui, ou alors un sérieux pépin le retardait, ou bien encore planait-il dans cette dimension connue de lui seul où il se complaisait parfois. Un type ambigu, ce Jack, travaillant pour une multinationale établie dans le Minnesota. Commercial efficace et rigoureux, il pouvait péter les plombs brusquement et disparaître sans laisser d’adresse pendant plusieurs jours. À son retour, il ne proférait pas le moindre commentaire ni l’ombre d’une excuse, seule, une apparente satisfaction se lisait sur son visage. Ces errements exaspéraient Yannick qui conduisait ses affaires sans rien laisser au hasard.
Depuis trois mois qu’ils négociaient, Jack et lui avaient finalement conclu la veille un accord au terme duquel Yannick et son équipe commercialiseraient en France les engins agricoles proposés par la société américaine. Enthousiasmé par cette perspective, Yannick piaffait, persuadé que son réseau commercial ferait un carton. Ces machines de ramassage automatique des pommes se vendraient comme des petits pains dans les quatre départements bretons. La veille, Jack avait promis de rédiger la mouture finale du contrat et de la lui soumettre sans délai. Ainsi étaient-ils convenus de se retrouver ce soir, ici, pour entériner le projet, signer la paperasse puis fêter ensemble l’événement. Ils ne l’auraient pas volé.
Mais, pour signer un contrat, il faut être deux.
Yannick détestait les lapins. Perpétuel affamé de l’existence, il ne supportait pas de perdre son temps. Pour se donner contenance, il appuya nerveusement sur la touche rappel de son téléphone mobile. À nouveau, il obtint la boîte vocale de Jack où il fut tenté de déverser son fiel, mais à quoi bon ? Le silence est d’or, surtout en affaires. Il coupa la communication, excédé, et imagina d’autres stratégies pour sa soirée. Yannick ne pouvait siroter des Margarita toute la nuit, son foie le supporterait mal et cela manquait singulièrement de charme.
La créature qui avançait vers lui, en revanche, en possédait à revendre : une femme distinguée, élancée, la trentaine épanouie, belle à damner un conclave. Elle jeta un regard circulaire sur le bar et s’installa deux tables plus loin. Yannick la détailla discrètement, subjugué par l’élégance de la nouvelle venue et la grâce de ses gestes. Sa simple manière de s’asseoir relevait du chef-d’œuvre. Sans savoir pourquoi, elle lui évoqua Modigliani. La chevelure de jais, sans doute ? Ou bien le visage oblong dans lequel étincelaient des yeux noirs et sensuels. La jeune femme exhalait un mélange subtil de douceur et de rébellion.
Au diable Jack Daniel ! Après tout, la signature du contrat pouvait attendre quelques jours de plus. Un contretemps avait retardé leur rendez-vous ? Tant mieux puisque cela ménageait à Yannick la possibilité d’une nouvelle rencontre. Comme à l’accoutumée, il positivait la situation, sans beaucoup se forcer toutefois, au regard du magnétisme de sa voisine.
Il prit sur lui-même pour détourner son regard, se rencogna dans son fauteuil et réfléchit. Laisser le temps au temps, certes, ne pas être brutal ni grossier, ne pas trop patienter non plus. Attendait-elle quelqu’un ? Était-elle seule à Paris ? Yannick ne l’imaginait pas mère de famille, plutôt mannequin ou comédienne. Le serveur s’approcha d’elle, enregistra sa commande et apporta bientôt un breuvage mousseux de couleur blanche. Piña colada, diagnostiqua Yannick en dépliant son mètre quatre-vingt-dix, décidé à passer à l’acte.
Alors qu’il s’avançait vers le bar, le verre à la main, son regard croisa celui de la jeune femme. Il décela l’esquisse d’un sourire sur ses lèvres, une invite à engager la conversation.
— Bonsoir, déclara-t-il d’une inclinaison de tête.
— Bonsoir, Monsieur, répondit la jeune femme en redressant le buste.
— Vous arrivez tout juste ?
— Vous êtes perspicace, observa-t-elle, moqueuse.
— Oh non ! Je m’impatiente ici depuis un moment. J’attends un de mes collègues qui ne viendra plus. Je tente bien de tuer le temps, mais il ne veut pas se laisser faire. C’est un coriace ! Je descends souvent dans cet hôtel et, j’ai honte de l’avouer, je ne vous y ai jamais rencontrée.
— Normal, c’est mon premier séjour ici.
— Alors, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. À Montparnasse, c’est la moindre des choses, plaisanta Yannick. Puis-je prendre place ? proposa-til en désignant le fauteuil. Nous serons plus à l’aise pour bavarder.
— Pourquoi pas ?
Les choses s’annonçaient bien.
— Je ne veux pas vous importuner, tempéra Yannick. En fin de journée, parfois, on apprécie la solitude…
— Je vous en prie, asseyez-vous.
— Merci… Piña colada ? demanda-t-il d’un signe du menton.
— Oui, acquiesça-t-elle.
— À la glace pilée ?
— Naturellement. J’adore ça.
— Moi je suis plutôt Margarita, c’est plus sec et plus corsé. En revanche, je les préfère “on the rocks”, car, voyez-vous, le froid de la glace pilée a tendance à brûler les autres saveurs.
— C’est précisément la sensation que j’adore ! La douceur de la noix de coco et la rondeur du rhum sur un torrent de glace en fusion s’allient à merveille, même en plein hiver. Un régal.
— Des goûts et des couleurs… Au fait, permettez-moi me présenter, je m’appelle Yannick Duchamp.
— Enchantée, moi, c’est Marie-Jo.
— Laissez-moi deviner. Marie-Josèphe ? Marie-Josiane ? Marie-Joséphine ? Marie-Joanna ? Marie-Jocaste ? Marie-Jocelyne ? Marie-Jorane ?
— Tout faux. Ne cherchez plus. Marie-Jo, tout court.
— Entendu. Et vous êtes de passage à Paris, Marie-Jo ?
— Oui, je suis en stage pour quelques jours. Et vous-même ?
— Oh ! Moi, je fais la navette entre Rennes et Paris plusieurs fois par mois. Cet hôtel est en quelque sorte ma succursale, sachant que mes bureaux sont à Rennes. Je commercialise des machines agricoles. Je sillonne la Bretagne pour visiter mes clients ; en revanche, je rencontre la plupart de mes fournisseurs à la capitale, c’est la raison de ma présence ici. J’apprécie particulièrement William, l’as du shaker qui, derrière son bar, concocte les plus subtils des breuvages.
— Breton ?
— Oui, et vous ?
— Presque. Je vis en Bretagne et « ça me gagne ».
— Dans quel coin ? Le Sud, le Nord ?
— J’ai habité Saint-Brieuc pendant trois ans. Maintenant, je vis à Saint-Malo, changement d’affectation et désir de bouger.
— Que faites-vous comme job ?
— Je m’occupe de la voie publique, nettoyage en tous genres, assainissement.
— Service des eaux ?
— Quelque chose comme ça, éluda-t-elle en terminant son verre.
— Marie-Jo, quitte à paraître obsessionnel, permettez-moi de vous offrir une piña colada alternative, je veux dire servie dans un verre rafraîchi, sans glace pilée. Vous m’en direz des nouvelles.
— Je vais être pompette, ce n’est pas très raisonnable.
— Est-ce vraiment raisonnable d’être raisonnable ?
— Soyons fous, s’exclama-t-elle alors que Yannick hélait le barman. Un dernier verre et je vais dîner. Je dois me coucher de bonne heure car mon train ne m’attendra pas demain matin.
— Vous dînez seule ?
— A priori oui, mais mon petit doigt me dit que ça ne va pas durer.
— Votre petit doigt est observateur, reprit Yannick. Fruits de mer, crêpes ?
— Plutôt poisson, pour ma part.
— Je réserve une table.
* * *
Vingt-deux heures trente-cinq. En sortant du Bistrot, la fraîcheur de la nuit fondit sur eux comme un rapace sur sa proie. Les reflets des néons brillaient sur le trottoir mouillé de la rue Delambre. Yannick et Marie-Jo avançaient dans l’air humide, des saveurs de calamars à la plancha et de daurade royale accrochées aux papilles. La pluie ne tombait plus, ils pressaient le pas en direction du boulevard Edgard Quinet. Un froid mêlé d’humidité attaquait la commissaire Marie-Jo Beaussange aux épaules, ajoutant aux crispations de fatigue accumulées depuis le petit matin. Elle était au bout du rouleau. Débarquée de Saint-Malo au premier train, elle avait passé sa journée, non-stop, avec ses collègues du commissariat du XIVe. Sitôt arrivée avenue du Maine, le temps d’ingurgiter un café soluble infect, ils s’étaient déplacés au jardin de l’Atlantique, un îlot de verdure lugubre cernée de verre et de béton suspendu au-dessus des voies ferrées de la gare Montparnasse. Là, parmi les buis et les bruyères, au pied d’un panneau de marbre froid comme la nuit, des promeneurs matinaux avaient découvert un corps sans vie. Un homme, natif de Saint-Brieuc, âgé de 68 ans selon sa carte d’identité. Il gisait recroquevillé derrière un bosquet d’ifs. À première vue, le décès s’apparentait à une mort naturelle, rupture d’anévrisme ou infarctus. À deuxième vue, les traces de strangulation autour du cou démentaient cette hypothèse, il s’agissait d’un meurtre ! Et pas n’importe lequel puisque le criminel avait signé son forfait de façon provocante. Le message laissé sur la scène du crime inquiétait les flics les plus blasés :
« Mission Apollo 1.
La place des résidus est à la déchetterie.
Je balaie la planète pour nos enfants.
Ce n’est qu’un prélude au crépuscule des vieux. On se verra plus tard.
Apollon »