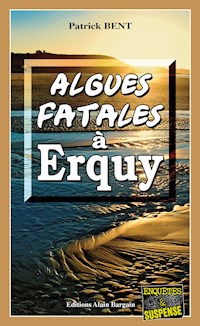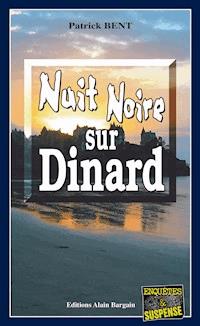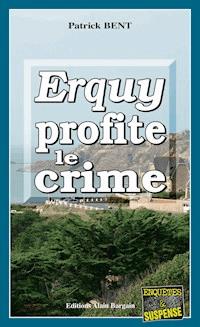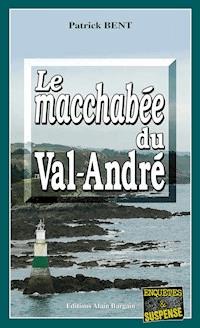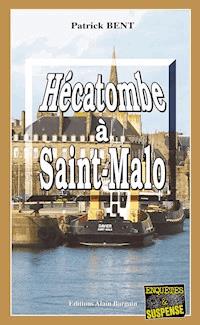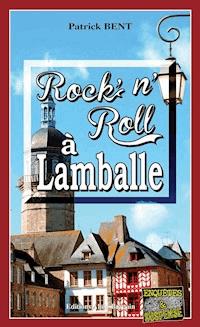
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Les enquêtes du commissaire Marie-Jo Beaussange
- Sprache: Französisch
Poussé par la fatalité, un jeune artiste peintre se transforme en hors-la-loi...
Sébastien Flanel, un jeune artiste peintre, s’est installé à Lamballe. Sa petite famille vit chichement sur le salaire de sa compagne. À l’occasion de la braderie d’été, Sébastien parvient à vendre son premier tableau. C’est le début d’un rêve fou, vite brisé par une succession de coups durs entraînant le jeune papa à enfreindre les lois et les conventions sociales contre son gré ; sa rencontre avec la commissaire Beaussange sera déterminante. Au fil d’une enquête échevelée au cœur du Penthièvre, Marie-Jo exhumera des secrets enfouis depuis l’après-guerre. Ses investigations la plongeront également dans les désordres du monde contemporain et il lui faudra déjouer la folie et les ambitions démoniaques d’adversaires puissants et retors.
Plongez au cœur de Lamballe, et découvrez le 5e tome des enquêtes bretonnes du commissaire Marie-Jo Beaussange, qui exhumera des secrets enfouis depuis l'après-guerre !
EXTRAIT
Indifférent au remue-ménage qui l’entoure, Sébastien Flanel replie fébrilement son étal. Tremblant d’émotion, il dispose dans sa carriole les deux tréteaux, la
planche, le chevalet et la caisse de bois où il a rangé ses toiles, puis la valise où sont entassés en vrac ses invendus. Au comble de l’excitation, il attelle sa remorque à son scooter et quitte le centre-ville alors que l’église Saint-Jean sonne cinq heures. Dans sa précipitation, il pousse les gaz au maximum. Sa bécane
asthmatique peine à arracher la charge de baudet qu’il trimballe, le moteur en surrégime crache une fumée blanche comme si le pape venait d’être élu. En définitive, l’attelage se met en branle cahin-caha.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Éditions Bargain, le succès du polar breton. -
Ouest France
À PROPOS DE L'AUTEUR
Patrick Bent situe son dernier récit à Lamballe. Il signe là une intrigue plus « terrienne » que dans ses précédents ouvrages. La mer et la côte de Penthièvre restent cependant toutes proches et participent au décor de ce roman noir cuvée 2012. Physicien et voyageur, Patrice Benoit signe ici son septième opus aux Éditions Alain Bargain.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NOTE DE L’AUTEUR :
Cette fiction a pour cadre la ville de Lamballe. Les événements parfois surprenants qui y sont décrits le sont spécifiquement pour les besoins de l’intrigue. Ils sont imaginaires et ne prétendent en aucun cas mettre en cause la quiétude et la qualité de vie de la capitale du Penthièvre ni les manifestations publiques qui s’y déroulent.
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
À Luce.
« L’art de la police est de ne pas voir ce qu’il est inutile qu’elle voie. »
Napoléon Bonaparte,Maximes et Pensées.
À PROPOS DU “PLAN BLEU”
J’ai utilisé à des fins romanesques la trame d’événements s’étant réellement produits en 1947. Le nom des protagonistes a été modifié et je n’ai conservé pour le besoin de mon intrigue qu’une vision très partielle, voire « améliorée », de l’histoire du Plan Bleu. À cette fin, je me suis essentiellement documenté dans l’excellent ouvrage de Jean-Marie Augustin ainsi qu’à l’aide des commentaires proposés par Laurent Boussaton sur Internet.
PREAMBULE
DINO ET RIQUET
11 septembre 1958.
D’épais nuages plombaient le ciel. Depuis l’aube, l’atmosphère poisseuse étouffait les velléités des moindres courants d’air, l’orage menaçait. Une fois encore, la cuvette de Lamballe allait connaître le feu des éclairs. Dans l’immédiat, l’étang de La Ville Gaudu déserté par les pêcheurs affichait ce calme préludant aux batailles, pas un souffle ne ridait sa surface couleur de cendre. Pour une fois, les goélands ne disputaient pas leur nourriture aux poules d’eau. Tels des appeaux, ils flottaient immobiles sur la face argentée du miroir. En levant le nez, l’imposante architecture de la collégiale Notre-Dame se découpait sur fond de lavis par-dessus le rideau de végétation. L’édifice aux dimensions de cathédrale semblait veiller sur ses ouailles durant les dernières heures des vacances d’été car, dans deux jours, ce serait déjà la rentrée scolaire. À mille lieues de cette sombre échéance, le grand Dino et le petit Riquet – les inséparables – s’affairaient sur la berge, au beau milieu d’un fatras de planches, de cagettes et de bidons. Ces deux-là étaient cul et chemise, toujours prêts à tirer des plans sur la comète. Unis comme les deux doigts de la main, ils avaient si bien tanné le garagiste et l’épicier du bourg qu’ils avaient fini par rassembler les matériaux nécessaires à la construction de leur radeau. L’imminence de la mise à l’eau, ajoutée à l’humeur orageuse, décuplait leur excitation. Les deux garçons taillaient, ficelaient, clouaient avec frénésie.
Le plus jeune, Riquet, onze ans, entrait en sixième la semaine prochaine, en pension chez les curés à Dinan, par ordre d’un paternel intransigeant et officier d’active. La perspective de quitter le confort bourgeois de la maison familiale de Noyal n’enchantait guère le garçon. Cependant, dressé à obéir, il se pliait aux diktats parentaux. Après un passage chez le coiffeur – bien dégagé derrière les oreilles – il brûlait avec fièvre ses dernières heures de liberté. Futé et chétif, son imagination débridée faisait le bonheur du grand Dino.
Plus costaud, âgé d’une année de plus, moins à son aise à l’école, le jeune Italien avait débarqué avec ses parents voilà une dizaine d’années. Son père était venu tenter sa chance en France en s’installant comme maçon à Lamballe. À force de travail et de conviction, l’entreprise s’était développée, elle tournait désormais gentiment. Depuis l’âge de dix-huit mois, Dino avait grandi en Bretagne, il ne connaissait pas d’autre patrie. Par mimétisme et par crainte de paraître différent, il s’exprimait avec un accent du terroir un peu forcé. Assimilé à un véritable enfant du pays, il en avait intégré les codes et les comportements. Sa connaissance de la nature, sa force et son habileté manuelle impressionnaient beaucoup son jeune camarade.
Riquet la tête, Dino les mains, les deux formaient une paire indissociable. Accaparés aujourd’hui par la construction de leur chef-d’œuvre, ils assemblaient sans relâche les bidons dans les cageots, puis liaient chaque caisse à sa voisine de façon à confectionner une structure carrée dont la face cachée était lestée de galets. Des planches de récupération empruntées au père de Dino consolidaient l’ensemble sur les côtés. Au total, une vingtaine de cagettes formaient un ponton suffisant pour embarquer les deux garçons. Du haut de ses douze ans, Dino possédait une âme de coureur des mers, paré pour l’aventure au long cours. Plus réaliste, Riquet se contenterait d’un aller-retour sur l’île au milieu de l’étang. En effet, le récit du naufrage du Titanic qu’il avait lu dans Spirou tempérait ses ardeurs, sans pour autant le dissuader. Même si les “Belles Histoires de l’Oncle Paul” possédaient cette semaine un arrière-goût de plancton, l’attrait de l’île fantastique restait entier.
— J’installe un mât, hurla Dino en s’emparant du manche à balai qu’il avait subtilisé à sa mère.
— Tu crois qu’il faut mettre une voile ? Le vent va se lever… L’orage approche.
— Ça évitera de ramer, protesta le jeune Rital avec un sourire de vainqueur.
Le radeau pesait un âne mort, chaque mètre gagné pour le rapprocher de la rive coûtait aux garçons des efforts démesurés.
Au prix d’une bonne suée, ils atteignirent enfin la berge. Là, unissant leurs efforts, ils propulsèrent leur embarcation à l’eau non sans l’avoir préalablement assurée à un cordage. L’engin hésita d’abord à flotter, chancelant d’un côté, de l’autre, puis dansa quelques minutes avant de se stabiliser.
— Tout doux, tout doux. Tu vois, Riquet, c’est comme un cheval sauvage, il suffit de l’apprivoiser.
— Tu crois qu’il est calmé ?
— Bien sûr. Vas-y maintenant, déchausse-toi, prends ta pelle et monte ! Assieds-toi bien au milieu ! Je te rejoins avec la voile…
— Tu crois ?
— Vas-y ! À moi maintenant…
À l’instant où Dino prenait place, une risée agita les branches du saule voisin. La surface de l’eau se rida puis retrouva son calme. À deux mètres du rivage, les jeunes marins d’eau douce pagayaient comme ils pouvaient à l’aide de leurs pelles, mais leur radeau tournait en rond.
— Il faut nous coordonner, observa Riquet, ça ne va pas comme ça !
— Attends, je hisse la voile, rétorqua Dino en tendant un drap entre ses grands bras. Il avait renoncé au mât, trop compliqué à installer. Tu vois, on avance mieux…
— Peut-être, mais on penche !
— Pas grave, incline-toi de l’autre côté ! Vas-y, Riquet. Regarde, ça marche. Tutto bene !
Un éclair déchira les nuées, suivi immédiatement d’un grondement du tonnerre tandis qu’un coup de vent soulevait le clapot. À mi-chemin entre l’île et la rive, ballotté par les vagues, leur esquif incontrôlable valsait comme un bouchon. La pluie se mit alors à battre, à grosses gouttes, lourdes, violentes. En l’espace de quelques secondes, les deux enfants furent trempés comme des souches. Riquet avait toutes les peines du monde à conserver son équilibre. Cramponné au radeau, il n’en menait pas large malgré les fermes exhortations de son ami. Coupant court à tout dialogue, un nouvel éclair zébra le ciel alors que, dans un vacarme d’apocalypse, la foudre s’abattait sur l’île, vingt mètres devant eux. À travers le dense rideau de pluie, ils percevaient les lueurs d’un début d’incendie parmi les arbres fracassés. Pris de panique, Riquet se précipita vers son compagnon. Le radeau, déséquilibré, pencha brutalement, le gamin moulina l’espace de ses deux bras avant de tomber à l’eau.
— Accroche-toi au radeau ! hurla Dino.
— J’ai pas pied, j’sais pas nager ! s’écria Riquet, paniqué.
— Attrape le radeau, cramponne-toi, bon Dieu ! Tiens bon, Riquet, j’arrive !
L’orage redoublait, le déluge s’abattant désormais sur La Ville Gaudu réduisait la visibilité à moins d’un mètre. Insensible aux trombes d’eau, Dino écarquillait les mirettes afin de ne pas perdre de vue son camarade à qui il tendait la main. Cinquante centimètres à peine les séparaient, ils y étaient presque mais, au cœur de la bourrasque, le jeune Italien dut se résigner à fermer ses grands yeux noirs, matraqués par la pluie. Lorsqu’il les rouvrit, Riquet avait disparu. À sa place, un tourbillon saumâtre se refermait. Dino plongea immédiatement pour explorer le fond de l’étang. À l’aveuglette. Au terme d’une apnée à se faire péter les poumons, il remonta bredouille. Le souffle court, le regard aiguisé, il recherchait une trace de vie, un remous, un signe quelconque à la surface martelée inexorablement par les gammes sinistres de la pluie. Dino emplit une nouvelle fois ses poumons d’air humide et piqua tête la première vers l’abysse, sans parvenir à discerner quoi que ce fût dans la pénombre vaseuse. À grandes brassées de désespoir, il fouillait tous azimuts, lançant ses bras de droite et de gauche. Il heurta soudain quelque chose de mou qu’il agrippa. Une masse sombre prit forme devant lui. Il palpa et sut d’instinct ce qu’il lui restait à faire. D’une violente impulsion sur le fond, il parvint à remonter le corps inerte de son ami. S’efforçant de lui maintenir la tête hors de l’eau, il nagea jusqu’à l’île où il put enfin prendre pied sur la berge. Dans un dernier effort, il tira son copain à l’abri d’un chêne détrempé avant de souffler.
Mais Riquet ne respirait plus, le masque de la mort déformait son visage. Dino l’observa une poignée de secondes puis, le saisissant par les pieds, le secoua comme un tapis. À ce régime, la tête du jeune garçon dodelinait sur la mousse, docile, sans la moindre réaction. Dino s’obstina jusqu’à ce que son camarade tousse une première fois, puis une deuxième en régurgitant un bon litre de liquide noirâtre. Sauvé des eaux ! Alléluia ! Esquissant un sourire de satisfaction, Dino adossa le convalescent à l’arbre, il lui soutenait la nuque et le réconfortait pendant que Riquet recouvrait peu à peu des couleurs de vivant. Enfin rassuré, l’enfant adopta une respiration plus calme, la pluie hésitait désormais, le vent mollissait et les saules riaient.
PREMIERE PARTIE
I
SEBASTIEN
Samedi 30 juillet 2011, Lamballe.
Les guirlandes multicolores éclatent au soleil tandis que les haut-parleurs diffusent une gigue irlandaise. La fête bat son plein dans la rue du Val exceptionnellement livrée aux piétons, le temps de la braderie. Depuis le matin, l’odeur des galettes-saucisses et les effluves de beurre fondu excitent les papilles des gourmands flânant dans le centre-ville. Sur les trottoirs, les stands proposent pêle-mêle toutes sortes de marchandises, outils anciens, fripes, vaisselle, jouets, argenterie, instruments de cuisine, livres, CD, DVD, confitures maison, antiquités de toutes sortes. Les commerces ne sont pas en reste, rivalisant de couleurs et de vitrines aguicheuses. La grande braderie se termine ce soir dans une ambiance conviviale.
Indifférent au remue-ménage qui l’entoure, Sébastien Flanel replie fébrilement son étal. Tremblant d’émotion, il dispose dans sa carriole les deux tréteaux, la planche, le chevalet et la caisse de bois où il a rangé ses toiles, puis la valise où sont entassés en vrac ses invendus. Au comble de l’excitation, il attelle sa remorque à son scooter et quitte le centre-ville alors que l’église Saint-Jean sonne cinq heures. Dans sa précipitation, il pousse les gaz au maximum. Sa bécane asthmatique peine à arracher la charge de baudet qu’il trimballe, le moteur en surrégime crache une fumée blanche comme si le pape venait d’être élu. En définitive, l’attelage se met en branle cahin-caha. Parvenu au rond-point de La Ville Gaudu, Sébastien salue le cheval dans le champ face à lui, puis tourne à droite en direction de Vaumadeuc, La Hunnaudaye et La Poterie. Les cheveux dans le vent, impatient de retrouver sa dream team, il rit aux éclats. Dans quelques minutes, il annoncera son scoop à Anna et Romain. À la braderie, outre ses babioles habituelles, il a vendu l’une de ses toiles et empoché trois cents euros ! Du jamais vu. Bien entendu, cet argent va les aider à faire bouillir la marmite mais, surtout, il constitue une grande première. Jamais jusqu’à présent, il n’avait monnayé l’une de ses œuvres. Et aujourd’hui, sur un trottoir de Lamballe, une cliente d’une cinquantaine d’années tombe subjuguée par son Étude en bleu, un acrylique sur toile de 2010. Après un bref échange de banalités, la femme, émue aux larmes, sort une liasse de bons talbins de 20 et de 50 euros, le règle avant de prendre congé en lui laissant sa carte : Mathilde Lebranchais - Artiste peintre - Manoir du Pengoët à Maroué. Stupéfait, Sébastien en oublie de la remercier. Il est ailleurs, avec les anges. Les trompettes de la renommée l’assourdissent alors que la foule absorbe la silhouette un peu lourde de sa cliente. Bientôt, l’apparition s’évanouit, laissant Seb plus que sceptique. À l’ordinaire, ses œuvres éveillent au mieux un intérêt poli, voire de sympathiques encouragements. Mais là, un coup de cœur-coup de foudre et vlan ! Trois cents Zorros cash ! Du jamais vu ! Pour s’en convaincre, il tapote régulièrement la poche de sa chemise gonflée de billets en lançant des cris de joie. Un vrai gamin. Si son moteur le lui permettait, il pousserait une pointe de vitesse afin d’atteindre sans attendre son nouvel horizon. Mais, à vingt à l’heure, son scooter le rappelle aux dures réalités. Depuis le temps qu’il a délaissé ses études d’archi pour affronter son destin, après toutes ces années de vache enragée consacrées à la peinture, enfin, il reçoit l’ombre d’une reconnaissance ! Cette journée du trente juillet restera comme celle de l’envolée vers les cimes. Tout s’accélère soudain, Seb se projette un nouveau film. Finis les tontes de gazon, les épuisantes tailles de haies et l’entretien des jardins qui lui démolissent le dos. Il ne retournera plus la terre des autres, trop basse à son goût. L’occasion rêvée aussi de mettre fin à ses combines à deux balles puisqu’une vie d’artiste se profile dorénavant, la vraie avec un grand V, consacrée à la création. Le reste peut attendre, tout le reste y compris le projet de “Potager Des Gourmets”, le PDG imaginé par Anna. Une idée toute simple finalement, celle de proposer à des propriétaires de villas – de ces grandes maisons familiales qui pullulent sur la côte – de créer un coin potager dans leur jardin et de prendre en charge la préparation des sols, les semis et l’entretien. Ainsi, l’été venu, lorsque viennent les vacances, les légumes, fruits ou salades sont prêts à être consommés. Moyennant un petit supplément, Seb et Anna offrent accessoirement de cueillir ou de cuisiner les légumes. Du jardin à la table, sans efforts ni intermédiaires pour les clients. Un programme séduisant auquel adhèrent, paraît-il, beaucoup de stars de Beverly Hills. Une affaire de mode, certainement. Alors si ce système fonctionne à Hollywood, pourquoi la clientèle aisée de Dinard, du Val André ou de Saint-Cast ne s’y mettrait-elle pas ? L’idée est excellente mais pour dépasser le stade du projet, il faudrait pouvoir la vendre, créer le buzz, faire de la pub, avoir un blog, visiter les clients et, pour cela, disposer d’un peu de temps, de moyens financiers et surtout d’une voiture pour se déplacer. Or, ils ne possèdent ni l’un ni l’autre. Avec son job au GigaMart, Anna n’a guère de loisirs ; quant à Seb, il s’occupe de leur fils de deux ans tout en bricolant çà et là dans les jardins des voisins. Le couple fonctionne en mode survie et leur projet PDG moisit au fond des cartons. Tous deux assument cette situation, conséquence de leur décision de quitter Paris avec armes et bagages lorsqu’à la naissance de Romain, le studio de 15 m2 dans le XIIe arrondissement est devenu trop petit. La famille agrandie requérait davantage d’espace et de tranquillité. Il fallait partir. Après une semaine de réflexion, ils avaient jeté leur dévolu sur Lamballe. Par sa taille humaine, sa proximité de la côte et sa liaison TGV avec la capitale, la ville répondait à leur attente, sachant que, contrairement à Paris, le coût du logement leur permettrait d’y offrir une chambre à leur rejeton. De fait, la maisonnette qu’ils louent depuis deux ans à La Poterie possède trois pièces et un carré de jardin au fond duquel un appentis tient lieu d’atelier à Sébastien. Le jeune papa s’y enferme pour peindre chaque fois qu’il en a la possibilité, c’est-à-dire la nuit, lorsque son fils et sa compagne se reposent. Par chance, il est de ceux que quelques heures de sommeil suffisent à contenter, cela lui permet d’exercer son art en demeurant tout à la fois un papa de proximité et un compagnon amoureux. Du grand art de vivre.
Pour ne pas être en reste, Anna avait recherché un travail dès leur arrivée en Bretagne. Sans être trop regardante, elle s’était gavée de petites annonces, rédaction de CV et lettres de motivation, coups de fil, entretiens. À force d’essuyer des refus, elle avait appris. Sa persévérance avait payé puisqu’elle travaillait désormais chez GigaMart au rayon Pet Food. Sans être Byzance, cette solution était préférable au Pôle Emploi. En dépit de son amour très relatif pour les animaux de compagnie, Anna avait sauté sur l’opportunité car un salaire reste un salaire. Aujourd’hui, la jeune femme déborde d’énergie, promue chef de rayon, elle compose tant bien que mal avec les odeurs de croquettes. L’intérêt qu’elle porte à son travail est secondaire, ses priorités se résument à élever son fils toujours plus haut et à pousser son artiste adoré, persuadée que son génie éclatera tôt ou tard.
De son côté, Seb a suivi une formation de jardinier et s’est inscrit aux chèques emploi service afin de rapporter lui aussi son écot. Mais il s’y prenait comme un Parisien et ses plantations ont crevé plus souvent qu’à leur tour. Résigné, il se limite désormais à la tonte des pelouses et à la taille des haies. Une exception toutefois avec le potager de Papi Yvon, un octogénaire habitant une maison isolée dans le voisinage, un ancien du Haras National de Lamballe. Souffrant de la maladie de Dupuytren, le vieil homme ne peut plus aujourd’hui serrer un outil ni retourner la terre. Aussi a-t-il demandé l’aide de Sébastien. D’emblée, les deux voisins se sont mis d’accord autour d’un verre, Seb s’occupe du potager sur les recommandations exclusives de Papi. Savoir-faire contre huile de coude, le deal est équilibré et les légumes bio profitent à toute la famille. Cependant, ses activités potagères rapportent trop peu à Sébastien Flanel qui, à chaque occasion, reprend son petit commerce de brocante avec l’indicible espoir de monnayer ses toiles. Dans les vide-greniers de l’été, il vend également des objets fournis par son copain Antoine. Seb y trouve son intérêt puisqu’il empoche la moitié des bénéfices sur la vente de ces marchandises sans avoir à se préoccuper de les approvisionner. Antoine s’occupe de tout et Sébastien se garde bien de lui poser des questions indiscrètes.
Bon an, mal an, à force d’imagination et de petits boulots, Anna et Seb parviennent à joindre les deux bouts sans jamais remettre en question leur fonctionnement. Leur petit Romain commence à parler, leur existence parfois inconfortable regorge de bonheur. Au fil du quotidien, leur relation est devenue mature. Seb adore Anna qui le lui rend au centuple.
La poignée des gaz à bloc, des larmes aux commissures des yeux, Seb se grise d’air tiède. Devant lui, la route dégagée et le ciel clair augurent d’un avenir radieux. À l’entrée du bourg, il fait un détour pour saluer le père Yvon. Papi prend le soleil sur le pas de sa porte, assis sur son tabouret, les deux mains rassemblées sur sa canne, coiffé de son éternelle casquette de marin bien qu’il n’ait ja-ja-ja-jamais navigué, Papi Yvon opine à la vue de Sébastien. Sous ses moustaches en broussaille s’ébauche un sourire pudique.
— Salut, Papi ! hurle Seb en coupant son moteur.
— Beau temps… Hum, demain, tu pourras ramasser les oignons, ils commencent à bien venir. Frais dans la salade, c’est bon. Mais il faudra aussi châtrer les tomates, je te montrerai. Après, tu retourneras le carré de salades. La terre est trop tassée.
— D’accord, Papi, je viendrai demain matin. Anna gardera le petit, c’est dimanche.
— Je compte sur toi.
— Pas de souci. En attendant, tu viens boire un coup avec nous, disons, dans une demi-heure ? J’ai acheté du cidre et des Gavottes.
— C’est la fête ?
— Oui, je t’expliquerai. À plus !
Deux kilomètres plus tard, Sébastien gare son attelage devant l’appentis dont la porte communique avec la ruelle. Debout sur la selle de son scooter, il jette un coup d’œil par-dessus la haie et découvre le jardin où Romain joue avec une auto en plastique déglinguée. Un peu plus loin, Anna est allongée sur le gazon, les yeux clos. Son maillot de bain souligne ses formes gourmandes de statue de Maillol. Anna déplie son corps avec grâce, elle se redresse sur ses coudes, ses cheveux noirs mi-longs flottent au vent. Elle est ravissante, désirable. Romain qui a délaissé son tacot, court vers elle, un bouquet de pâquerettes à la main. Elle lui tend les bras et, pareille à une affamée, l’embrasse avec frénésie. Seb les observe, attendri, son désir est retombé comme un soufflé, des larmes de joie le remplacent. En silence, il descend de son perchoir, s’empare de la bouteille de cidre et des crêpes dentelle avant de faire son entrée dans le jardin. Le gamin aussitôt court à lui en hurlant un « baba » attendrissant, puis s’accroche à sa jambe sans le lâcher. À l’apparition de son homme, Anna a d’abord froncé les sourcils avant de sourire de toutes ses dents lorsqu’il a brandi la bouteille de cidre bouché.
— T’as gagné au Loto ou quoi ?
— Mieux que ça, beauté !
— Tu veux me demander en mariage ?
— C’est une idée, mais il y a autre chose.
— Alors, tu as trouvé un client pour le PDG…
— Ça serait parfait, mais c’est encore mieux.
— …
— Langue au chat ?
— Ah non ! Ça me rappelle trop le boulot.
— Je voulais dire : joker…
— Joker !
— Eh bien, ma chère, j’ai le plaisir de t’informer que j’ai vendu ma première toile !
— Hein ? Super ! Laquelle ?
— Étude en bleu. Regarde, trois cents boules !
Seb empoigne les billets dans sa poche, les maintient à bout de bras dans sa main gauche pendant que, de la droite, il effeuille la liasse.
— Je t’aime, un peu, beaucoup…
Les coupures volètent au-dessus de la pelouse, Romain se précipite pour les attraper, mais sa mère intervient :
— À la folie ! C’est génial, Seb. C’est génial ! J’en étais certaine ! dit-elle en se blottissant contre lui.
— On va pouvoir vivre autrement peut-être…
— Tu vas arrêter les jardins. Pendant la journée, tu auras une autre qualité de lumière, d’autres inspirations, tu deviendras encore meilleur.
— Pas si vite, il faut d’abord que tu négocies un mi-temps au boulot. Pas question de faire autrement.
— C’est pas gagné, mais je vais essayer. Et puis, dans un an, le petit ira en maternelle. C’est super, Seb, c’est trop super !
— Ne nous emballons pas quand même… Ce n’est qu’un tableau, un début, mais mon acheteuse a l’air mordue. Elle a demandé à voir mes autres toiles…
— Pour en acheter d’autres ?
— J’espère, et puis si ça commence à marcher, on va pouvoir exposer dans une galerie, et puis voir avec l’office de tourisme, le musée, les journaux locaux, on fera marcher le tam-tam, ça peut décoller…
— Ça va décoller, tu veux dire !
— En attendant, on va arroser ça. Je mets la bouteille au frais. J’ai invité Papi Yvon. Il doit arriver dans dix minutes.
— Romain, tu entends ? Papivon vient nous voir, tu vas pouvoir lui tirer les moustaches. C’est trop génial, Seb, trop génial !
II
Samedi 30 juillet, soirée. Manoir du Pengoët.
Madame Lebranchais, née de Vermelce, s’affaire à ses derniers préparatifs. Ses invités ne sauraient tarder et, à son habitude, elle tient à superviser son dîner de A à Z. Après avoir livré ses ultimes consignes à l’office, elle s’attarde dans la salle de réception où la longue table est dressée pour cinq couverts. La vaisselle en porcelaine de Sèvres et l’argenterie sont en place sur la nappe immaculée. Bien que dehors il fasse encore clair, des chandeliers d’argent diffusent dans la pièce une lumière douce. Les ouvertures étroites du manoir justifient un éclairage d’appoint à toute heure du jour, témoin le lustre énorme mais éteint, suspendu au plafond. La pendulette dorée sous cloche de verre égrène huit tintements cristallins, annonciateurs de l’arrivée prochaine de ses hôtes. Mathilde lève les yeux vers la cheminée, le trumeau lui renvoie l’image d’une femme mûre, vêtue d’une robe de soirée au décolleté sage. Sa nouvelle coiffure et sa couleur blond vénitien sont tout à fait seyantes, elles allongent son visage où resplendissent deux yeux verts chargés de mascara. Les soins de peau et les injections d’acide hyaluronique lui permettent de tricher avec le temps, à peine si quelques tavelures éparses trahissent sa vérité. Certes, ses formes se sont alourdies mais, à l’approche de la soixantaine, elle conserve tout son pouvoir de séduction malgré ses épaules un peu fortes. Ne vaut-il pas mieux faire envie que pitié ? S’approchant du miroir, elle pince ses lèvres charnues afin de mieux répartir son rouge. Au-dessus d’elle, accrochés aux murs lambrissés, les portraits des aïeux Lebranchais – des huiles sur toile – la contemplent, l’œil sévère. Hommes et femmes possèdent tous ce même air pète-sec et ce port de tête altier. Une lignée de rigides dans laquelle la plupart des hommes arborent des uniformes constellés de décorations. Chez les Lebranchais, on collectionne les médailles car on veille sur la nation avant toute chose. Mathilde ressent une sorte de gêne sous le feu de ces regards figés : ses ancêtres par alliance la jugeraient-ils ? Qu’auraient-ils pensé d’elle, l’artiste, la dernière épouse du dernier maillon survivant de la dynastie ? Du moins de ce qu’il en reste car, à 81 ans révolus, le général Lebranchais connaît quelques soucis de santé. Incapable de tenir debout, il se déplace en fauteuil roulant et ne sort de sa bibliothèque que pour prendre ses repas ou gagner sa chambre. Aurélien Lebranchais conserve cependant toute sa tête qu’il emploie, résigné, à rédiger un traité de philosophie politique. En effet, ses mémoires de guerre n’ont jamais trouvé preneur en dépit de sa foisonnante carrière. Une histoire commencée en Indochine où, jeune sous-officier au 6e BPC, il s’illustra aux côtés de Bigeard, à Dien Bien Phu, puis quelques années plus tard, en Algérie. Là, après un flirt appuyé avec les colonels putschistes, il tourna délibérément son treillis dans le sens du vent. Promu général de brigade, Aurélien Lebranchais étrenna ses deux étoiles au Tchad avant de lustrer ses derniers pantalons d’uniforme au Ministère de la Défense, jusqu’à l’âge de cinquante-sept ans, quand l’insatiable baroudeur décida enfin de se ranger. À la recherche de l’épouse idéale qui l’accompagnerait vers la sortie, il jeta son dévolu sur la jeune et jolie Mathilde de Vermelce, nièce de son grand ami et mentor, le comte du même nom. De vingt-cinq ans sa cadette, mademoiselle de Vermelce se laissa cependant séduire par le sémillant militaire, homme serein et fortuné, au surcroît en excellente forme physique, amateur d’art et d’exotisme. Mathilde qui avait toujours pratiqué la peinture, trouva dans cette union la possibilité d’exercer son art sans souci des lendemains. En quelque sorte, elle épousait un mécène.
Aujourd’hui, en retraçant le chemin parcouru, elle ne regrette rien car, face à des contraintes minimes, son choix conjugal l’a autorisée à conduire de front ses trois passions, la peinture à l’huile, la cuisine et sa fringale obsessionnelle des hommes. Sur ce dernier point, Aurélien s’est toujours montré compréhensif compte tenu de leur différence d’âge. Depuis dix ans déjà, il lui lâche la bride sur le cou. Forte de cette relative liberté, appuyée sur ses trois fondamentaux, Mathilde déguste la vie sans oublier pour autant l’entretien du domaine du Pengoët. La maîtresse de maison met un point d’honneur à ce que son intérieur autant que les quatre hectares de prés, forêt et étang du parc soient impeccablement tenus. Pour y parvenir, elle emploie Hélène, une femme de chambre-gouvernante logeant au manoir, et un jardinier-garde-chasse. Célibataire, âgé de cinquante ans, Norbert habite à Noyal et vient tous les matins au château, sauf le dimanche. Madame Lebranchais règne d’une main de fer sur son petit empire, elle entoure son mari de beaucoup d’égards, et, lorsqu’elle ne peint ni ne cuisine, se réserve de temps à autre des cinq à sept coquins en ville. Mathilde ne doute de rien sauf peut-être de ses véritables capacités d’artiste peintre. Au fil des vernissages dans les galeries de Dinard, force lui a été de constater ses propres limites. Lucide sur ses capacités, elle préfère encourager les jeunes talents, ne peignant elle-même que pour son plaisir et n’offrant ses toiles, en exclusivité, qu’à ses amants.
Elle esquisse un sourire à l’adresse des portraits accrochés aux murs, les dévisage longuement, l’un après l’autre. Et eux ? Et elles, ces grandes bourgeoises, épouses de soldats, se sont-elles morfondues dans l’attente du retour possible de leur guerrier ? Son expertise des boudoirs lui permet d’en douter. Particulièrement Henriette Lebranchais, née Foutoir (1824-1876) dont le regard étincelant trahit la gourmandise. Derrière son chemisier de dentelle et ses dehors collet monté sommeillait à coup sûr la bête, celle qui dévore les cœurs et pénètre l’entrecuisse. Aucun doute.
Le crissement des graviers de la cour la tire de ses rêveries. Écartant l’épais rideau, elle découvre en contrebas le Porsche Cayenne noir aux vitres teintées. Les deux occupants en sortent pour se diriger vers l’entrée. À distance, les silhouettes se ressemblent à s’y méprendre. Depuis son poste d’observation, Mathilde repère Henri à sa calvitie affirmée, seul détail le distinguant de son fils. Vêtus d’un costume sombre et d’une chemise blanche à col ouvert, les deux hommes se déplacent sans gestes superflus. Efficaces, discrets, fluides comme à l’accoutumée. Henri de Caduce atteint le perron le premier, suivi comme son ombre par Horace. Mathilde exulte à l’idée de revoir enfin ses amis après les épreuves qu’ils viennent de subir, particulièrement Henri, son ancien complice.
La cloche de l’entrée retentit. Hélène, la femme de chambre, se précipite pour leur ouvrir tandis que Mathilde demeure à l’étage, le temps de rejoindre Aurélien. Lorsqu’elle entrouvre la porte de la bibliothèque, le vieil homme a déjà rangé son bureau. Pas un papier n’y traîne, un ordre strict règne dans la pièce. Des centaines d’ouvrages rangés au garde-à-vous occupent les rayonnages disposés sur trois des quatre murs. Du sol au plafond, les archives familiales côtoient les traités de stratégie et quelques très grands classiques. Des livres d’histoire aussi dont le cuir des reliures dégage les effluves d’un passé refusant de tomber aux oubliettes. Les exploits de générations de Lebranchais péries en mer ou mortes au champ d’honneur. Mathilde apprécie le mélange de certitudes et de religiosité émanant de ce lieu. Attendrie, elle observe son époux effectuer un impeccable demi-tour sur place, puis avancer vers elle. Vêtu de sa sempiternelle robe de chambre de soie couleur bordeaux, l’homme rectifie la position, réajuste les médailles ornant son plastron, puis esquisse un sourire fugitif. Mathilde se place derrière le fauteuil, baise tendrement la tempe de son compagnon avant de l’entraîner vers la salle de réception.
— Bonsoir, Aurélien, nos invités arrivent…
— À la bonne heure ! J’éprouve chaque fois une grande joie à les retrouver en dehors du conseil d’administration. Vous savez toute l’estime que je porte à Henri. Il est en quelque sorte le fils que je n’ai jamais eu. Nous partageons tant de choses depuis si longtemps ! Je commençais à me morfondre. Plus de six mois qu’il ne nous a rendu visite !
— Il ne faut pas lui en vouloir. Le brutal décès d’Alice l’a tant affecté ! Il en est resté longtemps sous le choc. Je l’ai appelé maintes fois, je lui ai réaffirmé notre amitié par courrier, mais jusqu’à la semaine dernière, il ne répondait pas. Il ne décrochait pas même son téléphone.
— Chagrin ! Il est vrai qu’Henri adorait son épouse. Le coup en a été d’autant plus féroce. Dieu merci, dans cette épreuve, ses enfants l’ont solidement épaulé. Horace possède une sacrée carapace et Bérénice n’a pas son pareil pour tempérer les heurts et les humeurs du quotidien. Henri a fichtrement bien fait de leur confier les rênes du laboratoire. Ainsi, il peut consacrer toute son énergie à la fondation sans se disperser dans la gestion de l’entreprise. C’est excellent pour les affaires, les actionnaires ne s’y sont pas trompés. Depuis le passage de témoin, AesclepiosLab SA caracole aux avant-postes du CAC 40. Mais les voici qui arrivent, ils nous en diront davantage…
— Bonsoir, Henri, bonsoir, Horace ! s’exclame Mathilde en descendant à leur rencontre. Je suis tellement heureuse de vous revoir, cela fait si longtemps… Mais, Bérénice ne vous accompagne pas ?
— Elle ne t’a pas appelée ? Malheureusement, elle ne pourra pas être des nôtres. Nous l’avons déposée au TGV. Une urgence à Paris pour régler les derniers détails avec l’agence. Le lancement du Cholrector requiert toute notre attention.
— Colrector ?
— Avec un H après le C. C’est le nom de code d’un nouveau traitement contre le cholestérol. Nous devons être opérationnels à l’automne, lorsque les brevets de nos concurrents tomberont dans le domaine public. L’enjeu est colossal ! Je ne peux fermer les yeux sur un marché de dix milliards de dollars par an. Nous travaillons le juridique, la communication, le packaging, rien de doit être laissé au hasard. Nous devons être prêts à l’heure, comme le train qui a emporté Béré vers la capitale.
— Les temps changent ! déplore Mathilde. On disait autrefois Ladies first, de nos jours, c’est devenu Business first. J’aurais tant apprécié revoir ma Bérénice !
Un haussement d’épaules traduit la déception de Mathilde qui, s’emparant du bras d’Henri, lui plaque deux bises appuyées en souriant de toutes ses dents.
— Enfin, je te retrouve ! lui susurre-t-elle à l’oreille puis, se retournant, elle salue Horace :
— Alors, voici le nouveau PDG ! Félicitations et encore bravo à vous deux ! Venez, montons célébrer cet événement comme il se doit…
Saisissant chacun des hommes par un bras, elle les entraîne vers le palier où les attend le général.
* * *
AesclepiosLab – AL pour les initiés – était à l’origine un modeste laboratoire pharmaceutique qu’Henri de Caduce racheta dans les années 70. À cette fin, il dut s’entourer d’investisseurs car il ne possédait pas les capitaux suffisants pour se lancer seul dans l’aventure. Plutôt que de solliciter des banques, il fit appel à son entourage et à ses proches. Ainsi, le général Lebranchais, grand ami du père d’Henri, participa-t-il grandement au tour de table. Financé à hauteur de ses aspirations, le jeune entrepreneur décolla comme une fusée, débordant d’énergie et d’idées novatrices. Sous son impulsion, l’entreprise connut un développement prodigieux.
C’était l’époque des minijupes, des Beatles, de Bob Marley et du « Faites l’amour pas la guerre », adage qu’Henri avait pris à son compte, picorant l’existence à chaque occasion jusqu’à ce que sa vie bascule par hasard, une soirée de juin. C’était au cours d’un cocktail à l’ambassade du Canada, un de ces rassemblements d’industriels, de banquiers et de militaires qui alimentent le lobbying international. Un événement d’un romantisme très relatif. Cependant, c’est là qu’ils s’étaient rencontrés, lui dans son costume d’entrepreneur, Alice dans sa fonction de chargée de communication de l’ambassade. Dès leur première poignée de main, au simple contact de leurs peaux, Henri avait su. Les délicieux frissons ressentis dans l’échine ne pouvaient le tromper, la femme de sa vie se tenait devant lui, blonde, jolie toute en grâce diaphane, le sourire mystérieux, le regard insondable. Outre son accent québécois, Alice exhalait un charme insolite auquel Henri avait succombé sans lutter, trop heureux de passer la soirée en sa compagnie.
Ils s’étaient fréquentés, revus, unis. Installés ensemble pour fonder une famille, ils avaient vécu quarante années de bonheur, émaillées certes d’accrocs mais, en définitive, l’ensemble de leur œuvre méritait un triple A, notamment leurs deux enfants, Horace et Bérénice.