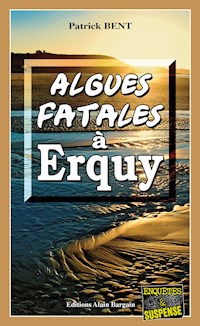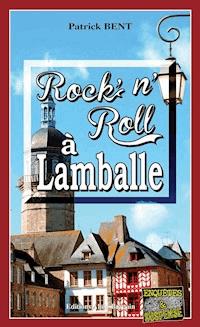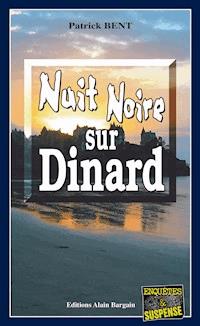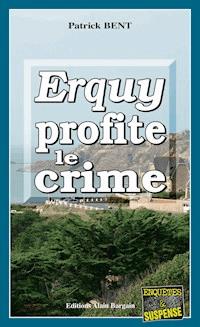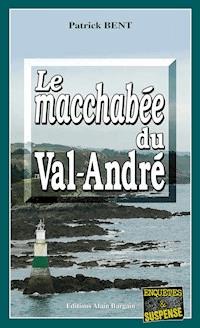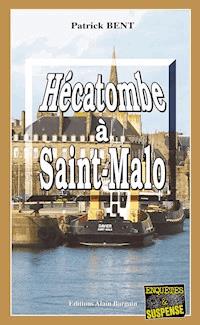Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Les enquêtes du commissaire Marie-Jo Beaussange
- Sprache: Französisch
Quatre dates espacées de presque un siècle… et pourtant reliées par une mystérieuse affaire
– Août 1927 : classement officiel de Sables-d’Or-les-Pins comme “station climatique et établissement de jeu”.
– Janvier 1944 : le maréchal Rommel déjeune avec les hommes de troupe au cap Fréhel.
– Janvier 2013 : Marie-Jo démissionne de la police. L’ex-commissaire Beaussange se consacre désormais à ses chambres d’hôtes.
– 2019 : les éoliennes off shore de la baie de Saint-Brieuc produiraient leurs premiers kilowatts ?
Quatre événements sans lien apparent, et pourtant…
D’un cap à l’autre, d’Erquy à Fréhel, en passant par Sables-d’Or-les-Pins, Plurien ou Plévenon, Marie-Jo renoue avec sa passion de l’investigation pour démêler l’écheveau d’une intrigue enfouie depuis belle lurette.
L’indicible n’est pas loin…
Avec ce tome 8 des enquêtes du commissaire Marie-Jo Beaussange, Patrick Bent trempe sa plume dans l’histoire locale pour nous emmener sur les chemins escarpés d’un étonnant thriller !
EXTRAIT
Dans la période difficile qu’elle affrontait, Marie-Jo cherchait à s’éblouir. Toutes les solutions étaient bonnes pour traverser le désert où elle s’était aventurée.
Il y a trois mois, au terme d’une réflexion mûrement mijotée, la commissaire Beaussange avait démissionné de la police. Cette fois-ci, sa hiérarchie avait acté sa décision sans prétendre la retenir. Depuis, le commissariat de Saint-Malo était orphelin. En regardant dans le rétroviseur, Marie-Jo ne regrettait ni son choix ni ses dix années d’engagement. Dix années trépidantes, pas tout à fait inutiles à en juger par le nombre de malfrats, d’escrocs ou de pervers qu’elle avait mis hors jeu. Ses méthodes peu orthodoxes ne l’avaient pas empêchée de se constituer l’un des plus beaux tableaux de chasse de la profession. On la jalousait au
36 quai des Orfèvres, on la haïssait dans les cours de prison. Mais à présent, la miss avait atteint la saturation.
Si elle avait pris du plaisir à faire son boulot, les dérives voire les magouilles de certains de ses collègues avaient fait déborder le vase.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Editions Bargain, le succès du polar breton. –
Ouest France
À PROPOS DE L'AUTEUR
À Erquy,
Patrick Bent partage son temps entre les copains, la navigation, l’écriture ou la pêche au gré des saisons littéraires… Voyageur étonné, sa curiosité et sa gourmandise le conduisent occasionnellement à parcourir le monde. Auteur de nombreux articles scientifiques et techniques, puis d’un premier roman à compte d’auteur, Patrick a rejoint l'équipe des Éditions Alain Bargain en 2003. Patrick Bent apprécie les rencontres, la cuisine asiatique, le roman noir, les BD tendance Tardi-Pratt-Franquin, le haut médoc, la pêche au bar… Parmi ses auteurs “noirs” fétiches il admire particulièrement les regrettés Thierry Jonquet et Pascal Garnier.
Patrick est venu au monde en 1947. En dépit d’un lourd passé de physicien et d’une carrière consacrée aux lasers, c’est dans l’écriture qu’il s’épanouit aujourd’hui.
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -
Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
REMERCIEMENTS :
- À Luce, ma compagne au quotidien,
- À Joël Gorguès pour ses archives familiales,
- À la Bouquinerie de Plurien – Annie et sa maman – pour leurs souvenirs et leurs documents,
- À Pierrette pour ses cocktails, Bar le Tue-Mouches, Plurien.
- À toutes et à tous, un énorme merci !
PRÉAMBULE
L’orchestre de Nino Pataquez avait attaqué la soirée sur les chapeaux de roue. Ses rythmes endiablés affolaient le public malouin ; dans la salle, on dansait debout en frappant dans les mains, c’était chaud-bouillant ! Tout près de la scène, Marie-Jo se trémoussait sans perdre des yeux le bassiste, un garçon dont la gueule semblait dessinée par Hugo Pratt. Plutôt râblé, la trentaine copieuse, il dégageait une énergie fantastique. Sa manière de se pencher pour atteindre le registre le plus aigu de sa contrebasse avait quelque chose de charnel. Les bras lovés autour de l’instrument, il en arrachait des notes inattendues, comme des râles de jouissance. Ce type dégageait une sensualité particulière, inexplicable. Emportée par les accents de la bossa, la miss ferma à demi les paupières. Elle transpirait. Un instant, elle imagina son corps vibrant à la place de la contrebasse entre les mains du musicien. À la fin du morceau, elle jugea plus efficace d’inviter Roberto à boire un verre après le spectacle. Miss Beaussange possédait en effet des arguments auxquels peu d’hommes étaient capables de résister et, en dépit de sa petite forme du moment, elle convainquit rapidement le garçon de l’accompagner intramuros… jusqu’à sa chambre. Au lit, la dextérité du bassiste dépassait tout ce qu’elle avait pu imaginer, il l’avait initiée à des résonances insoupçonnées, de ces sensations insolites qu’elle adorait. Dans la période difficile qu’elle affrontait, Marie-Jo cherchait à s’éblouir. Toutes les solutions étaient bonnes pour traverser le désert où elle s’était aventurée.
Il y a trois mois, au terme d’une réflexion mûrement mijotée, la commissaire Beaussange avait démissionné de la police. Cette fois-ci, sa hiérarchie avait acté sa décision sans prétendre la retenir. Depuis, le commissariat de Saint-Malo était orphelin. En regardant dans le rétroviseur, Marie-Jo ne regrettait ni son choix ni ses dix années d’engagement. Dix années trépidantes, pas tout à fait inutiles à en juger par le nombre de malfrats, d’escrocs ou de pervers qu’elle avait mis hors jeu. Ses méthodes peu orthodoxes ne l’avaient pas empêchée de se constituer l’un des plus beaux tableaux de chasse de la profession. On la jalousait au 36 quai des Orfèvres, on la haïssait dans les cours de prison. Mais à présent, la miss avait atteint la saturation. Si elle avait pris du plaisir à faire son boulot, les dérives voire les magouilles de certains de ses collègues avaient fait déborder le vase. Avec ça, l’allégeance à une hiérarchie elle-même inféodée au pouvoir politico-financier lui était intolérable. Considérant sa liberté comme inaliénable, elle jugeait aujourd’hui sa fonction de flic incompatible avec son humeur. Le fond de l’air du temps fraîchissait. Dont acte ! Sans comprendre tout à fait sa démarche, ses collaborateurs l’avaient comblée d’éloges à son pot de départ. Ils s’étaient cotisés pour lui offrir une canne à pêche, comme à une retraitée. Marie-Jo avait ri jaune. Ses jolies lèvres couleur griotte avaient peu à peu viré à l’orangé, elle avait articulé des remerciements crispés puis s’était enfuie, la larme à l’œil et la gaule sous le bras.
De sa vie, la miss ne s’était jamais sentie aussi seule. Sans se projeter dans l’avenir, elle se contentait d’affronter le présent à cheval sur son unique certitude, celle de savoir ce qu’elle ne voulait pas. Que ce soit dans l’éducation nationale ou dans la police, ses deux expériences professionnelles l’avaient dégoûtée à jamais des grands corps de l’État. Ras-le-bol de ces pyramides vertigineuses où chacun se protège de l’étage au-dessus en démolissant le voisin du dessous ! Marie-Jo n’en pouvait plus des familles nombreuses, des problèmes de jalousie et des pacs contraints et forcés. Désormais, elle voulait vivre sans entraves, à son compte. Sans toutefois cracher dans la soupe, car la miss avait conscience de ses propres limites, de son sale caractère, mais surtout de sa préférence pour les partitions en solo plutôt que celles des grands orchestres. Le manque de liberté l’asphyxiait. L’air du commissariat lui était devenu irrespirable.
Depuis le soir de sa démission, elle écumait les discothèques de la région. Au gré de ses rencontres, elle cabotait d’aventures en petits matins blêmes. En cas de disette, elle se noyait Rue de la soif, souvent jusqu’à la fermeture du dernier bastion… Plusieurs semaines à ce rythme l’avaient fracassée jusqu’à ce qu’un regain de lucidité vienne frapper à sa porte, trois jours plus tôt. À l’évidence, son existence de papillon possédait le charme de l’imprévu, mais lorsque l’unique perspective de sa journée se limitait à cela, cet imprévu devenait attendu donc convenu. Retour à l’envoyeur, tournez en rond manège ! Sa vie courait après son ombre. Infoutue d’aligner deux pensées cohérentes, la miss se demandait parfois si, tel un cachet effervescent, son cerveau n’était pas soluble dans le temps. À mesure que les jours passaient, il rétrécissait, ses capacités s’émoussaient. Un matin cependant – à l’orée d’une gueule de bois – mademoiselle Beaussange avait pris conscience du pétrin dans lequel elle s’engluait. À l’égal de Jeanne d’Arc, des voix lui avaient susurré durant la nuit : « Électrochoc, Marie-Jo ! Remue tes jolies petites fesses ! »
Aussitôt dit, aussitôt fait. Sur un coup de tête, elle avait mis son appartement en vente puis acheté un billet d’avion direction Yangon via Kuala Lumpur. La semaine précédente, un étonnant voyageur rencontré au hasard d’un bar lui avait raconté son périple en Birmanie.
Le mec parlait bien, il était beau, sa fièvre de l’Asie était contagieuse. Depuis, l’idée avait fait son chemin de Saint-Malo jusqu’à Sagaing.
* * *
Le coup de gong avait cueilli mademoiselle Beaussange en plein potage. La pénombre brouillait le décor incertain qui l’entourait. Il lui fallut plusieurs minutes avant de prendre ses marques. Ce réveil assassin n’avait pourtant rien à voir avec le décalage horaire. Depuis quatre semaines qu’elle avait atterri au Myanmar, elle avait digéré son jetlag. Sa montre indiquait trois heures du matin, pas un rayon de lumière ne perlait du vasistas. Peu à peu, son environnement avait pris forme, le ronron du ventilateur s’était précisé. La cellule offrait un confort rudimentaire, un lit métallique, une commode, le tout réparti sur six mètres carrés. Abrutie de sommeil, elle s’était longuement étirée. Au ralenti, Marie-Jo avait passé une tunique de coton fin et un longyi1, puis avait rejoint le cloître où déambulaient des dizaines de nonnes au crâne rasé, toutes identiques.
Dans leurs amples robes roses, on aurait dit des clones qui auraient oublié leur séduction au vestiaire, à droite à l’entrée du couvent. Dans un silence sépulcral, chacune marchait, recueillie, en regardant ses pieds. Miss Beaussange avait pris place dans cette ronde des ombres. Suivant les recommandations des religieuses, elle se concentrait sur ses gestes. Notamment, elle décomposait ses mouvements afin de mieux percevoir l’action de chacun de ses muscles, de ses tendons, de son squelette. Cette première étape de la méditation, la plus facile, reflétait également les préceptes de la doctrine du theravãda, ou bouddhisme du Petit Véhicule, que Marie-Jo avait rebaptisé “Mini-Morris”.
Sans être totalement convaincue, la miss avait décidé de tenter l’expérience. Elle avait frappé à la porte d’un couvent de Sagaing où une brochure en anglais lui avait été remise. Ensuite, après avoir visionné une vidéo explicative, une religieuse francophone lui avait fait visiter les lieux. À l’issue de cette mise en bouche, elle avait accepté de jouer le jeu, c’est-à-dire de se plier à la vie de l’institution pendant quelques jours. Depuis, elle se consacrait à la méditation. Vu son tempérament, Marie-Jo avait présumé qu’elle ne tiendrait pas en place. En pratique, le rythme et les rites l’épuisaient. Chaque journée, le marathon recommençait, lever à trois heures pour une première séance dans le cloître jusqu’à la cloche de quatre heures et demie quand il fallait se rassembler pour le petit-déjeuner en commun. Et en file indienne, en silence, dans sa bulle individuelle ! C’était effrayant ! Chacune contemplait le vide, n’échangeant ni un mot ni un regard avec ses voisines. La demi-heure suivante était consacrée au nettoyage des chambres. Venait alors la première session de méditation assise, dans la pagode, face à la gigantesque statue de Bouddha. Durant la première séance, la miss avait souffert le martyre, car “assise” signifiait ici en position du lotus, une posture qu’elle avait toutes les peines du monde à tenir. Sa souplesse féline n’empêchait nullement des poignards de lui meurtrir les cuisses au-delà des dix premières minutes. Le supplice alors s’accentuait, la douleur gagnait toute la jambe percluse de crampes. Rapidement, sa seule pensée intelligente devenait : « Quelle position adopter pour moins souffrir ? » La recherche posturale appartenait, paraissait-il, au travail de méditation. Après plusieurs tentatives, la miss avait progressé grâce à des coussins judicieusement placés. Elle était alors parvenue à concentrer son attention sur d’autres sujets que celui de sa souffrance.
À 9 heures 30 venait le temps de la douche dans des sanitaires collectifs ; les nonnes rafraîchies partaient ensuite étudier tandis que Marie-Jo se livrait à une nouvelle séance de méditation déambulatoire jusqu’à 11 heures. De nouveau, la cloche retentissait. Alors, sorties d’on ne sait où, les novices convergeaient vers le réfectoire, un bol à la main. Après s’être déchaussées et avoir rangé leurs sandales au sol dans une impeccable géométrie, elles prenaient place en files indiennes tirées au cordeau. Son tour venu, chacune avançait vers l’escalier au pied duquel deux nonnettes lui distribuaient sa ration de riz. Dans la salle de restaurant, les demoiselles s’agenouillaient autour de tables circulaires par groupe de huit, selon un ordre bien établi. Le service était assuré par des orphelines du village prises en charge par le couvent. Mademoiselle Beaussange et les deux autres stagiaires faisaient table à part en respectant la même consigne de silence absolu. La nourriture était copieuse et variée, pas spécialement végétarienne. Il s’agissait de bien gérer son appétit, car ce deuxième repas était le dernier de la journée. Jeûne bouddhiste oblige ! Et il faudrait tenir jusqu’au lendemain matin…
De même que pour les postures, la miss avait mis son estomac au diapason. Petit à petit, elle était parvenue à maîtriser sa fringale du milieu d’après-midi sans toucher aux barres de céréales planquées sous son matelas. Les séances d’introspection se succédaient jusqu’à la tombée du soleil, alternativement debout ou assise. À 20 heures 30, les nonnes et les stagiaires disposaient d’une heure de détente avant qu’un ultime coup de gong envoie ce pieux petit monde au pieu.
Cinq journées à ce régime et soixante heures de méditation au compteur avaient eu raison des états d’âme de Marie-Jo. Totalement vidée, elle avait ressenti un apaisement inconnu, quelque chose de proche d’un état de grâce. Sans adhérer à la doctrine “Mini-Morris”, la pratique de la diète et les exercices de concentration l’avaient ragaillardie. Elle avait accompli une sorte de remise à zéro, déblayé les dernières scories occultant son horizon. À présent, elle était à nouveau dans les starting-blocks, prête à écrire une nouvelle page de sa vie. Sous les cocotiers de Ngwe Saung par exemple où, après son esprit, son corps pourrait à son tour donner toute sa démesure.
Son séjour d’une semaine l’avait enchantée. Dans cette Birmanie saignée pendant des années par la junte, les sourires foisonnaient, la gentillesse débordait à chaque coin de rue, les regards en disaient long sur la volonté de survivre. À côtoyer cette population, Marie-Jo nourrissait un fol espoir en l’avenir. C’est blindée d’optimisme qu’elle avait repris l’avion pour l’Europe, trois mois plus tard.
1. Sorte de jupe longue portée les Birmanes et les Birmans.
PREMIÈRE PARTIE1927, ANNÉE FOLLE
I
Au coup de clairon, des cris retentirent de proche en proche. « Gare à la mine ! » Les hommes lâchèrent aussitôt leurs outils pour plaquer leurs mains sur les oreilles. Dans la carrière, le temps s’était figé en arrêt sur image, le bruit des burins sur la pierre avait cédé à un silence de cathédrale bientôt déchiré par la déflagration. Le vacarme de l’explosion se répercuta en écho, il fit trembler la falaise avant de s’évacuer vers le large. Peu à peu, le cliquetis des outils travaillant le granite reprit. La charge avait creusé dans la roche une saignée vers laquelle Yannick et Jorge se précipitèrent. Compte tenu de l’orientation du front de taille et de l’inclinaison des bancs de grès, l’exploitation de la carrière Saint-Michel s’effectuait en gradins successifs vers le bas. Il leur fallut descendre plusieurs échelles pour atteindre l’excavation qu’ils examinèrent attentivement. Jugeant l’effet des explosifs satisfaisant, Yannick fit signe à Marcel de les rejoindre. Ils pouvaient attaquer.
Plusieurs heures d’un travail harassant leur furent nécessaires. L’un des hommes maintenait et orientait la barre à mine sur laquelle les deux autres frappaient tour à tour à l’aide d’énormes masses. Il fallait prendre soin de tourner la barre d’un quart de tour à chaque coup pour éviter qu’elle se bloque. L’outil progressait lentement dans la pierre, les carriers devaient se montrer patients, adroits et costauds, car parfois, la présence d’un silex ou un mauvais choix de l’angle d’attaque faisait que le burin rebondissait. Dans ce cas, l’énergie se répercutait dans le manche du marteau et l’opérateur récupérait la douleur dans son bras. Les trois hommes interrompirent leur ouvrage vers midi pour affûter la pointe émoussée de l’outil. La forge installée à demeure limitait les pertes de temps.
Ils firent une pause pour casser la croûte pendant que le forgeron acérait la barre à mine, après quoi, il leur fallut encore plusieurs heures de labeur pour libérer l’énorme bloc de pierre. Un mètre sur deux, soixante centimètres d’épaisseur, un monstre. Les trois gaillards étaient lessivés. À leur demande, le contremaître les rejoignit, il examina le caillou sous toutes les coutures, apprécia la qualité de la roche et prit la décision de la débiter. Une équipe de tailleurs prendrait le relais le lendemain. Les moellons et les pavés seraient alors remontés à dos de mule puis, à l’aide du treuil, jusqu’en haut de la falaise ; ils seraient ensuite chargés dans les wagonnets de la voie ferrée Decauville et acheminés jusqu’au cap d’Erquy. De là, le funiculaire les descendrait sur le quai jusqu’à l’embarcadère. C’est au prix de ces travaux de forçat que les Carrières de l’Ouest pavaient de grès les rues du Havre, Paris, Rouen, Dunkerque et de bien d’autres cités.
Quand la sirène libératrice retentit, Jorge se massa le dos, frotta ses mains l’une contre l’autre, passa sa veste, ajusta sa casquette et proposa à ses compagnons de venir boire « oune » coup à Plurien, chez Ginette. Pour se désaltérer après la journée de boulot. Depuis trois ans qu’il fréquentait les Bretons, Jorge Portander ne s’était pas totalement affranchi de son accent catalan, il baragouinait la langue de Molière, s’adaptait au gallo lorsqu’il taillait la pierre et connaissait le minimum vital de breton pour survivre sur un bateau de pêche. En définitive, Jorge pratiquait un sabir que lui seul était à même de comprendre. Marcel déclina son offre, sa femme l’attendait à Plévenon, il en avait pour presque une heure sur sa vieille bécane. Yannick, en revanche, était libre comme l’air, toujours disponible pour boire un canon, surtout avec son grand copain Jorge. Les deux garçons étaient cul et chemise, ils s’étaient rencontrés trois ans plus tôt sur une goélette au large de Terre-Neuve et depuis, ils ne se lâchaient plus.
Leur histoire avait commencé par un naufrage. Celui du “Real Pesos”, le navire battant pavillon espagnol sur lequel avait embarqué Jorge. C’était sa première campagne en tant que matelot. Les années précédentes, il avait fait ses armes comme mousse sous la férule d’un capitaine bienveillant, un vieil ami de ses parents décédés dans un incendie. Ce subrécargue l’avait en quelque sorte adopté et lui avait appris les ficelles du grand métier. Désormais, la pose de palangres et leur relevage en doris n’avaient plus de secret pour Jorge qui émargeait à part entière sur le rôle d’équipage. Son gabarit gigantesque et la dimension de ses battoirs imposaient le respect, ses collègues comme ses supérieurs le considéraient avec sympathie.
Cependant, s’il avait su protéger le garçon de la fureur des hommes du bord, le patron de pêche ne maîtrisait pas aussi bien les caprices météo. Une tempête d’une violence inouïe s’était abattue en pleine nuit sur le Real Pesos pendant que les marins dormaient. Le jeune Portander, alors âgé de dix-sept ans, n’avait dû son salut qu’à sa baraka et à sa constitution de colosse. C’était un costaud, un balèze tout en muscle. Grand, brun, les yeux noirs, il dépassait d’une tête les autres membres de l’équipage. Réveillé par les cris de panique et la gîte inhabituelle du bateau, il avait bondi de son hamac. Sur la passerelle, le capitaine, accroché à la barre, tentait tant bien que mal de mettre le navire à la cape. Il luttait, jetait toutes ses forces dans une bataille inégale. Dans son regard luisait la résignation d’un homme convaincu de la vanité de son combat, mais déterminé à le conduire jusqu’au bout. Jorge s’était approché pour l’aider ; son patron l’avait repoussé avec vigueur, lui commandant de foutre le camp illico, de récupérer un doris, s’il le pouvait, et de s’enfuir à toutes rames. Le jeune garçon n’avait pas hésité longtemps. Mû par son instinct de survie, il avait foncé au pied du mât pour dénouer les sangles retenant les canots. Sitôt détachées, les barques avaient valdingué sur le pont avant de s’éparpiller dans une mer déchaînée où elles dansaient, pareilles à des coquilles de noix. Au prix d’un effort inhumain, Jorge avait réussi à en maintenir une à bord ; il y avait pris place, s’était recroquevillé sur le siège et s’était laissé glisser à son tour dans les remous. Par chance, le doris n’avait pas chaviré au contact des vagues. Montant, descendant, tanguant, valsant, il avait miraculeusement conservé son assise. Entre deux éclairs, le jeune garçon avait entrevu le visage de la Vierge. Il lui avait adressé une prière expresse, car ses urgences étaient ailleurs, ramer, souquer, fuir sous le vent… Secoué par les déferlantes, le canot peinait à garder son équilibre. Arc-bouté sur ses avirons, ballotté, cinglé par les rafales de pluie battante, Jorge ne parvenait plus à percer la nuit ni à fuir les tourbillons provoqués par le Real Pesos s’enfonçant vers les abysses.
Incapable de s’orienter, le jeune homme avait galéré pour échapper au maelström quand, soudain, devant lui, des cris avaient retenti. Dans l’eau, un de ses compagnons se débattait avec la vie. Le naufragé gesticulait comme un pantin. Jorge avait souqué en direction de la voix, mais le vent le propulsait dans la direction opposée. À force de tirer sur ses rames, il était parvenu à rejoindre l’homme en détresse. C’était Pablo, un sale con. Jorge lui avait néanmoins tendu la main et l’avait hissé dans le doris. À deux, ils seraient moins seuls…
La nuit avait été apocalyptique, les deux marins frigorifiés avaient dû se blottir l’un contre l’autre pour ne pas crever de froid. Mais la Vierge avait entendu Jorge puisqu’au lever du jour, le vent avait molli et le ciel s’était dégagé pour faire place à un soleil réconfortant.
Au terme de deux semaines de dérive, en s’orientant comme ils le pouvaient, ils avaient atteint les rivages de Saint-Pierre où une brave femme les avait recueillis à demi morts. Épouse d’un marin disparu, Marie-Hélène les avait bichonnés comme ses propres fils. L’état de Pablo n’était cependant pas brillant, la présence d’eau de mer dans ses poumons avait provoqué une pneumonie aiguë. Marie s’était arrangée pour le faire transférer vers le navire-hôpital, le “Saint François d’Assise” qui croisait dans la rade. Il y serait en bonnes mains. Jorge, quant à lui, avait rapidement récupéré grâce à l’excellent régime de son hôtesse, trois repas par jour, une chambre chauffée et une attention permanente. Dès qu’il s’était senti en meilleure forme, il avait recherché un emploi de façon à rembourser Marie-Hélène pour son hospitalité. Ainsi Jorge avait-il embauché dans une gravière pour y trancher, saler et faire sécher les morues.
Sa vie à Saint-Pierre s’était organisée, Jorge payait désormais un loyer à sa logeuse, il s’était fait quelques amis parmi les ouvriers de la pêcherie et, malgré les conditions climatiques difficiles, les journées défilaient sans traumatisme. Cependant, à dix-huit ans, cette existence manquait de piment et de soleil.
Un soir, dans un café du port de Saint-Pierre, il avait croisé des Bretons en bordée. Leur navire le “Santez-Gwen” relâchait au Barrachois depuis le matin, pour des réparations de routine. L’équipage fêtait l’événement à la gnole et c’est dans cette ambiance d’euphorie que Jorge avait rencontré Yannick Lecarou, un gars de Plurien, son aîné de cinq ans environ, avec qui il avait sympathisé d’emblée. Le Santez-Gwen ayant perdu un homme pendant la traversée, le capitaine cherchait à le remplacer par un marin aguerri. Jorge s’était aussitôt porté volontaire, Yannick l’avait présenté à ses patrons et l’affaire avait été conclue dès le lendemain. Jorge avait fait ses adieux à Marie-Hélène et avait embarqué sans se retourner. À bord du Santez-Gwen, la complicité de Yannick et Jorge avait été immédiate. Trois mois de vie rude et de travail harassant avaient définitivement rapproché les deux garçons, leur solidarité leur avait permis de tenir le coup dans l’enfer de Terre-Neuve où c’était “Pêche ou crève”.
Lorsque, début octobre, la campagne s’était achevée sur les quais de Saint-Malo, Jorge s’était trouvé face au vide, avec son paquetage pour tout viatique. Il avait hésité à retourner en Espagne pour y passer l’hiver et rechercher un embarquement pour le printemps suivant. Mais comment s’y prendre ? Il ne connaissait plus grand monde là-bas. Le capitaine du Real Pesos n’avait certainement pas réchappé du naufrage. Selon les rumeurs circulant à Saint-Pierre, aucun survivant n’était réapparu. Alors l’Espagne ? Personne ne l’y attendait ! Alors, à quoi bon accomplir ce périple supplémentaire ? Yannick lui avait parlé de son pays des Côtes-du-Nord, de l’autre côté de la baie de Saint-Malo, non loin du cap Fréhel. Là-bas, les falaises de grès rose fournissaient de la pierre pour les constructions et les travaux publics. Même sur le déclin, cette industrie continuait d’activer une main-d’œuvre nombreuse. L’extraction du granite demandait de l’huile de coude et des biscoteaux, le métier était dur, sans concession, mais comparativement à la pêche sur les bancs, c’était la vie de château. Yannick, comme beaucoup de marins, travaillait habituellement aux carrières d’octobre à février en attendant son prochain départ pour Terre-Neuve ou Islande, en début de printemps. Il troquait temporairement ses sabots-bottes pour des sabots râpés. Jorge avait écouté son ami, la perspective de trouver un boulot pour passer l’hiver l’avait séduit, d’autant que Yannick lui proposait de partager sa chambre, le temps qu’il prenne ses marques.
Jorge avait été accueilli comme un deuxième fils par les parents Lecarou. Pendant leur première semaine à terre, les deux gaillards avaient participé aux travaux de la ferme à Plurien où la force herculéenne de Jorge avait fait merveille. L’après-midi, Yannick emmenait son copain découvrir la région, sur la côte et dans les carrières. Le soir, après le repas familial, les deux garçons finissaient leur journée à l’auberge du bourg ou poussaient parfois jusqu’au cabaret sur le port d’Erquy. Là, marins en goguette et carriers se croisaient, buvaient, chahutaient, chantaient ou se bagarraient sur le quai.
Au bureau d’embauche des Carrières de l’Ouest, le gabarit et la jeunesse de Jorge firent impression. On l’affecta à Saint-Michel, une des exploitations les plus difficiles. Il y travaillerait en équipe avec Yannick chargé de son apprentissage. Le maigre salaire de Jorge serait compensé par son hébergement au coron de la Fosse-Eyrand où il partagerait une chambrée avec trois autres ouvriers espagnols. « Bienvenue chez les sabots râpés ! » lui avait lancé le chef de chantier en lui présentant le rôle à émarger. Jorge y avait apposé maladroitement une croix en face de son nom.
Bien que situé sur la côte, le site n’était pas des plus riants. Les carrières creusées dans la falaise se trouvaient à environ 500 mètres de la mer face à l’îlot Saint-Michel. Exposé aux vents du nord, il y régnait en hiver un froid de gueux alors qu’en été, la chaleur pouvait y être étouffante. Dès le début du siècle, les premiers exploitants avaient bâti des habitats ouvriers. Aujourd’hui, plusieurs rangées de maisonnettes accolées, toutes identiques, hébergeaient la majorité des travailleurs. Certains logements abritaient des familles dont le père et les enfants étaient employés à la carrière. À la Fosse-Eyrand, les conditions de vie n’étaient pas pires qu’ailleurs, l’eau courait au robinet, une boulangerie proposait du pain sur place. Autour des maisons, des carrés de terre permettaient aux habitants de cultiver leur potager. Choux et patates, en hiver, tomates et salades, l’été, amélioraient l’ordinaire. Jorge avait emménagé avec trois de ses compatriotes, Miguel, Angel et José. Cette cohabitation le satisfaisait à un détail près, la proximité de la poudrerie. Ses camarades l’avaient rassuré ; jamais les réserves d’explosifs abritées par d’épais remblais de terre n’avaient causé d’accident. Dans la chambrée, les quatre hommes avaient vite sympathisé, l’usage de l’espagnol facilitait leurs échanges. Ravi de retrouver la langue de son pays, Jorge, d’ordinaire si peu prolixe, s’était fait un plaisir de raconter son histoire à ses nouveaux amis.
Le Catalan avait ainsi pénétré l’univers des carriers où sa force et son habileté lui avaient permis de s’affirmer rapidement. Ayant assimilé en quelques mois les techniques d’extraction, il aspirait à apprendre la taille de la pierre, un exercice moins pénible, vu de l’extérieur. En effet, les tailleurs besognaient, postés devant leur bac à sable plutôt que de crapahuter sur les falaises suspendues à une corde. Mais cela était prématuré, sa collaboration avec Yannick fonctionnait à merveille, les deux garçons s’entendaient comme larrons en foire et, en compagnie de Marcel, ils formaient la meilleure triplette d’extracteurs entre Fréhel et le cap d’Erquy. On ne change pas une équipe qui gagne ! Jorge avait dû se cantonner au boulot qu’il pratiquait depuis maintenant neuf mois, trop heureux d’avoir un travail à terre et de pouvoir en vivre. Car du côté de la grande pêche, les besoins s’étiolaient, les méthodes évoluaient et les embarquements devenaient aléatoires. Cette année, les propriétaires du Santez-Gwen avaient renoncé à armer pour Terre-Neuve. Leur goélette, impropre à la pêche à Islande, était restée à quai. Son équipage aussi.
Aujourd’hui, Jorge s’accommodait de sa nouvelle existence. Finalement, taper dans le granite pour en extraire la pierre ou prélever à la mer des tonnes de morue procédait d’une même démarche, puiser dans les tripes de la planète les ressources pour subsister. Bien sûr, les étendues maritimes lui manquaient, il se consolait avec des promenades sur la lande ou sur les quais d’Erquy. Là, le déhanchement gracieux des bisquines et les courbes trapues des doris lui donnaient l’occasion de rêver.
La présence assidue de Yannick à ses côtés avait facilité l’intégration de Jorge. Contrairement aux travailleurs italiens ou espagnols cantonnés à la Fosse-Eyrand, le colosse était accepté par les pêcheurs locaux. Son histoire forçait le respect, il était davantage l’un des leurs qu’un quelconque “Rital” un “Espingouin” ou un “Portos” de plus. De Plévenon à Erquy en passant par Plurien, que ce soit dans les carrières, les commerces, les bistrots ou sur les quais, Jorge était apprécié comme un enfant du pays.
*
— Qu’est-ce que tu bois, Yann ?
— Une bolée, et toi ?
— Vino tinto !
— Quoi ?
— Gwin ru ! je veux dire.
— Ginette, un pichet de cidre et une fillette de rouge !
— Ça vient, les gars !
La fumée de tabac gris collait aux murs du caboulot. En cette saison, le jour n’en finissait pas de finir et, par les minuscules fenêtres aux rideaux de dentelle, les lueurs du couchant suffisaient à éclairer la salle. Autour des tables, des hommes aux visages cuits et burinés. Les marins se distinguaient des agriculteurs ou des carriers à la nuance plus cuivrée de leur teint, cependant, ils possédaient en commun des mains aux dimensions de battoir à lessive. Seule présence féminine à bord, Ginette régnait sur son petit monde sans s’en laisser conter. Forte en gueule, la repartie cinglante, malheur à celui qui tentait de lui marcher sur les pieds ! Si d’aventure un buveur insistait pour se faire servir le verre de trop, « celui de l’arrogance et de la baston » comme disait la taulière, elle le flanquait à la rue sans discussion. Du coup, les ivrognes se tenaient à carreau et le troquet était plutôt paisible.
Au fond de la salle, un individu râblé que Jorge et Yannick n’avaient pas repéré au préalable se leva et s’avança vers eux.
— Salut, les anciens, je peux m’asseoir ?
— Si tu veux…
— Vous me remettez ? demanda l’homme.
— Attends voir, tourne-toi vers la lumière… Avec la barbe et la casquette en moins, oui ! Le trancheur !
— Bien sûr, c’est lui ! Rolland ! Hombre ! Que tal ? Qu’est-ce que tu fabriques dans le coin ?
— Dame, pas grand-chose ! Je suis comme vous, cloué à terre. Je me balade sur la côte, je loue mes services quand je peux. L’ambiance du bateau me manque, le contact avec le poisson aussi. Et vous ?
— Nous ? On bosse à la carrière. C’est dur, mais c’est un boulot. Avec ça, on arrive à se maintenir.
— Tu t’es marié, Yannick ?
— Non, pas encore.
— Tu as bien une petite fiancée ?
— Un peu… On a dansé deux ou trois fois ensemble au fest-noz avec Anne.
— Il préfère faire la fête avec moi ! ironisa Jorge.
— Pas seulement, finassa Yannick. Je peux même vous avouer que, pas plus tard qu’hier, je lui ai parlé…
— Et alors ?
— Elle a rougi, mais elle est d’accord !
— Alors ?
— Alors ? On attend la fin de l’été pour prévenir la famille. Anne travaille pour la saison à Sables-d’Or.
— Et toi, le matador, qu’est-ce que tu deviens ? demanda Rolland.
— Je casse des cailloux, je porte des tonnes de gravats chaque semaine, je vis dans la mine… Parfois, je rêve du large.
— Vous seriez prêts à repartir ?
— Avec Anne, c’est pas gagné ! répondit Yannick. Mais si c’est bien payé, pourquoi pas ? Dis toujours ! Tu as une combine ?
— Pas vraiment, mais monsieur Kerjaouen, l’armateur du Santez-Gwen, a décidé de remettre ça. Je suis chargé de recruter un équipage pour la prochaine campagne. J’ai pensé à vous. Il me faut des hommes de confiance, des bons.
— Il tourne pas rond, Kerja ! Une année, il arrête tout, l’année d’après, il veut repartir, il est maboul ou quoi ?
— On parle d’un nouveau projet, les gars ! La pêche en doris, c’est fini, adios ! Si vous me promettez de tenir votre langue, je vous en dirais un peu plus.
— Tu me connais, l’apostropha Jorge, je suis muet comme un bacalao.
— Et moi comme un pavé de grès rose, ajouta Yannick. Vas-y, Rolland, dis-nous…
— Voilà ! Le patron fait construire un vapeur, un gros pour chaluter. Il dit qu’avec ces navires, on peut obtenir des rendements quatre à cinq fois supérieurs à celui des voiliers. On sera une cinquantaine de marins, que des gars ayant déjà navigué. Des costauds ! Sur ce bateau, fini le boëttage des lignes et le canotage dans la brume sur des coquilles de noix. Tout le monde reste à bord, on pêche au filet, il faut remonter le chalut, trier le poisson et le préparer comme on sait le faire. Le chalutier est équipé de dortoirs chauffés avec des couchettes. Il y a aussi des cuisines, des WC. Le confort y sera bien meilleur. La paye, comme toujours, dépendra de la pêche, vous serez payés “à la queue”.
— La date de départ est fixée ?
— Pas encore. Probablement en mars pour arriver à Islande à la bonne saison. Si j’ai voulu vous rencontrer maintenant, c’est que j’imagine que vous avez des engagements et qu’il va falloir vous préparer à repartir. Vous avez un peu de temps. C’est comme ça, on se civilise.
— Ça paraît tenir la route… déclara Yannick.
— Si le moteur n’explose pas ! s’effraya Jorge.
— En tout cas, le bateau avance par tous les temps, qu’il y ait du vent ou non ! La traversée pour Islande prendra à peine deux semaines !
— Tu rigoles ?
— Pas du tout, c’est ça la modernité ! Alors on fait quoi, les gars ?
— Tu penses quoi, Jorge ? s’inquiéta Yannick.
— J’ai bien envie d’essayer, répondit-il après un temps de réflexion.
— Moi, je vais réserver ma réponse quelques jours. Ça me tente bien, mais je dois en parler à Anne.
— Je savais que je pouvais compter sur vous ! Topez là, matelots ! Je reviendrai vous voir en septembre avec les enrôlements, les dates de départ et tout le fourbi. Yannick, préviens-moi si jamais tu décidais de ne pas venir, tu m’écris chez l’armateur, à Saint-Malo. Madame, s’il vous plaît, du rhum pour fêter ça, et du meilleur !
— Gigi, à boire, por favor !
— Attention, vous deux ! Vous n’en parlez à personne. C’est moi et seulement moi qui choisis mes équipiers. Si j’apprends que vous avez causé, j’annule. Pas d’embarquement sur le steamer !
— On sait la fermer, Amiral ! Pas de danger. Allez, on trinque ?
— À la vôtre !
— À la tienne, Rolland ! Mais dis-nous, comment es-tu arrivé jusqu’ici ?
— Je me doutais que je vous trouverais dans le secteur. Un copain m’a débarqué à Saint-Cast où il allait livrer un chargement de bois exotique. Là, j’ai pris le petit train, c’est vachement pratique et c’est beau !
— Il paraît.
— Juste avant Plurien, à l’arrivée sur Sables-d’Or… quelle plage ! Et quelle jolie ville ! Depuis la voie ferrée, j’ai aperçu des voitures, des chevaux, d’énormes villas. On se croirait à Dinard !
— Tu sais, Rolland, ce sont surtout des Parisiens qui viennent à Sables-d’Or. Nous, on n’y met pas les pieds, on ne les connaît pas. Anne m’a dit que les hommes sont habillés en costume, les femmes en robe longue. C’est une station balnéaire, tu penses… Nous autres, on reste entre nous, on ne traverse jamais L’Islet.
— L’Islet ?
— C’est la rivière qui se jette dans les bouches de Sables-d’Or. Tu es passé par là avec le chemin de fer.
— Je vois ! Mais je ne comprends pas pourquoi vous n’allez pas regarder à quoi ressemble la ville. Vous n’êtes pas curieux ! Personne ne vous l’interdit et puis ça a l’air drôlement joli !
— « Tout ce qui brille n’est pas or », disait mammgozh.
— Qui c’est ? demanda Jorge.
— Ma grand-mère ! Et elle avait bien raison ! Je ne crois pas que cette nouvelle ville fasse partie de mon monde. Ces gens-là me foutent la trouille.
— La trouille ? À toi, Yann, qui a risqué ta vie sur les bancs et à toi, Jorge, le miraculé, vous auriez la pétoche de l’argent ? Vous êtes de drôles d’oiseaux ! Enfin, ça vous regarde. Moi, si j’habitais ici, j’y serais fourré tous les soirs. Il y a tant de belles filles !
— Tu restes souper avec nous, Rolland ?
— Certainement, mais c’est moi qui rince. Je vous invite, ici. L’auberge est bonne, m’a-t-on dit, et c’est Kerja qui régale.
II - I
De la terrasse de sa chambre, Mathilde admirait l’étendue de sable blond se perdant dans la mer. Au loin, la houle se mélangeait au ciel dans la brume du large. Telle une fillette devant une pochette-surprise, elle s’émerveillait de ce spectacle sans cesse renouvelé. Pour la deuxième année consécutive, madame Balutaire passait l’été dans la somptueuse villa que son mari avait fait construire à Sables-d’Or. Impliquée dans le projet depuis son origine, elle vivait dans ce qu’elle considérait aujourd’hui comme son palais. Depuis sa plus tendre enfance, Mathilde fantasmait sa vie en princesse. Son mariage avec un roturier n’avait en rien fléchi ses désirs. Peu lui importait après tout d’avoir laissé sa particule sur l’autel de ses épousailles – elle était née Minois de la Souche – du moment qu’Édouard gagnait suffisamment d’argent pour la combler. Sans doute y était-elle pour quelque chose. En effet, à trente ans tout juste révolus, elle lui avait donné deux beaux garçons, Gaëtan et Ludovic, qui faisaient leur fierté. La jeune femme menait sa famille tambour battant, focalisée sur la réussite professionnelle de son époux dont dépendait leur bien-être. Maîtresse de maison avisée, femme de devoir, économe dans le bon sens du terme, elle veillait sur son petit monde comme une mère poule. L’éducation de ses garçons, âgés de six et huit ans, requérait toute son attention, Mathilde leur consacrait beaucoup d’énergie.
Édouard, le mari, était son aîné de dix ans. Il travaillait dans l’immobilier. Négociateur hors pair, habile commerçant et fin diplomate, l’homme n’avait pas son pareil pour renifler les affaires juteuses. Son carnet d’adresses et son réseau de relations lui ouvraient l’accès aux plus hautes sphères de la capitale, là où les décisions se prenaient. Il évoluait comme un poisson dans l’eau, dans les coulisses du pouvoir. Rien d’étonnant donc qu’à la fin des années 20, il se soit associé aux promoteurs du fabuleux projet de Sables-d’Or-les-Pins. À leurs côtés, il y avait beaucoup investi de son temps et de son argent.
L’idée était aussi folle que belle ; à partir d’un site sauvage, il s’agissait d’édifier un paradis de luxe pour des touristes aisés. Pour cela, il avait fallu remodeler complètement la centaine d’hectares de dunes occupant le front de mer, les araser, puis percer de larges avenues et bâtir des hôtels haut de gamme, des commerces, un casino, des restaurants, un théâtre, un golf, des tennis… tout cela autour d’un concept original et dans un style architectural résolument nouveau. Confort, luxe, calme, volupté et modernité résumaient ce projet démentiel. Pour conduire leurs travaux pharaoniques, les financiers avaient fait appel aux meilleurs talents du moment, les frères Treyve, paysagistes de Vichy ou l’architecte Hémar connu pour son style anglo-breton, qui ne manqueraient pas d’attirer les clients britanniques. Bref, rien n’était trop beau pour permettre à Sables-d’Or-les-Pins de rivaliser avec Biarritz ou Dinard, voire de les surpasser.
Placé aux premières loges pour s’octroyer un terrain, Édouard Balutaire avait fait bâtir une villa en bordure de mer, six chambres plus des mansardes pour les domestiques, un séjour double, une salle de billard, une bibliothèque et une énorme cuisine. Au soussol, une buanderie et une cave à vin abritant une appréciable collection de flacons. Aujourd’hui, le palace imposait sa stature en haut du promontoire, ses murs blancs à colombages rouges et ses toitures d’ardoise dominaient l’océan. Au couchant, les baies vitrées reflétaient le feu du soleil, la bâtisse brillait alors comme un diamant incandescent. L’effet était des plus heureux. Une allée de gravier bordée de pins maritimes permettait d’accéder en automobile jusqu’à l’entrée de la maison. À l’opposé, côté mer, la lande abandonnée aux oyats et aux genêts avait un goût d’inachevé au regard de Mathilde. Docile, Édouard avait fait livrer des tombereaux de terre qui n’attendaient que le bon vouloir des jardiniers pour être transformés en plate-bande. Il avait promis à son épouse de s’en occuper à sa prochaine visite.
Mathilde coulait chez elle des jours si plaisants qu’elle en oubliait les absences répétées de son mari encalminé à Paris par ses affaires. Les journées de la jeune femme à Sables-d’Or se partageaient entre l’éducation de ses garçons, la vie mondaine et les bonnes œuvres. Elle lisait peu, juste ce qu’il faut pour alimenter les conversations. En dépit de la vogue sportive chez les garçonnes d’alors, elle ne pratiquait ni le tennis – les “Mousquetaires” avaient repris possession de la coupe Davis cette année – ni le golf. S’il lui arrivait de se déplacer à bicyclette dans la station, elle appréciait par-dessus tout les promenades en bord de mer ou dans les forêts de pins alentour. Notamment dans la quiétude bucolique de la vallée de Diane ou la Ronde du Bois d’Amour. Chaque après-midi, lorsqu’Édouard était absent, Mathilde retrouvait ses amies autour de l’étang et d’une tasse de thé, c’était l’occasion de s’informer des ultimes rumeurs circulant en ville. Ces derniers jours, les ragots allaient particulièrement bon train. En effet, le 14 juillet approchait et, cette année, la date marquait un triple événement. La fête nationale et ses flonflons, bien entendu, mais aussi le classement officiel de Sables-d’Or-les-Pins comme station climatique et établissement de jeu puisque, concomitamment, le casino serait inauguré. Le programme des festivités était exceptionnel, on attendait une foule énorme. Le train spécial prévu le 13 au départ de Montparnasse ainsi que les hôtels affichaient complet. Édouard ne voulait ni ne pouvait manquer ces réjouissances, il avait annoncé son arrivée le 12 dans la soirée en prévenant toutefois son épouse qu’il serait très accaparé par ses fonctions officielles le 14 et le 15. Quoi qu’il en fût, le couple Balutaire comptait parmi les invités d’honneur au gala du casino.
* * *