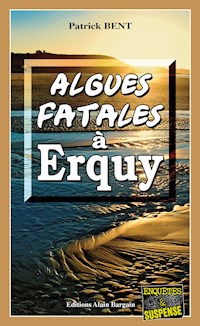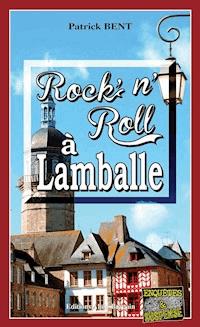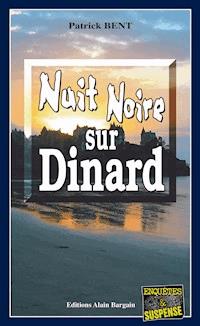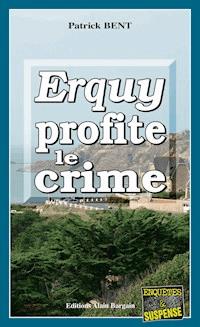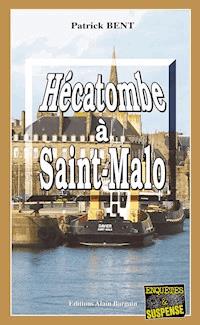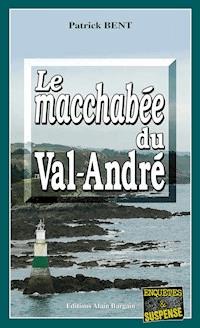
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Les enquêtes du commissaire Marie-Jo Beaussange
- Sprache: Französisch
Double énigme autour de la découverte d'un squelette de marin.
Printemps 2004 : Un paquet d'os non identifié est découvert à Dahouët.
Le mort n'est pas tout neuf. La plupart de ses contemporains reposent six pieds sous terre ou au fond de l'océan. Quant aux rares survivants, ils ont la langue en gelée ou racontent des salades.
Au fil de ses investigations dans le triangle Pléneuf-Val-André-Dahouët, la commissaire Marie-Jo Beaussange est amenée à revenir un siècle en arrière, quand la marine était à voile et les trains à vapeur. A l'époque, la morue valait de l'or et attisait les convoitises.
Marie-Jo, l'ex-professeur de collège devenue flic, devra utiliser tous ses talents pour éclairer les ténèbres d'une enquête particulièrement salée. Sa gourmandise de la vie, son QI et son look de déesse lui permettront-ils de résoudre le casse-tête de Dahouêt ?
Le tome 2 des enquêtes prenantes du commissaire Marie-Jo Beaussange vous plongera dans un passé mystérieux !
EXTRAIT
Les deux hommes se séparèrent à une dizaine de mètres de ma planque et, enfin, il s’approcha de chez lui, seul, saoul comme une bourrique. Une giclée d’adrénaline m’assaillit aussitôt. Je me redressai à demi, la barre à mine en main, prêt à bondir. J’avais hâte d’en finir. Les quelques mètres qui le séparaient de moi semblaient des années lumière. Le salaud tenait une telle biture qu’il ne trouva pas immédiatement la porte du jardin, ses jambes butèrent dans le muret. Il en perdit l’équilibre et s’enfonça dans les troènes derrière lesquels je me trouvais tapi. L’homme proféra des jurons mêlés de borborygmes. Sa respiration haletait et, sans pouvoir discerner son visage à travers l’épaisseur végétale, j’imaginais sa trogne avinée. Je l’entendis alors grommeler en fourrageant dans ses habits, comme s’il recherchait sa clef. Je me trompais : un jet de plus en plus puissant se fit entendre puis un liquide chaud me dégoulina sur le dos. Ce sagouin me pissait dessus en ânonnant pour lui-même : « Plus haut, salope ! »
Ayant remisé son fourbi, il poussa enfin le portillon pour s’engager dans le jardin. Depuis le temps que j’attendais cet instant, il était enfin à ma portée. Tout se passa très vite et très simplement. Je me redressai et lui abattis la barre à mine derrière la nuque.
À PROPOS DE L'AUTEUR
À Erquy,
Patrick Bent partage son temps entre les copains, la navigation, l’écriture ou la pêche au gré des saisons littéraires… Voyageur étonné, sa curiosité et sa gourmandise le conduisent occasionnellement à parcourir le monde. Auteur de nombreux articles scientifiques et techniques, puis d’un premier roman à compte d’auteur, Patrick a rejoint l'équipe des Éditions Alain Bargain en 2003. Patrick Bent apprécie les rencontres, la cuisine asiatique, le roman noir, les BD tendance Tardi-Pratt-Franquin, le haut médoc, la pêche au bar… Parmi ses auteurs “noirs” fétiches il admire particulièrement les regrettés Thierry Jonquet et Pascal Garnier. Côté cinéma James Gray, Roman Polanski, Pedro Almodovar, Joel et Ethan Cohen, Stanley Kubrick sans oublier l’immense Tarantino, tiennent la corde. Sa musique c’est le blues et certains compositeurs de jazz (Duke, Miles, Coltrane, et tout ce qui vient de la Nouvelle Orléans…).
Patrick est venu au monde en 1947. En dépit d’un lourd passé de physicien et d’une carrière consacrée aux lasers, c’est dans l’écriture qu’il s’épanouit aujourd’hui.
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -
Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près, ni de loin, avec la réalité, et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
« C’est pas l’homme qui prend la mer,c’est la mer qui prend l’homme… »Renaud Séchan
REMERCIEMENTS
A Luce dont le sourire et les souliers rouges éclairent mon quotidien,
À mes enfants et mes pitchouns,
À mes partenaires de pêche, pour leur indulgence,
À Bruno qui raconte si bien, et…
À tous les matelots à qui nous devons la brandade.
Mention spéciale à Alain Bargain et son équipe pour leur confiance et leur amitié.
PRÉAMBULE
Jour J moins 29 350.
Des pluies diluviennes s’étaient abattues sur le chantier autour de Plévenon ; aujourd’hui, l’équipe s’activait à remblayer le talus dans la descente des Hôpitaux car le trafic ne circulait plus depuis la veille. A peine établie, la liaison ferroviaire entre Erquy et Pléherel connaissait déjà des problèmes et le sommeil de l’ingénieur en chef s’en ressentait. Après tout, c’était son affaire. On le payait grassement pour ses cauchemars !
Quant à moi, j’avais mes propres préoccupations. Employé comme manœuvre par la Compagnie des Chemins de Fer des Côtes du Nord, je participais à la construction du petit train qui desservirait bientôt la côte jusqu’à Saint-Briac. Ce qu’on appelait le second réseau. Il restait encore deux années de travail pour établir la jonction de Matignon d’une part, et rallier Saint-Briac d’autre part. Travailler sur la ligne pour des salaires en peau de chagrin, c’était pas Byzance, mais en comparaison de ceux qui pratiquaient la pêche dans le grand Nord, nous menions une vie de château. Ah ! Ils faisaient le “grand métier” les autres, ceux qui naviguaient ! Certains même revenaient des brumes de Terre-Neuve avec de l’argent plein les poches, mais combien restaient au fond, couverts d’oubli, en laissant des orphelins et une veuve accablée de dettes. Quel dégât des eaux ! On prétendait qu’en six mois, les pertes en hommes sur les grands voiliers morutiers correspondaient au nombre de soldats tués pendant deux batailles rangées de l’époque napoléonienne. Joli score pour une partie de pêche ! Les temps changeaient, certes, mais les conditions de travail n’évoluaient guère pour les forçats de la mer.
De mon côté, le soir au campement, inconfortablement couché sous ma bâche humide et à demi intoxiqué par un feu qui dégageait davantage de fumée que de chaleur, je me sentais vivant. Vivant et libre de mes mouvements. Une vibration tellurique me portait, symbiose avec cette terre qui m’usait les bras toute la journée et à laquelle j’adhérais jusqu’à m’y fondre. Une existence de terrien succédait à mes aventures maritimes bafouillées. J’avais fait mon choix et ma présence ici, ce soir, s’imposait à l’évidence. La flamme de mes dix-huit ans brûlait dans mes veines. Je courais à la poursuite de mon destin.
Les travaux du chantier avaient cessé dès la tombée du jour, tout juste six heures sonnées à la chapelle. Certain de mon fait, je filai vers l’Ouest au lieu de rejoindre mes compagnons au campement de la Fosse-Eyrand. Ma barre à mine et ma pelle à l’épaule, je me dirigeai vers Erquy en suivant la voie ferrée. J’en connaissais chaque méandre. Le tracé correspondait au chemin le plus court pour atteindre ma destination et, à cette heure tardive, je ne courais pas le risque d’être dérangé ou surpris par un convoi.
La voie cheminait à travers champs avant d’atteindre la gare, puis, après avoir longé la chapelle, elle descendait en pente douce vers le viaduc de Caroual. Là, depuis le pont, l’horizon se confondait avec le sable et l’océan. Derrière moi, la silhouette des arbres se découpait dans le crépuscule pourpre. Pas un nuage ne maculait l’espace, quel contraste avec le déluge de la veille !
J’allongeai le pas, en ajustant mes enjambées à l’écartement des traverses. Fort à propos, les dimensions de la voie métrique du petit train s’adaptaient mieux à ma foulée que celles du réseau national. Ainsi évitais-je de m’essouffler et de m’épuiser avant le travail d’Hercule qui m’attendait. La vivacité de l’air brûlait mes poumons, j’exhalais des panaches de vapeur comme une Corpet-Louvet, les locomotives alors en fonctionnement sur la ligne.
Déterminé, je fonçais dans la pénombre à la recherche de ma vérité, avec la pleine lune pour compagne.
En arrivant à la halte de Saint-Pabu, une draisine abandonnée sur la voie de garage s’offrait à moi. Quelle chance ! L’aiguillage ne résista pas longtemps à ma barre à mine et l’engin se trouva rapidement sur la voie principale. Attention au départ ! Le véhicule s’actionnait à l’aide d’une pompe à bras et le démarrage fut poussif car je me trouvais seul à actionner le dispositif de traction prévu pour deux costauds. Néanmoins, je parvins à ébranler la machine puis à conserver une vitesse de croisière raisonnable pendant plusieurs kilomètres, jusqu’au vallon du Rau de Nantois. Là, une montée trop sévère m’imposa d’abandonner mon équipage. Je pris soin de basculer la draisine hors des rails pour éviter tout risque d’accident, puis j’attaquai la côte au pas de course. Du sommet, je devinais maintenant les premières maisons du bourg.
Un quart d’heure plus tard, tout essoufflé, j’atteignais Pléneuf où l’église sonnait les huit heures. Déjà ! Il était encore temps mais je devais me hâter. Je poursuivis ma course de plus belle, redoublant l’allure au risque de me casser la figure à plusieurs reprises. La crainte d’arriver trop tard me propulsait vers mon objectif.
Au sortir du bourg, le chemin de fer s’incurvait en descente jusqu’à la mer après avoir longé l’étang de Vauclair. On gagnait par là l’estuaire de la Flora, le fond du port de Dahouët, bien protégé à l’ouest, au nord et à l’est par des promontoires rocheux. Seul, le noroît parvenait à s’engouffrer dans le chenal et y chahuter les trois-mâts ou les goélettes en attente de départ.
Dahouët et moi, on se connaissait bien, Dame ! Chaque venelle, chaque maison, chaque caillou, les odeurs qui varient avec la hauteur d’eau. Rien ne pouvait plus me surprendre. Je m’y sentais chez moi, dans mon port d’attache.
J’optai pour la discrétion absolue. En quittant la voie ferrée, au lieu d’obliquer vers les quais où j’avais rendez-vous avec le diable, je choisis de longer le moulin à marée pour avancer à travers les marécages. La mer avait délaissé le port pour quelques heures encore et le passage restait praticable. Néanmoins, je ne pus éviter de me tremper les pieds en franchissant le gué du Bignon. Tant pis ! Je retrouvai bientôt la vase du port que je traversai au milieu des barques endormies. Un nouveau bain de pieds pour traverser la Flora qui ruisselait parmi les navires échoués, puis j’atteignis la digue, essoufflé, mais enfin au pied du mur. Un rempart de douze mètres de hauteur me narguait, comme une forteresse à prendre d’assaut.
Mes souvenirs des lieux me tirèrent d’affaire. A trente mètres en contrebas, une échelle se dressait à l’aplomb de la capitainerie, face à la rue de Lisbonne, là où la rive s’incurve. Des arceaux de métal directement scellés dans le granit permettaient d’accéder à l’embarcadère. En assurant mes outils, je gravis avec précaution les échelons jusqu’à ce que je puisse risquer un coup d’œil alentour.
A ma droite, le quai filait, rectiligne, jusqu’à l’étang et au moulin à marée. Grâce au clair de lune, on distinguait les façades des maisons d’armateurs et les entrepôts. Sur ma gauche se trouvaient la cale puis la montée vers l’oratoire d’où les femmes guettaient le retour des navires à l’automne. Les demeures avoisinantes semblaient déjà dormir, volets clos. De loin en loin, des lumières électriques récemment installées épousaient le tracé de la rue pavée. Rien ne bougeait dans le havre privé de son eau, pas une âme qui vive pour troubler les fantômes de mon enfance. Seules, les silhouettes immobiles de deux goélettes amarrées au quai témoignaient d’une présence humaine bien qu’à bord tout soit silencieux. Les matelots dormaient ou plus probablement s’encanaillaient à la taverne de la mère Muche, au fond du port, près du moulin. La lune trônait maintenant, claire et majestueuse. L’ombre des grands mâts découpait le quai en tronçons réguliers.
Au prix d’un rétablissement, je pris pied sur le môle en veillant à ne pas heurter mes outils. Le succès de ma mission dépendait de ma vigilance. A pas feutrés, je remontai la digue en direction de la terre. Un chat tapi dans l’ombre d’une bitte détala à mon approche. Il poussa un feulement de désespoir. Un chat noir ? Mauvais présage ! La soirée s’annonçait merveilleusement bien !
Je poursuivis ma progression en direction de la mer, d’ombre en encoignure, le plus discrètement possible. Pour vivre heureux, vivons cachés ! Un peu plus loin, sur ma droite, une façade familière portait l’usure du temps et des coups de chien. Les pierres érodées par le vent maintenaient l’édifice comme par miracle. Dans son prolongement, à l’alignement de la rue, un muret bas délimitait le jardin de la maison voisine. Les deux bâtisses étaient désertes, pas un rai de lumière ne filtrait des persiennes. Pas un bruit non plus ! En revanche, des bribes d’accordéon parvenaient sporadiquement du lointain, portés par la brise d’est. On s’amusait chez Muche !
Je poussai le portillon de bois pour pénétrer dans le jardinet où je m’immobilisai, les sens en éveil.
De part et d’autre de l’entrée, deux haies doublaient le muret pour protéger la cour des regards indiscrets. Au centre, un espace libre bordé à droite d’un parterre fraîchement retourné et, sur la gauche, d’un massif d’hortensias aux fleurs sèches comme un bouquet de deuil. Je posai mon caban à terre, retroussai mes manches et crachai dans mes mains, fin prêt à m’atteler à la première partie de mon travail, la plus laborieuse mais la plus aisée.
Je choisis la plate-bande de terre meuble et j’y creusai un trou de deux mètres de long sur soixante centimètres de large le long du mur mitoyen. Je progressais sans à-coups, maniant la pelle avec ténacité, avec la volonté d’aboutir au plus vite. Malgré le froid de février et mes pieds mouillés, je transpirais à grosses gouttes. Je ne m’interrompais que pour écouter le silence environnant, troublé çà et là par les flonflons de l’estaminet. En y prêtant attention, je reconnaissais cet air d’accordéon. Il m’en avait tant rebattu les oreilles ! Ce salopard jouait toujours la même java lorsqu’il se saoulait la gueule et, comme toujours, plus sa cuite avançait, plus les notes se succédaient sur un tempo de feu. L’alcool le transformait en virtuose. Ce soir, le bougre devait en tenir une belle. Tôt ou tard il ressentirait le besoin de prendre l’air. Je devais me presser.
La profondeur de la tranchée atteignait maintenant un mètre cinquante, cela suffirait. Je pris soin de niveler les remblais pour ne pas attirer l’attention au cas improbable où quelqu’un entrerait dans la courette. J’épongeai mon front d’un revers de manche et je soufflai enfin quelques minutes, satisfait de mon travail. La deuxième partie de la soirée pouvait commencer. Je passai mon caban, cachai la pelle derrière un massif et je me pelotonnai contre le muret. L’affût débutait, armé de ma seule patience et de la barre à mine que je tenais serrée contre moi. Malgré ma position inconfortable, je restais concentré, prêt à bondir sur la bête immonde. Je ruminais ma vengeance – un plat qui se mange froid, dit-on. Et ce soir, on était servi question frimas ! Je ne sentais plus mes pieds et, au fur et à mesure que l’attente se prolongeait, mes membres s’engourdissaient. La soif et la faim s’ajoutaient à la fatigue de ma longue marche et de ma journée de travail. Tandis que je me tenais blotti derrière la haie en position accroupie, ma tête dodelinait, mes doigts picotaient. Je luttais contre le sommeil et la pétrification.
Soudain, des éclats de voix rapprochés me sortirent de ma torpeur. Je réalisai que l’accordéon ne bronchait plus depuis quelques minutes, la mère Muche fermait sa taule et la clientèle regagnait ses foyers. Je ne parvenais pas à saisir les paroles qu’échangeaient au loin les buveurs ; sans doute une dernière fanfaronnade ?
Des bruits de pas se rapprochèrent. En tendant l’oreille, je distinguai la progression hésitante de deux ivrognes qui déambulaient bras dessus bras dessous. Cela contrariait mes projets mais ne pouvait entamer ma détermination. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux, ils pouvaient compter sur ma générosité.
Les deux hommes se séparèrent à une dizaine de mètres de ma planque et, enfin, il s’approcha de chez lui, seul, saoul comme une bourrique. Une giclée d’adrénaline m’assaillit aussitôt. Je me redressai à demi, la barre à mine en main, prêt à bondir. J’avais hâte d’en finir. Les quelques mètres qui le séparaient de moi semblaient des années lumière. Le salaud tenait une telle biture qu’il ne trouva pas immédiatement la porte du jardin, ses jambes butèrent dans le muret. Il en perdit l’équilibre et s’enfonça dans les troènes derrière lesquels je me trouvais tapi. L’homme proféra des jurons mêlés de borborygmes. Sa respiration haletait et, sans pouvoir discerner son visage à travers l’épaisseur végétale, j’imaginais sa trogne avinée. Je l’entendis alors grommeler en fourrageant dans ses habits, comme s’il recherchait sa clef. Je me trompais : un jet de plus en plus puissant se fit entendre puis un liquide chaud me dégoulina sur le dos. Ce sagouin me pissait dessus en ânonnant pour lui-même : « Plus haut, salope ! »
Ayant remisé son fourbi, il poussa enfin le portillon pour s’engager dans le jardin. Depuis le temps que j’attendais cet instant, il était enfin à ma portée. Tout se passa très vite et très simplement.
Je me redressai et lui abattis la barre à mine derrière la nuque. Vlan ! Le coup du lapin Jeannot. Du boulot sans bavure ! Je doublai ma frappe en visant cette fois le sommet du crâne. Un craquement sinistre scella son arrêt de mort, le scélérat avait son compte et s’écroula. Dans la chute, un ultime sanglot de son accordéon déchira la nuit, il ne jouerait plus jamais sa maudite java !
Je poussai le corps dans la tranchée, j’y jetai mon instrument de mort et sa boîte à musique. Une demi-heure plus tard, la tombe était rebouchée. Ni vu ni connu. Je pris soin de replanter les oignons de tulipe que j’avais mis sens dessus dessous, les fleurs seraient grassement nourries au printemps prochain !
Après avoir effacé au mieux les traces de mon passage et replacé la pelle dans la remise du jardin, je me dirigeai vers le port pour achever ma mise en scène. Trois heures au moins me séparaient encore de l’aube : le temps de sortir du chenal, de faire un tour en mer et de rentrer à la cale. La brise faciliterait ma tâche. En plein hiver, je courais peu de risques de rencontrer quelque pêcheur matinal. Je quittai le port en souquant ferme.
De retour à terre, je pris mes cliques et mes claques sans m’attendrir. Je traversai le village encore désert et je repris ma route. Plus question de retourner au chantier car la région pouvait devenir inhospitalière pour ma petite personne. J’atteignis Saint-Alban au lever du jour. Là, après avoir chapardé des pommes dans un cellier, je passai la journée à dormir dans une grange. Mon organisme réclamait du repos avant d’entreprendre une nouvelle nuit de marche sur la voie ferrée du petit train, discrétion oblige. Un assassin dans son bon droit n’est pas pour autant un crétin !
Le lendemain matin, j’étais à Lamballe. Je sautai dans un train de grande ligne jusqu’à Guingamp. De là, je gagnai Paimpol où m’attendait l’embarquement pour Terre-Neuve que j’avais signé à la foire aux marins de Vieux-Bourg deux semaines auparavant.
Trois jours plus tard, le Marie-Henriette appareillait.
Le tour était joué, bien malin qui pourrait s’y retrouver !
PREMIÈRE PARTIELE SQUELETTE DE DAHOUËT
I
Jour J moins 96 : Mai 2004.
Le soleil de mai baignait le quai des Terre-Neuvas. Adossé au mur de grès rose, Bertrand Grandrouzic éprouvait un formidable sentiment de bien-être. Le monde respirait autour de lui, ses projets avançaient au galop. Son regard allait et venait de la façade du Grand Banc, son bar ouvert voilà deux ans, vers le goulet d’entrée du port que la marée montante envahissait peu à peu. Dahouët se remplissait à vue d’œil avec le flot. Les navires affalés dans la vase retrouvaient l’un après l’autre leur équilibre et leur fierté pendant que les goélands entreprenaient leur charivari en gueulant. Plus loin, dans le bassin à seuil, une forêt de mâts pointait vers le ciel. Bertrand cherchait à y distinguer son voilier, un Dragon qu’il avait remis en état au cours de l’hiver. Le jeu en valait la chandelle et, aujourd’hui, le galbe de la coque étincelait sous les vernis. Le spectacle continuait d’émerveiller son skipper et le confortait dans son choix de vivre ici.
Bertrand pratiquait la voile avec ses copains le week-end, quand les vents et la marée le permettaient. En semaine ou lorsqu’il se trouvait seul, il embarquait à bord de son Virage 80, une vedette de pêche de huit mètres qui mouillait dans la travée suivante. Bertrand cajolait ses deux engins comme des pur-sang et leur consacrait une grande partie de son temps. Il pouvait se le permettre car, depuis deux ans, il disposait d’une fortune colossale et ne travaillait plus que pour son plaisir. Coup de chance ? Hasard ? Opportunisme ? Concours de circonstances ? Un cocktail gagnant en tous les cas et l’occasion de vivre une de ces facéties du destin qui n’arrive en général qu’aux autres.
Pourtant, il était là : cinquante-quatre ans, toutes ses dents ou presque, un mètre soixante-quinze de chair et d’os et un compte en banque mieux garni qu’un panier de loterie. Lui, que rien ne prédisposait à une telle réussite. Lui, un petit-fils de Terre-Neuvas !
Sans prendre la grosse tête, Bertrand se savait adulé par la vie. Aussi estimait-il devoir lui sourire en retour et s’y employait sans se ménager.
* * *
La douceur de la température contrastait avec la canicule de l’été 2003.
Aux oubliettes les 40 degrés et les puanteurs de vase ! La douceur régnait à nouveau sur le Penthièvre. Bertrand appréciait particulièrement cette période de l’année où les journées s’étirent après la longue sieste de l’hiver. La lumière de fin d’après-midi et l’imminence des travaux d’agrandissement du bar, tout concourait à le rendre heureux d’autant que Betty rentrait ce soir par le TGV de 19 heures 20 à Lamballe. Dans trois heures, il allait retrouver sa compagne enfin de retour d’une escapade à la capitale. Bertrand n’en pouvait plus d’impatience, excité par la joie des retrouvailles après leurs quinze jours de séparation.
Voilà un mois environ, en feuilletant un magazine féminin, un encart avait interpellé Betty : « Les meilleurs chefs de France partagent leurs secrets ». Renseignements pris, il s’agissait d’une formation de haut niveau malgré la connotation racoleuse de la publicité. Fin cordon bleu et toujours disposée à se cultiver, Betty avait sauté sur l’occasion et dans le premier train pour Montparnasse. Le magot des Grandrouzic lui autorisait de telles lubies et Bertrand ne s’en offusquait pas. Il tenait à sa liberté autant qu’à celle de son épouse. A chacun ses tocades après tout !
Cependant, du haut de son nouveau savoir-faire, Betty caressait l’idée de transformer le Grand Banc en un restaurant haut de gamme. Perspective à laquelle elle semblait très attachée alors que Bertrand ne voulait pas en entendre parler. Têtu comme un breton le patron ! Un bar à thème ? Oui ! Un projet d’expansion ? Certes, mais pas un restaurant ! Trop de boulot, trop de galère. Après tout, ne travaillaient-ils pas uniquement pour le fun ?
— A tout prendre, on pourrait aussi l’appeler “Cayenne”, osa-t-il un jour où Betty délirait à haute voix.
— Comme le piment ? Bonne idée. J’ai justement une recette de crevettes aux épices qui…
— Comme le bagne ! avait tranché Bertrand avant de sortir prendre l’air.
En dépit de ces piques à fleurets mouchetés, Betty et Bertrand s’adoraient et cela durait depuis plus de trente ans. Ils appartenaient à l’espèce en voie de disparition des couples non disloqués s’épanouissant avec leur entourage. Homo sapiens authentiques, leur harmonie engendrait l’harmonie et ils traversaient la vie sans que leurs cerveaux ne prennent une ride.
Bertrand ? Un mec cool, moins baba qu’en 68 mais un garçon entreprenant et charmant malgré le sel et le poivre qui commençaient à assaisonner sa chevelure éparse. Sous son front dégagé éclatait un regard acéré, bleu clair. Hâlé, sportif, il portait son âge sans fard et cultivait davantage le look mataf que yachtman : pantalon de toile écrue, vareuse itou, Dock Side avachies dans lesquelles ses pieds vivaient enfin libres après des années d’incarcération en Weston.
Madame Grandrouzic, elle aussi, prenait soin de son apparence mais dans un registre plus sophistiqué. Son culte de l’image ne datait pas d’hier : « Tout est affaire de décor. » Née Jeanne-Huguette Ducrota, elle se faisait appeler Betty depuis son adolescence et le secret de son véritable état civil restait enfoui dans un livret de famille. Betty dégageait une beauté naturelle dont la simplicité ne devait rien au hasard. Ses cheveux auburn coupés au-dessus des épaules encadraient un visage à l’ovale parfait. Ses yeux noirs maquillés avec discrétion possédaient une profondeur abyssale. Tirée à quatre épingles en toutes circonstances, Betty semblait à peine tutoyer la quarantaine et remportait un franc succès auprès de ses contemporains. Bertrand s’en amusait mais, au fond de lui-même, en éprouvait une grande fierté.
Les Grandrouzic rayonnaient de gaieté, ensemble ou pris séparément. La joie de vivre semblait programmée dans leurs gènes et le ticket gagnant tiré à la tombola de la vie n’avait rien gâté. Ils en profitaient largement, notamment en décidant, voilà trois ans, de quitter la région parisienne pour rentrer au pays. Retrouver des racines et un environnement.
Deux événements leur avaient permis de réaliser ce rêve. En premier lieu, une tragédie. Le décès des parents de Bertrand au cours d’un crash d’avion, à Pâques, voilà une dizaine d’années. Un sale accident sur le Rome-Paris. Pas un survivant parmi les passagers, y compris ceux bénis par le pape la veille sur la place Saint-Pierre. Comme quoi, personne n’est à l’abri… Bouleversé par la brutalité de cette disparition, Bertrand s’était consolé en pensant que son père et sa mère se trouvaient réunis pour affronter la mort. A deux, on a moins peur, et, à tout prendre, leur brutal épilogue valait mieux que les souffrances d’une lente agonie dans un lit d’hôpital.
Fils unique, Bertrand avait reçu en héritage la petite habitation de Dahouët d’où plusieurs générations de Grandrouzic s’étaient embarquées pour Terre-Neuve. Une lignée de gens de mer, de matelots voués au “grand métier”.
Plutôt que de vendre la maisonnette du quai et de brader l’histoire familiale, Bertrand et Betty l’avaient mise en location en attendant des jours meilleurs, avec l’espoir d’y réaliser un jour leur projet : un espace à la mémoire des anciens, un lieu de rencontre entre passé et présent. Un bar, avec un coin-librairie, une salle multimédia pour des animations culturelles, des débats, des projections, des spectacles, des expositions. Et pourquoi pas un musée ? Tout restait à faire mais l’idée du Grand Banc avait pris corps voilà trois ans. A l’époque, le manque d’argent avait retardé sa mise en œuvre. Les banques d’alors ne voulaient pas en entendre parler… Pas rentable, estimaient les financiers qui se refusaient à jouer les mécènes. Dommage ! Car le programme Grandrouzic tenait debout et s’inscrivait à merveille dans le développement de Dahouët.
Après les heures de gloire de la Grande Pêche puis celles du fret dans les années cinquante, le port s’empâtait. Certes, le bassin en eau profonde et la qualité de l’abri attiraient des plaisanciers dont la présence apportait un semblant d’activité. Mais pouvait-on tirer un trait sur cinq siècles d’histoire et des milliers de vies ?
Aujourd’hui, sous l’impulsion de quelques pionniers, Dahouët renaissait et commençait une nouvelle carrière d’espace culturel. Ainsi pouvait-on chiner dans les anciens entrepôts ou, plus loin, conjuguer les plaisirs de l’esprit et du goût dans les divers établissements qui rivalisaient de charme. Ici on pariait sur la qualité de l’accueil et sur l’intelligence des visiteurs. En conservant son authenticité, l’espace du port devenait un lieu recherché. On y trouvait encore des ateliers de peintre ou des expositions et puis le hangar de la “Pauline”, la chaloupe-pilote du port de Dahouët reconstruite à l’ancienne. Encore un témoignage !
Après une éclipse, Dahouët brillait de nouveau ! Mais, au goût des Grandrouzic, la dimension historique faisait défaut. Aussi s’accrochaient-ils à leur projet en attendant des jours meilleurs pour apporter leur écot au rayonnement du port.
Soudain, début 2001, tout devint possible.
Un groupe américain de télécommunications offrit à Bertrand de lui racheter son entreprise, une PME de vingt personnes qui fabriquait des soudeuses pour fibres optiques. En ce début du troisième millénaire, il s’agissait d’un créneau technologique très “tendance” et le montant offert dépassait l’entendement ! En l’espace de trois ans, la bulle Télécom avait enflé comme la grenouille faite plus grosse que le bœuf. La démesure était devenue la norme et la moindre parcelle de technologie se négociait à prix d’or. Cette alchimie nouvelle répandait une fièvre de cheval sur les bourses du monde entier. La plus petite entreprise, hier encore exsangue, se voyait surcotée du jour au lendemain. Le pôle optique de Lannion explosait, des start-up venaient au monde chaque jour.
Bertrand et son associé, ni plus ni moins opportunistes que d’autres, mirent à profit cette éruption et, en février 2001, acceptèrent la montagne de dollars offerte pour le rachat de leur entreprise. Du jour au lendemain, les deux hommes se retrouvèrent projetés sur le devant de la scène, parmi les grosses fortunes de la profession. Le deal prévoyait qu’ils occupent leur fonction de dirigeant à temps plein pendant encore une année entière. Dont acte !
L’argent n’avait jamais été une fin en soi pour Bertrand ou Betty, pour autant ils entendaient se faire plaisir. Chez les Grandrouzic, quand on tire le gros lot à la loterie, on ne rentre pas dans les ordres pour remercier le ciel.
A ceux qui louaient son sens des affaires, Bertrand répondait sans vanité qu’il avait eu du bol. Beaucoup de pot… et qu’il ne travaillerait plus que pour s’amuser !
La vie s’accélère parfois, des parcelles de l’espace-temps dans lesquelles l’énergie s’engouffre pour remodeler l’avenir, s’ouvrent. Ainsi, en quelques années, la succession des parents de Bertrand, la vente de l’entreprise puis le désir de changer d’air avaient bouleversé le paysage familial, tout au moins celui de Betty et Bertrand car leurs enfants volaient de leurs propres ailes depuis plusieurs années. Le fils était installé à La Rochelle et la fille habitait la région d’Annecy et, jusque-là, pas de petits-enfants à l’horizon. Cette génération tardait décidément à se reproduire ! Les Grandrouzic le déploraient mais n’y pouvaient pas grand-chose. Alors, comme toujours, ils rassemblaient leurs propres forces pour façonner l’avenir. Le dynamisme et l’imagination de Bertrand, le sens de l’organisation et la patte artistique de Betty constituaient un mélange en combustion permanente. Le couple fonctionnait à merveille et se goinfrait de vie.
Sans heurt, ils avaient laissé l’Île-de-France pour migrer vers l’Ouest, plus près des vents, en récupérant la maison du quai pour y réaliser leur espace-patrimoine. Ils n’envisageaient pas de s’y établir pour y vivre car ce lieu appartenait à leur famille.
En revanche, la villa à vendre sur la digue du Val-André leur plut immédiatement. Une grande bâtisse du début du siècle située entre le Casino et la Guette. Ses murs épais à colombages et sa toiture d’ardoise étaient taillés pour encaisser les tempêtes. Le terrain de dimensions raisonnables entourait la maison, il offrait plusieurs angles d’exposition, dont le sud. La demeure au caractère bien trempé par les embruns correspondait à leurs desiderata. Ils en firent l’acquisition cash !
La rue des Macareux, leur nouvelle adresse, donnait directement sur la promenade de la digue. Au soir, par temps clair, la maison s’éclairait des feux du couchant qui, peu à peu, se diluaient dans l’océan. Ces embrasements comblaient Betty au point d’en photographier les nuances quotidiennement. Son appareil numérique ne quittait jamais le trépied installé devant la porte-fenêtre du premier. Ainsi, depuis trois ans qu’ils habitaient là, possédait-elle environ cinq cents clichés, tous cadrés de manière identique, mais tous différents. Elle cultivait la nuance comme d’autres le paradoxe. A chacun ses marottes !
De la salle de séjour, à travers la baie vitrée, la plage se déroulait vers le môle de Piégu. Aux grandes marées, la mer se retirait parfois très loin, boudeuse, avant de revenir frapper la digue avec fureur quelques heures plus tard. La nuit, au fond de leur lit, Betty et Bertrand se berçaient de la rumeur des vagues. Dans la grande maison, quatre chambres supplémentaires, réparties sur deux étages, attendaient la famille ou les amis de passage. Sur l’arrière de la villa, à l’abri des vents dominants, le jardin rassemblait des espèces rares. La clémence du climat permettait à ces arbres venus d’ailleurs de s’épanouir en Côtes-d’Armor.
* * *
Aujourd’hui, planté sur le quai des Terre-Neuvas, le Grand Banc appartenait au décor de Dahouët. Devenu une institution, l’établissement fonctionnait hiver comme été. Un couple d’enfants du pays, Erwan et Guenièvre, y assurait le service des cafés du matin, des apéros du midi et des bières du soir. Leur implication auprès de la clientèle contribuait largement au succès du caboulot.
Les véritables patrons n’intervenaient que sur la décoration et sur la programmation événementielle, à l’occasion de soirées spéciales.
De temps à autre, Betty ou Bertrand venaient néanmoins prendre un verre pour discuter avec des amis ou rêver d’expansion bien que l’affaire soit à peine rentable. Mais qui se souciait de rentabilité ? Bertrand s’en battait l’œil !
Seul comptait pour lui le développement de son lieu de mémoire, les mânes de ses aïeux le réclamaient. Bertrand considérait que les anciens méritaient un hommage permanent mais le Grand Banc, dans sa formule actuelle, ne permettait pas la création d’événements à la hauteur de ses ambitions. La salle de vingt-cinq mètres carrés limitait les possibilités malgré la terrasse débordant sur le quai l’été venu.
Mais Bertrand visait plus loin.
A l’automne 2003, le bâtiment jouxtant son bar fut mis en vente. Une succession. Il s’agissait d’une petite habitation flanquée d’un entrepôt de bonne taille. Une aubaine ! Enfin un espace à la mesure des Grandrouzic qui avaient surenchéri pour l’obtenir.
Aujourd’hui, les locaux leur appartenaient et les travaux débutaient dans trois jours.
On réunirait d’abord les deux corps de bâtiment. Ensuite, on agencerait dans l’entrepôt le nouvel espace puis on agrandirait le bar en créant une véranda sur l’actuel jardin. Le chantier devait durer deux mois. Erwan et Guenièvre en profiteraient pour prendre des vacances.
Bertrand et Betty assureraient le service minimum, quelques heures le matin en fonction de la marée, puis, le soir, une heure ou deux pour l’apéritif.
Fin juin, tout devait rentrer dans l’ordre, de sorte que le nouveau Grand Banc connaisse sa véritable vocation.
Dans l’immédiat, Bertrand contemplait le ciel. Le temps ne bougerait pas jusqu’au lendemain.
Il consulta sa montre, donna un tour de clef pour fermer le bar et monta dans sa voiture. Le train de Betty arrivait dans vingt minutes. Le PT Cruiser glissa sans un bruit le long du quai et fila en direction du bassin à flot.
* * *
En l’absence de Guenièvre et d’Erwan, Bertrand tenait la baraque lui-même. Il ouvrait le matin quand la marée le justifiait car les pêcheurs matutinaux accros au petit noir maison n’acceptaient pas de trouver porte close. Alors, Bertrand se faisait violence pour se lever parfois à l’aube, acte qu’il exécrait au point de le considérer comme barbare. A chacun sa vision de l’histoire, lui, admirait la sagesse des rois fainéants.
Aujourd’hui, la grisaille tapissait un ciel uniforme, plombé par l’absence de vent. La mer devait être belle au large et les conditions, idéales pour traquer le lieu jaune ; la pêche serait fameuse. Bertrand Grandrouzic regrettait de ne pas être sur l’eau, retenu par ses obligations de mastroquet ; il essuyait les verres au fond du café et les rangeait au fur et à mesure au-dessus du percolateur.
Les deux heures à venir seraient calmes, jusqu’à midi moins le quart où les premiers retours de pêche et les buveurs d’apéros animeraient à nouveau l’établissement.
Il aimait ces heures rares lorsque, solitaire, il pouvait s’imprégner de l’humeur de la vieille maison. De la configuration d’origine il n’avait conservé que les quatre murs et la cheminée en grès rose. La pierre patinée par des siècles de fumée cernait le foyer. Des poutres noueuses soutenaient le plafond. Sur les murs, on célébrait la grande pêche avec quelques photos de navires, tantôt déployés comme des géants, tantôt recroquevillés comme des fétus. Sur une gravure voisine, des doris accrochés à la lame défiaient les lois de l’équilibre. Dans la vitrine, à droite en entrant, se trouvaient des sabots de bois et une collection de couteaux effilés, indispensables outils des matelots d’antan.
Une galerie de portraits entourait la salle à hauteur des yeux, un quarteron de gueules burinées par les paquets de mer, plus pittoresques les unes que les autres. Leurs regards remplis de fierté et de dérision convergeaient vers le centre de la pièce. La chique à la bouche ou la bouteille de gnôle à la main, ces hommes affirmaient leur gravité.
La collection de Bertrand comptait plus de deux cents portraits parmi lesquels il renouvelait sa décoration tous les quinze jours. Ainsi, pas de jaloux, tout le monde participait. Les morts comme les vivants, car certains d’entre eux respiraient encore. De Cancale à Paimpol, Bertrand en avait dénombré vingt-trois, pour la plupart des octogénaires conservés par le sel et l’air du large. Longévité insolite pour des organismes durement mis à l’épreuve, mais surtout sélection naturelle. On ne survit pas à une succession de campagnes sans porter en soi de la graine de centenaire !
Des durs de durs car l’inconfort, le manque d’hygiène, la précarité des instruments de navigation, tout concourait à rendre la vie infernale à bord de ces navires-caveaux.
Toujours en quête d’archives ou d’anecdotes, Bertrand, de temps à autre, rendait visite aux survivants. Il envisageait d’organiser une journée des Terre-Neuvas à laquelle il convierait les plus ingambes. Probablement le jour de la fête du port, l’été prochain, s’il parvenait à accorder ses violons avec les organisateurs. Il imaginait déjà la salle où l’on écouterait le récit des anciens dans une ambiance de rhum et de fumée, grouillant de monde. Comme avant ! Ce serait magnifique.
Mais dans l’immédiat, seul à son comptoir, Bertrand contemplait le joyau de ses collections : une carte marine datée de 1728 ! Une pièce authentique sur laquelle figuraient les contours de Terre-Neuve mais aussi les bancs principaux et les îles de Saint-Pierre-et-Miquelon. Une foule de détails accumulés depuis plus de deux siècles comme l’attestait encore la reproduction située à gauche du bar et intitulée : « La Jacquette quittant Dahouët pour Terre-Neuve Mars 1510. » Forts de plus de deux siècles d’expérience et de témoignages, les marins du XVIIIe siècle possédaient déjà une grande connaissance des parages de Terre-Neuve.
Un aviron suspendu au-dessus de la cheminée décorait le mur du fond, une rame d’aspect anodin. Du bois flotté, rien de plus ! En y regardant de plus près, on décelait pourtant des lignes d’écriture gravées dans le bois poli par les intempéries. Des noms et des dates se succédaient, par endroits, à peine lisibles. Le relief des caractères s’accentuait à mesure que la liste s’allongeait. Une lugubre énumération, celle des Grandrouzic pris par la mer avec la date de leur disparition. Le plus ancien remontait à 1765, puis s’égrenait à intervalles plus ou moins réguliers la funèbre litanie, celle du tribut payé à l’océan par le clan. A la dernière ligne figurait une épitaphe maladroitement taillée au canif : Jean Grandrouzic, 1924. Le grand-père de Bertrand.
L’aviron tenait lieu de relique. On se le transmettait de génération en génération. Bertrand, l’actuel dépositaire, l’avait reçu le jour de ses dix-huit ans des mains de son père Yannick, ici même dans la maison familiale où les paroles du discours paternel résonnaient encore aux oreilles de Bertrand :
« Mon fils, je te transmets le symbole de notre lignée, l’aviron des Grandrouzic. Brandis-le avec fierté ! Ces hommes ont bâti le monde dans lequel nous vivons, ils méritent notre respect. Cela dit, je ne formule qu’un vœu à ton attention et à celle de tes enfants : que le nom de ton grand-père Jean clôture définitivement cette maudite liste ! Il existe tant de mauvaises raisons de mourir qu’il est inutile de braver le destin. C’est pourquoi j’ai moi-même refusé de prendre la mer au prix d’un conflit familial, mais j’ai tenu bon ! Je me suis ensuite saigné aux quatre veines pour te donner de l’instruction. Fais-en bon usage ! La mer est profonde, la terre est basse et dure, les bureaux sont chauffés. A toi de choisir ! »
Les paroles paternelles éclataient de modernité et de réalisme mais Bertrand ne pouvait y souscrire totalement car le sang des coureurs d’océan bouillonnait en lui. Le sang des Frères de la Côte, celui des corsaires et des boucaniers. Certes, son père lui avait permis de faire des études supérieures, il lui était redevable de sa réussite actuelle mais, sans ces générations de matelots, de pêcheurs et de forbans, quelle serait aujourd’hui sa personnalité ? Posséderait-il cette pugnacité et cette vigueur ?
Bertrand regrettait de n’avoir pas connu son grand-père Jean. Un personnage hors du commun, disait-on, le premier Grandrouzic à avoir accédé au rang de saleur sur un trois-mâts Terre-Neuvier. Un poste envié, beaucoup mieux payé que les lignotiers. Car on ne chômait pas sur les bancs, on était polyvalent. Une fois la pêche débarquée sur le pont du navire, un autre travail commençait, les hommes devaient encore préparer leurs prises. Après l’étêtage des cabillauds par le décolleur, l’ouverture et le désossage par les soins de l’habilleur et l’éviscération effectuée par le nautier – un jeune mousse – le poisson passait enfin entre les mains du saleur, en cale. De la qualité du salage dépendait la bonne conservation des morues : trop de sel et elles cuisaient ; trop peu de sel, elles pourrissaient. D’où l’importance stratégique des saleurs à bord des trois-mâts.
Selon les témoignages, Jean Grandrouzic possédait un sixième sens pour jauger du salage au gramme près. L’artiste n’avait jamais loupé une cargaison et les armateurs se l’arrachaient de Brest à Saint-Malo, bien que le bonhomme soit connu pour mettre son grain de sel partout, et pas seulement sur le poisson ! Il se mêlait de tout à bord, aussi bien de la pêche que de la navigation. Pour autant, on acceptait ses travers. Jean se disait Terre-Neuvas avant d’être Dahouëtin, car c’est sur les bancs qu’il prenait toute sa dimension. Un exalté, capable de prendre le commandement au besoin, et aussi l’un des derniers à vanter la pêche à la nage à laquelle il participait souvent. Ses talents et sa fougue justifiaient un salaire élevé qui faisait des envieux sur la côte nord. Selon les témoignages, Jean le dur le disputait à Jean l’artiste.
Un homme ambigu mais un sacré marin dont on se demande encore comment il avait pu disparaître bêtement, ici, dans la baie de Saint-Brieuc, un matin d’automne. Peu bavard, veuf depuis cinq ans, Jean Grandrouzic vivait alors solitaire et refusait de voir son propre fils, un planqué en col blanc qui travaillait aux Affaires Maritimes. Bertrand ignorait les détails du naufrage, mais les anciens parlaient encore d’un accident stupide.