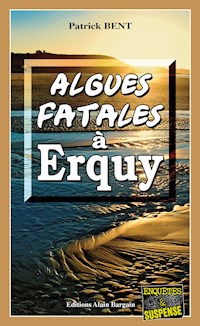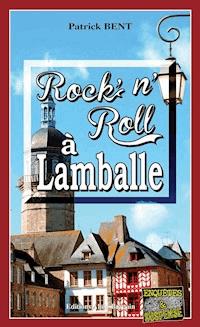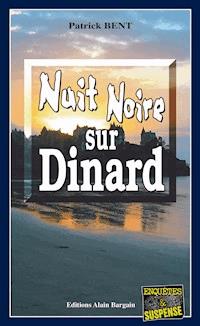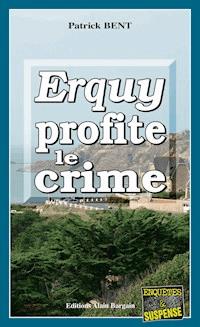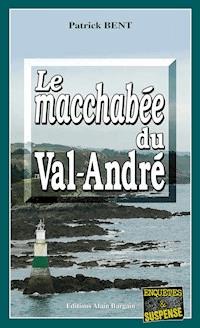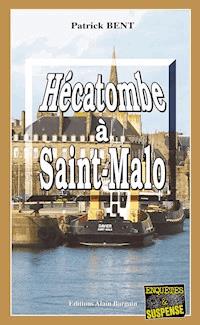Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Dans la peau d'enquêteurs malgré eux, Maud et Julien vont tenter de percer le mystère de secrets familiaux depuis longtemps enfouis
Le hasard fait-il toujours bien les choses ? Toute vérité est-elle bonne à dire ?
Maud et Julien pourraient en douter… Tout avait pourtant commencé par une aimable rencontre mais, au gré de leurs découvertes, les placards du passé se révèlent truffés de bombes à retardement. Au cours d’un mois de juillet chaotique à Erquy, ils découvriront enfin ce qui se dissimule derrière ces « Mensonges d’une nuit d’été ! » Bas les masques !
Patrick Bent jongle avec habileté entre les périodes historiques et nous plonge dans un thriller haletant
EXTRAIT
Fin septembre 1968
Julien avait rencontré Maud au Quartier Latin au début des « évènements ». Au terme d’un joli mois de mai, ils avaient mis cap à l’est au volant de leur 2 CV, Titine pour les intimes. Partis mi-juin, ils achevaient, trois mois plus tard, un périple qui les avait conduits à Kaboul via la Grèce, la Yougoslavie, la Bulgarie, la Turquie, l’Iran… 15 000 bornes avalées sans trop de dégâts. S’ils n’avaient pas toujours mangé à leur faim ni couché dans des palaces, ils avaient ramassé des pastèques, châtré les maïs, revendu un peu d’herbe aux touristes ou négocié leur sang dans les hôpitaux pour joindre les deux bouts. Crevés, hirsutes, amoureux, ils rentraient à Paris avec des images et des parfums plein la tête.
A PROPOS DE L’AUTEUR
Bourlingueur et physicien,
Patrick Bent livre son neuvième roman dans la collection « Enquêtes et Suspense ». Son regard sur la côte de Penthièvre – son pays d’adoption – passe cette fois-ci par le prisme de l’histoire locale. Son nouveau thriller se déroule dans l’effervescence de l’été 1969, une époque récente mais déjà si lointaine…
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -
Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À Luce, pour ton soutien sans faille au quotidien, pour ta patience, ta joie de vivre et tes relectures. Merci ma toute belle !
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
Le blog de l’auteur : http://patrickbent.pagespersoorange.fr/ et sur Facebook
AVERTISSEMENT
Ce roman jongle avec deux périodes distantes d’un quart de siècle, d’une part, la fin de la guerre de 40, d’autre part, les années 70.
En évoquant le sort de prisonniers de guerre, ceux que l’on a nommés les « absents », j’ai voulu rendre hommage à ce million et demi d’hommes qui ont laissé leur jeunesse en captivité dans les stalags. Soldats peu glorieux, capturés sans avoir combattu, ils sont un peu les oubliés de l’Histoire.
Vingt-cinq ans plus tard, leurs enfants, les « baby-boomers », vivent l’effervescence des années 70. Clin d’œil à cette folle époque, l’année 1969 – érotique pour les uns, historique, hystérique ou mythique pour les autres – représente une charnière dans le XXe siècle : de Gaulle démissionne ; la pilule contraceptive fait son apparition ; Armstrong marche sur la lune ; au Vietnam, Ho Chi Minh décède ; à Woodstock, la musique adoucit les mœurs ; les Beattles sortent Abbey Road ; au cinéma, Il était une fois dans l’Ouest fait un tabac ; en France la quatrième semaine de congés payés devient une réalité, Johnny et Sheila envahissent les juke-boxes.
Dans le récit qui suit, un jeune couple de baby-boomers traverse en trombe cette année d’espérance, de bouillonnement, d’euphorie.
Patrick BENT
PS : Les aficionados ne manqueront pas de noter l’absence de la commissaire Beaussange.
Je tiens à les rassurer, mademoiselle Beaussange est en pleine forme dans sa maison du Gué. Si elle n’apparaît pas dans ce récit, c’est tout simplement parce qu’elle n’était pas née en 1969. Son retour ne saurait tarder…
Bonne lecture !
REMERCIEMENTS
Les personnages de ce récit sont fictifs. Toute ressemblance avec des personnes ayant réellement existé ne pourrait être que fortuite. En revanche, certains lieux ou certaines situations réelles ont pu servir de socle à la trame romanesque. Merci, encore une fois, à celles et ceux qui ont accepté de partager leurs souvenirs. Merci, notamment, à mes amis d’Erquy pour leur contribution, en particulier Brigitte et Loïck, mais aussi Annie, Christiane, Dany, Josie, Soizick, Véronique, Jacques, Patrick, Thierry et bien d’autres encore… Que ceux que j’aurais oubliés ne m’en tiennent pas rigueur.
Mention spéciale à Bernard pour l’accès à ses archives familiales et à ses souvenirs personnels.
Un clin d’œil aussi à Jacques Prévert dont quelques vers se sont glissés subrepticement dans mon texte…
PROLOGUE
Fin septembre 1968
Julien avait rencontré Maud au Quartier Latin au début des “évènements”. Au terme d’un joli mois de mai, ils avaient mis cap à l’est au volant de leur 2 CV, Titine pour les intimes. Partis mi-juin, ils achevaient, trois mois plus tard, un périple qui les avait conduits à Kaboul via la Grèce, la Yougoslavie, la Bulgarie, la Turquie, l’Iran… 15 000 bornes avalées sans trop de dégâts. S’ils n’avaient pas toujours mangé à leur faim ni couché dans des palaces, ils avaient ramassé des pastèques, châtré les maïs, revendu un peu d’herbe aux touristes ou négocié leur sang dans les hôpitaux pour joindre les deux bouts. Crevés, hirsutes, amoureux, ils rentraient à Paris avec des images et des parfums plein la tête. À l’approche de l’écurie, la fringante Titine frôlait encore les 90 km/h dans les descentes sur l’autostrasse bavaroise. Dehors, le soleil de midi inondait les sommets des Alpes. Dans un jour ou deux, ils franchiraient l’ultime frontière les séparant de la douce France. Le cher pays de leur enfance aurait-il changé durant l’été ? Les feux allumés en mai se seraient-ils propagés ? Ni Maud ni Julien n’en avaient la moindre idée. Privés d’informations durant leur voyage – les journaux français étaient introuvables et l’autoradio ne captait plus grand-chose – ils s’étaient essentiellement consacrés à eux-mêmes.
La clope au bec, grisée d’air chaud, Maud conduisait, capote relevée. Elle avait placé une cassette dans le lecteur et pianotait sur le volant. Ses bouclettes blondes flottaient au vent. Les petits miroirs insérés dans les broderies de son gilet en mouton retourné renvoyaient mille soleils dans l’habitacle. Un collier d’ambre et d’argent massif pendu à son cou, Maud respirait autant le bonheur que la nicotine. Malgré les courants d’air et le ronflement du moteur, la musique des Beatles envahissait la voiture.
À ses côtés, Julien somnolait, jambes repliées, les pieds nus calés dans le vide-poches. Ses cheveux noirs teintés de henné étaient rassemblés en catogan. À leur aspect laineux, on pouvait imaginer qu’une pénurie de shampoing frappait le Moyen-Orient depuis plusieurs semaines. Outre sa chevelure en bataille, le garçon exhalait des senteurs de fromage corse. Sa compagne, beaucoup moins négligée, n’y prêtait plus attention. L’osmose du jeune couple était telle qu’ils partageaient absolument tout, y compris leurs effluves boucanés. À Kaboul, ils s’étaient fait tatouer le même signe sur la cheville gauche, le gawf1 de l’alphabet farsi. Ce symbole aux élégantes volutes représentait leur engagement indélébile, une façon de signifier « Je t’ai dans la peau ». Maud et Julien se désiraient dans les moindres recoins. Dans ses bagages, la jeune fille avait emporté un stock de pilules, des nouveautés payées à prix d’or.
Julien avait déplié la carte routière sur ses genoux. La région regorgeait de lacs. Il imaginait déjà leur soirée au pied des montagnes, à déguster leur éternel bol de corn-flakes devant un feu de bois. Maud, sa guitare et les chansons de Joan Baez feraient le reste. Il adorait. Encore faudrait-il convaincre sa camarade de passer une nuit supplémentaire sous la tente, car, la veille, Mademoiselle avait soudain réclamé une douche chaude et des draps frais. Pétage de plombs à l’approche de l’écurie ? En tout cas, requête inattendue autant qu’inenvisageable au regard de leurs finances. Julien avait argumenté ; certes, leur voyage durait plus longtemps que prévu, mais dans quelques jours, ils seraient à Paris.
En définitive, ils avaient encore une fois planté leur canadienne à l’orée d’une forêt, avaient dîné, chanté puis ils avaient fait l’amour à même le tapis de sol. Vers deux heures du matin, ils s’étaient endormis, apaisés.
Ils se relayèrent au volant tout l’après-midi. Après avoir dépassé Munich, ils roulèrent à l’inspiration en direction du nord-ouest. Vers 17 heures, ils atteignirent un gros bourg médiéval aux maisons joufflues, une ville nommée Memmingen située aux confins de la Bavière et du Bade-Wurtemberg. Là, Julien engagea la 2 CV sur une route secondaire. De loin en loin, d’énormes bâtisses ponctuaient les champs et les pâturages. À en juger par les vaches qui les regardaient passer, c’était une région d’élevage.
— Qu’est-ce qu’on fabrique dans ce trou ? s’étonna Maud. Note bien que si on pouvait se payer sur la bête, je me découperais volontiers une entrecôte…
— Ne compte pas sur moi ! Je serais incapable d’abattre une vache, même avec un bazooka.
— Et avec ton Opinel ?
— Arrête, Maud !
— Alors, on fait quoi ?
— Tu verras, dit-il en engageant la deux-pattes dans une cour de ferme.
Face au portail se dressait l’imposante habitation, un bâtiment jaune surmonté d’un toit percé de tabatières. Sur la façade, chaque appui de fenêtre était orné de géraniums multicolores. Au rez-de-chaussée, des voilages défendaient l’intimité de la demeure tandis qu’à l’étage, des rideaux à carreaux rouge et blanc ajoutaient une note pimpante. Sur la droite de la maison, un hangar où s’alignaient deux tracteurs rutilants et des machines agricoles impeccablement entretenues. De l’autre côté, une grange flanquée d’une étable complétait le tableau. Une impression de netteté se dégageait de l’ensemble. Tout cela avait une allure de carte postale.
Julien gara la 2 CV au-delà du porche, sur un emplacement d’où une allée pavée menait au bâtiment principal. Il s’apprêtait à descendre lorsque des aboiements tempérèrent ses ardeurs. Un gros chien noir se précipita sur la voiture, côté conducteur. Julien claqua la portière et rabattit sa vitre avant que la bête ne lui morde le coude. Cet échec déclencha la fureur de l’animal qui se mit à aboyer de plus belle, griffant la carrosserie comme s’il voulait la décaper. Julien se demanda un instant si sa bonne idée en était vraiment une. Maud se serra contre lui, pas franchement rassurée.
— Tu passes la marche arrière ou tu attends qu’il nous bouffe un pneu ?
— T’inquiète, il en aura ras le bol avant nous.
— Mais Titine ?
— Elle en a vu d’autres !
Le chien cessa soudain son charivari, une femme était apparue au seuil de la maison, elle portait une blouse à fleurs sans manches. Ses cheveux blond paille tirés en queue-de-cheval dégageaient un aimable visage taquiné de ridules quadragénaires. Plutôt jolie, en dépit de ses épaules voûtées, elle se déplaçait avec élégance et, à mesure qu’elle approchait, le mystère de son regard s’imposa. De grands yeux bleu clair, très pâles, presque délavés, troublés par une forme de résignation, comme s’ils avaient été dépossédés de leur éclat. La fermière s’avança sans hâte, ses sourcils froncés marquaient davantage la surprise qu’une quelconque animosité. Son étonnement redoubla lorsqu’elle découvrit les plaques minéralogiques et la lettre F dans son ovale blanc placardé sur l’aile avant de la 2 CV. La femme esquissa un sourire puis saisit le chien par le collier pour le mener à sa niche. La bête se laissa attacher sans broncher.
Rassuré, Julien sortit de la voiture. L’air de la ferme sentait bon le laitage. Il tenta de défroisser sa tunique puis de ramener ses cheveux vers l’arrière. S’estimant présentable, il avança vers la femme et lança :
— Grüssgott !
— Grüssgott ! répondit-elle.
— Heu… Ich spreche nicht deutsch, can you speak english ? My girlfriend is very tired… Sorry.
— Je parle français un petit peu, articula la fermière. Longtemps, je ne parlais pas. Depuis plus de vingt ans. Oublié un peu…
— Formidable ! s’enthousiasma Julien, la main tendue.
— Bienvenue, wilkomen ! le congratula-t-elle. Je peux aider vous ?
— Eh bien, poursuivit-il, nous rentrons en France après trois mois de voyage. Mon amie, Maud, est très fatiguée. Elle aimerait se rafraîchir et se reposer un peu. Si vous pouviez nous héberger dans la grange pour la nuit, ce serait formidable.
— Héberger, je pas comprendre…
— Dormir, schlafen, la nuit prochaine…
— Ach ! Certainement, grosse plaisir d’accueillir jeunes Französisch. Vous, garer l’auto près de le grange. Non… la grange… J’ai bien dit ? Je vous installer dans le foin. Achtung ! Pas le feu. Verboten ! Mon mari fâché si vous fumez. Si vous voulez l’eau, le puits est dans la cour… Ah, bonjour Fraulein-Mademoiselle.
— Je m’appelle Maud, dit la jeune femme qui venait de les rejoindre. Bonjour Madame.
— Je suis Birgitte.
— Enchantée. Lui, c’est Julien.
— Gut ! Allez vous installer, je reviendrai vous voir plus tard.
— Merci Birgitte ! Vous êtes adorable !
La touffeur de la grange et son entêtante odeur séduisirent Maud d’emblée. Après mille et une nuits passées sur les cailloux, elle tenait enfin son palais où deux charrettes tenaient lieu de carrosses. Une échelle menait à la réserve de foin, dans les combles, tout près du septième ciel. Radieuse, elle y confectionna un nid d’amour où elle s’étendit pendant que Julien vérifiait les niveaux de la voiture.
Vers six heures, Birgitte vint les trouver, accompagnée d’un colosse à l’embonpoint de buveur de bière. Sa calvitie intégrale luisait sous le soleil de fin d’après-midi. D’un ton fort affable, Ernst leur souhaita la bienvenue. Il s’excusa de ne s’exprimer qu’en allemand, langue dans laquelle il prononça un discours incompréhensible, avant de retourner à ses occupations, il lui restait du bois à couper. Julien lui offrit son aide, Birgitte traduisit à son mari qui accepta après avoir jaugé les biscoteaux du jeune Français. Les deux hommes s’éloignèrent tandis que la fermière proposait à Maud une visite de l’exploitation.
Très vite, la discussion des deux femmes s’écarta du registre agricole. Birgitte se montra curieuse de la vie en France, elle aimait tant ce pays où elle n’avait jamais mis les pieds. Il faut dire que le bétail nécessitait une présence permanente, Ernst et elle ne voyageaient donc que par procuration, grâce à la télévision. Les tout nouveaux appareils couleur étant hors de prix, ils se contentaient d’images noir et blanc. Ainsi, avaient-ils suivi les évènements de mai à Paris, auxquels Maud et Julien avaient certainement participé. Ici aussi, les jeunes avaient bougé après l’attentat contre Rudi Dutschke2. À Munich, les étudiants contestaient la société de consommation, la guerre du Vietnam, les journaux de Springer et toute forme d’ordre établi. Certains prônaient la révolte armée, beaucoup rêvaient de non-violence et de liberté, à l’instar de son grand fils Guenther, éternel adepte du Peace and Love.
À 24 ans, Guenther allait finalement soutenir son doctorat d’ingénieur chimiste en octobre, après avoir hésité à partir à Katmandou au printemps dernier. En définitive, la raison l’avait emporté sur la passion ; le garçon était resté en Bavière où il brûlait à sa façon ses ultimes vacances universitaires. Chaque jour, il se rendait à Ulm ou à Munich sur sa vieille moto. Il détestait la campagne. Quand son père le lui demandait, il condescendait cependant à donner un coup de main à la ferme.
Birgitte haussa les épaules, Maud éclata de rire. Manifestement, le courant circulait entre les deux femmes. Tour à tour, elles s’arrêtèrent dans la laiterie, un laboratoire équipé de grandes cuves d’aluminium, puis descendirent à la fromagerie au sous-sol où des rangées de tommes s’alignaient sur des clayettes.
Maud posa mille questions sur l’élaboration de la pâte et sur l’affinage. Cet univers étincelant la fascinait aussi par sa richesse olfactive. Des parfums spécifiques baignaient chaque pièce, chaque recoin. Dans l’étable où régnait une odeur plus forte, la succion des trayeuses imposa d’élever la voix. Birgitte détailla son projet d’acquérir des machines mieux automatisées, un énorme investissement qui leur permettrait enfin de s’absenter plus de quelques heures, car les vaches devaient être traites deux fois par jour. Un vrai bagne !
Maud la citadine n’en revenait pas. Nourrie aux images d’Épinal depuis son enfance – et bercée par le fantasme soixante-huitard d’élever des chèvres dans le Larzac – elle découvrait ici une réalité bien différente. L’existence des fermiers bavarois était rythmée par les bêtes et les saisons, loin, très loin du « jouir sans entraves » placardé sur les murs du Quartier latin. C’était au contraire une vie dure, requérant de la détermination et un investissement permanent. Maud fit part à Birgitte de son admiration puis se présenta à son tour sans fausse honte. Issue d’un milieu “favorisé”, elle arrivait d’une autre planète. Fille unique de médecins, elle étudiait le droit et rêvait d’accéder à Sciences Po avec l’ambition de devenir journaliste. Elle avait rencontré Julien à Paris, un soir de barricades. Depuis, ils vivaient ensemble avec un appétit que trois mois de bourlingue n’avaient pas rassasié.
À ces mots, le visage de Birgitte se fissura, un souffle de vulnérabilité balaya son masque paisible, ses yeux se voilèrent de larmes contenues. Maud l’entoura de son bras et la serra contre elle ; une fois encore, elle se rangeait du côté de ceux qui doutent. La fermière lui adressa un sourire d’une extrême douceur avant d’incliner la tête sur son épaule. Le temps se figea quelques secondes, l’espace d’un soupir, la durée d’un câlin. Sans que de grands discours aient été nécessaires, un courant fort s’était établi entre les deux femmes, une confiance spontanée avait émergé. De simples atomes crochus avaient transcendé plusieurs décennies d’hostilités transfrontalières. Cet après-midi, Birgitte et Maud apportaient la preuve par neuf que l’Europe deviendrait tôt ou tard une réalité.
Pour l’heure, l’image que Maud – le rat des villes – percevait de son aînée restait confuse. Elle appréhendait mal le fonctionnement de sa nouvelle amie – le rat des champs – dont le mode de vie se situait aux antipodes du sien. Maud, curieuse d’en apprendre davantage, la pressa de questions. La fermière se livra sans détour, trop heureuse de présenter sa « tribu », en français dans le texte. Outre son aîné Guenther, deux filles complétaient la famille Grubhaldt, Nina, 20 ans, poursuivait ses études à Munich, la plus jeune, Cristina, vivait encore ici. Elle aurait 17 ans en décembre. Les deux sœurs passaient actuellement leurs vacances en Toscane. À mesure qu’elle s’exprimait, les mots de Birgitte coulaient de plus en plus limpides. Les automatismes et les tournures familières revenaient, Maud l’en félicita :
— C’est formidable, Birgitte ! Comme j’aimerais parler aussi bien l’allemand ou l’anglais !
— Question de pratique. Si tu restais ici six mois, tu parlerais couramment…
— Pas sûr ! Je n’ai pas spécialement le don des langues. Et toi, où as-tu appris le français ?
— C’est une longue histoire…
— J’ai tout mon temps… Cela dit, je ne veux pas être indiscrète…
— Il est préférable que je prépare le dîner. Ce soir, vous serez nos invités, je vous mijote une spécialité du Souabe.
— Qu’est-ce que c’est, le Souabe ?
— Le nom de notre belle région.
— Et c’est quoi ton plat ?
— Tu verras.
— Je peux t’aider en cuisine ?
— Je préfère te laisser la surprise et puis, Julien a dit que tu devais te reposer, précisa Birgitte d’un air entendu…
— N’importe quoi !
— Tu n’es pas enceinte ?
— Pas que je sache ! s’esclaffa-t-elle.
— Bon, j’aurais cru… Vous venez à 19 heures ?
— Avec plaisir, merci beaucoup. Danke !
— Bitte !
*
Le repas fut divin, les maultsachen3 de Birgitte n’avaient rien à envier aux raviolis transalpins, le fromage de la ferme tutoyait le sublime et les breuvages locaux facilitèrent les échanges. Au cours du dîner, les deux femmes poursuivirent leur discussion tandis qu’Ernst s’efforçait d’entretenir l’amitié de Julien à grand renfort de bière, de schnaps et de « Prosit ! » Bientôt, les deux hommes sortirent fumer un cigare dans la cour, laissant à leurs compagnes le privilège de débarrasser et de faire la vaisselle, tâches auxquelles elles s’attelèrent avec bonne humeur.
Confortée par l’intimité de la cuisine, Maud trépignait d’impatience, pareille à une môme avant de se coucher.
— Birgitte ?
— Ya ?
— Tu veux bien me raconter ton histoire ?
— Quelle histoire ?
— Tu sais, ta longue histoire, celle de ton apprentissage du français…
— Ah ? Si tu insistes, mais dans ce cas, allons nous installer devant la cheminée. Je pense que nous sommes tranquilles pour un certain temps… Guenther, mon grand fils, m’a appelée, il passe sa soirée chez des amis, il sera ici vers minuit. Quand je lui ai dit que vous étiez là, il a regretté, car, lui aussi adore parler votre langue.
— Dommage pour lui… et pour nous !
— Vous le croiserez peut-être, s’il ne rentre pas trop tard… Tu les entends dehors, les deux autres ?
— Oui, ils chantent faux dans des langues différentes, mais parviennent à s’amuser ensemble ! C’est formidable, le pouvoir de la musique…
— Et celui de la bière ! Allez, viens. Nous, on va prendre une infusion, je préfère…
*
— En 1944, j’avais 18 ans, c’était la guerre. Je vivais ici avec mes parents. Sans être nazis, ils composaient avec les autorités, ils n’avaient pas le choix. Comme beaucoup de leurs concitoyens, ils étaient sans illusion face à la propagande du Reich mais ne cherchaient pas pour autant à savoir ce qui se passait. Je crois qu’en français, on appelle ça “faire l’autruche”. À cette époque, mes frères étaient au front, Franck en Pologne, Gert en France, le Reich avait besoin de toute sa chair à canon pour combler l’appétit du Führer. Ils n’en sont jamais revenus…
La ferme devait fournir des quotas de lait, de choux, de patates et de céréales pour l’armée. En échange de ce racket, le Reich nous fournissait de la main-d’œuvre, des prisonniers de guerre du camp voisin qui ne lui coûtaient rien. Le stalag VII B de Memmingen nous envoyait quotidiennement une dizaine de KG4 de différentes nationalités, Anglais, Américains, Français. Ces hommes arrivaient le matin et repartaient le soir, sous escorte, dans des camions bâchés. Ici, ils travaillaient sans conviction, sous la férule d’un garde-chiourme, un retraité pas méchant mais vénal. Sous son déguisement militaire, Fritz veillait au respect des règlements et à l’avancement des travaux. Tout le jour, il fumait son éternelle pipe sans jamais manquer de tabac.
Les hommes que l’on nous envoyait étaient prisonniers depuis des mois, voire des années. En discutant avec eux – ce qui était formellement interdit – j’appris qu’ils avaient déambulé dans le froid pendant des centaines de kilomètres, en guenilles, dormant dans les fossés, crevant de faim, avant d’atteindre le stalag. Là, hébergés dans des baraques en planches, mal chauffées, sans aucun sanitaire, ils subsistaient dans des conditions de précarité extrême. Leurs visages creusés et leurs silhouettes décharnées en disaient long sur leurs souffrances. « Kriege, gross malheur ! » comme on répétait à l’époque. Papa et Maman les nourrissaient le mieux possible avec des patates, du lait, du fromage, quand ils arrivaient à en mettre de côté… Parfois un peu de saucisse. Pour ces prisonniers, venir travailler chez nous était une aubaine, car cela répondait à leur premier besoin, manger. Ils se bousculaient pour venir ici. En effet, beaucoup d’autres “employeurs” les traitaient comme des chiens. Ils les considéraient comme des esclaves.
C’était une sale époque. Dans les campagnes, on vivait mieux qu’à la ville, mais il fallait se méfier de tout. Les ordres du Reich étaient très fermes vis-à-vis des captifs : pas de contact avec la population. Pour une liaison avec une femme allemande, les KG encouraient la peine de mort. Le Führer voulait avant tout préserver la race aryenne. Pas de mélange de genres. Pourtant, les occasions étaient nombreuses à l’extérieur des camps, dans les usines ou dans les fermes. L’enrôlement de tous les mâles allemands valides dans la Wehrmacht ne faisait pas que des heureuses. En conséquence, toutes les ruses étaient bonnes pour se ménager quelques instants d’intimité internationale. Avec ça, tu l’imagines, les dénonciations allaient bon train, il fallait se cacher, mentir en permanence.
Je te raconte tout cela pour que tu comprennes cette période où nous manquions de tout, de nourriture, mais surtout de la possibilité de rêver, de se projeter dans l’avenir. Vous autres avez cette chance aujourd’hui. Quand je vois mon fils Guenther, toi ou Julien, je pense que vous avez bien raison. Chaque génération porte une croix plus ou moins lourde. La nôtre a pesé des tonnes, j’espère que la vôtre sera plus légère.
Mais je m’égare. Pour revenir à nos moutons, comme on dit, j’ai appris le français – et l’anglais – au contact des prisonniers. Tous les jours, je leur servais le repas de midi et, moyennant quelques patates supplémentaires, Fritz me laissait discuter avec eux. Nous parlions de tout et de rien, ils se montraient particulièrement curieux de l’état des offensives alliées en Italie ou de la situation sur le front russe. L’information que nous possédions n’avait aucune valeur puisqu’elle provenait du Reich. Qu’importe, ils voulaient quand même savoir. Certains demandaient parfois un service, des vêtements de rechange ou une paire de chaussures, ou voulaient acheter de la nourriture pour la revendre à des camarades moins chanceux. À l’époque, les prisonniers disposaient de leur propre monnaie, les marks de camp réservés aux échanges entre eux ou à quelques transactions par voie officielle. Cet argent n’avait pas cours dans le pays, il était interdit aux Allemands d’en accepter. Tout était fait pour empêcher les KG de se mêler à la population.
Malgré cela, j’échangeais quotidiennement en anglais et en français avec eux. J’avais 19 ans, à peu près l’âge que tu as aujourd’hui, celui de l’insouciance. Les femmes ne sont jamais aussi jolies qu’à 20 ans ! Profites-en, ma belle ! Moi aussi, j’étais mignonne, et tous ces hommes vivant comme des bêtes depuis des mois ou des années rivalisaient de courtoisie pour m’approcher. J’étais une princesse inaccessible, un conte de fées. C’était devenu un jeu, chacun devait m’apprendre un mot différent chaque jour. C’est ainsi que mes connaissances en français et en anglais ont progressé. Peut-être davantage en français avec un groupe de trois copains qui sont restés chez nous pendant plusieurs mois. Ils s’appelaient Valentin, Lucien et Francis. Je me souviens d’eux comme s’ils étaient encore là, nous avons passé des moments merveilleux ensemble.
Mais voici nos hommes qui rentrent, et Ernst déteste que j’évoque cette sale période. Allons les accueillir, suis-moi !
*
Le lendemain, le coq bavarois n’eut aucune pitié de la grasse matinée des jeunes Gaulois. Dehors, le jour commençait à poindre. Maud se réveilla embrumée par l’odeur du foin et le manque de sommeil. À ses côtés, la tête enfouie dans son duvet, Julien tentait de s’offrir un petit rab. Jalouse, elle l’en empêcha, jugeant qu’il avait suffisamment abusé avec ses ronflements de tronçonneuse. Déjà, hier soir, ou plutôt ce matin très tôt, lorsqu’ils s’étaient allongés, il s’était endormi d’un sommeil d’ivrogne, incapable de lui faire l’amour. Autrement dit, il avait commis un crime de lèse-majesté dont elle demandait réparation immédiate.
Quelques minutes plus tard sous les assauts de sa compagne, Julien avait recouvré sa fougue. Le grincement du portail les surprit en pleins ébats.
— Hou hou, les amoureux, je peux entrer ? lança Birgitte. Je vous apporte du café tout chaud et des tartines. Je pose tout ça sur le marchepied de la charrette. Descendez quand vous voulez…
— Merci ! hurlèrent-ils en chœur.
Une heure plus tard, Maud et Julien, rincés à l’eau froide du puits, brillaient comme des sous neufs. Le café avait fini de les réveiller, leurs bagages étaient rassemblés, ils s’apprêtaient à les transporter jusqu’à leur voiture, lorsque Guenther les rejoignit. Il portait un gros sac à dos.
De jour, le grand Bavarois en imposait moins que la nuit. Sans doute ses vêtements y étaient pour beaucoup puisqu’il avait troqué son cuir de motard pour un jeans et une chemisette à fleurs.
La veille au soir, en arrivant, il avait croisé Maud et Julien dans la cour de la ferme. Ils avaient fumé quelques cigarettes ensemble et avaient sympathisé autour d’une dernière bière avant de se coucher. Le français impeccable de Guenther avait facilité le contact. Comme sa mère, il était fan de la France. Il y avait séjourné à deux reprises, une fois à Lyon, une autre fois sur la Côte d’Azur, mais rêvait de mieux connaître Paris où il n’avait jamais fait que de courtes haltes. Malheureusement, son antique BMW R2 n’était plus en mesure de le transporter aussi loin. Et puis, ses vacances se terminaient puisqu’il soutenait son diplôme dans quinze jours…
Maud n’avait fait ni une ni deux. Sans même consulter un Julien trop imbibé, elle avait proposé à Guenther de les accompagner à Paris. Ils partaient le lendemain et, en se serrant un peu, ils lui feraient une place dans la 2 CV. Contrairement à sa vieille BM, Titine était suffisamment vaillante pour gagner la France sans embarras. Et puis, ils connaissaient assez de monde à Paris pour héberger Guenther pendant une semaine… Le grand gaillard avait affecté une mine étonnée, sa barbe soigneusement taillée dissimulait mal son sourire réjoui.
— Tu sais, Maud, mon plus beau rêve ?
— Non ?
— C’est de boire une bière Place du Tertre.
— Alors, banco ?
— Banco !
Sur ces paroles définitives, ils étaient partis se coucher.
*
Le soleil éclairait la cour où Guenther et Julien chargeaient la deudeuche tandis que Maud ramenait le plateau du petit-déjeuner à la cuisine. En passant devant l’étable, elle aperçut Birgitte occupée à la traite. La fermière s’interrompit pour accompagner la jeune femme jusqu’à la maison. Là, après s’être lavé les mains, elle ôta sa blouse puis invita Maud à boire un café avec elle. Machinalement, elles s’installèrent autour de la table aux mêmes emplacements que la veille au soir. Birgitte paraissait tendue, presque crispée, des cernes violets entouraient ses yeux transparents.
— Tout va bien ? demanda Maud. Tu as l’air fatiguée…
— J’ai peu dormi cette nuit, j’ai écrit une lettre…
— Une lettre ? À qui ?
— Tu sais, je ne t’ai pas tout dit hier. Je me méfie de mes souvenirs et peut-être je devrais en rester là… En vérité, je te connais à peine, mais j’ai envie de te faire confiance.
— C’est sympa, merci !
— Tu vois, Maud, je t’ai parlé de ces trois prisonniers français que j’ai rencontrés en 44, ceux avec qui j’ai appris votre langue.
— Tu me l’as déjà dit.
— S’il te plaît, ne m’interromps pas, c’est suffisamment difficile comme ça…
— Entendu, je me tais.
— L’un de ces trois hommes était particulièrement séduisant. Et drôle ! Brun, élancé, la trentaine, un corps très mince, le visage émacié, le regard espiègle, il parlait avec un accent du sud de la France. On aurait dit qu’il chantait. Valentin adorait faire le pitre ; chaque jour, il se démenait pour faire oublier le stalag à ses copains. Il prétendait que c’était une technique de survie. La première fois que je l’ai vu, c’était fin 43. Les prisonniers étaient rassemblés autour d’un vieux poêle, dans l’appentis, derrière la grange où vous avez dormi. Je leur apportais de la soupe au chou et des patates pour leur déjeuner. Chaque jour, les gars m’attendaient avec impatience, tous me dévoraient des yeux. Parmi eux, Valentin m’a observée avec plus d’acuité que les autres, son sourire était triste comme s’il s’excusait de ne pas m’emmener valser. Cela m’a émue, tu sais comme on est romantique à 18 ans ! Nos regards se sont incrustés l’un dans l’autre. Il a fallu le coup de sifflet du contremaître et les railleries de ses copains pour décider Valentin à reprendre le travail. Il n’avait pas touché à sa nourriture. En achevant de débarrasser les gamelles, je me suis débrouillée pour frôler sa main décharnée. Un flot d’énergie bienveillante m’a envahie aussitôt. J’ai tout de suite compris que j’étais amoureuse.
— Aïe !
— J’ai pensé à lui toute la nuit suivante. Et ça a continué, je passais mes journées à le regarder travailler, je l’observais de loin par la fenêtre, car il était interdit d’approcher les hommes, sauf pour les repas. Petit à petit, moyennant compensation sous forme de saucisse, Fritz a accepté de fermer les yeux. Et puis, lorsque les autres prisonniers de l’équipe ont compris notre situation, ils ont tout fait pour nous faciliter les choses. C’était fou la solidarité de ces garçons ! Ils se sont débrouillés pour abattre le boulot en l’absence de Valentin à qui Fritz accordait chaque jour un bon de sortie d’une demi-heure. De mon côté, je devais me méfier des regards indiscrets, mes parents ne devaient en aucun cas connaître notre secret. Nous avancions donc sur une corde raide. On se retrouvait dans le petit bois où, avant la guerre, mes frères avaient aménagé une cabane. C’est là que nous avons échangé toutes nos promesses, c’est là que nous nous sommes aimés. Nous avons vécu plusieurs mois de folie jusqu’à ce jour maudit, début 44, où Valentin m’a déclaré qu’il voulait partir, rentrer en France. Pour moi, ce fut un choc énorme, un coup sur la tête, j’étais déboussolée. Cependant, j’ai écouté ses arguments, j’ai fait semblant de les comprendre. Il n’en pouvait plus de la captivité et, selon les rumeurs, la victoire des Alliés ne faisait plus de doute. Il désirait en être acteurs, participer aux combats. Sa décision était difficile à prendre, il s’en voulait de me causer de la peine, tiraillé entre notre amour impossible et son engagement dans la lutte. Il disait qu’il fallait finir cette guerre au plus vite pour revenir me chercher. J’étais sa « Nine », prétendait-il, la femme de sa vie. Il m’a convaincue, j’étais amoureuse. Pour lui, j’étais prête à tout, je l’ai aidé à s’évader.
— Et alors ? Tu l’as revu ?
— Non ! Valentin n’a plus donné signe de vie. Je n’ai jamais su s’il avait réussi à rejoindre la France ou s’il s’était fait prendre ou tuer. J’ai écrit aux autorités françaises, je n’ai jamais obtenu de réponse. Avant de partir, Val m’avait laissé une adresse sur la Côte d’Azur où il était pêcheur avant la guerre. Je lui ai envoyé plusieurs lettres, elles me sont presque toutes revenues.
— Tu as dû être malheureuse ?
— Les premières années, j’ai vécu un calvaire… Avec le temps, on apprend que la vie est faite de soubresauts, d’incertitudes. J’ai relativisé. Et puis j’avais rencontré Ernst à la fin de la guerre, il était lui aussi au bord du gouffre. Il sortait d’une sale histoire. Ernst est un garçon prévenant, patient, attentif. On a rassemblé nos misères pour devenir plus forts, et on a réussi. Je suis heureuse de ce que nous avons bâti, je suis fière de notre famille, mais je n’ai jamais oublié Valentin. Alors, puisque le destin t’a conduite ici cette nuit, je lui ai rédigé une lettre. Je te la confie, Maud, son adresse figure sur l’enveloppe. Essaie de savoir ce qu’il est devenu. Voici mon téléphone à la ferme, tu me diras… Évite toutefois de m’écrire ici. Ernst serait mécontent d’apprendre que je recherche Valentin.
— Je comprends. Je ferai l’impossible pour t’aider, Birgitte, mais la Côte d’Azur ce n’est pas tout à fait la banlieue proche de Paris. Cela risque de demander un peu de temps…
— J’attends depuis 25 ans, alors quelques mois de plus ou de moins, quelle différence ?
Deux brefs coups de klaxon les rappelèrent à l’ordre. Birgitte écarta le voilage. Ernst avait rejoint les deux garçons, son tracteur paraissait énorme à côté de la 2 CV. Il discutait avec son fils pendant que Julien astiquait le pare-brise et les phares. Le grand départ approchait.
— Encore une chose, Maud. Guenther m’a dit que vous l’emmeniez à Paris. Merci pour lui, mais pas un mot de tout cela ! Dissimule cette lettre dans ton sac, qu’il ne reconnaisse pas mon écriture. Allez, viens m’embrasser, jeune fille, c’est l’heure de partir. Je te souhaite beaucoup de bonheur avec Julien !
1 Lettre de l’alphabet farsi, équivalent du « g » de l’alphabet romain.
2 Militant de gauche allemand pris pour cible par un forcené le 11 avril 1968.
3 Ravioles rectangulaires, traditionnelles de la région de Souabe.
4 KG : Krieg Gefangener, appellation en vigueur dans l’armée allemande pour désigner les prisonniers de guerre. Pour beaucoup, ces hommes portaient l’inscription KG en lettres géantes au dos de leurs manteaux pour être aisément identifiables.
I
Mai 1969
L’aiguille du compteur dépassait les 160 km/h, Julien conduisait, le nez tendu vers l’avant, les yeux exorbités, les mains crispées sur le curieux volant de l’ID19. À mesure qu’il accélérait, les ponts enjambant la route lui paraissaient de plus en plus minuscules. Quelle sacrée bagnole, ça changeait de la deudeuche ! Maud avait manœuvré avec diplomatie, son cher papa leur avait finalement prêté sa voiture pour leur escapade dans le Midi, un week-end à rallonge permettant de commencer le mois de mai en fanfare, puisque cette année le 1er et le 8 tombaient un jeudi. Mieux qu’un viaduc ! Julien et Maud avaient décidé de sécher les trois journées de cours pour bénéficier de dix jours de vacances. Le jeu en valait la chandelle, surtout avec la fête que Thadée – un de leurs amis – organisait à Mandelieu, dans les Alpes-Maritimes.
Thadée et Julien s’étaient connus deux ans plus tôt, à l’université de Jussieu. Les deux garçons avaient sympathisé, par le plus grand des hasards,