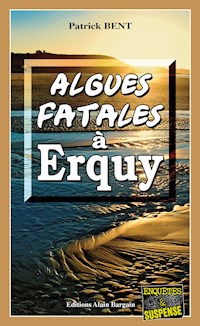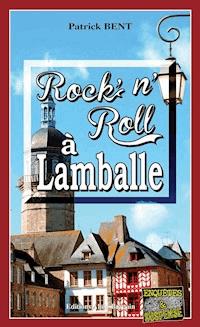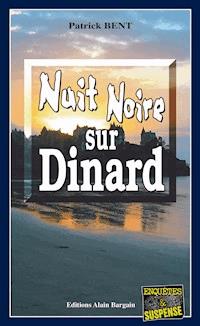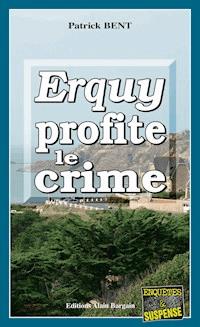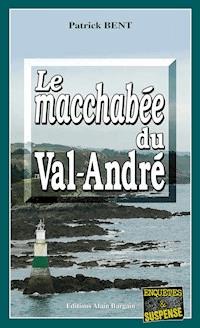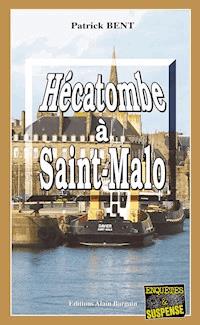Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Palémon
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Le commissaire Sébastien Bressac, méridional en exil, vient d’être nommé à Saint-Brieuc.
Sa première enquête bretonne le conduit entre Erquy et le Val-André, où les membres d’une famille fortunée sont frappés d’un mal mystérieux qui les ronge de l’intérieur.
Épaulé par ses lieutenants Morgane Bozec et Yvon Marquis, Bressac va découvrir le monde de l’aquaculture et se confronter à des notables locaux aussi bien qu’à des industriels de l’agroalimentaire.
Nourrir les dix milliards d’individus prévus sur la planète à l’horizon 2050 représente un enjeu technologique et financier colossal. Le pactole associé suscite les insatiables appétits d’individus sans scrupules. Certains parmi eux avancent masqués, d’autres nagent en eaux troubles, tous appartiennent au monde des prédateurs…
À PROPOS DE L'AUTEUR
Tombé tout petit dans la marmite de l’imaginaire, Patrick Bent a publié à ce jour une vingtaine de romans noirs et polars régionaux ainsi que des nouvelles (noires, blanches ou roses). Auteur prolifique, physicien de formation, mais aussi marin, inlassable voyageur, il s’est établi à Erquy au terme d’une carrière internationale consacrée aux lasers. De par son enfance marseillaise et sa fréquentation assidue des côtes bretonnes, il voue à la mer une passion sans réserve.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Retrouvez les ouvrages de Patrick Bent sur :https://patricebenoit91.wixsite.com/patrickbent
Retrouvez tous nos ouvrages sur www.palemon.fr.
CE LIVRE EST UN ROMAN.
Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres, des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.
À Luce, ma compagne.
Chapitre 1
Hôtel de police de Saint-Brieuc, 17 h 45
La pluie de novembre constelle les vitres du bureau. Depuis ce matin, un crachin obstiné brouille les contours de la ville. Voilà un an que j’ai atterri ici et force m’est de constater que ma moto passe plus de temps sous sa bâche que sur la route. Mais j’ai juré de m’adapter ; en prime, j’ai le privilège d’être vivant. Somme toute, ce n’est pas si mal ! Avec ça, l’ambiance du commissariat fait l’unanimité, notre hôtel de police est noté quatre étoiles sur Internet1.
On frappe à ma porte. Par l’entrebâillement, la lieutenante Bozec affiche une mine préoccupée. Je lui fais signe d’entrer.
— Un souci, Morgane ?
— Probable, Patron ! Une femme vient d’appeler, elle s’est bouclée dans son appartement avec ses deux mômes. Elle chiale, genre grosse crise de nerfs. Sur le palier, son mari menace d’enfoncer la porte, il serait ivre et armé. À entendre ses hurlements, ça a l’air sérieux.
— Tu as prévenu les voitures en maraude ?
— Elles sont toutes sur une baston monstre au Plateau.
— Et Marquis, il n’est pas là ?
— Non, il est à Erquy ! Va falloir que j’aille au charbon moi-même…
— Je viens avec toi, décidé-je en récupérant mon Sig-Sauer dans le tiroir.
Pendant que j’enfile ma veste imperméable, Morgane s’éclipse.
Je la retrouve au parking, assise au volant d’une C3 tricolore, gyrophare et moteur allumés. Nous démarrons vers la Croix Saint-Lambert, une zone restée en « QSP », quartier sensible problématique, de niveau 4, même après la démolition des tours.
Dès ma nomination à Saint-Brieuc, la lieutenante Morgane Bozec m’a chaperonné. En poste ici depuis des lustres, la ville n’a pas de secrets pour elle. De deux ans mon aînée, c’est une femme efficace, décidée, mariée à un marin pêcheur d’Erquy. À l’occasion, Morgane ne rechigne pas à aller à la castagne, sa robuste morphologie le lui permet. Côté personnalité, ma collègue me captive par sa facilité à conduire les interrogatoires. Sous sa foisonnante crinière blonde, son regard de louve sait déstabiliser les plus rétifs. À sa manière de souffler le chaud et le froid, d’alterner le yin et yang, c’est une championne du confessionnal. Lorsqu’elle se met en cuisine, même les anorexiques passent à table.
Tout juste quadra, Morgane n’a pas d’enfants. Elle affirme que c’est un choix assumé face aux perspectives catastrophiques des cinquante prochaines années. A-t-elle raison ou bien utilise-t-elle cet argument pour dissimuler la stérilité de son couple ? Ce ne serait pas la première… Aujourd’hui, nous ne sommes pas suffisamment intimes pour aborder le sujet. Un jour peut-être ? Pour l’heure, chacun conserve ses secrets, ce qui n’empêche pas notre petite équipe de ronronner comme un moteur de Formule 1.
La sirène deux-tons nous ouvre la route, les essuie-glaces balayent le pare-brise, bientôt la C3 stoppe au pied de la barre d’immeubles. Dans le hall, les boîtes aux lettres sont défoncées et l’ascenseur ne répond pas. Par la cage d’escalier, des cris de déments dégringolent jusqu’à nous. Nous grimpons quatre à quatre, le barouf se précise, les noms d’oiseaux pleuvent, les coups dans la porte se multiplient. Je m’arrête à la dernière volée de marches menant au quatrième. Morgane me rejoint, nous reprenons notre souffle, puis nous achevons notre ascension au ralenti, sans un bruit, comme des Sioux. Trop occupé à démolir la cage d’escalier et à insulter sa femme, le furieux ne nous sent pas venir. Sans attendre, je lui fonce dessus et le ceinture. Il risque une ruade, tente de se retourner, mais je le plaque contre la porte de l’appartement. Sa tête fait un bruit de noix creuse contre le battant. J’immobilise ses bras dans son dos pendant que ma collègue lui passe de jolis bracelets chromés. Du travail d’orfèvre, vite fait, bien fait, sans bavure. La fouille au corps ne donne rien, l’homme ne porte pas d’arme, il bluffait. C’est sans doute mieux pour lui !
De retour à l’hôtel de police, Morgane embarque le prévenu vers la salle d’interrogatoire pendant que je regagne l’étage. Dans le couloir, je croise le divisionnaire Franquet dont le bureau jouxte le mien. Nous échangeons deux ou trois banalités, puis il disparaît dans son antre.
Ancien du SRPJ de Brest, Archibald Franquet assume aujourd’hui la responsabilité de la direction départementale de la sécurité publique. En jargon flic, ça donne DDSP et ça pèse quelque trois cents agents entre Lannion et Saint-Brieuc. Pas de quoi chômer ! En chef d’orchestre avisé, Franquet cornaque l’ensemble d’une main de fer dans un gant de velours. L’homme est imaginatif, pragmatique, exigeant. Un patron à l’ancienne, de ceux qui montrent l’exemple.
Voilà deux mois, au terme de ma période probatoire à l’hôtel de police, Franquet m’a proposé de créer un service d’intervention dédié aux affaires criminelles. Une sorte d’antenne locale du SRPJ, une structure légère, autonome, capable de réagir immédiatement. Sans m’attarder sur ses motivations, j’ai accepté son offre, conscient du privilège qui m’était accordé.
Sur les recommandations du patron, j’ai constitué mon noyau dur avec Morgane Bozec d’une part, et le lieutenant Yvon Marquis, frais émoulu de l’école d’officiers. Jusqu’à présent, notre équipe carbure à merveille. Peut-être est-ce simplement parce que nous rapportons directement au grand manitou Franquet sans être encombrés de strates intermédiaires. Notre trio jouit d’un statut hors norme, et beaucoup de nos collègues donneraient cher pour nous rejoindre. Mais ce n’est pas à l’ordre du jour. Mon équipe doit faire ses preuves avant de se développer. En attendant, nos voisins nous matent d’un sale œil. Les mieux intentionnés ne détesteraient pas glisser quelques peaux de banane sous nos godasses à la première occasion. Aussi ai-je recommandé à mes troupes de vivre sans esbroufe et de participer à la vie de la maison.
Assis à mon bureau, je fais pivoter mon fauteuil afin de ranger mes dossiers dans le coffre-fort situé derrière moi. Cela fait, je claque la porte blindée, brouille la combinaison, puis je reviens à mon écran d’ordinateur. Ma boîte mail ne propose rien de franchement palpitant, outre un mémo de Franquet à propos de livraisons de drogue à domicile.
Un phénomène très tendance ces derniers mois. Selon ses chiffres, les UberSniff, et les UberBeuh – comme on les a baptisés – se substituent de plus en plus aux dealers traditionnels. Les caméras de surveillance installées en ville n’y suffiront plus. Il va falloir démultiplier les contrôles aux carrefours, traquer les dealers sur les réseaux sociaux et le Darknet. Le patron nous convoque le surlendemain avec nos collègues des stups pour élaborer un nouveau dispositif. Sans être directement concerné, je note la date et l’heure sur mon agenda, puis j’éteins mon PC. Il est 19 h 45.
J’enfile ma veste de quart, coiffe une casquette de base-ball, et je boucle mon bureau. Avant de quitter le commissariat, je passe saluer Yvon et Morgane au sous-sol.
On les a installés dans un cagibi éclairé dans la journée par une imposte haut perchée et la nuit par des tubes néon. Pas la moindre fenêtre ! Devant mes récriminations, Franquet m’a convaincu que mon team jouissait suffisamment de prérogatives spéciales pour avaler cette minuscule couleuvre. Ainsi éviterons-nous les crocs-en-jambe de nos collègues.
— Car, enfin, Bressac, quel officier de police normalement constitué accepterait de bosser dans un pareil débarras ? Personne ! En y installant vos troupes, vous donnez le change. Croyez-moi, poursuit le divisionnaire, c’est le prix à payer pour vivre sereinement. Après tout, ne sommes-nous pas des « gardiens de la paix » ?
La pièce mal ventilée sent le fauve en fin de journée. Le parfum musqué de Morgane et la lotion après-rasage d’Yvon n’y peuvent pas grand-chose. Installés face à face, leurs bureaux à touche-touche, les lieutenants Bozec et de Marquis partagent leur oxygène avec parcimonie. Ils peuvent à peine reculer leurs sièges sans heurter les cloisons.
— Faudrait pousser les murs, suggère Yvon.
— D’accord, mais un peu plus de mon côté que du tien, gringalet ! lui rétorque Morgane.
Yvon Marquis ne paye pas de mine. À peine plus grand que moi, il arbore malgré son jeune âge une calvitie naissante et une petite brioche d’amateur de bière. Son inaltérable sourire inspire une sympathie de bon aloi. Yvon est un mec à qui l’on a envie de faire confiance, il affirme même avoir une tête de confessionnal. Il tiendrait le rôle du flic bonasse quand Bozec pourrait jouer la méchante. Mais il faut se méfier de l’eau qui dort, Marquis pige les gens au quart de tour et, sans avoir l’air d’y toucher, c’est un redoutable. Morgane et lui forment un binôme complémentaire, capable de chanter le duo de Lakmé sans une fausse note.
— T’en as fait quoi de notre artiste ? demandé-je à ma collègue.
— Pas grand-chose à raconter, Chef. Père de famille, chômeur, alcoolique… l’engrenage classique. Il passe la nuit en dégrisement. J’ai transmis aux services sociaux. Demain il fera jour.
— Rien d’autre ?
— Non, Chef !
— Alors je vous laisse. Ne couchez pas ici quand même !
— À demain, Patron !
— Je vous ai dit cent fois de m’appeler Sébastien, bordel ! Gardez les chefs pour la cuisine et les patrons pour les mecs du CAC 40 !
— Entendu, Commissaire ! lui lance Yvon. Bonne soirée.
Dehors, la bruine tourbillonne sous les lampadaires. J’enfile ma capuche par-dessus ma casquette. Il me faut dix minutes à pied pour atteindre le deux-pièces que je loue à Balzac. Le quartier du Plateau ne respire pas la poésie. En pleine reconstruction après le démantèlement des deux premières tours, il est plutôt craignos, mais sa proximité du commissariat me convient. À la première occasion, je déménagerai au port du Légué. Même si la mer y est invisible, la présence des bateaux et les balades sur les quais me changeraient les idées, car ici, c’est genre tristounet. Béton, travaux de réaménagement, voie rapide, anonymat, contre-allée, paysage urbain des seventies, un environnement de grisaille dans lequel je m’achemine sans plaisir.
L’ascenseur me dépose au quatrième, je fouille mes poches sans trouver mes clefs. Et merde ! Je me souviens que, cet après-midi, lorsque j’ai pris mon pistolet pour partir en opé, j’ai hésité à laisser mon porte-clés dans le tiroir. Mais je ne l’ai pas fait. Erreur, car, à tous les coups, mon trousseau a glissé de ma poche dans la bagarre ! Inutile de cavaler jusqu’à la Croix Saint-Lambert maintenant, c’est cuit ! Je ne le récupérerai jamais !
Planté devant la fermeture à cinq points de ma porte, je cherche une solution. À cette heure, nos serruriers maison ont terminé leurs services. Difficile de faire appel à eux pour mon cas personnel. Il me reste bien quelques notions de crochetage, mais, même avec un bon rossignol, je me casserais les dents.
La minuterie s’éteint. Seul un rai de lumière filtre sous l’une des six portes du palier. Visiblement, ce soir, il n’y a pas foule au quatrième étage. Depuis mon installation dans l’immeuble, je n’ai jamais recherché le contact avec mes voisins. L’anonymat me convient, je suis un homme de l’ombre, un cow-boy solitaire. Je laisse les honneurs de la presse au divisionnaire. Pour vivre vieux, je vis discret.
La minuterie s’éteint de nouveau. Pareil à un papillon de nuit, je me dirige vers le filet de lumière au sol à l’autre extrémité du palier. Je m’arrête devant la porte et je rallume. Sous l’œilleton, une bande autocollante Dymo indique « Clémence Thébault ». Mon voisin est donc une voisine. Élémentaire, mon cher… De l’appartement sourdent les accents d’un grand orchestre ; des cuivres et des cordes soutiennent les envolées d’une flûte traversière, c’est grandiose, aérien ! Je me laisse séduire le temps de quelques mesures puis je me décide à sonner. Un coup bref.
Presque instantanément le volume sonore baisse et des bruits de pas se précisent. Je rabats ma capuche sur mes épaules, ôte ma casquette, lisse mes cheveux noirs de la main et tente un sourire engageant face à l’œilleton.
— Qu’est-ce que c’est ? s’inquiète une voix féminine. Que voulez-vous ?
— Je suis votre voisin, Sébastien Bressac.
— La musique vous dérange ?
— Pas du tout ! J’ai égaré mes clefs.
— Dommage pour vous, mais je n’y peux pas grand-chose !
— N’ayez crainte, madame ! Je désire simplement voir s’il est possible de rentrer chez moi par les balcons.
— Vous êtes fou ! Avec cette pluie, vous allez vous tuer ! Allez dormir à l’hôtel et appelez un serrurier demain.
— Rassurez-vous, je suis habitué à ce genre de gymnastique.
— Vous êtes cascadeur ? Ou peut-être pompier ?
— Pas franchement, mais il m’arrive d’en côtoyer, ajouté-je en ravalant ma salive.
Puis, exhibant ma carte tricolore, je fais valoir mon métier de policier dont le but est de protéger plutôt que d’agresser ses congénères. Mais ma voisine ne bronche pas, mes arguments rebondissent sur sa porte !
— Vous aimez Beethoven ?
— Je suis fan…
— Et vous écoutiez quoi ? C’était splendide !
— Le scherzo de la Symphonie n° 3, l’Héroïque. Vous connaissez ?
— Un peu, improvisé-je.
— Moi, je le connais par cœur !
— Vous êtes musicienne ?
— Non, simplement mélomane à mes heures perdues, dit-elle en débloquant le verrou.
La porte s’entrouvre suffisamment pour apercevoir sa frimousse. Ses cheveux blonds coupés court encadrent un visage délicat. Une forme de fragilité émane de ses yeux pâles, bleu délavé, presque éteints qu’elle plisse pour mieux me détailler par l’entrebâillement. Son inspection achevée, ses lèvres finissent par sourire. Aussitôt, de charmantes ridules apparaissent aux commissures de ses yeux. La grâce de la quarantaine…
— Entrez ! se décide-t-elle en décrochant la chaînette de sécurité.
— Merci ! Mais ma veste est trempée, je vais flanquer de l’eau partout.
— L’eau, ça ne tache pas, suivez-moi !
— Vous êtes sûre ?
— Venez !
Vêtue d’une robe de chambre surpiquée beige, Clémence Thébault m’apparaît en pied. Son petit gabarit n’affecte en rien l’harmonie de sa silhouette. Elle me guide vers sa terrasse à travers la salle de séjour. Son deux-pièces est une copie du mien en plus cosy, tentures aux murs, tapis de haute laine posé sur la moquette, bibelots, photos sous-verre, plantes vertes. Un intérieur féminin, coloré, soigné.
Sans m’y attarder, je me rends sur son balcon. Nos appartements disposent de terrasses couvertes séparées par d’épaisses cloisons dressées jusqu’au plafond. Pour passer chez le voisin, la seule solution est de grimper sur le garde-corps et d’enjamber par l’extérieur, dos au vide. Pour gagner mon chez-moi, ce sera double peine, car l’appartement de Clémence Thébault et le mien ne sont pas contigus. Un autre logement se trouve entre les nôtres.
Je défais ma veste imperméable, la pose sur la chaise longue, puis, les deux mains sur la balustrade, je me penche, afin de me repérer. Le parcours, même vertigineux, ne présente aucune difficulté. Sans attendre, je lance un clin d’œil à ma voisine et je prends pied sur le garde-corps.
— Je peux vous aider ? s’inquiète Clémence qui s’est approchée.
— Remettez la Symphonie Héroïque à fond, s’il vous plaît, je vais en avoir besoin !
Dos au vide, insensible à la flagellation des bourrasques, je passe ma jambe et mon bras gauche vers le balcon voisin. Le pied posé sur la rambarde cylindrique, mouillée, glissante, je parviens à m’assurer un appui. De la main, je cherche une prise à tâtons. Je bute sur un pot de fleurs suspendu à un crochet, suffisamment robuste pour transférer mon poids de l’autre côté. Au moment de ramener ma jambe droite, un éblouissement m’aveugle. Pris de vertige, les mains cramponnées de part et d’autre de la séparation, mon corps se tend, exsude ses humeurs, mon intestin se noue, je tremble comme une feuille. Plusieurs minutes inconfortables s’égrènent durant lesquelles je m’efforce de ne pas bouger, amarré à ma peur. Les yeux fermés, je pratique une série de lentes respirations abdominales et, petit à petit, mon trouble s’évanouit comme il était venu. Mon calme retrouvé, j’enjambe le vide sans aucune appréhension. À peine ai-je pris pied sur la terrasse qu’une voix se fait entendre sur fond de Ludwig van. La voix des anges ?
— Tout va bien ?
Penchée à la balustrade, Clémence s’émeut de mon atterrissage.
— Impeccable ! Je n’avais pas bivouaqué sur une paroi depuis longtemps !
— Vous êtes sûr que ça va ?
— Rentrez au sec. Je vous retrouve dans quelques minutes.
Sans attendre, je réitère mon acrobatie entre le balcon de mon voisin et ma propre terrasse où je me pose, trempé, mais sans encombre cette fois.
Pour pénétrer chez moi, je dois encore déverrouiller la baie vitrée. De l’extérieur, cela peut sembler compliqué. En pratique, une carte de crédit glissée sous la serrure suffit. Un coup sec et le mécanisme se débloque. N’importe quel apprenti braqueur connaît ça. C’est aussi simple que d’entrer dans une banque.
À poil dans ma chambre, je me frictionne avec un drap de bain. De la main, je mets un peu d’ordre dans ma tignasse brune encore humide. Des vêtements propres achèvent de me redonner figure humaine. Dans le miroir, mon double me dévisage de son regard noir et inquisiteur : teint mat, barbe naissante, visage émacié, cheveux brillants, fatigué mais rassuré à l’idée d’être toujours en seul morceau.
Après un ultime coup de peigne, je m’adresse un clin d’œil et sors récupérer ma veste imperméable.
Ma voisine m’attend sur le pas de sa porte, elle tient un grand sac plastique dans les mains.
— Votre parka ! Avec ce mauvais temps, déclare-t-elle, vous en aurez besoin !
— On en a pour trois jours de pluie, il paraît.
— La météo, vous savez, je n’y crois qu’à moitié !
— Je vous rapporterai votre sac demain.
— Rien ne presse.
— Merci encore, voisine. Bon, je vais y aller !
— Eh bien, moi aussi ! Après cet intermezzo, je retourne à mon cher Beethoven. Bonsoir, monsieur.
— Appelez-moi Sébastien, proposé-je. Ou plutôt Seb tout court.
— Je préfère Sébastien, tranche-t-elle. Moi, c’est Clémence.
— Entendu, Clémence !
Nous échangeons une poignée de main veloutée, chaleureuse, bienveillante. Nos regards se croisent tandis que nos paumes s’attardent l’une contre l’autre. J’ai l’impression de tenir un oisillon blessé entre mes doigts.
— Et si nous prenions un verre ensemble demain ? improvisé-je.
— Vous croyez ? dit-elle, le rouge aux joues.
— Je passe vous chercher à 19 h 30 ? On ira en ville…
— En fait, demain, ça ne m’arrange pas !
— Après-demain alors ?
— Pourquoi pas ? Eh bien, c’est d’accord, Sébastien !
J’attends qu’elle ait refermé sa porte pour rentrer chez moi, avec la clef, c’est plus facile.
Le deux-pièces que je loue en meublé transpire l’austérité. On pourrait croire une cellule de moine équipée au rabais. Dans mon contexte actuel, je n’ai pas pris la peine d’ajouter la moindre décoration. Pas même un calendrier de la Poste pour égayer les murs. Rien ! Des cloisons tendues de papier peint beige uniforme, une moquette grise d’un autre âge et une table basse en palette recyclée. Ambiance !
Mes émotions de début de soirée m’ont creusé. Dans la cuisine, le frigo ronronne comme un vieux chat. À l’inverse des pensionnaires du commissariat, il faut lui cogner gentiment dessus pour le faire taire. Quand je l’ouvre, une lumière froide me dévoile un stock de yaourts hors d’âge assorti d’une boîte d’œufs, d’un paquet de beurre entamé, d’un demi-litre de lait et de quelques tranches de pain industriel périmé. Seules rescapées des épisodes précédents, trois bouteilles de Coreff fraîchissent dans l’épaisseur de la porte. J’en décapsule une que je verse lentement dans un verre où naît un faux col empli de promesses. Sans être diplômé en biérologie, je considère que boire une bière au goulot relève du crime de lèse-houblon. Pour rien au monde, je ne priverais mes lèvres du contact capiteux de la mousse de la première gorgée.
Affalé sur le canapé, je me demande quelle mouche m’a piqué d’inviter ma voisine. Certes, le courant passe bien entre nous, par ailleurs, il est sans doute temps pour moi de retrouver la civilisation. Méfiance ! Mes pulsions ne jouent pas forcément dans mon camp, je dois coller au modèle, me défier du feu de l’action même si je n’ai jamais prononcé de vœu de chasteté. Je dois me contrôler, ils en ont de bonnes !
Je termine ma mousse et commande une pizza à l’accent sicilien, anchois, olives, tomates, sans dégoulinades de fromages synthétiques. Elle sera là dans quinze minutes, le temps de bisser ma bière !
1. Véridique ! Les prévenus vantent particulièrement la qualité de l’accueil et de la cuisine !
Chapitre 2
Golfe de La Napoule, quatre ans auparavant
Parti de Mandelieu, le Feeling 32 faisait cap sur Théoule au vent arrière. Mois de mai, 23 °C, mer calme, soleil, petite brise, des conditions idéales pour une balade en amoureux. Assis à la poupe, torse nu, du haut de ses trente-quatre ans, Francis barrait au millimètre afin de maintenir ses voiles en ciseau. Ce travail d’équilibriste lui procurait un intense plaisir. À vrai dire, il révisait ses classiques, car il n’avait plus navigué depuis des lustres. Il avait fallu la perspective de deux journées de congés exceptionnels, doublées de prévisions météo idylliques pour le décider à louer un voilier.
Allongée sur la banquette, Gabriella rêvassait. Le soleil de printemps mordillait sa peau. Son slip couleur fuchsia illuminait son corps menu magnifiquement proportionné. Seins nus, les yeux clos, la nuque posée sur les cuisses de son skipper préféré, elle se laissait bercer par le roulis. Ses boucles noires jouaient dans le vent. Francis la contemplait avec ravissement. Jamais, deux ans auparavant, il n’aurait imaginé partager de tels moments.
Sorti major de l’école de police à trente-deux ans, Francis Carbonnel avait choisi sa première affectation sur la Côte d’Azur. Marseillais d’origine et malgré la proximité de la cité phocéenne, il avait vite découvert un nouveau monde à Cannes. Loin des tapis rouges et des falbalas festivaliers, il s’était frotté à une pègre violente, bien organisée. Il avait combattu aussi bien de petits voyous, des dealers à la sauvette que des trafiquants internationaux ou des escrocs en cols blancs. Dans la région, en outre, le cambriolage de villas demeurait un artisanat prospère.
Dans un tel environnement, Francis apprenait vite. À force de recevoir des coups et d’en donner, son cuir s’était tanné et son tableau de chasse s’était étoffé. Impliqué sans réserve dans son métier, il y consacrait ses jours et ses nuits. Corollaire, la vie sociale du lieutenant Carbonnel manquait de consistance. On lui connaissait peu d’amis, ses expériences amoureuses se limitaient à des rencontres d’un soir, tarifées ou non. Francis justifiait ce choix par sa soif de liberté et la dangerosité même de son activité. Pour rien au monde il n’accepterait de mettre en péril des êtres qu’il aimait. En conséquence, il s’interdisait toute relation suivie.
Sa rencontre avec Gabriella et Giulia, voilà dix mois, avait rebattu les cartes.
Un après-midi, la bella ragazza avait brusquement débarqué dans sa vie. Assise dans le couloir du commissariat, pareille à une madone, la jeune femme venait porter plainte pour vol. On lui avait dérobé son sac à dos. Immédiatement séduit, Francis avait invité la jolie Turinoise dans son bureau pour recueillir sa déposition.
Âgée de trente-quatre ans et ingénieure en technique du vide, Gabriella Fantini élevait seule sa fille Giulia, sept ans – son géniteur s’étant carapaté sans laisser d’adresse le soir de la naissance. Gabi ne regrettait rien, ni ce salaud de Luigi ni sa vie de mère célibataire largement ensoleillée par la présence de sa fille.
Sitôt qu’elle évoquait sa fillette, le regard sombre de la maman s’éclairait, ses lèvres charnues s’épanouissaient. L’apparente sévérité de Gabriella, affirmée par des cheveux noirs coupés au carré, fondait alors comme neige au soleil. Sa gamine était sa pépite, sa joie de vivre. Mais il avait fallu qu’un soir, Luigi refasse surface. Bien qu’il ait toujours refusé de reconnaître la gamine, il réclamait dorénavant de faire valoir ses droits. Le bouffon ! Devant son insistance, Gabriella avait choisi la fuite en avant. Le cœur serré, elle s’était résignée à quitter la capitale piémontaise.
Employée par un groupe d’aéronautique spatiale, Gabriella avait demandé sa mutation à La Bocca, où une occasion se présentait. L’usine possédait la double attractivité de fabriquer des satellites sophistiqués et d’être située face à la plage, à proximité de Mandelieu.
Arrivée la veille à Cannes, elle découvrait la ville avec sa fille quand on lui avait arraché son sac à dos, bretelle coupée au rasoir. Bienvenue sur la Croisette ! Sans passeport, ni permis de conduire, ni téléphone, ni carte de crédit, elle s’en était remise à la police.
Maigre consolation, son employeur lui fournissait un logement de fonction pour une période de deux mois. Un petit appartement dont Gabriella triturait les clefs dans sa poche de jean comme pour exorciser sa malchance. Francis, sous le charme, la regardait faire.
Le lieutenant Carbonnel avait immédiatement pris la situation en main, assistant Gabriella dans ses démarches auprès des banques, des fournisseurs de téléphone, et des autorités. Le soir même, il avait invité la mère et la fille au restaurant, puis leur avait proposé de les héberger chez lui. Il vivait dans un appartement au Suquet, dans la vieille ville, où entre la chambre d’ami et le canapé-lit, elles pourraient passer une nuit confortable. Trop heureuse de l’aubaine, Gabriella avait accepté.
Le jeu s’était poursuivi toute la semaine, le temps de faire plus ample connaissance. De fil en aiguille, la cohabitation s’était prolongée et ce qui devait advenir était advenu. On avait installé Giulia dans la chambre d’ami. Quant à Gabriella, elle partageait la couche de Francis. Désormais, Giulia était en CE1 à l’école du quartier. Parfaitement intégrée, l’enfant s’exprimait dans un français impeccable. Une petite lune de miel illuminait le Suquet depuis dix mois.
Le voilier naviguait à présent au largue, Gabriella tenait la barre. Pour une débutante, la jeune femme s’en tirait à merveille. Jusque-là, son expérience maritime se limitait aux ferries vers la Corse ou la Sardaigne. Concentrée sur ses gestes, elle maintenait son cap vers la pointe de l’Aiguille, un paradis où les roches de lave rouge dessinent leurs arabesques dans les eaux turquoise.
— Tu voudras te baquer, bella ?
— C’est quoi, baquer ? Non capisco !
— Te baigner, quoi ! C’est du marseillais !
— Caro, Francisco, j’ai assez à faire avec le français !
— Si tu veux, on peut échouer le bateau sur le sable, au fond d’une crique. La dérive se relève, c’est étudié pour…
— Basta ! L’eau n’est pas assez chaude. Et puis, on a loué un bateau ; c’est pas pour aller à terre ! Prego.
— Alors, on continue ! Mais il va falloir contourner les cages.
— Les cages ?
— Vé ! Les bouées, devant nous, des élevages de loups et de daurades royales. Ils grandissent là-dedans, puis ils sont vendus. Ce sont les poissons calibrés que tu trouves dans la plupart des restaurants.
— Ils mangent quoi ?
— Vaï ! Va savoir ? Y a des questions qu’il vaut mieux ne pas poser !
À midi, ils avaient mouillé dans une anse minuscule où Francis avait réussi à insérer le bateau au chausse-pied. Un lieu réservé aux initiés. À la couleur des roches près, le site lui évoquait les calanques de Marseille, là où il avait tant bourlingué avec le pointu paternel. Mais c’était le passé. Foin de la nostalgie, il fallait laisser ses chers disparus en paix, même s’ils vivaient toujours en lui. Seul le présent importait, et aujourd’hui, avec Gabriella et Giulia, il avait fière allure !
À l’abri du vent et des regards indiscrets, Francis avait solidement amarré le voilier par la proue et la poupe, prévenant ainsi les chocs contre la roche. Son mouillage assuré, il avait plongé. L’eau était fraîche et vivifiante, il nageait nu, comme à son habitude. Gabriella l’observait, attendrie, en martelant sa tempe avec son index.
En remontant à bord, Francis avait une faim de loup. Avec la complicité de Gabriella, ils s’étaient confectionné un en-cas dans la kitchenette rudimentaire du bateau : socca passée au four, tomates mozzarella basilic, fougasse aux olives, tarte aux fraises, le tout arrosé d’une bouteille d’Héritage du Château-Maïme, un rosé sec et fruité, tout en équilibre, élaboré à Puget-sur-Argens. Pour couronner ce festin, Gabriella avait fait deux ristretti sur son percolateur de voyage, des cafés d’une intensité à contrarier les humeurs les plus lénifiantes. Leur tentative de sieste sur la banquette du cockpit s’était vite muée en étreinte passionnée. Bercés par le clapot, leurs corps s’étaient une nouvelle fois unis, aspirés l’un par l’autre comme par une force inconnue.
Quand, plus tard, ils avaient délaissé leur repaire de pirates, des crêtes d’écume blanchissaient la houle.
— Le coup de vent arrive plus tôt que prévu ! On va aller s’abriter aux îles de Lérins. On mouillera dans le chenal pour la nuit. Tant pis pour ta fille, on n’a plus le temps de monter jusqu’au cap Roux.
À la dernière minute, Giulia avait en effet décliné l’invitation au voyage. La gamine avait préféré passer le week-end chez Chloé, sa copine d’école, dont les parents possédaient une villa entre Théoule et Saint-Raphaël, là où les pentes de l’Estérel se perdent dans la Méditerranée. Francis et Gabriella lui avaient promis d’aller la voir, mais, en voilier, la météo et les promesses ne sont pas toujours compatibles. C’est la mer qui décide !
— Je préviens la maman de Chloé ! dit Gabriella, son portable à la main.
Chapitre 3
Saint-Brieuc
Je saute de mon lit à 5 h 30 avec une furieuse envie de bouger. Cette nuit, entre deux sommeils, je me suis repassé la séquence du balcon. Jamais je n’avais subi un pareil blocage ni une telle crise de vertige. Conséquence, j’ai été à deux doigts de me viander du quatrième étage. Pourtant, l’exercice ne comportait aucune difficulté majeure. Conclusion, c’est le bonhomme qui est en cause ! Or mon métier n’accepte pas la faiblesse, je dois réagir ! Entraînement de choc et régime spartiate ! Y a plus qu’à !
Ce matin, cependant, l’humidité de la nuit et les travaux en ville ne m’incitent guère à sortir. Passe encore de cavaler dans les rues au printemps, mais l’hiver dans la boue, j’aime moins ! Alors, en attendant les beaux jours et les joggings en bord de mer, je me promets d’investir dans un tapis de course. Dès que j’aurai un moment de disponible, je fonce en acheter un ! Demain, je recommence à courir. Chez moi !
Dans l’immédiat, pour faire bonne figure, je répète mes enchaînements de karaté. L’espace exigu dont je dispose m’impose une maîtrise gestuelle drastique. Exactement ce dont j’ai besoin. Rigueur, contrôle ! Je débute en douceur, puis je monte progressivement en cadence. Tout y passe, techniques de poings, de pieds, de hanches, rapidité d’exécution, respirations. Au terme de quarante minutes à ce régime, me voilà gonflé d’énergie et dégoulinant de sueur. Je récupère sous la douche puis un solide petit-déjeuner finit de me réveiller. Au menu, œufs au plat, céréales au lait, pain périmé grillé, confiture, jus de fruits, thé… Prêt à affronter les douze travaux d’Hercule.
J’arrive au commissariat peu avant la relève de 7 heures. Ni Morgane ni Yvon ne sont encore là. Rien de surprenant puisque notre équipe fonctionne en hors-sol, avec ses propres règles d’autonomie. Je salue quelques collègues réunis devant la machine à café, puis je gagne mon bureau. À peine ai-je pris place que le divisionnaire débarque dans son impeccable costard bleu marine. Avec sa cravate rouge vif et sa chemise blanche, le patron hisse chaque matin les couleurs nationales, il ne plaisante pas avec ça !
— Asseyez-vous, Bressac ! ordonne-t-il en refermant la porte.
Il déboutonne machinalement sa veste, s’installe dans le fauteuil visiteur, croise les jambes et tire sur le pli de son pantalon. Son crâne rasé brille comme une boule de billard, les fragrances de son eau de toilette se diffusent dans le bureau. Comme souvent, Franquet impose sa présence de but en blanc. Fidèle à sa réputation, le divisionnaire affiche un sourire constipé et me darde d’un regard globuleux niché derrière ses sourcils buissonneux. Même si sa visite matinale ne présage rien de plaisant, je ne me laisse pas intimider. Je commence à connaître le monsieur, il n’est pas venu m’apporter des croissants.
— Voici ce qui m’amène, Commissaire.
— Je vous écoute, Patron !
— J’ai reçu hier soir, chez moi, un appel insolite. Celui d’un vieil ami, un être tout à fait recommandable. Antoine-Auguste Le Bihan. Ce nom vous parle ?
— Non, il devrait ?
— Pas nécessairement, Bressac ! Cela dit, malgré votre méconnaissance de l’histoire locale, vous auriez pu relever son nom dans la presse. Cet homme est une célébrité dans la région. Mon ami Antoine-Auguste, aujourd’hui âgé de soixante-quinze ans, est un chirurgien de renom. Voilà deux mois qu’il a passé la main et qu’il s’est plus ou moins retiré des affaires. Tout au moins, dans la version officielle, car Antoine n’a jamais eu les deux pieds dans le même sabot. Vous voyez ce que je veux dire ? S’il prend grand soin de sa famille, il demeure à la tête de plusieurs associations, et a conservé des liens forts avec ses ex-confrères. Le docteur Le Bihan siège notamment aux conseils d’administration de son ancienne clinique et d’un laboratoire pharmaceutique à Erquy.
— Je vois.
— Vous vous ferez votre propre idée, Bressac ! Mais, venons-en à son appel. Figurez-vous que, la semaine dernière, Antoine-Auguste et son épouse Anna avaient réuni leurs trois enfants, leurs conjoints et leurs neuf petits-enfants pour une fête familiale.
— Sacrée troupe !
— Eh bien, Bressac, dans les quarante-huit heures qui ont suivi, plusieurs de ces dix-sept personnes ont été affectées d’un mal étrange ! Pour l’une d’entre elles, le pronostic vital serait engagé.
— Un nouveau virus ?
— Pas du tout ! Antoine-Auguste vous expliquera, il est médecin et sait poser un diagnostic. Si j’en crois ses supputations, il pourrait s’agir d’une affaire criminelle. Le Bihan va porter plainte contre X, dès aujourd’hui. J’ai prévenu le procureur, il va confier l’instruction au juge Farcy. Foncez, Bressac ! Le Bihan est un ami doublé d’un homme puissant. Laissez tomber vos dossiers en cours et mettez-vous là-dessus. Mobilisez Bozec et Marquis. Je veux des résultats et vite !
— Bien, Patron !
— Et cela reste entre nous ! Omerta totale pour la presse. Idem en interne, seule votre équipe est informée. Tenez, conclut Franquet en tendant une carte de visite, voici le 06 d’Antoine-Auguste et son adresse. Au boulot !
Le boss sort de la pièce sans refermer la porte. Calé dans mon fauteuil, les deux pieds posés sur le bureau, je retourne le bristol dans mes mains. Le Bihan habite entre Pléneuf-Val-André et Erquy, au lieu-dit La Ville Broussais. Un coin sympa ! Une demi-heure en voiture et on aborde un autre monde, celui de la mer, du tourisme, de la pêche, de l’agriculture, celui des plages immenses aux reflets changeants.
Le numéro d’Auguste-Antoine Le Bihan sonne dans le vide, son répondeur me propose de laisser un message et promet de rappeler « dès que possible ». Je décline mon identité et l’objet de mon appel, puis je pars en chasse sur la toile.
Internet me livre un historique de la lignée Le Bihan. Une dynastie qui, de père en fils, a armé des navires pour la grande pêche à Terre-Neuve ou à Islande à partir de Paimpol ou de Dahouët. Selon les archives disponibles, l’armada Le Bihan n’a cessé de croître depuis la Révolution française jusqu’au début du siècle dernier ! C’est dire la prospérité du business ancestral que les héritiers ont apparemment fait fructifier, témoin le manoir familial où réside aujourd’hui le descendant de la lignée. J’imagine en outre des racines plus lointaines où ferrailleraient corsaires et flibustiers. Bon sang ne saurait mentir !
Je laisse là mes conjectures généalogiques pour revenir au sieur Auguste-Antoine. Sa page Wikipédia m’apprend qu’il est ancien interne des hôpitaux de Paris et ancien chef de clinique à l’hôpital de Nantes. Après avoir exercé une dizaine d’années en milieu hospitalo-universitaire, Antoine-Auguste a créé la clinique Jouvencelle, spécialisée en chirurgie esthétique et basée entre Dinard et Saint-Malo.
Le site www.jouvencelle.bzh décrit un établissement à échelle humaine, plutôt pimpant, disposant d’une trentaine de chambres et entouré d’un parc luxuriant. On y respire le fric et l’air marin. Je passe rapidement sur les liposuccions, rhinoplasties, augmentations mammaires, acide hyaluronique, botox, liftings et autres spécialités maison pour m’attarder davantage sur le profil des dirigeants. Si Antoine-Auguste n’exerce plus, son nom figure toujours au directoire comme président émérite. Après tout, un jeton de présence de temps en temps, ça met du beurre dans les épinards !
Je ferme le site de la clinique et affine ma radioscopie du plaignant sur Wikipédia.
Auteur de communications multiples dans des revues aussi prestigieuses que The Lancet, Antoine-Auguste a également créé la société francophone de chirurgie réparatrice Le Bihan, qu’il continue de gouverner.
Outre sa carrière médicale, je découvre que le docteur fut jadis un joueur de volley-ball de niveau national, puis conseiller municipal d’un village savoyard où il possédait un chalet, enfin, qu’aujourd’hui, il finance et préside le cercle druidique de Planguenoual, une association fondée par ses soins. Je n’oublie pas ses soutiens aux clubs sportifs du canton, au bagad communal, aux œuvres sociales et culturelles en tous genres. Homme protée, humaniste multitâche, couteau suisse, touche-à-tout.
Comme toujours, les vainqueurs écrivent l’histoire d’une plume parfumée à l’encens. Le curriculum vitae d’Antoine-Auguste fait son panégyrique de médecin brillantissime, bienfaiteur de la planète doublé d’un philanthrope.
Trop beau pour être vrai ! Je cherche la petite bête et, à force de fouiner, je mets le doigt sur un accident de parcours.