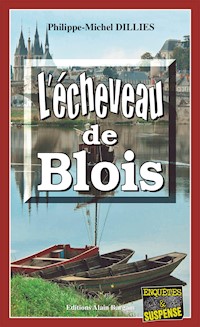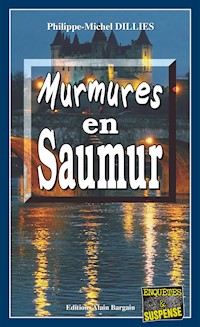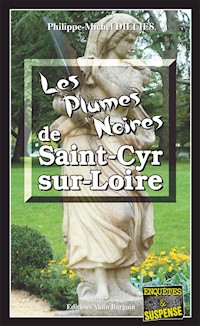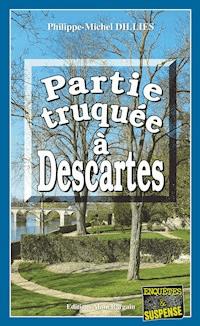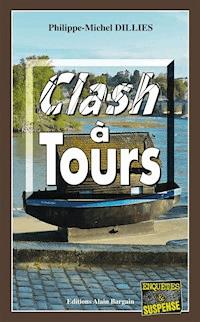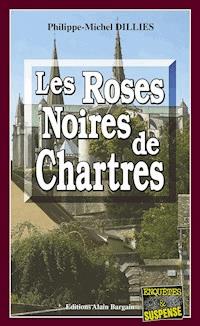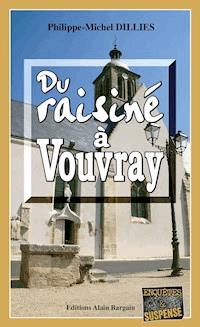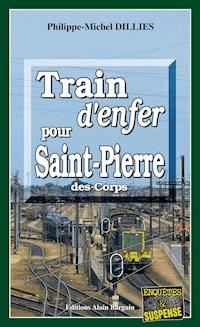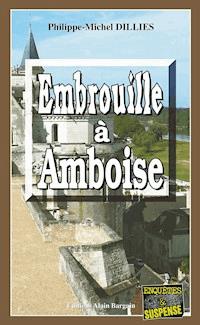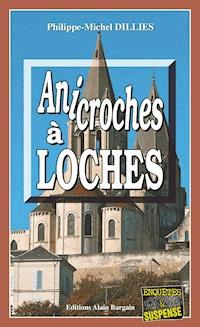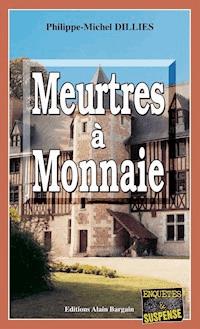
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Emma Choomak, En quête d’identité
- Sprache: Französisch
Deux affaires en apparence indépendantes semblent étrangement liées...
Monnaie, petite ville d’Indre et Loire. Charles Wenzy coule des jours paisibles, jusqu’au jour où son meilleur ami est assassiné d’une flèche dans le dos. Les ennuis commencent pour ce spécialiste de la chasse à l’arc.
Un château fait l’objet d’un étrange cambriolage… Y a-t-il un rapport entre les deux affaires ? De Monnaie à Tours en passant par Montlouis, l’inspecteur Huberdeau suit la trace sanglante laissée par le tueur. Pourquoi troubler ainsi la quiétude de ces bords de Loire ?
Suivez les pas de l'inspecteur Huberdeau dans une double enquête en Touraine ! Le premier tome d'Emma Choomak, En quête d’identité.
EXTRAIT
— Montrez-moi vos flèches de chasse !
— Elles sont là, dans ce gros tube de carton, mais c’est absurde, tout chasseur marque ses flèches de son nom et de son numéro de permis, je ne déroge pas à la règle. Je n’ai pas vu la flèche qui a tué mon ami, mais je doute qu’elle porte mon nom, ni aucun autre !
— Si, justement, elle porte un nom… Et un numéro… Les siens ! Ne trouvez-vous pas cela étrange ? Le vétérinaire de Monnaie assassiné avec une de ses propres flèches !
— Effectivement, mais cette flèche aurait pu avoir été volée…
— Par un ami…
— Je vous interdits !
— Allons, calmez-vous, monsieur Wenz! Au fond, peu importe que cette flèche fût sienne, dérobée ou prêtée pour une raison qui m’échappe encore, l’essentiel n’est-il pas qu’elle fut bien tirée? Par un arc, bien entendu ! Or des arcs, vous en possédez plusieurs. De fortes puissances ?
— Soixante-dix livres…
— Vous êtes chasseur…
— Mais pourquoi aurais-je tué Benjamin ? Je vous le demande !
— Un point pour vous, Wenz ! Pourquoi ? Voilà précisément ce que j’ignore : le mobile. C’est bien pour cela que je ne vous ai pas encore inscrit définitivement comme suspect numéro un !
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Éditions Bargain, le succès du polar breton
. -
Ouest France
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né en 1952 à Roubaix (Nord),
Philippe-Michel Dillies s’est épris de la Touraine où il vit depuis vingt-trois ans. Dans ce premier roman, il s’est attaché à faire partager au lecteur une certaine "ambiance tourangelle" à travers la description des divers manoirs et châteaux qui jalonnent cette histoire.
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -
Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le blog de l’auteur : http://philippemicheldillies.blogspot.com
Couverture : Manoir de Bourdigal, avec l’aimable autorisation du propriétaire. Photo D. Ronflard Château-Renault.
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute res-semblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
À Françoise…
AVERTISSEMENT
Cette œuvre est une pure fiction, volontairement intemporelle.
Que le lecteur n’y cherche pas de chronologie mais se laisse porter par l’histoire pour que se révèle la magie du conte…
L’auteur.
PROLOGUE
La lame d’acier luisait doucement sous les rayons du soleil couchant. Non loin, un chevreuil arrachait goulûment sa pitance à la lande. L’homme ne bougeait plus, concentré sur la petite touffe de poils marron – le point d’impact – les doigts blanchis par la tension de la corde.
« Se calmer, contrôler tout son corps, inspirer, lentement, expirer… »
L’homme prit une dernière inspiration avant de décocher une flèche qu’il savait, maintenant, mortelle. Le brocard leva soudain la tête, en alerte, regarda dans la direction du chasseur, se tassa et disparut d’un bond échappant à la lame meurtrière.
« Ah, ça ! C’est à n’y rien comprendre, il ne m’a pourtant pas éventé, j’en suis sûr ! »
Il en était là de ses réflexions quand il ressentit un grand choc dans le dos. Il regarda, éberlué, la pointe de chasse qui lui trouait la poitrine puis tout devint noir.
La cloche de Bourdigal sonna dix heures, le bourdon de l’église lui répondit, le soleil se couchait sur Monnaie…
I
La sonnerie du téléphone fit sursauter Wenz. « Quel est le pénible qui m’appelle à six heure du matin ? Et un dimanche en plus ! » Il resta au lit, décidé à décourager le raseur… Le combiné continuait à distiller sa sonnerie, obstiné…
— Allô ?
— Euh… C’est Marthe… Marthe Lonpré… Benjamin n’est pas chez vous ?
— Non.
— Ah ! Je suis inquiète, Charles… Il n’est pas rentré de la nuit…
— Où était-il allé ?
— Il est parti chasser hier, en fin d’après-midi… Oh, Charles, c’est terrible si…
— Allons, rassurez-vous, il aura peut-être été surpris par la nuit et se sera fait héberger par quelqu’un…
— Oui, vous avez sûrement raison, je suis bête, mais c’est plus fort que moi, je m’inquiète… Bon, excusez-moi… Oh ! Si vous avez des nouvelles…
— Oui, oui, je vous appelle.
« Bon sang, me réveiller à six heures du matin, un dimanche, pour une escapade de ce vieux grigou de Benjamin, on aura tout vu ! » pensait-il en se remettant au lit. « Ah ! ce Benjamin, un ami de longue date, et un sacré chasseur, bon vivant. Nous avons vécu pas mal de bons moments ensemble, comme cette fameuse soirée où il était passé, vers vingt-trois heures, après un tournoi de belote au Café du Centre. Il avait copieusement arrosé sa victoire. C’est une carcasse le Benjamin ! Il avait encore toute sa tête ! Et nous avions bu encore pas mal de godets en nous narrant nos aventures de chasse. Cette nuit-là fut blanche ! Il était rentré chez lui au petit jour. Ah ! Quelle nuit ! » Il se leva, l’envie de dormir maintenant dissipée par tous ces souvenirs, se prépara un café et regarda par la fenêtre.
La Blondellerie était encore à demi plongée dans l’obscurité, tout était calme. Le calme de La Blondellerie, c’est ce que Charles Wenz appréciait peut-être le plus. Le jardin était magnifique : un hectare de pelouse, de fleurs, entouré d’arbres divers, entretenu amoureusement par sa propriétaire, une quadragénaire portant bien, inspectrice de l’Éducation nationale, brune, cheveux courts, yeux verts, sportive, qui avait pour patronyme Choucry de Roquefeuille et répondait au joli prénom de Maud. Elle habitait la seconde maison, plus au fond du parc, une vieille bâtisse datant de 1290, héritage de famille, colombages et murs blancs, glycine et toit de petites tuiles rouges. Les dépendances étaient aussi vieilles que l’habitation principale et Wenz y jouissait d’une vie paisible, méditant sur l’ordonnancement des bosquets, des massifs de fleurs. Il était toujours impressionné par les lignes parallèles des allées ratissées, actuellement perturbées par sa voiture qu’il avait oublié de rentrer. « Rentrer ! » Wenz eut comme un flash ! Benjamin était certes un coureur des bois, peut-être même un coureur tout court et il faisait la fête, mais il rentrait toujours ! C’était chez lui comme un rite. « Mon métier de vétérinaire me permet de quitter la maison bien souvent, j’aime sortir et faire la noce, mais j’ai à cœur de ne pas inquiéter Marthe que j’adore ; alors : je rentre ! » Et cette fois, Benjamin n’était pas rentré.
Wenz renonça à absorber son café, il avait horreur du café froid… S’habillant à la hâte, il descendit, démarra sa voiture et sortit en trombe de la propriété, ignorant les regards furieux que lui lançait sa logeuse.
La route jusqu’à “Moque-Souris” où logeaient les Lonpré n’était pas très longue, mais assez sinueuse et le brouillard matinal incitait à la prudence. Wenz entra dans la cour, il vit de la lumière, frappa. Une frêle silhouette se dessina derrière la vitre de la porte, Marthe ouvrit.
— Ah, c’est vous ! Je suis heureuse que vous soyez venu, je ne devrais pas m’inquiéter, mais c’est plus fort que moi, je ne peux pas m’en empêcher, vous comprenez, d’habitude Benjamin prévient, bien sûr, ce n’est pas une raison pour se soucier de cette manière, je sais bien, mais cette angoisse qui m’é-treint… je n’arrive pas à me raisonner et… Oh ! Mais entrez, vous êtes tout trempé par ce brouillard, excusez-moi, je manque à tous mes devoirs, mais je suis si perturbée…
Wenz entra. La grande pièce était accueillante avec sa cheminée où brûlait déjà un bon feu. Fauteuils profonds, meubles anciens, trophées de chasse… Un plaid recouvrait le fauteuil le plus proche du foyer.
— Café ? demanda-t-elle en s’éclipsant vers la cuisine.
Marthe revint avec deux tasses de café brûlant, les posa sur une table basse et se laissa tomber sur le plaid.
— Asseyez-vous près du feu, vous êtes trempé ! Elle lui tendit une tasse. Ses mains étaient fines et soignées…
— Merci, vous avez l’air bien lasse…
— Je me suis éveillée à quatre heures, depuis je n’ai pas fermé l’œil.
Elle avait de jolis cheveux châtains où miroitaient des reflets auburn. Le plus surprenant c’était ses grands yeux bleu pâle qui semblaient vous traverser à chaque regard, un regard insupportable de clarté, un regard minéral presque incongru dans ce visage doux, à l’ovale parfait. Elle semblait frêle, mais ce n’était qu’une apparence, Marthe n’était pas une inconnue sur les différents courts de tennis et autres terrains de sport…
— Charles ! Vous m’entendez ?
— Je… Oui… Oh, pardon ! Excusez-moi, je crois que j’étais ailleurs, préoccupé…
— Vous êtes inquiet, vous aussi ?
— Allons, je connais bien Benjamin, il ne va plus tarder maintenant, s’il n’a pas prévenu, c’est qu’il en était empêché, vous savez bien que…
Il ne termina pas sa phrase, tant elle lui parut creuse. Marthe se recroquevilla un peu dans son fauteuil, finissant son café à petites gorgées, le regard dans le vague… Gêné, Wenz resta coi, les yeux rivés au fond de sa tasse… Seul, le lourd balancier de l’horloge de parquet donnait encore discrètement signe de vie. Ils sursautèrent ! Un crissement de pneus ! Marthe se rua vers la porte pendant que Wenz se dressait d’un bond…
Quatre képis descendaient du véhicule, le brigadier Froissard en tête.
— Wenz ! Laissez-nous, je vous prie !
Dehors, le quatrième képi faisait les cent pas, près du fourgon. La radio crachait des indications.
— On l’a retrouvé n’est-ce pas ?
Silence du képi.
— Sauveteurs à marguerite 1, nous emmenons le corps à Trousseau.
— OK, sauveteurs, bien reçu.
Le képi reposa son micro.
— Où était-il ? Mais répondez, bon sang !
— Wenz ! Par ici, je vous prie !
— Brigadier, pouvez-vous me dire où vous l’avez trouvé ?
— En lisière du bois du Mortier, juste en face de Bourdigal. J’ai besoin d’entendre madame Lonpré au bureau, pour les besoins de l’enquête. Pourriez-vous l’y amener ? D’ailleurs, je voudrais vous entendre, vous aussi.
Le fourgon démarra, Wenz rentra, Marthe était maintenant totalement tassée dans le fauteuil, le regard noyé dans les braises du foyer, absente… Il fit un effort pour la ramener à la réalité.
— Venez… Ils nous attendent à la gendarmerie. Elle se laissa mener jusqu’à la voiture, s’y installa sans un mot… « Bon dimanche, monsieur Wenz… », se dit-il en entrant dans le bureau du sous-brigadier Martel…
* * *
Maud ne décolérait pas ! Elle détestait être éveillée en fanfare ! Elle détestait le ronflement des moteurs de voitures ! Elle détestait que l’on perturbe le calme de sa propriété, qui plus est un dimanche ! Elle détestait par-dessus tout que l’on écrase ses parterres de fleurs, et justement, son locataire, un homme d’habitude si calme, voire pondéré, n’avait pas hésité à sacrifier ses cyclamens nains, roses et blancs qui faisaient comme un tapis de chaque côté du portail d’entrée. Elle se servit une troisième tasse de thé. Neuf heures sonnèrent à la pendule.
— Voilà deux heures qu’il est parti en trombe, comme s’il avait le diable aux trousses, et pour où ? Je vous le demande !
Elle se parlait souvent à haute voix, une vieille habitude contractée peu après le décès de son mari : Bertrand Saintonge de la Foy, officier de cavalerie au Cadre noir, dont le portrait équestre ornait la bibliothèque. C’était l’endroit de la maison qu’elle préférait, avec son petit bureau qui donnait sur un vieux four à pain. Ce bureau, c’était son jardin secret, il n’était pas facile d’accès : il fallait ouvrir une petite porte de placard dissimulée entre les étagères de livres pour y pénétrer. Mais une fois là, l’on se sentait comme dans un autre monde. C’était très pratique pour s’isoler, travailler ou simplement réfléchir. La bibliothèque occupait la moitié du rez-de-chaussée de la maison, l’autre moitié, séparée par des colombages, était réservée à la grande salle de séjour où trônait la cheminée. À côté, une vieille horloge de parquet marquait le temps ; une grande table de chêne, un bahut ancien, un vieux saloir meublaient cette salle. Maud s’apprêta à beurrer un toast. Le toast cassa !
— Il fut un temps où vous m’auriez tancée, Bertrand : montrer ainsi son agacement n’est pas digne d’une Saintonge de la Foy ! Vous n’eussiez pas manqué de m’en faire la remarque ! Oh ! Et puis zut !
Toast et couteau percutèrent la théière en argent, Maud s’élança pour son footing matinal. Elle prit son circuit habituel, traversa le bourg, remonta le long de l’étang, tourna à gauche au cimetière pour redescendre sur le manoir de Bourdigal. Elle entrait dans l’allée qui menait au manoir lorsqu’elle croisa le père Franceau. C’était un pauvre hère que les habitants de Monnaie surnommaient “Mon Pote” parce qu’il avait l’habitude d’appeler ses interlocuteurs de la sorte. Mon Pote portait un éternel béret vissé sur le crâne et passait le plus clair de son temps à parcourir le bourg quand il n’était pas au café. Les jeunes du bourg lui cherchaient noise, parfois même lui jetaient des pierres, alors il les insultait de sa voix nasillarde… Elle s’aperçut très vite que le père Franceau avait l’air bizarre. Répondant à peine à son salut, il lui dit :
— Y’en a des qui s’croyent chasseur, mais au bout du compte y sont bien gibier ! Alors ça oui !
— Que vous arrive-t-il, père Franceau ? Vous êtes tout pâle !
— Faudrait p’têt ben prévenir les gendarmes…
— Allons, expliquez-vous !
« Il divague c’est sûr ! », pensait-elle.
Il la mena le long du bois du Mortier jusqu’à une coulée de gibier… Bien que couché sur le ventre, elle le reconnut tout de suite.
— Le vétérinaire !
Elle se mit à crier au secours, en courant vers Bourdigal…
* * *
Le brigadier Froissard la regardait d’un air soupçonneux… Il reprit la déposition.
— Vous déclarez donc avoir rencontré le père Franceau à l’entrée de l’allée du manoir de Bourdigal et, de là, il vous a emmenée à l’endroit où vous avez découvert le corps ?
— C’est cela, à peu de chose près…
— Comment cela : « à peu de chose près » ?
— Eh bien, ce n’est pas à l’entrée de l’allée mais au premier tiers de l’allée !
— C’est pareil !
— Ah non ! Brigadier, le début de quelque chose est totalement différent du premier tiers ! Excusez-moi, mais j’aime la précision, Bertrand, lui-même…
— Bertrand ? Vous n’étiez donc pas seule ?
— Voyons Brigadier, Bertrand, feu mon époux !
— Ah ! Oui… Bon, revenons-en à cette rencontre…
— Eh bien c’est comme je viens de vous le dire, après que Mon Pote…
— Votre quoi ?
— Mon Pote… Le père Franceau si vous préférez, m’eut indiqué l’emplacement du cadavre, j’ai couru au manoir d’où l’on vous a prévenu. Je n’ai rien à ajouter !
La portière du fourgon s’ouvrit. L’un des képis s’empara d’un appareil photo et disparut. Maud signa sa déposition.
— Vous pouvez disposer, Madame, mais vous connaissez la consigne en pareil cas…
— Merci, Brigadier, je rentre chez moi.
— Martel ! Vous en terminez avec Mon Po…, monsieur Franceau, et vous attendez l’ambulance, nous filons chez la victime…
Maud reprit la route qui menait au bourg, elle n’avait plus le courage de courir : l’émotion. Elle avisa le café “L’Orée des Bois”, y entra.
— Madame de… !
Le patron du bar n’en croyait pas ses yeux !
— C’est un jour à marquer…
— Oui, je sais, monsieur Germain, mais à circonstance exceptionnelle…
Il se dirigea vers la machine à café, prit une tasse.
— Un cognac ! Double, je vous prie !
La tasse de porcelaine se brisa derrière le comptoir. Il se retourna vers Maud, l’air effaré.
— Ah ! il faut que je vous dise… C’est bête… Je n’ai pas d’argent sur moi… Je n’avais pas prévu, n’est-ce pas… mais vous pourriez peut-être me faire crédit jusqu’à tout à l’heure…
Il lui servit son cognac sans la quitter des yeux, toujours incrédule.
— Ma parole ! On dirait que vous avez rencontré le diable en personne, vous avez l’air toute retournée. Quelque chose ne va pas ?
Maud vida son verre d’un seul trait et sortit, sans mot dire.
Germain regardait, éberlué, ce verre à cognac qu’il avait rempli à ras bord et que cette femme venait de vider d’un trait, sous son nez, comme s’il s’agissait d’une simple camomille.
— Elle a du coffre, la Baronne !
Il l’avait toujours surnommée ainsi. Elle n’était pratiquement jamais entrée dans son établissement, ou alors il y avait longtemps, du temps où son mari, rentrant de la chasse, offrait la tournée générale à ses amis, parfois elle l’accompagnait. Elle ne devait pas être baronne d’ailleurs, mais elle l’avait toujours impressionné… Les conversations commençaient à aller bon train :
— Ben, dis-donc, t’as vu, Bernard ?
— Oui, c’est bien la première fois qu’on la voit ici !
— Moi je vous dis qu’il se passe des choses, j’ai vu les gendarmes descendre la rue tout à l’heure…
— Tu as peut-être raison, Louis, d’ailleurs, regarde ! Voilà une ambulance maintenant !
En un instant, “L’Orée des bois” fut en ébullition.
* * *
— Alors, monsieur Wenz, que faisiez-vous chez la victime ?
Le sous-brigadier Martel le regardait, par-dessus sa machine à écrire, les deux index levés, prêt à taper.
— Son épouse m’a appelé à six heures ce matin, elle m’a semblé inquiète…
L’interrogatoire dura une bonne heure, le sous-brigadier reprenait les questions dans d’autres sens, sous d’autres formes, on eut dit qu’il voulait décortiquer les réponses de Wenz. Celui-ci ne pouvait s’empêcher de penser que dans cette même situation, tout individu, tôt ou tard, éprouve, ne fut-ce qu’un instant, un sentiment confus de culpabilité. Il était las, vraiment las… Il signa enfin sa déposition.
— Vous pouvez disposer, monsieur Wenz.
Il sortit avec soulagement.
— Madame Lonpré… ?
— Nous n’en n’avons pas encore terminé avec elle. Si vous voulez attendre à l’accueil…
Il s’installa dans l’entrée, contemplant les avis de recherches lancés à l’encontre de divers truands. Une porte s’ouvrit, Marthe sortit à son tour…
L’air frais leur fouetta le visage, ils montèrent dans la voiture, Wenz démarra, ils roulèrent au hasard, un long moment…
— Il faut que j’aille reconnaître le corps…
— Oui, c’est toujours ainsi… Quand ?
— Avant midi.
— Je vous y emmène !
— Non ! Ramenez-moi à la maison, je veux y aller seule !
— Mais il serait peut-être plus prudent que…
— Charles ! Je vous en prie, je dois y aller seule !
Il la déposa à Moque-Souris. Il s’apprêtait à l’accompagner jusqu’à la demeure mais elle l’en dissuada d’un regard.
— Non ! S’il vous plaît…
Il fit demi-tour et repartit lentement vers le bourg…
*
Elle entra dans la grande pièce, le feu était presque mort maintenant. Elle frissonna, autant de froid que de lassitude. Le temps s’était figé depuis la mort de Benjamin. « Oh, que cette nuit fut longue ! » pensat-elle. Elle aurait voulu que tout s’arrête, là, maintenant, mais il lui fallait tenir… et continuer. « C’est trop difficile ! » pensait-elle. Une sorte d’angoisse l’étreignit, machinalement elle porta la main à sa poitrine. Elle sentit le médaillon sous ses doigts, l’ouvrit : un sourire maternel la rassura, la rappela aux nécessités de la vie. Elle prit une cigarette. C’était bien la première fois, dans cette maison… Personne n’aurait pu dire qu’elle fumait d’ailleurs, cela faisait partie de ses petits secrets…
La douche finit de la revigorer ; elle se vêtit de noir, releva ses cheveux en chignon, mit des lunettes de soleil, monta en voiture et prit la direction de Tours…
Le temps s’était mis au beau, le cabriolet ne mit pas plus de quinze minutes pour rejoindre l’hôpital Trousseau…
— La morgue, je vous prie…
— Au fond à droite. lui répondit un gardien, impassible.
Elle entra.
— Madame ? Que puis-je… ?
— Je suis madame Lonpré.
— Ah… Oui… C’est pour reconnaître le corps… Mes condoléances, Madame… Seulement, ces messieurs de la police ne sont pas encore là…
— Ce sont les gendarmes de Monnaie qui m’ont demandé de venir… avant midi… Je signerai le formulaire !
— Dans ce cas…
Il la précéda dans une pièce, ouvrit un grand tiroir, souleva le drap : Benjamin Lonpré apparut. Son visage témoignait encore de la surprise plus que de la douleur. Elle s’en approcha.
— C’est bien mon mari ! dit-elle, à demi défaillante.
Elle crut qu’elle allait s’effondrer dans cette salle froide, sous les yeux du préposé, mais sa main rencontra le médaillon. Elle ôta ses lunettes et, son regard minéral posé sur Benjamin, elle sourit.
Derrière, le préposé se raclait la gorge, pressé d’en finir avec cette visiteuse. Il tenait des papiers en main. Elle remit ses lunettes, se retourna… Il alla refermer le tiroir.
— Si vous voulez bien me suivre, nous pourrions satisfaire aux formalités : divers imprimés à remplir, ce n’est pas très agréable, surtout en ces circonstances, j’en conviens, mais c’est indispensable, j’espère que vous comprendrez… Voilà, c’est ici…
Elle le suivait derrière ses lunettes, sans l’écouter. Il lui présenta un tabouret puis étala la liasse d’imprimés qu’elle remplit en silence, pendant qu’il se perdait en bavardages inutiles. Elle sortit enfin de l’immonde bâtisse qui sentait la mort, démarra et partit, très vite…
* * *
Dix heures sonnèrent à la pendule du salon… Monsieur Duffort essaya encore de se retourner dans ses draps… N’y tenant plus, il tira le cordon d’appel. Alfréda, la dame de compagnie entra, tira les rideaux, laissant pénétrer le soleil. Duffort cligna des yeux, un instant ébloui, puis aperçut le plateau.
— Ah, ma bonne Alfréda, vous m’avez apporté mon chocolat ! Merci, merci.
Au fil des années, Victor Duffort était devenu gourmet, puis gourmand…
Antiquaire en “préretraite”, comme il aimait à le souligner lui-même, il ne sortait pratiquement plus de sa propriété de “Maucartier”, sauf pour quelques rares mais délicates affaires à New York, Ottawa ou toute autre grande ville du monde. Ces transactions-là : achat ou vente de pièces très rares d’antiquités, V.D., c’est ainsi qu’il se présentait, se plaisait à lesmener lui-même, c’étaient les seules qui le distrayaient encore.
Victor Duffort était très riche, ses magasins de Paris et de Londres dégageaient des chiffres d’affaires impressionnants et il avait à son service tout un réseau d’observateurs à travers le monde. Qu’un vase de l’époque Ming ou une crédence Louis XV fut à vendre quelque part sur la planète, Paris, Londres et V.D. étaient immédiatement prévenus. Son jet personnel était basé à l’aérodrome de Tours-Saint-Symphorien et quelques minutes suffisaient au chauffeur de sa Jaguar pour l’y amener.
V.D. ne se déplaçait que pour les “gros coups”, le reste du temps il s’adonnait à sa seconde passion : la gourmandise. Se faisant, il avait atteint les 140 kilos et se mouvait difficilement. Il n’occupait que le rez-de-chaussée de sa demeure, s’y déplaçant au moyen d’un fauteuil roulant électrique qu’il avait fait construire spécialement.
Le chocolat, du pur cacao délayé dans du lait frais, fumait dans le bol en vermeil. Il y mit quatre morceaux de sucre de canne et se saisit d’une des quatre brioches, la beurra. Il ferma les yeux. Le cérémonial matinal commençait…
Le chauffeur amena les fax et autres nouvelles arrivés dans la nuit. V.D. n’avait pas de secrétaire, il n’aimait pas s’entourer de personnel. Le strict minimum, des personnes de confiance : le chauffeur, un polonais qu’il avait un jour sorti d’une sale affaire et qui lui vouait depuis une reconnaissance sans bornes et Alfréda, sa cuisinière, femme de chambre, dame de compagnie qui le servait depuis bientôt trente ans.
Une heure plus tard, rasé, parfumé et vêtu de l’un de ses éternels costumes d’alpaga sombre, il se roula vers ses collections. Celles-ci étaient rangées dans une immense salle occupant tout le sous-sol de la bâtisse. Porte blindée, air climatisé, pas d’ouvertures. Les lumières indirectes créaient une ambiance feutrée, accentuée par la présence, sur le sol, de nombreux tapis persans. Quelques tapisseries des Gobelins, dans un parfait état de conservation, décoraient, un pan de mur ; là, s’alignaient des armes blanches de toutes époques, absolument authentiques, ici, un candélabre Renaissance, plus loin un bureau à cylindre ayant appartenu au roi louis XVI, quelques meubles du premier Empire, une véritable caverne d’Ali Baba…
V.D. passait dans cette pièce chaque matin, avant toute autre activité. Il s’arrêta devant sa collection d’armes blanches : une place était ménagée dans l’alignement des rapières : elle était destinée à ce dont il rêvait : une dague de chasse époque Charles IX. Une arme introuvable sur le marché. Seuls, quelques rares collectionneurs en possédaient mais ne s’en dessaisissaient à aucun prix et Victor Duffort connaissait ainsi le paradoxe de ne pas pouvoir s’offrir, malgré toute sa fortune, la seule chose dont il rêvait. Cela l’aidait à supporter l’ennui qu’il éprouvait parfois à diriger la vie de centaines de personnes de par le monde. Lui à qui la fortune avait donné quasiment tout pouvoir, pour une fois, n’était pas maître du jeu. Il attendait donc avec impatience, tout en le redoutant, le moment où l’objet de sa convoitise viendrait prendre la place qui lui était destinée dans cette cave…
— Le journal, Monsieur…
Alfréda se tenait debout à l’entrée de la pièce, le journal local posé sur un plateau qu’elle tenait en main.
V.D. se fit rouler jusqu’à elle, s’empara du quotidien, l’étala sur une table de jeu époque Louis XIII et s’enquit des nouvelles. Cela aussi faisait partie du cérémonial. Après la visite à ses collections, Victor Duffort lisait le quotidien local, plus particulièrement la rubrique de Monnaie : une gageure, il ne se passait jamais rien à Monnaie mais c’était pour lui une façon de garder le contact avec cette ville où il ne se rendait plus. “Maucartier” était assez isolé du reste du bourg, en bordure de la forêt “Bellier” et il y avait bien quinze ans qu’on ne l’avait vu dans la commune. Et pourtant, il fut un temps où Victor Duffort exerçait des fonctions municipales importantes comme premier adjoint au maire. C’était du passé et, sa profession aidant, il avait peu à peu perdu le “contact”, recevant encore le maire de l’époque qui était mort l’année dernière, et le second adjoint, ancien notaire, qui se faisait vieux, lui aussi.
— Un fax, Monsieur ! Le cabinet Goëtsen d’Oslo met en vente un lot de meubles anciens très intéressant.
— Merci Stanislas, nous y allons. Veuillez vous occuper des préparatifs, j’aimerais y être dans une heure trente. Ma bonne Alfréda, préparez mon bagage, je vous prie… Et quelques brioches au beurre de cacahuètes.
* * *
L’automobile roulait à faible allure, Wenz avait la migraine : cette matinée commencée tôt, tous ces événements… La question qui le taraudait depuis qu’il avait appris l’assassinat de son ami : qui ? Une question en amenant une autre : pourquoi ? Il prit la direction de Château-Renault, il avait besoin de carburant.
Il avait beau se creuser les méninges, les questions restaient sans réponses… « Non… Il connaissait bien Benjamin et ne lui connaissait pas d’ennemi… Ou alors un concurrent ? Absurde ! À moins qu’un client mécontent… Ridicule ! Alors quoi ? Un crime gratuit ? Simplement crapuleux ? Non, le sous-brigadier lui avait dit que le contenu de ses poches et de son portefeuille, d’ailleurs bien garni, était intact… » Il freina… Brusquement, de sa droite avait surgi une grosse Jaguar grise qui lui coupa la route et prit la direction de Tours…
— Oh, l’imbécile ! Et le stop ?
Il eut le temps de reconnaître la silhouette du chauffeur.
— Monsieur Duffort est sans doute encore très pressé. En tout cas, son chauffeur conduit toujours aussi mal.
Il arriva à la station-service, c’était la piste la plus fleurie de Touraine, Wenz l’aurait parié. Une multitude de géraniums s’épanouissant sur des colonnes de fûts en plastique ou des roues de charrette… Fermée… « C’est bien ma chance… », pensa-t-il, mais pouvait-on décemment invoquer la chance en ce dimanche ? Il reprit la direction de Tours. Tout à coup, il s’aperçut qu’il mourait littéralement de faim. Il fit halte à la boulangerie. Il avait englouti les deux tiers d’une baguette lorsqu’il arriva au fast food de Tours nord. Il préféra manger dans sa voiture, cela évitait les interminables queues à l’intérieur. Ce n’est pas qu’il aimait particulièrement la restauration d’outre-Atlantique, mais il ne voulait pas cuisiner chez lui, d’ailleurs, le réfrigérateur devait être vide… Il se gara devant la grange de Meslay pour manger tout en réfléchissant. Un “jet” déchira le ciel… Dehors, les cerfs-volants dessinaient des arabesques…
* * *
Maud achevait son repas lorsqu’elle entendit le ronronnement du moteur de la voiture de son locataire…
Wenz s’arrêta à hauteur du portail ; il pensait bien avoir commis quelques dégâts en quittant “La Blon-dellerie” ce matin, mais il n’aurait jamais imaginé avoir détruit un parterre entier. Or, c’était le cas… « Elle doit être furieuse ! » pensa-t-il en allant prudemment ranger l’objet du délit dans le garage. Il ferma la porte et se dirigea vers la demeure de sa logeuse.
— Entrez ! lui dit-elle alors qu’il s’apprêtait à frapper.
— Madame, je viens vous présenter mes excuses pour…
— Entrez, vous dis-je, ne restez pas là, avec votre je ne sais quoi à bout de bras, cela manque d’équilibre…
Il entra, posa négligemment la boîte carrée sur la table.
— Vous allez bien ? Vous semblez perturbée… Ce n’est quand même pas à cause des cyclamens ? Je vous promets de les faire remplacer, à mes frais.
— Il s’agit bien de fleurs, monsieur Wenz ! J’ai eu une matinée très riche en émotions alors les fleurs, vous savez… Comme disait Bertrand : « Il faut savoir aller à l’essentiel et l’essentiel actuellement n’est pas rose et blanc ! » Mais vous même, vous m’avez l’air bien déconfit et je ne pense pas que ce soit dû uniquement à la perte de mes parterres ?
— À vrai dire, j’ai eu, moi aussi, une matinée chargée. Il y a parfois des dimanches dont on se passerait volontiers. Mais il faut que je vous dise : je viens de perdre l’un de mes amis.
— Oui, je le sais, hélas, je suis même bien placée pour le savoir…
— Comment… C’est vous ?
— Oui… C’est moi !
— Mais pourquoi ?
— Pardon ? Oh ! Quelle horreur ! Vous n’allez tout de même pas croire que… Non, non, c’est moi qui ai découvert le corps !
Un silence se fit, pesant.
— Qu’est-ce ? demanda-t-elle en désignant la boîte carrée posée sur la table.
— Des pâtisseries, j’avais pensé qu’en ces circonstances, et en attendant les réparations…
— Vous avez raison, c’est très indiqué contre la baisse de moral.
Il ouvrit le paquet.
— Éclair ou religieuse ?
— Tolstoï, s’écria-t-elle. Guerre et paix, j’opte pour la paix, dit-elle en décapitant la religieuse…
II
Wenz ferma la porte du garage, le moteur de sa voiture tournait, il s’apprêtait à partir pour faire quelques courses avant de passer chez le pépiniériste acheter de quoi réparer les dégâts commis la veille. Il monta à bord et enclencha prudemment la première, roulant au pas… Un petit homme brun s’encadra dans le portail… Wenz s’arrêta.
— Monsieur Wenz ?
— Inspecteur Huberdeau, Sylvestre Huberdeau de la Criminelle… Il sortit sa carte.
— Je pensais que c’était la gendarmerie qui menait l’enquête, d’ailleurs, je leur ai déjà fait ma déposition et je ne vois pas ce que je pourrais bien y ajouter.
— Pour répondre à votre remarque, bien que je n’y sois aucunement tenu, monsieur le Procureur de la République a dessaisi la gendarmerie de cette affaire au profit de la Criminelle. D’autre part, j’ai, bien entendu, examiné scrupuleusement votre déposition et elle me paraît claire, cependant j’aimerais examiner votre cadre de vie, pour un inspecteur, cela peut aider, parfois…
— Je ne vous demanderai pas si vous avez un mandat, comme dans les mauvais films ?
— Vous savez comme moi que ce genre de papier n’existe pas. J’agis sur commission rogatoire…
— Bien, je vous montre le chemin.
Wenz coupa le contact et précéda l’inspecteur.
— Voilà bien une garçonnière comme je l’imaginais ! Oh ! Que de livres ! Félicitations, vous avez là une magnifique bibliothèque.
Il avisa une photo sur le bureau.
— Qui est-ce ?
— Ma femme…
— Divorcé ?
— Veuf ! Et puis pourquoi cette question ? Vous savez déjà tout cela, non ?
— Bah ! La routine, la routine…
L’inspecteur s’arrêta devant un pan de mur garni de flèches de toutes sortes.
— Vous collectionnez ce genre de projectiles ?
— Oui, elles viennent d’un peu partout : Afrique, Australie, Europe centrale, États-Unis… Tenez, ces deux-là sont des reconstitutions de flèches préhistoriques : fût en fusain, empennage en plumes de canard et pointe en bois de renne, le tout fixé à la colle animale et renforcé de tendons…
— Vous chassez ?
— Oui, à l’arc…
— Comme ce pauvre vétérinaire… Saviez-vous qu’il a été assassiné d’une flèche de chasse ?
— Bien sûr… Mais où voulez-vous en venir ? Vous ne croyez tout de même pas que c’est moi qui…
— Montrez-moi vos flèches de chasse !
— Elles sont là, dans ce gros tube de carton, mais c’est absurde, tout chasseur marque ses flèches de son nom et de son numéro de permis, je ne déroge pas à la règle. Je n’ai pas vu la flèche qui a tué mon ami, mais je doute qu’elle porte mon nom, ni aucun autre !
— Si, justement, elle porte un nom… Et un numéro… Les siens ! Ne trouvez-vous pas cela étrange ? Le vétérinaire de Monnaie assassiné avec une de ses propres flèches !
— Effectivement, mais cette flèche aurait pu avoir été volée…
— Par un ami…
— Je vous interdits !
— Allons, calmez-vous, monsieur Wenz ! Au fond, peu importe que cette flèche fût sienne, dérobée ou prêtée pour une raison qui m’échappe encore, l’essentiel n’est-il pas qu’elle fut bien tirée ? Par un arc, bien entendu ! Or des arcs, vous en possédez plusieurs. De fortes puissances ?
— Soixante-dix livres…
— Vous êtes chasseur…
— Mais pourquoi aurais-je tué Benjamin ? Je vous le demande !
— Un point pour vous, Wenz ! Pourquoi ? Voilà précisément ce que j’ignore : le mobile. C’est bien pour cela que je ne vous ai pas encore inscrit définitivement comme suspect numéro un !
— Je suis sensible à tant d’égards ! D’ailleurs, je voudrais vous faire remarquer qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un arc de forte puissance pour tuer quelqu’un ; un arc de quarante-cinq à cinquante livres suffit, si la distance est courte…
— Tiens, je n’y avais pas songé ! Il faut dire que je ne suis pas grand clerc en matière d’archerie. Voilà qui pourrait bien m’ouvrir de nouvelles portes… Merci de ce renseignement… Mais dites-moi, Wenz, mis à part la victime et vous-même, qui chasse à l’arc par ici ?
— Personne… C’est vrai mais cela ne prouve rien ! L’assassin peut être venu d’ailleurs !
— Ce n’est pas impossible… À propos de numéro un… Regardez cette photo ! Il tendit une photographie de la tête de la victime. Que pensez-vous de cette trace, là, sur le front ?
— Wenz fut troublé par la vue de son ami mort, il essaya de se concentrer… Rien… Je ne vois pas…
— Ne dirait-on pas un numéro ? Ou pour être plus précis : un chiffre, le chiffre un ! C’était tracé avec le sang de la victime… Il avisa un encrier et du papier sur le bureau.
— Pourriez-vous me tracer le chiffre un avec votre doigt, sur cette feuille de papier ? Wenz s’exécuta.
— Merci ! reprit l’inspecteur s’emparant du papier, nous comparerons au labo.
— En voilà assez ! Je n’ai pas tué Lonpré, que ça vous plaise ou non ! Vous n’avez pas de mobile, aucune charge contre moi, juste des suppositions, des théories assez fumeuses basées sur de vagues analogies, alors fichez-moi la paix avec vos chiffres ! Du diable si j’y entends quelque chose !
— Monsieur Wenz ! Vous n’avez pas d’alibi ! Que faisiez-vous samedi dernier vers vingt et une heures trente ?
— Je dormais, Monsieur ! Ça, quand on vit seul et que l’on dort, on n’a pas d’alibi bien entendu ! À mon prochain coucher, je prendrai la précaution de faire venir deux témoins !
— Pas d’ironie, je vous prie ! Allons, personne ne pourrait témoigner en votre faveur ?
— Peut-être ma logeuse…
— Ah oui, voyons…
Il consulta son carnet.
— Madame Choucry de Roquefeuille… Maud… C’est exact ?
— Veuve Saintonge de La Foy, c’est exact Inspecteur !
— Peste ! Du beau linge apparemment ! Je vais aller la voir, peut-être éclaircira-t-elle quelques points ? C’est elle qui a découvert le corps, n’est-ce pas ? Au revoir, monsieur Wenz…
Wenz renonça momentanément à ses courses, rentra sa voiture au garage, prit sa bicyclette et partit sans se retourner.
Il éprouvait un impérieux besoin de changer d’air. Il prit la direction de la forêt Bellier…
* * *
“Valmoutier” n’avait en rien perdu de sa splendeur passée. Ancienne métairie, “Vaumoutiers” comme on l’appelait alors, appartenait au XVIIe siècle à un notable de la ville voisine : le maire de Tours, conseiller du Roi. C’était un joli château situé en forêt, auprès d’un charmant vallon au sud de Monnaie. On y accédait en empruntant une grande allée qui séparait le bois en deux parties inégales, ou par le corps de logis des métayers, en franchissant une porte en plein cintre prise au centre du bâtiment précédant la demeure des Maîtres. Les allées étaient entretenues avec autant de soin que les pelouses.
Sous ces toitures d’ardoises vivaient depuis cinq générations les Mureau… Le premier Empire avait permis à Joachim Mureau d’acquérir cette ancienne métairie et les terres attenantes. Joachim avait acquis une solide fortune au service de l’Empereur et, outre le domaine de “Valmoutier”, avait acheté une charge de notaire pour son fils, Germain. Depuis les Mureau exerçaient la charge de notaire de père en fils. Leurs confortables revenus avaient permis l’entretien et la restauration de “Valmoutier”.
Pour l’heure, c’était le dernier des Mureau, Philippe qui occupait le fauteuil du cabinet notarial de
Monnaie et dirigeait également les offices de Chanceau, Château-Renault et Notre-Dame-d’Oé. Philippe Mureau avait succédé, voici quelques années, à son père, Marcel, bientôt septuagénaire. Marcel Mureau goûtait depuis une retraite paisible au domaine, partageant son temps entre la lecture de livres anciens et l’étude de la généalogie des propriétaires successifs du château.
Le majordome entra dans la bibliothèque. Un feu brûlait dans l’imposante cheminée. Marcel Mureau lui faisait face, confortablement installé dans un fauteuil de cuir. Il était plongé dans le livre d’heures de Gaston Phoebus en édition originale. Le patriarche était un passionné de chasse à courre et de vénerie.
— Un télégramme pour Monsieur…
— Merci Edgar… Ah, c’est de Victor Duffort… D’Oslo… Il me propose une table et une crédence Louis XIII… Après tout, cela serait bien, dans le petit pavillon, répondez-lui que…
Des pas se firent entendre dans le corridor, la porte s’ouvrit avec fracas et une fillette de huit ans courut jusqu’au vieil homme.
— Grand-père ! Grand-père ! Regardez ce que Maman m’a acheté !
Elle l’entraînait tirant la manche de sa veste d’intérieur vers l’une des fenêtres…
— Regardez, cette fois il est bien là, et bien à moi… C’est le plus beau des cadeaux… Un poney, il est beau n’est-ce pas ?
— Marie ! Allez-vous cesser d’importuner votre grand-père ? Bonsoir, Père, avez-vous passé un bon après-midi ? Excusez Marie, elle est folle de joie !
— Mais Maman…
— Allez, petite sotte, allez aider le palefrenier à rentrer Tootsie dans son box !
— Il est beau mon poney, n’est-ce pas Grand-père ? Elle repartit en courant jusqu’à l’extérieur.
Le patriarche termina de donner ses ordres quant à la réponse au télégramme puis considéra sa belle-fille occupée à donner ses directives pour le repas du soir à la cuisinière qu’elle avait fait mander.
Consuelo, Isabel, Christina Sepulveda de Yeltes était une grande femme brune aux yeux myosotis. Son allure un peu hautaine était souvent adoucie par ce sourire éclatant dont elle n’était pas avare. Issue de l’une des plus anciennes familles d’Espagne, cette Castillane, indépendante et volontaire, avait épousé Philippe Mureau sans le consentement de son père qui avait bien sûr d’autres vues pour sa fille…
Consuelo et Philippe s’aimaient. Il achevait ses études de notaire, elle terminait Polytechnique. Ce fut donc un mariage d’amour et cet état durait. Elle avait donné à son époux deux enfants : Marie et José, et ils s’aimaient après neuf ans, comme au premier jour. Même l’Espagne avait capitulé devant la détermination de Consuelo et Juan-Pablo Sepulveda de Yeltes lui-même avait fini par accepter le choix de sa fille.
Marcel Mureau était très fier de sa bru bien qu’il ne le montrât pas. Outre son intelligence et sa culture, il appréciait chez elle ce sens inné de l’organisation qui faisait que tous ici la considéraient comme la maîtresse de maison. Cette autorité bienveillante allait de pair avec une délicatesse peu commune. Consuelo savait respecter les autres au travers des petits détails de la vie de tous et tous en éprouvaient bonheur et respect. Consuelo était ce que l’on pourrait appeler une grande dame…
Le patriarche s’était d’autant plus vite abandonné à l’autorité de sa bru que, le veuvage faisant, il ne s’était jamais senti une âme d’organisateur.
Préférant laisser le soin de la gestion du domaine à celle qui en avait le goût, il était retourné à ses chers souvenirs qu’il entretenait dans Le Pavillon, une bâtisse aussi ancienne que le Château, isolée, un peu plus loin, dans le bois. Là, Marcel Mureau avait son domaine réservé, ses chers vieux meubles et ses rêves…
— Philippe n’est pas encore rentré, Père ?
— Non, il rentrera tard me semble-t-il : une succession délicate à régler pour demain.
— Le dîner sera prêt dans une heure, je monte me changer.
— Une heure ? C’est plus qu’il ne m’en faut ! Je vais jusqu’au Pavillon, il faut que je trouve un emplacement pour les meubles que je viens d’acquérir auprès de Duffort…
Le Pavillon était un bâtiment de taille assez respectable, composé d’une succession de pièces en un unique rez-de-chaussée. On entrait par un vestibule dont les murs blancs décorés de toiles représentaient des scènes de chasse à courre. Un grand portemanteau muni d’une glace occupait le pan de mur à droite de la porte d’accès au salon. Canapés et fauteuils anciens lui donnaient un charme désuet. Une salle de billard aux murs garnis de livres et de tableaux jouxtait, comme le bureau contigu, une véranda, mi-jardin d’hiver, mi-atelier de peinture. Depuis qu’il s’était retiré des affaires, le patriarche s’adonnait avec quelque bonheur, aux joies de l’aquarelle et de l’huile sur toile. L’homme passa dans le bureau, avisa le quotidien local qu’Edgar avait déposé dans la matinée. « Ce cher Edgar, toujours aussi attentionné… », pensa-t-il en parcourant le journal. Il s’arrêta, surpris de lire, en gros caractères :
« ASSASSINAT À MONNAIE. »
— Quoi ? Benjamin Lonpré est mort assassiné ! Le fils du maire ?
Une foule de souvenirs lui revinrent à l’esprit. Il sortit une chemise jaunie de l’étagère. Elle contenait, entre autres papiers : une photo sépia où trois personnages figuraient en pied sur le perron de la mairie de Monnaie. Trois jeunes hommes ! Celui du milieu avait la poitrine barrée de l’écharpe tricolore : Albert Lonpré. À sa droite, le premier adjoint de l’époque : Victor Duffort. Et à sa gauche, le second adjoint : lui-même. Que de temps passé depuis cette époque ! C’était la fin de la Seconde Guerre mondiale. Leur jeunesse ! L’âge des ambitions et des convictions parfois hâtives, l’âge de la vie quoi ! Il s’en allait peu à peu dans ses souvenirs d’après-guerre… Un frisson le parcourut tandis qu’il s’empressait de chasser une pensée, ou plutôt une image oubliée depuis longtemps, une image de femme qui le gênait un peu. Bah ! Erreur de jeunesse, pensa-t-il en revenant à son journal. C’est quand même surprenant que le fils d’Albert ait été assassiné ! Un vétérinaire ! Mais pourquoi ? L’enquête l’expliquerait sûrement, cet inspecteur allait…
La cloche annonçant le dîner sonna au Château. Le patriarche enfila son trois-quarts fourré, maudissant la vieillesse qui le rendait frileux et s’éloigna à petits pas rapides. Il n’aimait pas faire attendre Consuelo…