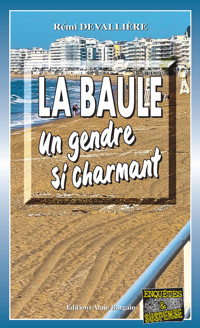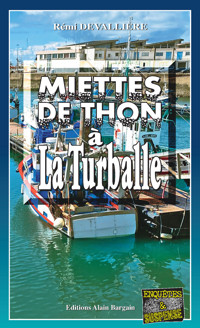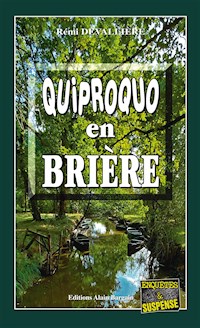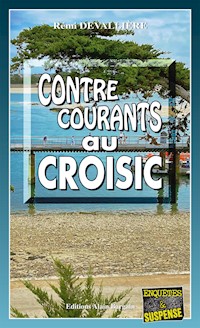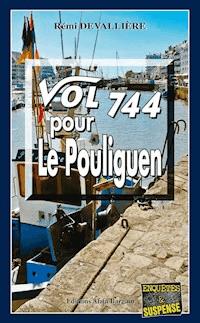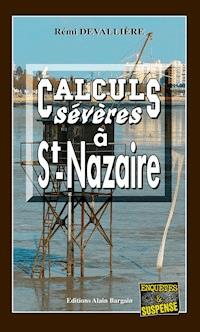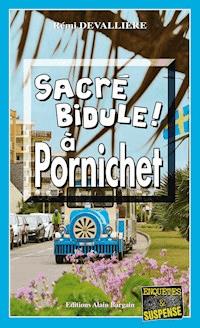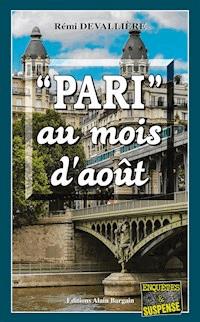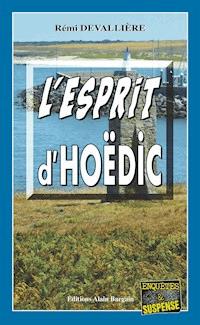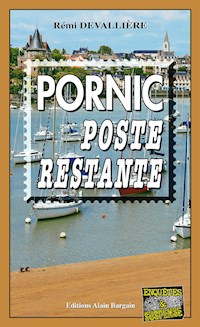
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Une enquête du Commissaire Anconi
- Sprache: Französisch
Dans un hôtel de Pornic en 1987, une femme confie avoir reçu un courrier bien étrange...
Mai 1987 : le commissaire Anconi et son épouse Hilda profitent de leurs vacances à Pornic. À l’hôtel, ils croisent une femme désemparée, Marie Avril, qui se confie à eux. Abandonnée dès sa naissance, elle a reçu récemment le courrier mystérieux d’un homme âgé : « Écrivez-moi en Poste restante à Pornic. » Est-ce son père, ainsi qu’elle l’imagine ? Elle répond, mais sans nouvelles, décide de venir à Pornic où elle le cherche et appelle au secours, puis le pense mort et à son tour, disparaît. Voilà nos vacanciers ballottés dans une enquête inattendue, entre escaliers de la ville haute et villa ancienne de Gourmalon, entre une vieille famille d’armateurs et les ombres d’un ancêtre finlandais, d’un peintre et d’un écrivain venus autrefois sur la côte de Jade…
Retrouvez le commissaire Anconi à Pornic, accompagné de sa femme Hilda, pour cette enquête palpitante. Les vacances ne s'annoncent pas de tout repos !
EXTRAIT
"L’antiquaire sortit, non sans un dernier regard vers ce qui semblait remplir sa vie : les livres. Il referma doucement la porte sur lui, y coinçant un instant sa drôle de tunique verte.
Sans cet étrange personnage, la pièce perdit son aspect de café-théâtre pour reprendre celui de librairie-musée. Le coffre-fort, resté visible derrière son panneau encore entrouvert, lui conférait un air de cambriolage.
— Il nous balade, ce càcou ! ragea Anconi.
— Il était le mieux placé pour dérober le manuscrit, et pourtant c’est son beau-frère qui s’en est chargé. Tu crois qu’ils seraient complices ces deux-là, mijn beminde ?
— Fatche ! Je ne le vois pas faire le baron ! Mais tout cela ne nous dit pas qui a décroché le tableau de Max Ernst du mur de la salle à manger ! Ni qui a abrégé les jours de belle-maman !
Ils échangèrent leurs questions. Que contenait le coffre-fort ? Où s’en trouvaient les clefs ? Avait-il déjà été visité depuis le décès de Gustav’ ? Le répertoire des livres existait-il vraiment ? Où était passé le tableau surréaliste ? Enfin, qui avait assassiné Jeanne Eklöf ? Et pourquoi, si ce n’est pour s’emparer de la peinture ? Pourquoi avoir laissé les deux autres toiles ? D’où venait ce tapuscrit dont le docteur Cottard s’était précipité d’en demander l’évaluation chez Drouot ?"
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
"Agréable moment de détente que de lire ce roman que certains penseront suranné mais qui reflète parfaitement l’époque des années 80. La trame de l’intrigue est intéressante et on y découvre Pornic dans de belles descriptions [...]." - cynodon78, Booknode
À PROPOS DE L'AUTEUR
Après plusieurs décennies passées, comme médecin hospitalier, à soigner les maux les plus graves, Rémi Devallière, désormais en retraite à Pornichet, se plaît à choisir les mots les plus appropriés pour ses histoires. L’hiver, ou lorsque la mer n’est pas navigable, il écrit, avec passion. Nouer des intrigues n’est-il pas le pendant d’une démarche médicale bien conduite ? Si les instruments de l’exercice en sont bien différents, le plaisir de parvenir à un résultat satisfaisant est bien le même. Et les aveux du coupable ne relèvent-ils pas du même défi qu’un diagnostic bien posé ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
« L’homme n’est pas entièrement coupable : il n’a pas commencé l’histoire ; ni tout à fait innocent puisqu’il la continue. »
Albert Camus
« Il y a certains jours dans lesquels je me jette Et je suis de retour en 1987… »
Calogero – Paul École
Tous mes remerciements à celles et ceux qui ont porté un regard critique sur le manuscrit, à Évelyne et Alain pour leur documentation d’époque.
Merci aussi aux Pornicais pour leur accueil bienveillant.
PROLOGUE
Cette dame âgée contemplait-elle le vieux port ? Toute son attitude le laissait entendre : ses bras posés sur les accoudoirs d’un fauteuil roulant, sa tête penchée de côté, elle paraissait admirer l’Anse aux lapins, tout en bas. Derrière elle, le jardin exubérant de sa villa, sur la corniche de Gourmalon. Une jolie demeure, ancienne et coquette, dont les fenêtres closes de l’étage gardaient le secret de souvenirs d’étés, de disputes d’enfants, de retours de chasse aux papillons ou de pêche à la crevette. Dans le parc, à l’ombre des arbres séculaires, la coque verdie d’un dériveur démâté renforçait cette image d’un passé révolu.
Était-elle venue seule jusqu’à cette petite terrasse dominant la ria ou l’avait-on poussée là, pour jouir du spectacle tranquille de l’eau, des bateaux au mouillage, du vieux château en face ? Elle ne le savait plus.
Au loin retentirent les cloches de l’église Saint-Gilles. Un glas. Celui de la cérémonie où elle n’avait pu se rendre. En effet, Jeanne, trop fatiguée, avait dû renoncer. Après que Violette, sa fidèle gouvernante, lui eut servi son infusion matinale, elle lui avait demandé de la conduire au jardin :
— Respirer sous la tonnelle me fera du bien ! Je me sens si oppressée.
— Je vais très vite en ville acheter quelques provisions, pour la collation, la famille aimera sans doute se restaurer, après les obsèques.
— Ah ! Oui, c’est vrai, l’enterrement ! avait-elle répondu, égarée.
Il s’agissait pourtant de celui de son mari ! À peine s’était-elle rendu compte de sa disparition, au point qu’elle avait oublié quel mal l’avait emporté. « Est-ce cette tension trop forte, ou alors les migraines dont il se plaignait sans cesse ? » Elle n’aurait su le dire.
— Êtes-vous certaine que tout ira bien, Madame ? s’assura la gouvernante.
— Mais oui, murmura-t-elle avant d’ajouter, dans un souffle, à peine audible : Merci, ne vous tourmentez pas pour moi.
La tête lui tournait un peu, ce matin, comme ces jours derniers d’ailleurs, « l’émotion sans doute », répétait mademoiselle Violette pour la rassurer. Des images surgissaient de sa mémoire, disparaissaient aussitôt, lui laissant une impression de flou, d’inachevé. Pourtant, au début de sa maladie, les médecins spécialistes lui avaient affirmé qu’elle garderait toujours toutes ses facultés. Elle avait d’abord perdu progressivement l’usage de ses jambes, maintenant ses bras devenaient si lourds qu’elle ne parvenait plus à se déplacer toute seule dans son fauteuil roulant. La respiration lui coûtait. Était-ce le cœur qui s’affaiblissait ?
Ses filles s’imposaient alternativement à son esprit, fugitivement. Elle n’en percevait curieusement que des images anciennes, du temps où, petites, elles s’amusaient à la balançoire que son mari avait suspendue au grand pin. L’été illuminait leurs robes à fleurs, celles qu’elle achetait chez… « Chez qui déjà ? Est-ce quai Leray ou dans cette rue en pente dont le nom ne me revient pas ? »
Ses pensées s’obscurcissaient aux souvenirs anciens, regrets et remords s’y mêlaient. Le mariage arrangé par ses parents n’avait jamais effacé cette idylle dévorante de l’été 1925 ni le drame qui avait suivi. Comme un écho du passé, quelques accords de la chanson d’Aznavour envahirent sa mémoire : « Non, je n’ai rien oublié… »
« Quelle heure peut-il bien être ? » se demanda-t-elle entre deux évocations éphémères. Voilà que, sur la rive opposée, le soleil éclaire la tour du château, se réfléchit sur les vitres de La Malouine. « Violette devrait être rentrée. »
Elle ressentait des battements irréguliers dans la poitrine, assortis de petites douleurs pointues. À peine s’apprêtait-elle à porter lourdement la main vers son cœur que la sensation disparaissait, pour revenir un peu plus tard, sans crier gare. Elle ne se souvenait pas quand elle était apparue pour la première fois, comme si elle l’avait toujours connue, tant elle s’y était habituée. Néanmoins, ce matin, les soubresauts s’accéléraient à l’intérieur, tel un moteur qui s’emballe. « Était-ce l’effet des gouttes ? »
« Où est donc Violette ? » Elle prit peur, voulut appeler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Jeanne pensa à son époux, prononça la première syllabe de son nom. Sa respiration s’amplifia brusquement, comme précédant un éternuement qui tarde à se produire. « Est-ce la chaleur ? Ce trouble de l’air est-il bien réel ? » Elle crut à un mirage, semblable à la réverbération intense que diffuse le sable miroitant du désert. Sa vue s’obscurcit soudain, un faible cri lui échappa.
I CURIEUX DÎNER
Dimanche 3 mai 1987, soir
Le commissaire Anconi avait remarqué, à la table voisine de la leur, cette femme seule, vêtue de noir. Elle lui avait paru agitée. Elle ouvrait sans cesse son sac à main, en extrayait vivement un poudrier assorti d’un miroir, contemplait son visage avant de se tamponner les joues d’un geste fébrile, rangeait nerveusement l’étui. Elle jetait des regards furtifs. En raison de l’âge respectable de la dame, il s’était demandé si elle ne souffrait pas d’une quelconque maladie du cerveau, qu’elle aurait cherché à dissimuler derrière un comportement de coquetterie. Lorsque, d’un geste malhabile, elle laissa tomber la salière, sa supposition en fut renforcée. Hilda, l’épouse du commissaire, se pencha immédiatement pour la ramasser et la lui tendit en souriant.
— Oh, pardon ! Je suis désolée. Je suis si maladroite, fit la dame en noir.
Les Anconi crurent même à un début de malaise, tant elle serrait fort son front de la main, tant elle était pâle dans sa tenue sombre.
— Cela peut arriver à chacun, assura Hilda. Vous sentez-vous mal, ajouta-t-elle avec empressement ? Vous faut-il un médecin ?
— Non ! Non ! Ce n’est rien. Une chaleur, cela va passer. Ce sont les circonstances. Je suis ici pour un deuil, un deuil familial. Je suis désolée, répéta-t-elle.
Elle eut à nouveau un geste maniéré, rejetant la tête en arrière, comme pour reprendre une certaine assurance.
Il émanait d’elle une tristesse réelle, mais aussi une fébrilité qui, par moments, supplantait son abattement.
— Je suis confuse, s’excusa Hilda. Recevez toutes mes condoléances, Madame, et celles de mon mari. Quelqu’un de proche, sans doute ?
L’arrivée de la serveuse interrompit les politesses. Anconi eut un sourire de connivence à l’adresse de sa femme. La curiosité de celle-ci n’était-elle pas partagée par son commissaire de mari ?
Le couple avait quitté sa péniche parisienne une semaine plus tôt. Chacun d’eux appréciait les premières chaleurs de mai, le calme qui précédait les cohues estivales. Ils avaient commencé leur périple à Port-des-Barques, dans les Charentes, où leur fils élevait des coquillages. Anconi avait accompagné Jean chaque jour sur sa plate, derrière l’île Madame, charriant des sacs de moules, réclamant la barre, campé dans ses bottes comme un vrai pêcheur. Hilda avait nagé Plage des Anses où une retenue d’eau garantissait une bonne température de baignade, surtout pour une Hollandaise, malgré la saison ! Bénéficiant de lumières inhabituelles, elle s’était consacrée à la peinture, sa passion.
Après ce séjour familial, ils avaient décidé de remonter tranquillement la côte, sans but précis, afin de profiter des quelques jours de repos qui leur restaient.
— Depuis combien de temps n’avions-nous pas pris de vraies vacances ? avait demandé Hilda, tout sourire, alors qu’ils roulaient vers Rochefort.
— Sur “Zeeland”, n’y sommes-nous pas un peu tous les jours ? plaisanta Anconi pour éviter de répondre à une question embarrassante.
Hilda avait éclaté de rire.
Zeeland était le nom de leur péniche, ancrée à Neuilly-sur-Seine, face à l’île du Pont. Elle leur avait été léguée par le père d’Hilda, un peintre hollandais dont elle avait hérité le talent. Les Anconi avaient fait ramener l’embarcation par les canaux du Nord, un long voyage de Hollande par Amsterdam et Bruxelles, l’Escaut et l’Oise. Modernisée et aménagée avec goût, elle disposait d’une terrasse abritée par la végétation du quai, face au rivage verdoyant de l’île. Bien des passants du boulevard Kœnig enviaient leur habitation, certains curieux qui se rendaient au bois de Boulogne, écartaient les feuillages pour tenter de découvrir cet univers flottant.
— Nous sommes au printemps 1987, cela fait déjà 5 ans que nous n’avons plus voyagé, mijn beminde*! ajouta la femme du commissaire, lorsque son rire se fut enfin éteint.
Après deux jours à La Rochelle, Pornic sut les retenir. L’hôtel “Beau Soleil”, leur avait proposé une jolie chambre au 1er étage, face à la ria. Le paysage changeant avec les marées, les belles villas d’autrefois sur la rive opposée, la silhouette du château dressant au-dessus de l’eau sa grosse tour médiévale sur un piton de roche noire, les avaient séduits. Malgré un refroidissement inattendu des températures, ils avaient prolongé l’escale. Ce jour-là – dimanche 3 mai – presque toutes les tables étaient occupées.
La serveuse déposa devant eux deux soles meunières et une demi-bouteille de menetou-salon dans un seau qui perlait. La dame en noir se fit apporter un simple bouillon dont elle se mit à remuer mécaniquement le contenu de sa cuillère, sans y goûter. Les Anconi, troublés par l’attitude de leur voisine, n’osaient pas échanger leurs impressions. Le bruit des couverts accentuait le silence qui s’était installé aux deux tables, laissant à distance le brouhaha de la salle.
La patronne, une femme élégante en tailleur clair et chemisier à larges fleurs, déplaçait son sourire avec grande agilité dans le restaurant. Elle vint s’informer de leur choix de dessert.
— Je craque pour une poire Belle-Hélène ! avoua Hilda.
— Et pour le commissaire ?
À leur arrivée, la propriétaire avait remarqué leur adresse « boulevard du général Kœnig, Neuilly-sur-Seine », soulignant qu’elle avait une sœur qui tenait « justement » un hôtel « tout près », rue de Long-champ. De fil en aiguille, sa curiosité l’avait facilement amenée à découvrir la profession de ses hôtes.
— Oh ! Un commissaire de la PJ de Paris ? Au moins, ici, vous serez tranquille ! Ce n’est pas demain que vous aurez une affaire criminelle à résoudre à Pornic !
Elle avait ri, partagée entre l’admiration et la crainte.
Depuis, elle plaisantait en toutes occasions, lui donnait du « commissaire » en rougissant.
— Juste une glace ! Une dame blanche, s’il vous plaît ! Avec beaucoup de chantilly…
Ils commandèrent ensuite un café. Leur voisine en noir avait fini par absorber lentement le contenu de son assiette, en s’essuyant la bouche furtivement à chaque cuillerée. Elle jetait régulièrement un mince sourire dans leur direction, comme pour s’excuser de son trouble trop apparent.
Anconi et son épouse se levaient de table lorsque la femme en noir, d’une voix timide, esquissa le geste de se redresser à son tour et demanda :
— Veuillez me pardonner, j’ai entendu malgré moi. Vous êtes policier ?
— Oui, en effet, Madame.
— Vous êtes de la région ?
— Non, seulement en vacances, pour quelques jours.
Le commissaire hésitait, la femme aussi. Un fin tremblement agitait la frêle silhouette. Pourquoi songea-t-il à Édith Piaf ? La robe noire ? Le regard désespéré ? Ou cette réplique surprenante qui sortit de sa bouche :
— Cela ne fait rien. Rien de rien. Je ne veux pas vous ennuyer.
Anconi échangea un rapide coup d’œil avec Hilda qui ébaucha un geste d’assentiment et se rassit, pour encourager son mari à poursuivre. Tous les trois reprirent leur place.
— Pouvons-nous vous être utiles ? se décida à demander le commissaire d’une voix empathique.
Hilda sourit à ce “nous” qui n’engageait que le policier.
— Vous êtes à Pornic pour des obsèques, n’est-ce pas ? poursuivit-il.
— Oui, souffla-t-elle, comme épuisée.
— Quelqu’un de très proche, sans doute ?
— C’est compliqué…
— Tè, je compatis, fit Anconi.
La femme sortit maladroitement un mouchoir de son sac, se tamponna le nez pour se donner contenance. Une lettre tomba, qu’elle ramassa prestement. Ce n’était pas tant le chagrin qui marquait son visage, qu’une grande agitation anxieuse.
— Vous ne pouvez pas comprendre, c’est affreux.
— Les obsèques, c’est toujours douloureux. Les souvenirs…
— Oh, ce n’est pas cela ! Depuis une semaine, je m’oblige à assister aux enterrements des vieillards de la région.
Elle éclata en sanglots.
— Bonne Mère !
Elle sortit la lettre qu’elle venait de ramasser, la tendit à Anconi.
— Lisez, Monsieur ! Je vous en prie, lisez !
Le courrier était adressé à « Madame Marie Avril ». Un papier qui avait été lu et relu, dans une enveloppe ordinaire froissée, sans doute par le séjour prolongé dans le sac de la femme en noir. Anconi découvrit le texte :
« Pornic, 3 avril 1987
Madame,
Vous ne me connaissez pas. Si ma démarche risque de vous surprendre, elle n’en est pas moins sincère et désintéressée.
Puissiez-vous pardonner à un vieil homme le tourment que va provoquer, chez vous, cette lettre. J’ai bien longtemps hésité à vous l’écrire, mais mon grand âge – je suis né au début de ce siècle – et une santé défaillante font qu’il sera bientôt trop tard. Je m’y décide donc, même si ce que j’ai à vous apprendre risque de vous plonger dans un désarroi et une colère bien légitimes.
Laissez-moi vous dire : le hasard m’a conduit, bien malgré moi, vers le secret de votre naissance. Je possède un document vous concernant, qu’il me paraît de mon devoir de vous confier. Comment en ai-je pris connaissance ? Qu’importe ! Sachez seulement que je m’attache à vous le réserver.
Comment ai-je retrouvé votre trace ? Le hasard, encore le hasard.
Puis-je me permettre de vous suggérer, par souci de discrétion, de me répondre, si vous le souhaitez, en Poste restante à Pornic, en Loire-Atlantique ? Ce service me reconnaîtra sous le nom d’emprunt de Philippe Stephan. Ainsi pourrons-nous convenir du lieu et du moment les plus opportuns pour vous remettre ce document vous concernant ?
Vous voudrez bien me pardonner de ne pas vous dévoiler mon identité. Sachez que ce n’est ni pour entretenir un mystère ni pour vous manquer de respect.
Un vieil homme, Philippe Stephan »
L’affranchissement, sur l’enveloppe, datait du 3 avril 1987, le tampon était celui de Pornic. Ainsi, le mystérieux correspondant avait posté sa missive le jour même où il l’avait composée, comme dans l’urgence. Sous une maîtrise pesée, ses mots évoquaient à la fois une sincérité et une gêne coupable. Un mois s’était écoulé.
— Vous avez donné suite à cette…
Le commissaire hésitait sur le terme à employer.
— Oui ! J’ai écrit deux fois, en Poste restante comme il me le demandait. Je n’ai jamais eu de réponse.
— Pardonnez-moi, avez-vous une idée ? Je veux dire, ce nom, Philippe Stephan, vous évoque quelqu’un ?
Des sanglots la secouèrent.
— J’ai cru que c’était mon père… que je n’ai jamais connu.
— Ah ! Je comprends.
— Et vous n’avez jamais pu rencontrer l’auteur de cette lettre, c’est cela ?
— Hélas, non.
— Je suppose que vous vous êtes rendue au bureau de poste de Pornic ?
— J’ai fini par y aller. Mais, bien entendu, personne n’a voulu m’en parler. Je ne porte pas le même nom, et puis ceux qui utilisent la “Poste restante” souhaitent demeurer dans l’ombre. C’est confidentiel, je le conçois ! Je ne savais plus que faire… et comment le reconnaître ? Alors j’ai décidé d’assister aux enterrements des hommes de plus de 80 ans, au cas où…
— On perçoit en effet une réelle urgence dans les mots employés. Cette lettre a été écrite, c’est certain, par quelqu’un de vieux, vraisemblablement de l’âge de votre père. L’évocation d’une « santé défaillante » vous laissant craindre une fin proche, vous décidez d’assister à des obsèques… C’est cela ?
— Oui. J’ai été élevée par les sœurs de la Sagesse, à Paimbœuf, hoqueta-t-elle. Ce sont elles qui m’ont déclarée sous ce nom de Marie Avril ! Elles m’ont attribué ce patronyme ridicule, car elles m’ont recueillie au cours d’un mois d’avril. J’ignore ma véritable identité ! Je n’ai jamais connu mes parents.
— Les religieuses ne vous en ont jamais parlé ?
— Non ! Je suis persuadée qu’elles savaient quelque chose. Elles étaient si sévères ! Elles prétendaient que ma famille avait disparu dans le terrible naufrage du Saint-Philibert, mais je n’y ai jamais cru.
— C’est affreux, murmura Hilda.
— Pourquoi mettez-vous leur parole en doute ? demanda doucement Anconi.
— Elles avaient les préceptes du Bon Dieu plein la bouche, mais cela ne les empêchait pas de nous mentir effrontément. Je n’aime pas en parler.
— Ce naufrage, a-t-il réellement existé ? poursuivit le commissaire, avez-vous fait des recherches ?
— Oui. La catastrophe s’est produite dans les années trente.
Elle raconta l’histoire. Le navire à vapeur appartenait à la Compagnie Nantaise de Navigation et assurait habituellement la liaison Pornic-Noirmoutier. À l’occasion, il promenait des excursionnistes, au Bois de la Chaise. Un dimanche de juin, le bâtiment a emporté ses 502 passagers, pour la plupart des ouvriers, sur l’île. Tous découvrirent avec émerveillement les chênes verts et une odorante végétation évoquant la Méditerranée. Au retour, le bateau fut pris dans une violente et, semble-t-il, subite tempête dont l’abri de la côte avait masqué l’imminence. Une énorme houle le chavira dans l’estuaire de la Loire. Il n’y eut que huit rescapés. Les passagers noyés ne furent pas tous retrouvés, même si la mer, dans les jours suivant la catastrophe, rejeta de nombreux cadavres sur les plages de la région.
— Et pourquoi ne croyez-vous pas que vos parents aient réellement péri dans ce naufrage ?
— En ce cas, pourquoi n’aurais-je pas disparu avec eux ?
— Té ! Peut-être vous auraient-ils confiée à quelqu’un de la famille, une personne que l’excursion au Bois de la Chaise n’intéressait pas ? Ou bien comptiez-vous parmi les rescapés ?
— Non, les bonnes sœurs me l’auraient précisé. Comment expliqueriez-vous cette lettre, s’ils s’étaient noyés lors de ce naufrage ? dit-elle en agitant le feuillet.
La conversation tournait en rond. La dame en noir portait en elle tant de rancœur à l’encontre des religieuses qui l’avaient élevée !
— Vous semblez si certaine, opposa Anconi. Qu’est-ce qui vous laisse croire que ce serait votre père ? Il pourrait s’agir seulement du courrier d’un témoin du drame qui aurait reçu des confidences et qui, tardivement…
Marie Avril fixait le commissaire, avec un fol espoir dans le regard.
Le policier relut cette lettre énigmatique, celle d’un homme qui semblait vouloir conserver le secret de sa démarche, mais également se libérer d’un pénible fardeau. Pourquoi n’avait-il pas donné suite ?
— Comment a-t-il pu vous retrouver ? En avez-vous une idée ?
— Pas la moindre, renifla-t-elle en sortant à nouveau son poudrier. Au début du mois, j’ai reçu cette lettre…
— Cette adresse, rue Coypel, c’est bien la vôtre ? l’interrompit le commissaire.
— Je travaille là-bas, dans un atelier de retouches. La patronne m’y loue un petit logement sur cour.
— Peut-être un client ?
— J’y ai pensé, mais alors pourquoi un cachet postal de Pornic ?
Anconi réalisa que la dame en noir habitait Paris. Il prit sa voix la plus douce :
— Vous me dites aller aux obsèques de tous les vieillards de Pornic. Tè, c’est une idée astucieuse, mais comment pensez-vous reconnaître celui qui vous a adressé cette lettre ?
— Je m’arrange pour approcher les familles…
— À combien d’enterrements avez-vous assisté ?
— Demain, ce sera la troisième fois que j’y participe. J’ai pris un congé exceptionnel, mais je crains que les frais occasionnés ne me permettent pas de continuer très longtemps.
Elle essuya furtivement les coins de ses yeux avec sa serviette de table. Un fin tremblement agitait ses doigts maigres.
— Comment procédez-vous, je veux dire, avec les familles. Comment les abordez-vous, comment savoir si le mort est bien celui qui vous a écrit ?
Elle eut un pâle sourire, redressa la tête. Elle avait subitement affiché une détermination espiègle, son triste visage s’en trouva éclairé comme par de la fierté.
— J’ai prétendu, auprès du prêtre de la paroisse Saint-Gilles, appartenir à la communauté religieuse des Filles du Saint-Esprit de Rostrenen, en pèlerinage pour Compostelle. Je me déguise, je me glisse dans un bras du transept, le regard plongé dans un missel, une grosse croix de bois sur la poitrine, un chapelet à la ceinture. Je chante aussi pendant la messe, je connais tous les cantiques, pensez ! Une fois, j’ai participé au choix des textes, avec les proches du défunt.
— Fatche !
— Dans l’ombre de l’église, face au banc de la famille, j’observe, j’écoute, je tente de percer les liens qui unissent les personnes présentes.
Les Anconi échangèrent un regard stupéfait. La dame en noir se mordit subitement les lèvres. Elle émit une note aiguë, très haute et très brève qui tenait du rire ou du sarcasme, et poursuivit :
— J’ai un peu honte de ce stratagème. Que voulez-vous, je n’ai rien trouvé d’autre pour approcher l’intimité des défunts.
C’est Hilda qui assura, en souriant :
— Vous ne faites de mal à personne.
— Le prêtre ne s’étonne pas de votre présence à Pornic ? interrogea le commissaire, dont l’intérêt pour cette femme singulière s’éveillait.
— J’ai pensé qu’il feignait de croire à mon histoire. C’est un homme si bon. Comme il ne dispose pas toujours d’un organiste, je lui ai proposé de le remplacer à l’harmonium, à l’occasion. Il a accepté.
— Vous savez en jouer ? s’étonna Hilda.
— J’ai appris chez les sœurs de Paimbœuf, sur l’instrument de la chapelle Saint-Anne.
Les Anconi et la dame en noir se parlaient d’une table à l’autre tandis que la salle se vidait peu à peu de ses pensionnaires. Les « bonsoir » par-ci, « bonsoir » par-là interrompaient leur conversation, laissant des moments creux, propres à la réflexion. Si elle débarrassait sans arrière-pensée les couverts voisins, la serveuse hésitait sur l’attitude à adopter devant les assiettes vides de ce couple en grande conversation avec une pensionnaire d’habitude si rapide à expédier un frugal dîner.
Le commissaire profita de son éloignement pour poser la question qui lui brûlait les lèvres :
— Et, pour l’instant, vous êtes certaine de n’avoir pas chanté pour votre “correspondant” anonyme ?
Marie Avril sourit faiblement, puis trembla à nouveau, comme si le froid l’envahissait. Elle avait participé à deux cérémonies. Chaque fois, la brutalité du décès ne cadrait pas avec la “santé défaillante” évoquée dans le courrier.
— L’un s’était noyé au cours d’une partie de pêche, détailla-t-elle à voix basse, l’autre était tombé de son toit. Cela ne correspond pas à l’image que je me faisais de…
Elle sortit de son sac son mouchoir en fine dentelle, sans s’en servir. Cette énumération semblait l’avoir épuisée.
— Acceptez-vous de prendre une tisane avec nous ? Cela va vous réchauffer, proposa Hilda.
La femme en noir y consentit, après bien des « je ne voudrais pas vous déranger ».
— Et le prochain ? demanda le commissaire, intrigué par la démarche rigoureuse d’une personne en apparence si fragile et mortifiée.
— Pardon ? sursauta-t-elle.
— Ne devez-vous pas assister à de nouvelles obsèques, bientôt ?
— Mijn beminde, tu es bien curieux ! gourmanda Hilda.
Anconi s’étonna aussi de l’indiscrétion de sa propre question.
Était-ce la détresse de cette femme qui l’affligeait ou l’intérêt du policier qui s’éveillait ? Sans doute les deux.
— Demain, justement ! confessa la fausse religieuse. J’ai l’intuition que celui-là correspond au rédacteur de ce courrier, ajouta-t-elle en glissant l’enveloppe dans son petit sac.
— Pardonnez ma curiosité, Madame. Celui que l’on enterre, comment s’appelle-t-il ?
— Gustav’ Eklöf.
Le nom avait jailli, comme un espoir inaccessible. Elle l’avait jeté, comme on lance une ancre pour stopper la dérive d’un navire désemparé.
— Un Allemand ?
Elle secoua vivement la tête, pinça légèrement ses lèvres pour préciser :
— Non. Un homme d’origine finlandaise. La famille semble aisée. Elle possède une propriété ici, à Gourmalon.
De quelques mots-clefs, elle avait brossé l’univers de son nouveau défunt.
— Et pourquoi ce Gustav’ Eklöf serait-il Philippe Stephan ?
* Mon bien-aimé, en hollandais.
II DISPARITION
Dimanche 3 mai 1987, soirée
L’étrange conversation du dîner avait plongé le commissaire et son épouse dans une grande perplexité. La dame avait pris congé brusquement, laissant sa tisane à demi-consommée. Sous prétexte d’une immense fatigue et de subits maux de tête, elle avait quitté la salle. N’avait-elle pas fui une question trop dérangeante ? L’évocation de ce sujet finlandais que l’on enterrait demain semblait l’avoir précipitée dans une panique irrépressible.
Elle s’était fébrilement excusée de les avoir si inélégamment importunés.
— Mais pas du tout ! l’avait promptement rassurée Hilda. Nous séjournerons ici encore quelques jours. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n’hésitez pas. Souhaitez-vous que nous appelions un médecin ?
Sa réponse « surtout pas ! » et l’effroi qui s’était peint sur ses traits avaient laissé ses voisins de table interdits.
Un peu plus tard, les Anconi, sans se concerter, sortirent de l’hôtel. Le soleil couchant, derrière le château, plongeait le quai Leray dans l’ombre du soir. La marée haute avait remis à flot les bateaux au mouillage dans la ria. Alors qu’ils marchaient en silence, bras dessus bras dessous, le commissaire serra plus fort sa compagne et plaisanta :
— Alors, comme ça, nous allons rester ici encore quelques jours ?
— Tu n’as pas envie d’en savoir plus, toi aussi, mijn beminde ? ironisa Hilda.
— Que penses-tu de cette femme ? N’est-elle pas un peu folle ? Son histoire est invraisemblable !
— Moi, j’y crois. Elle semblait si malheureuse, si sincère.
— Tu n’as pas remarqué sa réaction, lorsque je lui ai demandé des précisions sur ce Gustav’ Le Goff ?
— Eklöf,mijn beminde, Gustav’ Eklöf !
Le policier ne répondit pas immédiatement, un vague sourire aux lèvres.
— On pourrait se renseigner, vérifier, suggéra Hilda d’une voix sucrée.
— Et comment ? s’étonna le commissaire en s’arrêtant subitement. Il secouait sa boîte de cachous, regardant curieusement sa femme.
— Gourmalon, ce n’est pas cette rive, en face, d’après ce qu’elle nous a dit ?
Elle montrait de la main quelques villas qui émergeaient d’une colline boisée. Des lumières apparaissaient dans l’ombre des grands arbres.
— Fatche ! On ne va pas se coltiner du porte-à-porte, tout de même, et demander « Monsieur Strogoff, habite-t-il ici ? »
— Eklöf ! protesta-t-elle. Juste un coup d’œil aux boîtes à lettres…
— Mais la nuit va bientôt tomber, Hilda !
Un clocher tinta la demi-heure, dans la ville haute.
— Allons à l’église, alors ! Parfois, les cérémonies y sont annoncées. Nous aurons peut-être des renseignements sur ce Finlandais.
Ils quittèrent le quai, laissant la façade brillamment éclairée du casino pour s’engager dans une ruelle sombre et silencieuse. Ils traversèrent la rue des Sables et son bar animé, s’enfoncèrent dans une venelle en pente. Après un coude, ils trouvèrent les marches de l’Escalier Fouquet. De hauts murs coiffés d’une végétation odorante cachaient les maisons enchevêtrées. Chacun dans ses pensées, ils gardèrent leur souffle jusqu’à atteindre un passage pavé. Les rares piétons se pressaient, sous la lumière des globes de l’éclairage public. L’église se dressait là, dominant la ville.
Anconi railla :
— Je pourrais demander au directeur de te recruter, à notre retour à Paris ?
— Ne te moque pas, tu as autant envie que moi d’en savoir plus. Je me trompe ?
La remarque du commissaire sur son supérieur ne manquait pas de cocasserie. Les deux hommes ne s’entendaient guère. Arnaud-Fontaine était un politique, d’une prudence rusée, sans cesse à l’écoute obséquieuse de sa hiérarchie, tandis qu’Anconi se contentait d’être un bon policier, amateur de terrain. Les convocations dans le bureau rigide aux odeurs d’encaustique constituaient toujours pour ce dernier une redoutable corvée, pleine de promesses négatives. Les sourcils du personnage, en perpétuel mouvement comme les ailes d’une libellule affolée, affichaient une constante animosité à son égard. Le commissaire attendait impatiemment le « Pas de vagues, Anconi ! Pas de vagues ! » qui marquait la fin de l’entretien, en même temps que les sourcils s’immobilisaient sous les plis courroucés de son crâne chauve.
Ils s’approchèrent du porche de l’édifice auquel on accédait par les quelques marches d’un perron semi-circulaire.
À sa gauche, des avis étaient placardés, protégés derrière le verre d’un cadre de bois. L’éclairage public en autorisait la lecture.
On y apprenait d’abord que la messe dominicale de la paroisse Saint-Jean-le-Baptiste-en-Retz se déroulait à 11 heures et à 18 heures en l’église Saint-Gilles. En semaine, elle avait lieu les jeudis et samedis à 9 heures 30, en saison seulement.
— Regarde, là !
Anconi ne distinguait que la publication des bans d’un mariage dont la célébration interviendrait le 9 mai prochain, unissant mademoiselle Michèle Mussi à monsieur Guillaume Busso. Hilda montra du doigt avec jubilation un autre avis, celui-là encadré de noir :
« Pornic, Paris, Nantes, Porvoo
Une messe funéraire sera dite le lundi 4 mai 1987 à 10 heures
en notre église Saint-Gilles de Pornic
pour le repos de l’âme de
Monsieur Gustav’ EKLÖF
Enlevé à l’affection des siens le jeudi 30 avril 1987, à l’âge de 84 ans
en présence de sa famille :
Son épouse madame Jeanne Eklöf, née De la Lavanderie,
Ses filles, Anne-Sophie Girelle, Élizabeth Cottard et leurs époux
Otsö Eklöf, son frère.
Pas de condoléances. »
Elle laissa son mari prendre connaissance du communiqué.
— Tu vois, elle ne mentait pas ! commenta-t-elle.
Anconi agita la boîte jaune au-dessus de la paume de sa main, engloutit un cachou. Il relut deuxfois le texte.
— Sur un point, non : les funérailles d’un homme âgé auront bien lieu demain. Reste à savoir si ce pauvre Gustav’ Kokov et l’auteur de la lettre sont bien la même personne.
— Eklöf ! Tu le fais exprès, mijn beminde.
— Tous ces gens semblent tellement sortir d’un roman de Dostoïevski ! La malheureuse femme en noir, malade des nerfs, à la recherche d’un père disparu dans les glaces sibériennes…
— Tu exagères ! Ce n’est pas la Russie, mais la Finlande. Porvoo, ce doit être une ville de là-bas ?
— Pour celui de Marseille, pauvre, c’est loin du grilladou* !
Lorsqu’une expression marseillaise sortait de la bouche de son mari, elle devinait qu’un trouble l’agitait. Elle se tut, mi-amusée, mi-chagrine.
Ils s’éloignèrent par la rue de l’Église, puis descendirent celle du Maréchal Foch, guidés par les lumières. Pourquoi s’attardèrent-ils devant la vitrine du libraire ?
— Elle semblait si certaine d’avoir enfin reconnu celui qui lui a écrit, soupira Anconi, penché sur les ouvrages exposés. Elle ne nous a pas tout dit. Pour quelle raison ?
— Par pudeur peut-être, ou par honte ? Mets-toi à sa place, elle a déjà assisté à deux enterrements, elle espère que le troisième sera le bon ! Sa situation n’est pas simple. Imagine le choc, pour elle, d’être confrontée brutalement à ce qui pourrait être sa famille d’origine, des gens riches, elle qui mène une maigre existence. Elle découvre qu’elle pourrait avoir deux sœurs qui, selon toute vraisemblance, ne manquent de rien.
— Ou par peur ?
— Oh !
— Rappelle-toi, Hilda, comme elle s’est esquivée lorsque nous l’avons questionnée sur les liens entre le défunt et l’auteur du courrier. D’ailleurs, pour un Finlandais, il s’exprimait dans un français parfait. Quelque chose a bien dû éveiller ses soupçons ! Mais elle ne voulait pas le révéler à des étrangers, comme si c’était trop effrayant ou peut-être par peur de représailles.
— Qu’avait-elle à craindre d’un policier, selon toi ?
— Tè, je l’ignore.
Anconi détaillait attentivement les livres exposés sous les spots. Il fut attiré par des publications locales, dont une Histoire de Pornic et un Album illustré de la ville, dans des éditions anciennes. Quelques beaux ouvrages sur Renoir intéressèrent davantage Hilda.
— Ils vendent certainement des atlas, dans cette boutique, remarqua-t-il. Je serais curieux de situer cette ville, celle de l’avis de décès, tu te souviens du nom ?
— Un nom à consonance nordique. Nous reviendrons voir, si tu veux.
— Quel âge peut-elle avoir, cette dame en noir, à ton avis ?
— Difficile, le sombre dont elle se vêt ne la rajeunit pas. Elle fait “vieux jeu”, comme vous dites, les Français. Et puis ses tremblements incessants ! Je lui donnerais la soixantaine.
— De sorte que l’homme que l’on enterre demain pourrait mathématiquement être son père, compléta Anconi.
— Tu vois ! Nous devrions l’aider, mijn beminde.
Le commissaire ne répondit pas. Certes, un mystère entourait cette étrange femme. Devait-il pour autant s’immiscer dans une affaire qu’aucun crime n’entachait ? Quel secours pouvait-il apporter ? Ne lui reprocherait-on pas une curiosité malsaine, lui qui n’agissait même pas dans sa juridiction ?
Lorsqu’ils reprirent leur marche, Hilda eut conscience du dilemme qui agitait son mari. Elle n’osa pas insister, pressa plus fort son bras. Devait-elle troubler leurs si rares vacances communes ?
En bas de la rue Foch, ils retrouvèrent le quai. Les brasseries rangeaient leurs dernières tables. La nuit avait ramené le calme au Café du Port où seuls quelques consommateurs du dimanche soir empêchaient la fermeture. Le bassin scintillait sous les réverbères. Les coques sombres restaient immobiles.
Une automobile passa devant le couple qui rentrait nonchalamment.
Ils gagnèrent leur chambre. Hilda poussa un petit cri de surprise. Une feuille de papier pliée avait été glissée sous leur porte :
« Aidez-moi, par pitié ! J’ai peur !
Marie A »
Une écriture fébrile, jetée à la hâte au travers d’une page de bloc, à l’en-tête de l’hôtel.
— Fatche ! Voilà qui change tout ! Suis-moi, Hilda !
Ils dégringolèrent les escaliers, cherchèrent le veilleur de nuit. Il n’y en avait pas. Le rez-de-chaussée de l’établissement était occupé par la brasserie “Le Gilles de Retz”, où quelques clients finissaient de dîner.
La radio diffusait une émission musicale, en ce dimanche soir tranquille. La patronne les vit, accourut, blonde et souriante :
— Oh ! Bonsoir Madame, bonsoir Commissaire, fit-elle d’un air étonné, un problème ?
— Bonsoir Madame, je vous saurais gré de m’indiquer dans quelle chambre loge mademoiselle Marie Avril, s’il vous plaît ? demanda Anconi avec autorité.
Elle fronça les sourcils, intriguée par cette question insolite. Anconi lui montra l’appel au secours de la locataire.
— Oh là là ! Dans ce cas, montez ! C’est au “313” ! Montez ! accepta-t-elle avec empressement. Que s’est-il passé ?
Tous les trois grimpèrent l’escalier. La patronne fermait la marche, la mine décomposée, le pas précipité. Elle balbutiait des « Vite ! Vite ! »
— Oh là là ! Mon Dieu, crut-elle bon de préciser en désignant la porte du 313.
Anconi frappa trois coups secs, colla son oreille au chambranle. Aucun son ne filtrait de la pièce. Il fit tourner la poignée, en vain, toqua à nouveau. Aucune réponse.
— Le double de clef ! commanda-t-il. Vite ! Vous avez bien un double !
— Oh bien sûr ! Excusez-moi ! Je vais vous le chercher tout de suite.
Elle s’effaça en reculant, faillit tomber à la renverse dans l’escalier, dévala précipitamment les marches.
— Tu vois, j’avais raison, murmura Hilda.
— Comment cela ?
— C’est la peur qui la tenaillait ! Pauvre femme.
Anconi frappa à nouveau, appela à plusieurs reprises, essayant de retenir sa voix : « Madame Avril ! Madame Avril ! Ouvrez, c’est le commissaire ! »
Des portes s’entrebâillèrent, sur le palier. « Que se passe-t-il ? » maugréa un homme qui apparut en robe de chambre sur un pyjama rayé, pieds nus et la tignasse ébouriffée, le regard mauvais. « Ce n’est pas bientôt fini, ce vacarme ? » entendit-on à l’intérieur d’une pièce voisine. Un chien se mit à aboyer, que son maître essaya vainement d’apaiser. Très rapidement, une ambiance chaotique s’installa à l’étage.
— Rentrez chez vous, ne vous inquiétez pas, je suis de la police, tenta Anconi, pour calmer les esprits.
— La police ? Mon Dieu ! hurla une voix de femme. Son cri fut suivi d’un bruit de verre brisé, aussitôt accompagné d’un retentissant juron.
La patronne réapparut, effarée par l’ambiance “champ de foire”. Essoufflée, elle tendit une clef au commissaire. Celui-ci l’engagea dans la serrure, pénétra enfin au “313”.
Une lampe de chevet jetait une lumière rose sur un lit non défait. Une chaise était renversée, le placard se trouvait largement ouvert. Anconi alluma le plafonnier. Personne. Il explora le coin toilettes. Rien non plus. Fenêtre fermée. Marie Avril avait disparu.
La pièce ne donnait pas l’impression d’avoir été fouillée. Les vêtements restaient bien rangés sur les étagères, le tiroir de la table de chevet n’était pas ouvert. Sur les cintres bien alignés de la penderie, une robe noire et un imperméable marron demeuraient sagement accrochés. Pas de traces de violence non plus, hormis la chaise à terre. Anconi pensa plutôt à un départ précipité.
Il ne voulut pas effrayer davantage la gérante ni les autres pensionnaires. Pour restaurer le calme, il émit à haute voix, afin d’être bien entendu des chambres voisines :
— Tout est bien tranquille, ici, nous avons dû nous tromper !
— Mais, commença la patronne. Et le…
Le policier l’interrompit, la prit posément par le bras, commanda :
— Retournons dans votre bureau.
S’adressant aux occupants de l’étage et aux portes entrebâillées, il présenta toutes ses excuses pour le bruit et le dérangement. L’homme au pyjama ne put s’empêcher de tordre le cou pour scruter l’intérieur de la chambre 313. À regret, il regagna la sienne. Plusieurs invectives fusèrent, pas toutes à voix basse. Le calme revint dans l’hôtel.
Hilda restée en retrait, se rapprocha de son mari, murmura à son adresse :
— Le déguisement ?
— Quel déguisement ?
— Il n’y a pas de robe de bonne sœur, dans la penderie, poursuivit-elle sotto voce*.
Le commissaire pénétra à nouveau dans la pièce, fouilla soigneusement l’armoire.
— Pardi ! Tu as raison ! C’est qu’elle est partie avec ! assura-t-il. Il resta plusieurs minutes sur le seuil. Il se frottait la tempe, fronçait les sourcils. Une moiteur l’envahit. Il éteignit les lumières, boucla la chambre, mit la clef dans la poche de son vieux blouson de cuir. Bravo, Hilda ! Sans toi, je passais à côté !
Tous trois redescendirent, leur hôtesse fermant la marche.
— Peut-être serait-il prudent de prévenir les gendarmes, conseilla-t-elle dès qu’ils furent dans le petit bureau situé derrière l’accueil. Elle rougit aussitôt, réalisant qu’elle avait un commissaire parisien devant elle.
— Rien ne presse ! Que va-t-on leur signaler ? Que la locataire du 313 a découché ?
Il faillit ajouter « en emportant sa robe de religieuse », se retint juste à temps.
— J’oubliais que vous êtes policier vous-même…
— Dites-moi, Madame, à quelle heure avez-vous quitté l’accueil, ce soir ?
— Vers 19 heures, c’était calme, vous comprenez. Je dois m’occuper du service à la brasserie, à ce moment-là.
— Mais oui ! Personne ne vous reproche rien. Y a-t-il eu des arrivées, entre 19 et 21 heures ?
Elle retourna vers lui son grand cahier noir. La pâleur avait envahi ses joues.
— Un couple s’est présenté vers 20 heures. Ils avaient réservé. Voyez, c’est écrit là : « Monsieur et madame Danglade, de Paris. Chambre 201. »
— Quel âge ?
— La soixantaine environ.
— Vous n’avez rien remarqué de particulier dans leur comportement ?
— Non, des gens très bien, m’a-t-il semblé. La dame portait une tenue très élégante, de hauts talons, lunettes noires et chapeau fantaisie. Elle avait beaucoup d’allure. Monsieur était plus sport, voyez ?
— Hum ! Sont-ils arrivés en voiture ?
— Oui. Même qu’ils m’ont demandé où la parquer. Le stationnement n’est pas simple, à Pornic, je leur ai conseillé de…
— Ont-ils dîné dans l’établissement ?
— Ah ! Maintenant que vous me le dites, ils m’ont précisé qu’ils « souperaient dehors ».
— Savez-vous s’ils sont rentrés ?
— Je l’ignore.
Elle pivota vers le tableau des clefs.
— Attendez ! Pas encore, le “201” est au clou. Voyez !
— Y a-t-il eu d’autres clients à se présenter ?
— Non. Le dimanche soir, c’est calme, vous savez, précisa-t-elle. Le dernier train entre en gare à 21 heures 10.
— Vous n’avez eu aucun appel, avant le mien ?
— Si ! Un seul. Le 203 souhaitait être réveillé à 6 heures. Un habitué, un visiteur de commerce d’une maison de négoce en vins de Bourgogne. Il doit livrer une grande brasserie nantaise demain matin. Venez prendre quelque chose en bas, leur proposa-t-elle.
Au rez-de-chaussée, une salle accueillait à la fois des dîneurs et de simples consommateurs, dans une ambiance encore animée, malgré l’heure.
Hilda choisit une infusion, Anconi un Cognac. Ils s’accoudèrent au bar, trop ébranlés pour s’installer derrière une table.
Soudain, un silence écrasant stoppa les conversations. Les bruits de couverts restèrent comme suspendus. À la radio, une voix pleine d’émotion coupa Jean Fontaine et sa Musique est à vous :
« — … chers auditeurs, nous interrompons notre émission pour vous communiquer une tragique nouvelle. Dalida est décédée, nous l’apprenons à l’instant. La chanteuse aurait été retrouvée, en fin d’après-midi, inanimée au premier étage de son hôtel particulier de Montmartre. On ignore encore… »
— Oh non ! entendit-on ici et là, ce n’est pas possible !
Aucune précision ne vint compléter cette annonce, l’information tourna rapidement en rond autour de la rue d’Orchampt, vers laquelle devaient converger les reporters.
Le commissaire attendit les premiers accords de Mourir sur scène pour tenter de capter l’attention de la patronne.
— Vous aimiez bien Dalida ? demanda-t-il.
— Pensez, j’ai tous ses disques, à la maison.
— Mieux vaut vous laisser Madame, pardonnez-moi, puis-je vous poser encore une question ?
Pour reprendre contenance et réintégrer son rôle, elle réajusta sa tunique, puis lissa sa jupe machinalement. Son émotion restait visible.
— De la salle, pouvez-vous entendre les va-et-vient du vestibule d’entrée ?
— Oui… oui, enfin, pas toujours, le bruit des conversations… Avec la moquette, les pas sont étouffés ici. Nous sommes un établissement très calme.
— Vous n’avez rien remarqué ou perçu ? Mademoiselle Avril a manifestement quitté l’hôtel. Or, nous avons échangé quelques mots avec elle pendant le dîner et nous l’avons saluée vers 21 heures, n’est-ce pas Hilda ?