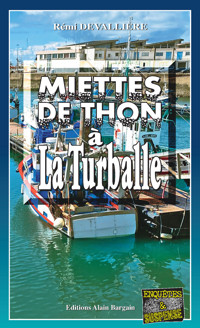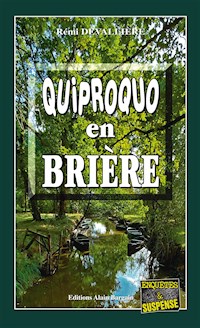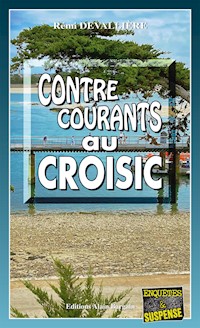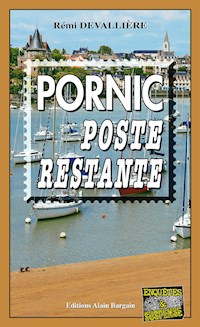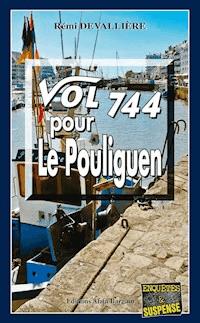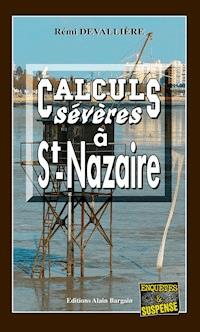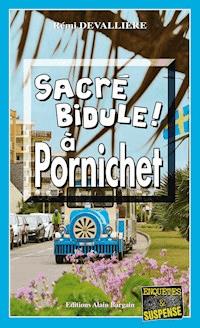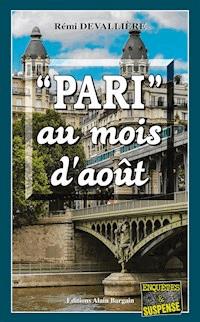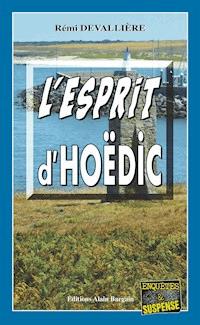Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Une enquête du Commissaire Anconi
- Sprache: Französisch
Un homme assassiné par strangulation dans un train... déclaré mort plus de quarante ans plus tôt.
Novembre 1989 : le train grand confort Jules Verne, parti de Nantes à 6 h 17, entre en gare Montparnasse à 9 h 12. Quelle n’est pas la stupeur du contrôleur lorsqu’il découvre un homme mort étranglé, dans les toilettes verrouillées de l’intérieur de la voiture 13. Selon sa carte d’identité, la victime habite à Nantes, 3 rue de l’Abreuvoir, une adresse disparue. Pire ! L’état civil déclare l’homme mort en 1943. L’autopsie écarte le suicide et retrouve des émeraudes dans son estomac !
De la chute du mur de Berlin aux bombardements de Nantes, du passage Pommeraye au pont du Généralde-la-Motte-Rouge, Anconi poursuit l’assassin de ce passager inconnu. Pas facile !
Plongez dans les limbes du passé avec ce polar historique rempli de mystères !
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
"Un bon polar et quand on connaît les rues de Nantes, c est hyper sympa." - Grazie1006, Babelio
"Après avoir apprécié "Sacré Bidule" j'ai voulu lire une autre roman du même auteur. Dans "Le Passager du Jules Verne" on se trouve plongé dans l'intrigue dès les premières pages. Une intrigue bien menée, un livre qu'on dévore." - Grigi44, Babelio
" J.ai beaucoup apprécié cette enquête d'Anconi qui nous replonge dans l'histoire de Nantes lors de la seconde guerre mondiale. Comme toutes les enquêtes du commissaire Anconina, on appréciera d'autant que l'on connaît les lieux, c'est un bon divertissement." - hermen, Babelio
À PROPOS DE L'AUTEUR
Médecin hospitalier, Rémi Devallière a soigné les maux les plus graves ; désormais en retraite à Pornichet, il écrit, avec passion, se plaisant à choisir les mots les plus appropriés pour ses histoires. Nouer des intrigues n’est-il pas le pendant d’une démarche médicale bien conduite ? Si les instruments de l’exercice en sont différents, le plaisir de parvenir à un résultat satisfaisant est bien le même. Et obtenir les aveux du coupable ne relève-t-il pas du même défi que poser un bon diagnostic ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
« Nantes : peut-être avec Paris la seule ville où j’ai l’impression qu’il peut m’arriver quelque chose qui en vaut la peine… »
Nadja – André Breton – 1928
« Jusqu’alors, Nantes n’avait pas été bombardé. Nous ne descendions même pas aux caves lors des alertes. Les avions survolaient la ville et allaient pilonner Saint-Nazaire. Mais un après-midi où tout le monde levait le nez en l’air pour regarder les escadrilles, des petits cônes argentés se détachèrent des avions et ce fut le sauve-qui-peut. »
Une place au soleil – Michel Ragon – 1955
PROLOGUE
Nantes, jeudi 16 septembre 1943
Cette journée ensoleillée du 16 septembre 1943 prolonge un été qui ne veut pas finir : aucun nuage dans le ciel, pas un souffle de vent, une température digne d’un mois d’août. Aussi, dans le centre-ville, les Nantais qui ont encore quelques moyens terminent tranquillement leurs achats de rentrée. Les trottoirs s’animent en ce début d’après-midi. Chez Decré, nombreux sont les mamans et leurs enfants à parcourir les étalages du plus célèbre magasin de la ville toujours bien achalandé, malgré les difficultés d’approvisionnement. Tous n’ont cependant pas cette chance, en cette période de privations.
Comme chaque jeudi, Oscar a donné rendez-vous à sa fiancée Jane, à “L’Imprévu”. Ils se contactent par un petit billet glissé soit dans un interstice du bâtiment du marché rue Cacault, soit dans une cachette du passage Pommeraye. Ils veillent à ne pas se faire remarquer par une patrouille allemande. Depuis l’assassinat en 1941 de Karl Hotz, le Feldkommandant de Nantes, l’occupant est sur les dents. Six mois plus tôt, son père, ouvrier communiste, a été arrêté et déporté en Allemagne. Son frère Lucien, de quatre ans son aîné, n’a pas pu échapper au Service du travail obligatoire, malgré la complicité d’un vieux contremaître qui l’a fait porter pâle à plusieurs convocations aux bureaux d’embauche de la rue Lekain. Bien qu’il n’ait donné aucune nouvelle depuis son départ, un camarade évadé affirme qu’il est à Essen, dans les usines d’armement Krupp.
À 17 ans, Oscar devient, de fait, le chef de famille. Il trouve du travail aux “Forges de l’Indre” grâce à un ami et se charge, avant sa journée, des interminables queues devant les rares magasins d’alimentation.
La mère fait des ménages. Dès 5 heures du matin, elle nettoie les bureaux du quotidien Le Phare de la Loire, place du Commerce, avant de traverser la ville vers les riches particuliers du quartier Monselet. L’après-midi, elle pousse jusqu’à Vertou, chez un prospère marchand de vin qui n’est pas scrupuleux sur les opinions de sa clientèle.
C’est à L’Imprévu, un café de la rue de Feltre, juste à l’aplomb du pont franchissant la chaussée de l’Arche-Sèche, qu’Oscar rencontre Jane en cachette. Assis l’un en face de l’autre, devant une maigre chicorée, ils se contemplent alors de longues minutes dans les yeux, croisent leurs doigts, se parlent un moment à voix basse, puis gardent le silence. Parfois, ils échangent furtivement une enveloppe dont chacun pense qu’elle renferme des mots d’amour tant leurs prunelles sont fiévreuses. Le patron, un rougeaud moustachu en blouse grise, les installe en souriant, toujours à la même table, à l’abri d’éventuels regards. Les fiancés s’y sentent bien. Ils disposent de si peu de temps !
Ils se sont connus l’été précédent. Un dimanche, ils s’étaient croisés sur la route de Montaigu, dans la commune du Bignon. Jane, sur le bord du chemin, réparait son pneu de vélo crevé. Comme lui, elle se rendait au ravitaillement. Les maigres tickets de rationnement, les longues attentes devant les boutiques, conduisaient les citadins de plus en plus loin, dans la campagne, à la recherche souvent difficile et parfois vaine, de denrées élémentaires. Oscar l’avait aidée à réparer la chambre à air. Elle l’avait remercié d’un sourire timide.
— D’où viens-tu ?
Ils s’étaient liés. Sous une apparence de frêle jeune fille brune, Jane recèle une énergie farouche. De semaine en semaine, ils réalisent qu’ils partagent les mêmes secrets.
Ce jeudi 16 septembre, Oscar l’attend, dans l’ombre du café. Il fume. Soudain, à 15 h 35, les sirènes retentissent. Nouvelle alerte ! Nantes a déjà subi plusieurs bombardements anglo-américains. Oscar se souvient de celui du mois de mars, à la même heure, qui avait détruit l’usine des Batignolles en causant de multiples victimes. Du centre-ville on distinguait la colonne de fumée. Mais il y en a eu tant, de fausses alertes, que nombreux sont les Nantais qui ne se rendent plus aux abris. Seuls les réfugiés de Saint-Nazaire, dont la ville n’est plus qu’un champ de ruine, prennent ces avertissements au sérieux et plongent dans les caves les plus proches. Beaucoup de passants poursuivent donc leur chemin, blasés. Si certains accélèrent la marche, rares sont ceux qui lèvent la tête tous les quatre pas, pour scruter anxieusement le ciel pur. D’ailleurs, parfois les avions se contentent de larguer des tracts ou de fines bandelettes métalliques destinées à brouiller les systèmes d’écoute allemands.
« Que fait Jane ? Elle devrait déjà m’avoir rejoint. » Un camion bâché grimpe la rue de Feltre en crachotant. Oscar craint surtout les arrestations. Il sort sur le trottoir. Le hurlement des sirènes devient perçant. On entend maintenant au loin des éclatements sourds, sans doute ceux de la DCA allemande. Sur les quais de Loire, l’occupant a probablement dispersé ses fumigènes destinés à couvrir la ville de brume, dissimulant ainsi les installations stratégiques au sol.
— Tu devrais vite rentrer chez toi, mon grand ! recommande le patron du café. On ne sait jamais. Je vais devoir fermer. Ça a l’air sérieux, cette fois !
— Encore une fausse alerte, plaide le jeune homme. Et puis, ils ne s’en prennent qu’aux installations portuaires.
— Sans doute, mais tu connais les consignes de la Défense passive. Et puis, ta mère va s’inquiéter !
— Nous avions rendez-vous avec Jane, elle va bientôt arriver. Je ne peux pas…
— Dame, si elle vient ici, je lui dirai que je t’ai obligé à partir, à cause de l’alerte. Juré ! Ne t’inquiète pas. Allez ! Rentre vite chez toi.
Les Chennut occupent, par manque de moyens, un vieil appartement sombre, rue de l’Abreuvoir. Sa mère ne doit pas s’y trouver, elle devait récupérer quelques vêtements usagés au Secours national. Au lieu de rentrer chez lui, il se dirige vers la rue Contrescarpe, dont les odeurs de café grillé ont disparu depuis les restrictions. C’est là qu’habite Jane. Il faut qu’il s’y rende, c’est important. Il attrape sa musette, salue le tenancier.
— Vous n’oublierez pas, n’est-ce pas ?
Le moustachu lui donne une tape amicale sur la nuque, promet. Les rares consommateurs ont déjà quitté L’Imprévu pour l’abri le plus proche.
Le jeune homme hésite encore. « Dois-je remettre un billet entre les deux moellons du marché de Feltre, pour prévenir Jane du contretemps ? Ou alors au “Café des Muses”, rue Racine, j’y croiserai peut-être un camarade… trop risqué. » Il choisit une autre option.
Il est 16 heures lorsqu’il remonte la rue du Calvaire, en serrant fortement sa musette sous le bras. Les détonations se font entendre au loin. Elles lui paraissent encore éloignées du centre-ville, mais se multiplient, se rapprochent. Il presse le pas, lève les yeux vers le ciel. Il aperçoit tout là-haut des points scintillant dans le soleil. Leur sourd bourdonnement s’amplifie. « Des bombardiers ! » La panique s’empare des passants qui s’engouffrent dans les caves ou l’îlot de la défense passive le plus proche.
16 h 08 : la rue du Calvaire est soudain balayée par un déluge. Les bombes tombent tout autour de lui. Le vacarme des explosions est suivi par le bruit insoutenable des immeubles qui s’effondrent. La fumée envahit tout. Oscar aperçoit un soldat allemand se mettre à l’abri dans un couloir. Il disparaît dans la poussière. Des cris retentissent de toutes parts. Un homme couvert de plâtras le dépasse et s’enfuit, hagard. Il court, cherche un abri.
À 16 h 20, le vacarme des explosions s’interrompt brutalement. Les bruits d’éboulement des immeubles s’espacent progressivement, laissant toute la place aux cris de détresse. Des flammes s’échappent des décombres, le feu crépite. L’eau jaillit des conduites crevées. Des odeurs de gaz, de poudre, d’incendie envahissent le décor apocalyptique. Les gravats encombrent la chaussée.
Oscar ne rentrera pas, ce soir-là. Le haut de l’escalier de la rue de l’Abreuvoir est obstrué par l’écroulement de plusieurs bâtiments. A-t-il été enseveli, à deux pas de son immeuble intact ?
Sa mère le cherche des jours durant. Elle participe au déblaiement de leur quartier, ne l’y trouve pas. Elle court vers l’hôpital Saint-Jacques où les innombrables blessés sont progressivement rassemblés, car l’hôtel-Dieu a été détruit par les bombes.
— Vous l’avez pas vu, mon garçon ? Il a 17 ans, une chemise bleue à manches courtes, un pantalon de velours marron, une casquette.
Il n’y est pas, pas plus qu’il ne se trouve dans les cliniques de la ville. Elle consulte les listes de blessés, entre au musée des Beaux-Arts où sont rassemblés les cadavres, à même le sol. Elle laisse des avis comme bien d’autres familles hébétées. Rien.
Sa recherche sera vaine : parmi les 685 morts liés à ce bombardement le nom d’Oscar ne figurera pas.
PREMIÈRE PARTIENovembre 1989
I
Gare Montparnasse, lundi 13 novembre 1989
« Le TEE 30* en provenance de Nantes, entre en gare voie numéro 6 ! Éloignez-vous de la bordure du quai… »
Marcel Pontoiseau, l’agent de service, rajusta son uniforme, vérifia d’un geste machinal le bon équilibre de sa casquette bleue. Il n’avait pas attendu l’annonce du haut-parleur pour prendre position à l’extrémité du quai numéro 6. Il s’avançait à pas lents le long de la voie. Déjà il voyait venir à lui la silhouette massive de la motrice BB 22200. « Elle a bien fière allure avec ses bandes bleues en forme d’éclairs sur ses flancs », se dit-il. Il leva les yeux vers l’horloge, surprit le mouvement de la grande aiguille : 9 h 05.
« Pas une seconde de retard ! » Le convoi parcourut lentement la dernière centaine de mètres, presque silencieux, malgré la puissance émanant de la motrice. Marcel fit un signe amical au conducteur. Il sentit le souffle chaud de la locomotive l’effleurer, cette tiédeur féline renforça son admiration.
« Voie numéro 6 ! Le TEE 30 en provenance de Nantes et Angers entre en… »
La voix sourde et noyée résonnait dans la gare. La suite du message disparut derrière les soupirs du convoi. Un faible crissement de freins marqua le dernier mètre. Partis de Nantes à 6 h 17, les sept wagons s’immobilisaient gare Montparnasse.
Au lendemain du week-end, nombreux furent les passagers en costume qui envahirent le quai. Beaucoup d’hommes seuls, attaché-case en main, pardessus noir sous le bras et uniformément vêtus, se pressaient vers une probable réunion au siège social. Certains allumaient nerveusement une cigarette. Quelques femmes en tailleur strict, chignon apprêté et maquillage subtil, se détachaient de cet univers masculin. Empêtré d’une énorme valise, un couple âgé dégringola difficilement le marchepied.
Marcel se précipita : « Laissez-moi vous aider. » Il était bien habitué à la clientèle choisie de ce train “Grand Confort”. C’était son préféré, ce bijou qui filait à 200 km/h, sans bringuebaler le moins du monde ses passagers privilégiés. Une atmosphère cossue et douce, des fauteuils confortables, des lumières tamisées. Et jamais le moindre retard, d’ailleurs la SNCF assurait au “Jules Verne”* la priorité des voies. Notre employé enviait les collègues effectuant leur service à son bord.
Attentif, droit dans son uniforme, il longeait à pas mesurés la voiture 14, le wagon-bar. Le quai se vidait progressivement. Le ruban clairsemé des derniers passagers s’étiolait dans les échos embrouillés de la gare mêlant coups de sifflet, crissements de freins, annonces confuses de haut-parleurs, brouhaha de voyageurs.
Le contrôleur du convoi apparut à la porte de la voiture de queue.
— Plutôt frisquet, à Paris ! commenta-t-il joyeusement, manière de saluer le collègue.
— Quelle chance tu as, Rolland ! s’extasia Marcel en inspectant le local réservé au personnel de service.
L’autre, blasé, haussa les épaules. Il avait “fait” tous les TEE, alors un petit trajet de moins de trois heures ne le faisait plus vibrer. Il lui désigna le journal Le Parisien qui titrait « Ruée vers l’Ouest ». Sur la photo occupant toute la première page, on distinguait une foule hétéroclite, mi-souriante mi-dubitative, s’engouffrer dans une large faille du mur de Berlin. Quelques soldats semblaient désemparés sur la place noire de monde.
— Es-tu au courant ? T’en rends-tu compte ? La fin du mur de Berlin ! s’enthousiasmait Rolland Garrec.
— Je n’y crois pas ! Souviens-toi du Printemps de Prague ! À peine le régime communiste tchécoslovaque s’était-il assoupli que les “frères” soviétiques rappliquaient. Demain, leurs chars entreront en RDA !
— Ne sois pas si pessimiste ! Regarde ! argumenta le contrôleur. Il lui montrait la manchette de L’Humanité, posé sur la tablette : « Le nouveau souffle du socialisme. »
— Hum ! Tu verras ! Moi, je n’y crois pas, répéta-t-il.
— Allez ! Camarade, viens avec moi, le coupa Rolland en empoignant sa grosse serviette de cuir. Allons faire notre vérification habituelle.
Tous deux remontèrent le convoi, empruntant le couloir central. Voiture 14, le barman claquait ses portes de frigo, épluchait ses stocks. Il salua à peine les collègues, c’était un nouveau. Ce soir, il assurerait le retour vers Nantes et servirait les repas “à la place”. Beaucoup prendraient l’apéritif, fatigués, mais détendus, confortablement installés dans leurs sièges de luxe.
Voiture 13, le voyant lumineux d’occupation des W.-C. était allumé.
— Tiens ! Pas normal, soupira Garrec. Regarde, il y a quelqu’un qui veut prolonger le voyage, se moqua-t-il.
Toc ! Toc ! Il tapa à la porte des toilettes.
— Madame ? Monsieur ?
En l’absence de réponse, il cogna plus fort.
— S’il vous plaît ?
Il appliqua l’oreille sur le battant, ne perçut aucun son. Il frappa à nouveau, impatient.
— Terminus ! Le train est en gare ! cria-t-il instinctivement. Vous êtes arrivé !
Les deux agents se regardèrent, déconcertés.
— Quelqu’un de malade ? suggéra Marcel.
Rolland tambourina à la porte, la fit trembler.
— Ouvrez ! s’entêta-t-il, puis, un ton plus bas demanda : tout va bien ?
Il se souvint d’un type, quelques années plus tôt, que l’on avait retrouvé comateux dans les toilettes d’un wagon. Son évacuation avait nécessité un arrêt intempestif dans la première gare rencontrée.
— Répondez, s’il vous plaît ! C’est le contrôleur.
Il frappa à nouveau, sortit sa clef de Berne, s’en servit d’abord pour toquer.
— Désolé, je vais être contraint d’ouvrir !
Il introduisit le carré, hésita encore, gêné. Encouragé par un mouvement de menton de son collègue, il fit jouer le loquet. Il poussa la porte, mais celle-ci s’entrebâilla faiblement et se coinça. Une résistance élastique.
— Fichtre ! C’est bloqué !
— Regarde, Marcel ! Quelqu’un est enfermé là-dedans.
Au niveau du sol, dans le mince interstice, on devinait un morceau d’étoffe sombre. Rolland s’accroupit, en perdit sa casquette, engagea à grand-peine deux doigts, pinça le tissu, tenta de le tirailler.
— Eh ? Oh ? Ça va ? Ouvrez, que diable !
Maintenant, Rolland poussait avec son index une masse ferme, mais inerte. Marcel, de son côté, essayait de forcer l’accès, gagna quelques centimètres. Il passa la main, parvint à saisir, dans le tissu, une forme ronde – une jambe ? –, la secoua. Aucune réaction.
— Tu vois quelque chose, par en haut ?
— Rien ! Je ne peux pas engager la tête. Impossible d’ouvrir davantage…
De l’épaule, il appuya un peu plus fermement, sans succès.
— Réclame du secours, Camarade, le type m’a tout l’air d’être dans le cirage. C’est bien ma veine.
Marcel fit crachoter son talkie, demanda à parler à son supérieur, expliqua la situation à mots couverts.
— Besoin d’un médecin ? proposa la voix.
— Oui ! Et d’un ouvre-boîte ! tenta-t-il de plaisanter. Impossible d’entrer dans le…
Pendant ce temps, le contrôleur ahanait. Il avait réussi à décaler, centimètre par centimètre, ce qui s’avéra être bien une jambe, dans un pantalon de tweed. L’apparition d’une chaussure à lacets en daim couronna ses efforts. Dans un dernier « Han ! » il repoussa la semelle au-delà du battant.
— Aide-moi, maintenant ! Plus fort ! Plus fort, bon sang, Marcel !
Peu à peu, ils agrandirent l’ouverture, suffisamment pour y passer la tête.
Un homme inanimé était effondré dans la cabine, replié, coincé entre la cuvette et la paroi. Son visage était violet, ses yeux grands ouverts fixaient le plafond. Le cou présentait une curieuse inclinaison. Sa cravate verte paraissait incongrue sur la chemise jaune et le costume sombre à la coupe démodée. Le corps était encore chaud.
— Oh ! Gare ! Voilà un client qui ne fera pas le voyage retour !
* * *
En ce lundi matin, le commissaire Anconi tournait en rond dans sa péniche. Ce rendez-vous avec le docteur Guénel, son médecin de famille, le tarabustait. Il ne voyait nullement la nécessité d’une consultation, se considérant en excellente santé. Du reste, il pensait qu’une trop grande fréquentation des toubibs conduisait inexorablement à la maladie. Il laissait volontiers au docteur Knock son « tout bien portant est un malade qui s’ignore ».
Hilda, son épouse, avait insisté pour cette visite, tant et si bien qu’il avait fini par accepter. Elle l’avait quitté vers 8 heures, pour gagner l’Institut néerlandais où elle donnait des cours et assurait des traductions. Anconi avait cru déceler dans son regard une lueur d’ironie lorsqu’elle l’avait embrassé, avant de disparaître dans les feuillages du rivage du boulevard Kœnig. « C’est une simple précaution, mijn beminde* », avait-elle soutenu.
Il consulta sa montre, écouta distraitement les nouvelles que diffusait son vieux poste de radio à lampes, un Schneider qui crachotait sur les grandes ondes, au grand dam d’Hilda.
« Fatche ! T’en rends-tu compte ? C’est un des premiers appareils de ce type à recevoir la FM, et en stéréo ! » plaidait-il régulièrement, sans vraiment convaincre son épouse.
Le speaker commentait les évènements du week-end en République démocratique allemande : « Des milliers de Berlinois de l’Est ont pu franchir librement le poste-frontière de Bornholmer Straße. Chaleureusement accueillis, ils ont reçu chacun cent marks et, émerveillés, ont fait du lèche-vitrines ou visité gratuitement les musées. Des bulldozers ont dû pratiquer des brèches pour réduire l’attente et les queues interminables. »
Malgré l’importance de l’évènement, le commissaire restait pensif, accoudé au bastingage entourant la terrasse de leur bateau, le “Zeeland”. Il se remémora le convoyage, depuis la Hollande, de cette péniche dont ils avaient hérité de son beau-père. Puis l’ancrage au pied du pont de Neuilly, l’aménagement du bâtiment, le plaisir qu’ils y avaient trouvé, leur enthousiasme à le voir se transformer en un petit appartement douillet sur la Seine.
« Bonne Mère, secoue-toi, Anconi, ce n’est qu’une visite de routine, pas un enterrement ! » Poisseuse, une nostalgie l’inondait insidieusement. Il coupa sèchement sa radio, se prépara à quitter le bord, enfila son vieux cuir. « Marcher jusqu’au Bois me détendra, j’ai même le temps de faire le tour de la mare Saint-James, avant de revenir rue de Longchamp… »
« Dring ! Dring ! »
Il hésita à décrocher. Ce ne pouvait pas être le Quai des Orfèvres, puisqu’il avait prévenu Lefebvre de son absence, pour toute la matinée. Ni Hilda, elle devait encore se trouver dans le métro. Son fils Jean, des Charentes ? Il n’appelait jamais à cette heure-là ! Il devait déjà être en mer, à inspecter ses cultures ou charrier ses poches d’huîtres. « Pourquoi a-t-il abandonné ses études de droit pour s’installer à Port-des-Barques et élever des coquillages ? »
La sonnerie s’interrompit. Il franchissait la passerelle qui menait à terre lorsqu’elle reprit, rageuse. Il revint vivement sur ses pas, ouvrit la porte d’accès à la timonerie, décrocha.
— Allô ? fit-il, circonspect.
— C’est vous, Patron ?
Le ton de Bolz lui parut altéré. Un sensible, cet inspecteur Bolz, toujours inquiet en l’absence de son supérieur. Anconi crut entendre un brouhaha sonore dans l’écouteur, des propos confus dans un portatif, des grésillements interrompus par des clics aigus.
— Mais oui. Que se passe-t-il ?
Le commissaire perçut le crissement d’un briquet suivi d’un souffle. La voix reprit :
— Une sale affaire.
— Raconte.
— Vous êtes à Paris, Patron ?
— Une sale affaire, dis-tu ?
Anconi réalisa, non sans un certain plaisir, qu’une chance s’offrait peut-être à lui d’échapper au docteur. Apaisant, il encouragea son inspecteur :
— De quoi s’agit-il, Petit ?
— Un type, dans le train. Raide. C’est Lefebvre qui est sur place. Il souhaiterait que vous le rejoigniez. Dès que possible, enfin, si…
Le commissaire comprit que Bolz transmettait une demande du collègue. Pour se donner bonne conscience, il expliqua son rendez-vous imminent, demanda en quoi sa présence était si indispensable.
— Le gars était dans les toilettes d’un wagon. Verrouillées de l’intérieur ! Le contrôleur l’a découvert en accomplissant son tour, après l’arrivée du convoi.
— Tè, êtes-vous certains qu’il s’agit d’un crime ? Il aura fermé derrière lui, un malaise dans ce type d’endroit, c’est classique. Un effort, le cœur lâche…
— Non ! Non ! Lefebvre est formel, c’est un meurtre. Strangulation !
— Fatche ! Tu dis qu’il s’était enfermé… il ne se serait pas pendu ?
— Négatif, étranglé ! Qu’est-ce que je lui réponds ? Pouvez-vous le rejoindre ?
Bolz anticipa la décision du commissaire en ajoutant : gare Montparnasse, voie numéro 6, voiture 13.
— Le légiste est-il sur place ?
— Coup de chance, oui. Le quai de la Rapée n’est pas si éloigné. Le labo est là également.
— Dis-leur que j’arrive, Petit.
Le « Merci, Patron ! » retentit dans le combiné comme un profond soulagement. La voix retrouvait la gaieté habituelle d’un Bolz serein.
Anconi composa le numéro du cabinet de la rue de Longchamp, s’excusa auprès du secrétariat du docteur Guénel de ne pouvoir honorer son rendez-vous, en raison d’un imprévu professionnel. Lorsqu’il raccrocha, une légèreté presque enfantine l’envahit.
Dans le taxi qui l’emportait avenue de la Grande Armée, il essaya d’imaginer la situation : un corps, ramassé dans l’espace réduit de toilettes – verrouillées – d’un wagon de chemin de fer. « Y a-t-il une autre issue possible ? » Dans son souvenir, seul un carreau au verre dépoli garnissait la paroi de l’étroite cellule biscornue et, pour des raisons évidentes, demeurait fixe entre ses robustes caoutchoucs. Lorsque son client eut un haut-le-cœur, le chauffeur le dévisagea dans son rétroviseur :
— Souhaitez-vous que je ralentisse, Commissaire ?
Anconi reconnut Albert, qui stationnait au coin de la rue du Général-Lanrezac et l’avait souvent conduit au “36”. La trentaine, le visage pâle du Parisien pas avare de ses heures, il tordait toujours la bouche lorsqu’il souriait sous sa casquette de Gavroche.
— Non, Albert. Ce n’est rien, juste une pensée désagréable.
— Ah ! Encore une affaire pénible, je parie ?
— Possible, se contenta de susurrer le policier.
Albert maîtrisait mal sa curiosité, mais n’insistait jamais.
— Tè, déposez-moi devant le parvis, ce sera parfait, précisa-t-il alors qu’ils empruntaient le boulevard Pasteur.
Deux agents interdisaient l’accès au quai. Au passage du commissaire, ils s’écartèrent en portant la main au couvre-chef. Des badauds s’étaient agglutinés et tendaient vainement le cou. Voyageurs en transit ? D’aucuns s’inquiétaient de la présence de la police, d’autres occupaient leur attente par une distraction imprévue. Quelques-uns gesticulaient, prenaient leurs voisins à témoin, semblaient avoir tout vu d’un évènement auquel ils n’avaient pourtant, sans doute, pas assisté.
Lefebvre, Gitanes aux lèvres, une jambe en appui sur le marchepied du wagon, griffonnait des notes dans un petit carnet rouge posé sur son genou plié, tout en guettant l’arrivée d’Anconi.
— Bonjour, Patron ! Désolé de vous avoir dérangé.
— Je t’en remercierais presque, Petit…
L’inspecteur, surpris, ne sut que répondre.
— Alors, qu’est-ce qui me vaut d’avoir échappé au toubib ? Que dit le légiste ?
— Il confirme le décès par strangulation. L’absence de sillon sur le cou permet d’affirmer qu’il n’y a pas eu pendaison. Le gars était dans les toilettes d’un wagon. Verrouillées de l’intérieur ! Le meurtrier l’aurait enfermé après coup. Le contrôleur l’a découvert en faisant son tour, après l’arrivée du convoi.
— Le corps a-t-il été transporté, selon lui ?
— Non. Il était encore chaud. Le médecin a estimé que la mort datait de moins d’une heure.
— Des papiers d’identité ?
Lefebvre consulta ses notes et raconta. L’homme avait une soixantaine d’années, de petite taille et plutôt rondouillard. Totalement chauve, il devait cacher sa calvitie derrière une perruque, une moumoute bon marché retrouvée sous lui. Il était habillé d’un costume sombre et usagé, pantalon de tweed à large revers, cravate vert grenouille sur une chemise “jaunasse”. Aucune marque sur les vêtements.
— Dans le portefeuille de la poche intérieure, nous avons découvert une carte d’identité très ancienne à en juger par le caractère juvénile de la photographie, au nom de Maurice Chennut, né le 11 août 1926 à Nantes, Loire-Inférieure. Adresse : 3, rue de l’Abreuvoir, Nantes.
— As-tu prévenu les collègues nantais ?
Il avait demandé au Quai de le faire.
— Hum ! Quoi encore ?
— Dans ses poches, un document d’un autre âge, une carte d’inscription donnant droit au ravitaillement, datant de 1943 ! Bizarre… Un souvenir, sans doute. Lefebvre montra un carton jauni et écorné, portant le nombre 28521, difficilement lisible sous un tampon « Mairie de Nantes » et « RAVITAILLEMENT ALLEMAND ». Établi au nom de Chennut. Un tableau en trois colonnes : denrées alimentaires d’un côté, nom de fournisseur et numéro d’ordre chez le commerçant de l’autre. Vous ne trouvez pas cela stupéfiant ?
— Fatche ! C’est Retour vers le futur, ton client !
Anconi absorba deux cachous, friandise dont il s’était privé toute la matinée pour éviter d’exhaler une haleine de réglisse chez son médecin. Il en abusait, à la désolation du praticien qui ne manquait jamais de lui en faire reproche. Cette position d’élève, obligé de subir les remontrances du professeur, l’irritait.
— Quelque chose d’autre, dans le portefeuille ?
— Un billet SNCF Nantes-Paris sur le Jules Verne d’aujourd’hui, poinçonné.
— Le Jules Verne ?
Lefebvre désigna le convoi immobilisé, ses wagons aux deux bandes orange.
— C’est le nom de ce train très confortable et très rapide. Genre luxe, voyez. Que des première classe !
— Ah ! Le type avait de l’argent, alors. On en a trouvé sur lui ?
— Quinze billets de cent francs tout neufs et de la monnaie étrangère, allemande, je pense.
— Quel pataquès !
Le commissaire, intrigué, mais de plus en plus intéressé, demanda à voir la scène de crime et la victime. Ils montèrent dans la voiture 13, se frayèrent un chemin entre les spécialistes du labo équipés de blouses blanches, qui avaient investi le couloir latéral. Ils avaient déployé leurs valises sur les confortables fauteuils couverts d’un textile marron quadrillé d’orange dont chaque dossier était surmonté d’un repose-tête garni d’un tissu blanc. Un homme muni d’un appareil photo se contorsionnait pour fixer tous les recoins du wagon. Son flash aveuglant crépitait et se réfléchissait sur le verre séparant les compartiments du couloir.
« Pardon, laissez passer le commissaire, merci. » Lefebvre s’excusait à chaque instant.
La victime avait été extraite des toilettes. Le corps était enveloppé d’une couverture de laine à carreaux rouge et noir, marquée SNCF. Anconi souleva l’étoffe. Il constata, à son tour, l’étrange habillement, à la fois démodé et mal assorti dans ses couleurs.
— Qui lui a retiré son soulier gauche ? demanda-t-il soudain.
Lefebvre se pencha, découvrit lui aussi le pied dégarni, la socquette marron.
— Mince ! Je n’avais pas remarqué, se reprocha l’inspecteur. Il interrogea les gars du labo, mais personne n’avait déchaussé le bonhomme. Je suis confus, Patron. Il tira deux bouffées de sa Gitanes. Peut-être est-elle restée dans les toilettes lors du dégagement du corps ?
Il s’y précipita, fouilla l’endroit. Rien. Il revint vers la dépouille sur laquelle le commissaire avait rabattu hâtivement la couverture SNCF.
— Pourquoi déchausser un type que l’on vient d’assassiner ?
— Tè, Petit, je l’ignore ! Autant me demander de te dire la messe, je la sais pas !
Lefebvre ne put répondre. Troublé, il cherchait comment rattraper sa bévue. Devinant l’appréhension de son supérieur, mais soucieux qu’il vérifie ses constatations, il lui proposa de découvrir le visage du mort. Le commissaire hésita, n’osa pas refuser. La peau violacée, le crâne chauve, les marques sur le cou lui valurent une nausée immédiate, difficilement réprimée. Une perruque jaunâtre avait été déposée sur son torse, comme on l’aurait fait d’un bouquet de fleurs.
— Des bagages ? réussit à articuler Anconi.
— Une sacoche, retrouvée dans les W.-C., contenant des affaires très banales : un journal, des mouchoirs en papier. Rien qui ne sous-entende un voyage prolongé, ni vêtement ni nécessaire de toilette.
— On croirait à une mise en scène. Sait-on quelle place occupait la victime dans le wagon ?
— Je vous appelle le contrôleur, celui qui l’a trouvé, proposa Lefebvre en rabattant la couverture sur l’étrange personnage. On peut l’emmener à l’institut médico-légal, Patron ?
Le commissaire acquiesça d’un signe de tête. Chacun, au 36, connaissait son aversion pour les premières constatations qui lui soulevaient invariablement le cœur. La vue du sang, les mauvaises couleurs des victimes et les odeurs lui étaient insupportables, comme tout ce qui, de près ou de loin, rappelait la médecine et ses instruments.
— C’est vous qui avez découvert le corps ? demanda le commissaire à l’homme qui se présenta de façon pompeuse.
— En effet, Monsieur. Rolland Garrec, contrôleur sur le Jules Verne. J’ai été intrigué par le témoin lumineux d’occupation des toilettes. À bord de ces voitures – des “A8tu”, précisa-t-il – une panne est impossible. Tous les passagers étaient descendus, de sorte que…
Il se lança dans un descriptif technique de ce train “Grand Confort”, expliquant qu’il disposait d’un local de service dans la voiture “A4Dtux”, située en queue de rame. Il le regagnait dès lors qu’il avait achevé la vérification des billets.
— Il n’y a eu aucune alarme durant le voyage ?
— Non. Tous les passagers étaient en règle. C’est d’ailleurs l’habitude dans ce train emprunté par des…
— Je vois, l’interrompit le commissaire, irrité. Le convoi était-il complet ?
— Oui, après l’arrêt à Angers. Vous savez, la réservation est obligatoire.
Garrec reprit aussitôt son énumération technique, wagon par wagon : « Sept voitures en tout ; quatre de type A8tu à couloir central emportant quarante-six voyageurs chacune, deux voitures A8u à couloir latéral accueillant quarante-huit places chacune, une voiture fourgon A4Dtux de vingt et une places seulement en raison de la présence du compartiment à bagages et des moteurs de générateur. Il n’y avait pas de “Vru”, comme toujours dans le convoi du matin, expliqua-t-il, mais simplement un wagon-bar, le A3rtu, doté de dix-sept places assises. En tout, trois cent dix-huit passagers, conclut-il fièrement ; si l’on comptabilise le personnel navigant, c’est-à-dire le barman, l’agent de service et moi-même, trois cent vingt et une personnes. En excluant le conducteur ! »
« Toi, tu es comme le tambour de Cassis* ! » pensa Anconi, de plus en plus agacé. Il dut se maîtriser pour continuer :
— Peut-on voyager debout ?
— Vous n’y songez pas ! s’exclama Garrec, profondément choqué par une telle supposition.
— Aviez-vous remarqué ce passager, durant le trajet ? Tè, son habillement n’était pas… habituel.
— La discrétion s’impose, auprès de cette clientèle. Ce sont les consignes.
— Et ses voisins de compartiment, vous en souvenez-vous ?
Le contrôleur fronça les sourcils avant de répondre :
— Non. Tous étaient en règle, évidemment.
— Évidemment ! Les billets ne sont pas nominatifs, je suppose ?
— C’est un train de standing, uniquement des première classe. Cependant, même s’il est très rapide, l’enregistrement n’est pas celui d’un avion, Monsieur.
Lefebvre, légèrement en retrait, souriait maintenant aux signes d’irritation du commissaire. Il feuilletait son petit carnet, autant pour vérifier ses notes que pour garder contenance.
— Vous dites avoir inspecté les voitures, après l’arrivée. Restait-il des bagages dans les filets ?
— Des vieux journaux, comme d’habitude, ici ou là. Rien à la place du…
Il n’osa pas dire « du mort ».
— Qu’avez-vous fait de la sacoche ?
Rolland Garrec était un employé scrupuleux. Il lissa sa fine moustache, réajusta sa casquette galonnée, se redressa.
— Je l’ai mise au coffre, par sécurité, en attendant votre arrivée. Ce sont les consignes.
— Avez-vous examiné son contenu, préalablement ?
— Oui, au cas où un nom, une adresse ou un numéro de téléphone y figurerait. Ce sont les cons…
— Bien sûr. Alors ? demanda Anconi que le comportement de Rolland Garrec impatientait.
— Je puis vous le dire, puisque vous êtes policier. Inspecteur… ?
Un reproche perceptible dans la question de l’employé.
— Pardonnez-moi, j’aurais dû me présenter. Commissaire Anconi, de la criminelle. Qu’y avait-il dans cette sacoche ?
— Un journal, une boîte de louzou*, un bouquin. Par contre, la doublure m’a paru contenir quelque chose. Je ne suis pas allé plus loin, ce sont…
— Tè, pardi, les consignes. Dites-moi, cela vous a-t-il fait penser à une arme ?
— Non… cela semblait beaucoup plus petit, arrondi et dur, voyez ?
La tête de biais, fermant un œil, il dessinait du pouce et de l’index la forme d’un cercle.
— Comme une balle de revolver ?
— Oh ! Je ne suis pas spécialiste comme vous, mais il s’agissait d’un objet moins allongé.
Lefebvre nota, dans son carnet rouge, ce détail que le contrôleur ne lui avait pas signalé avant l’arrivée de son supérieur. Il souligna « rond » et « dur », ajouta « 1 à 2 cm ? »
Ils durent s’écarter tous les trois pour laisser le couloir libre quand deux agents emportèrent le corps de Maurice Chennut, enveloppé dans sa couverture rouge à carreaux.
— Lorsque vous avez mené votre inspection, vous n’auriez pas trouvé une chaussure abandonnée ? Une gauche ! questionna Lefebvre, malheureux de n’avoir pas remarqué un détail aussi important.
Rolland Garrec eut un regard en biais vers le policier.
— Non. J’aurais dû ?
Anconi demanda qu’une vérification minutieuse soit réalisée à la recherche du soulier, puis réclama la sacoche. Ils parcoururent le convoi en file indienne, empruntant le couloir latéral. Marcel Pontoiseau, silencieux, fermait la marche.
— Le barman est parti ? s’enquit le commissaire alors qu’ils traversaient le wagon-bar.
— Voyez ! Tout est rangé. Il assurera le retour demain soir vers Nantes. D’ici là, il a quartier libre.
— J’ai relevé ses coordonnées, Patron. Un certain Jean Lemoine, 28 ans, domicilié – il feuilleta rapidement son carnet rouge – 12, rue Fénelon, à Nantes.
— Tè, a-t-on une idée de ce qu’il fait de sa pause parisienne ?
Nul ne le savait.
— Dans ce cas, il faudra le remplacer demain soir, monsieur Garrec, nous devrons l’interroger. Sans laisser le temps au contrôleur de protester, il enchaîna : quant à l’agent de service dont vous m’avez parlé, où est-il ?
Lefebvre intervint à nouveau :
— Je lui ai demandé de nous attendre au local du wagon de queue, précisa-t-il.
Ils reprirent leur cheminement, parcourant maintenant des voitures à compartiments et couloir central. Circuler dans ce train vide procurait une curieuse impression au commissaire. Un drame s’y était joué, quelques heures plus tôt, alors que chaque place se trouvait occupée. Y avait-il eu un témoin ? Que venait faire à Paris cet homme étrangement vêtu ? Devait-il rencontrer quelqu’un ? Pourquoi gardait-il dans son veston de vieilles choses sans valeur ? Un élément paraissait acquis, il s’agissait d’un Nantais : l’adresse en attestait. Quelqu’un avait voulu le supprimer avant qu’il n’atteigne la capitale. Un voleur ? Mais alors, pourquoi lui laisser l’argent dans ses poches ? Effacer un homme dans un train bondé nécessitait du sang froid. Une urgence ? La peur ? Mais de quoi ? Ou au contraire une préméditation soigneusement préparée ?
— Voilà, c’est ici, dit-il en introduisant son carré dans une porte sur laquelle était écrit « Service ».
— En dehors de vous, monsieur Garrec, qui possède un passe ?
— Une clef de Berne, voulez-vous dire ? Le barman ainsi que l’employé qui nous attend derrière cette porte.
— Tè, voilà déjà trois suspects !
— …
La remarque du commissaire avait jeté un froid. Ils entrèrent dans le local exigu.
Il était vide.
Seul le journal déplié et froissé, sur la tablette, donnait vie à la pièce.
— Où est-il, votre collègue ?
Lefebvre se précipita sur le quai, maintenant désert, à l’exception de deux agents de police postés devant le wagon 13, qui n’osaient pas quitter les lieux sans une autorisation officielle.
Garrec, offusqué, haussa les épaules, ouvrit le coffre, tendit la fameuse sacoche au commissaire. Une sorte de petit cartable en mauvais cuir, raide et désagréable au toucher. Elle se fermait par une simple lanière. À l’intérieur, un journal Ouest-France du jour. La doublure était faite d’une toile grossière. Aucun nom n’y était inscrit. Anconi passa la main dedans, glissa sur les parois qu’il palpa minutieusement. Ses doigts rencontrèrent un objet arrondi et dur qu’il extirpa par une petite déchirure.
Il tenait entre le pouce et l’index une pierre verte, oblongue. Une grosse émeraude.
— Fatche !
* Trans-Europ-Express, trains de prestige ayant roulé jusqu’à la fin des années 1980.
* En réalité, le Jules Verne a effectué son dernier trajet le 22 septembre 1989. Par admiration pour ce train, je me suis autorisé à le faire circuler quelques mois de plus.
* Mon bien-aimé, en néerlandais.
* Expression marseillaise : facile à mettre en branle, difficile à faire taire !
* Terme breton pour médicament.
II
Nantes, mardi 14 novembre 1989
Anconi arriva dès le mardi à Nantes. Il n’y était jamais venu. Il s’attendait à trouver une gare ancienne, un de ces bâtiments de pierre à toit en verrière où les trains terminent majestueusement leur course dans un nuage de vapeur. Il fut déçu de distinguer une construction récente, sans charme, comme déjà défraîchie. Il posa sa valise sur le trottoir.
La veille, après la découverte de l’émeraude, il avait distribué ses consignes. Il avait chargé Lefebvre de rechercher l’employé des chemins de fer, lequel s’était éclipsé, puis d’interroger le barman dès qu’il prendrait son service.
Il avait demandé à Bolz de retrouver les passagers du Jules Verne, du moins ceux du wagon numéro 13. Il lui avait suggéré de tenter de repérer ceux qui faisaient l’aller-retour dans la journée.
Lui-même s’était réservé d’enregistrer la déposition de Garrec. Pourquoi l’avait-il convoqué au Quai, l’après-midi même ?
Le préposé avait détaillé son emploi du temps, dans le Jules Verne, avec une précision extrême. Il s’était acquitté de son rôle « avec la discrétion de rigueur », de sorte qu’il n’avait, selon ses affirmations, pas remarqué l’un ou l’autre des passagers. « D’ailleurs, il se l’interdisait. » Après un rapide recensement des places libres, effectué avant et après l’arrêt d’Angers, il avait partagé le contrôle des billets avec son collègue. Ce dernier commençait le travail dans le wagon de queue, lui-même assurait le reste du convoi en partant de la tête de la rame. Ils se rejoignaient le plus souvent à son milieu, parfois l’un attendait l’autre au wagon-bar.
— C’est donc vous qui avez contrôlé la voiture 13 ?
— Tout à fait, avait-il concédé, étonné de tant de précision de la part d’un profane. Je vous l’ai dit, tout m’a semblé parfaitement normal.
— Quelle heure pouvait-il être ?
— Je m’en souviens très exactement, je terminais lorsque mon collègue m’y a rejoint. Nous passions juste en gare de Sablé-sur-Sarthe.
« Tout juste s’il n’avait pas aperçu François Fillon sur le quai ! »
— Comment pouvez-vous en être si certain ?
— Je connais la ligne par cœur, Commissaire. J’ai mes repères ! Au Mans, le contrôle doit être bouclé.
Il s’abstint de demander ce qu’ils faisaient entre Le Mans et Paris.
— Combien de passe-partout possédez-vous ?
— Chaque employé est doté d’une clef de Berne et il en existe une supplémentaire dans le local de service, par sécurité. Ce sont les consignes.
— De sorte qu’un voyageur aurait pu la subtiliser pendant votre absence.
Rolland Garrec avait bondi.
— Impossible ! Cet endroit est fermé ! Les passagers ne peuvent pas y accéder, s’était-il indigné.
— Êtes-vous sûr qu’il l’était, ce matin ?
Un horrible doute avait envahi l’employé scrupuleux, car il avait quitté le local avant son collègue et y était revenu après lui. Restait pour lui la certitude de l’observance, par tous, des “consignes”. Anconi avait vu là une faille et avait recommandé ensuite à Lefebvre de cuisiner l’autre agent sur cet aspect dès qu’il le retrouverait et de réaliser une enquête de proximité pour chacun d’eux.
— Ce sera tout pour l’instant, avait-il conclu. Je vous demanderai cependant de rester à la disposition de la police, pour un entretien complémentaire.
Rolland Garrec, en fin d’audition, avait perdu ses certitudes. Il sortit penaud du 36.
En milieu d’après-midi, le commissaire avait sollicité un rendez-vous urgent avec son directeur, Arnaud-Fontaine.
— Mes respects, Monsieur le…
— Entrez, Anconi.
Les deux hommes ne s’appréciaient pas. Aussi ne fut-il pas étonné de n’être pas salué par son supérieur ni invité à s’asseoir dans un des fauteuils Empire placés devant le bureau. Sous son crâne chauve, les sourcils du directeur étaient fixés en accent circonflexe, signe habituel de la désapprobation. Il griffonnait d’une main nerveuse, tournait les pages d’un parafeur en cuir, signait des documents à l’aide d’un volumineux stylo Montblanc, feignant la plus vive concentration.
Le commissaire se servit un cachou, après avoir secoué ostensiblement la petite boîte métallique jaune.
— Vous mangez toujours ces horreurs ? éructa Arnaud-Fontaine, sans lever les yeux sur son visiteur.
Une forte odeur d’encaustique imprégnait la pièce. Elle dérangeait le commissaire pour qui la propreté maniaque du lieu témoignait du caractère obsessionnel de son occupant. Ce dernier ne craignait-il pas avant tout l’incident de carrière, celui qui contrecarrerait ses ambitions ?