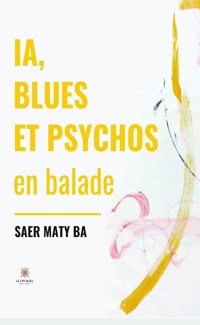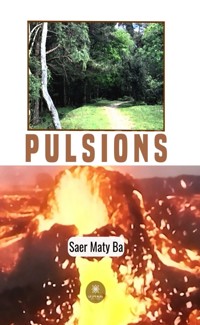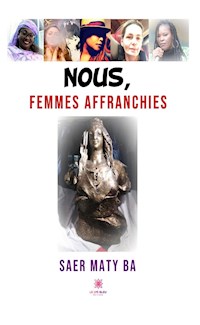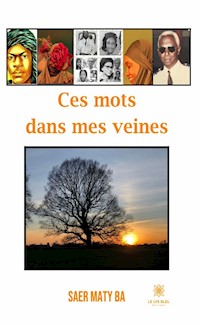Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Il n’a pas choisi sa famille, ses parents encore moins. Alors que l’un ne lui est jamais connu, l’autre ne lui laisse en héritage qu’une petite valise pleine d’articles. C’est ainsi qu’il se retrouve au centre de la fissure du temps, de la fissure d’une vie faite de prémices, de bifurcations, d’amour, de voyages, d’échecs et peut-être de succès. Il le sait, même s’il se demande encore ce qui lui arrive et réalise que son retour temporaire sur « le continent » de sa famille maternelle (la seule qu’il ait jamais connue) est en passe de devenir permanent. Cette introspection suscite en lui de nouvelles interrogations majeures, des questions liées à la difficulté qu’il éprouve à continuer de vivre en ermite, mais aussi à son désir de repartir du « continent ». En outre, il est conscient que sans se réenraciner dans sa riche histoire et dans sa culture maternelle, sans dompter ses propres démons afin de fissurer la forteresse qui l’habite et en sortir, rien ne sera comme il le souhaite. Les zones d’ombre de son passé ne seront pas éclaircies, ses trous de mémoire demeureront et ses silences ne lâcheront mot pendant que les rumeurs autour de lui continueront de causer. Parviendra-t-il à relever ces défis ? L’amour maternel, les amis(e)s, les arts martiaux, la lecture, l’écriture, la musique, les jeux d’échecs et les femmes – dont il semble vouloir s’entourer constamment – lui seront-ils d’une quelconque utilité ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Saer Maty Ba a enseigné la littérature, le cinéma, et les études culturelles pendant une vingtaine d’années au Royaume-Uni. Il aime les voyages, la philosophie, les cultures du monde noir et les arts martiaux. Il est l’auteur d’un récit,
Prothèses poussiéreuses : « Le Continent » au cinéma en 2019, Éditions Sydney Laurent, et d’un premier roman,
Le serment du maître ignorant en 2020, Le Lys Bleu Éditions,
Fissure est son deuxième roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 605
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Saer Maty Ba
Fissure
Roman
© Lys Bleu Éditions – Saer Maty Ba
ISBN :979-10-377-2301-7
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
À mes chers parents, frères et sœurs,
une merveilleuse famille que je garderai jalousement
jusqu'à la fin des temps.
La mémoire et l’imagination travaillent ensemble pour reconfigurer (…) ce que je prétends savoir de moi.
Jean Tenaillon
Mon histoire est à la fois en mouvement et devenir, non statique mais incomplète (…) j’essaie de remonter le temps pour parler de mon passé (…) tout en essayant de ramener jusqu’au temps présent ma propre histoire, une affaire singulière, de plusieurs points de vue.
Guchi K.
L’homme est une décision.
Jean Lescure
Prologue
Qui…
Il est né le premier mois de la neuvième année de son siècle de décès.
Il ne se mêle pas des affaires d’autrui.
Il n’incite pas à la bagarre mais ne l’évite lorsque provoqué.
D’études universitaires, il obtient un diplôme de juriste et une ceinture noire de Karaté.
D’une famille classe-moyenne et ayant des amis proches de la classe dirigeante et de l’armée,
il est coopté par les services secrets militaires de son pays.
Opérations clandestines, secrètes, chez les arches-ennemis et leurs vassaux.
De vastes territoires traversés, plus de 4 000 000 km² d’un seul Continent.
1
Prémices
J’ai renoncé à écrire mon histoire.
Le temps se mesure-t-il ?
Je n’ai plus ni de montre ni de réveil matin. Néanmoins, je sens l’heure du lever proche. Très proche. Car mon corps a pris l’habitude de se mettre en mode réveil progressif, c’est-à-dire, il m’éveille une dizaine de minutes avant l’heure H de sortie du lit, heure fixée dans ma tête la veille, au moment du coucher. Qui plus est, cela fait près d’une quarantaine d’années que ce mécanisme s’autolubrifie. Au point qu’aujourd’hui mon processus de réveil s’est bien enclenché, malgré la récente grosse fatigue éprouvée par mon plus très jeune corps, victime qu’il semble être de mon train de vie. Sain, mais intense. Intensité accentuée au gré des circonstances. Certaines de ces dernières, comme le décès d’un proche, sont subies par la force des choses, pendant que d’autres, c’est-à-dire la plupart, je me les impose par discipline, et/ou par habitude.
Ce matin, réveil difficile. Alors, je m’étire et me remets en position fœtale sur ma modeste couchette, en attendant que cerveau et esprit se dégagent assez de leurs toiles d’araignée nocturnes afin que je puisse glisser vers les étapes suivantes de mon processus de réveil : faire mes besoins et une petite toilette, puis verre d’eau tiède, fruit de saison, et tenue de sport pour passer aux premières activités de toutes mes journées (étirements, course à pied, suivis d’une séance d’entraînement d’Arts Martiaux, des activités ouvertes, ponctuées, et fermées par de la méditation). Ce matin, je m’étire et m’élance le long de la plage, encore déserte n’eut été les quelques pêcheurs en fin de service nocturne. Sans doute les mêmes qui échangent des plaisanteries et autres paroles chaque jour vers 6 heures du matin, pas loin de mon cabanon, me dis-je en les saluant d’un hochement de tête et signe de main. Toujours est-il que, tous les matins, en entendant des voix je sais que l’heure de mon entraînement a sonné et que je dois me dépêcher de sortir du lit. Aujourd’hui, plus que d’habitude, mon corps est lourd et mes pieds traînent : « allez, persévère l’ermite ! », me dis-je pour m’encourager.
Réveil difficile, disais-je. Plus difficile que d’habitude, vu que je me remets juste d’un épisode de grosse fatigue ayant duré des semaines. Corps lourd, grosses sueurs qui imbibèrent mon lit, insomnies, esprit flou, et narines et sinus bouchés. Au point d’être affaibli physiquement. Jusqu’à cinq kilos de perdus, dixit le médecin dépêché à mon chevet par la famille de ma frangine par alliance, Daado (ou Dècaff). Sauf la ténacité de cette dernière, j’aurais pu m’étioler davantage, disparaître, telle une ombre dans une pénombre, à la pleine lune. Parce que j’avais perdu toute notion d’heure et de temps, faisant le yoyo entre conscience et inconscient, entre sommeil et semi-éveil. Pour faire court, le toubib de la famille de Dècaff m’a tout de suite ordonné d’arrêter de prendre un certain médicament antipaludéen, prescrit par un autre toubib, tubaab, blanc, Britlandais celui-là, et de le remplacer par la nivaquine. Oui, j’avais le palu, mais pas seulement. Les effets de mes allergies s’y ajoutèrent, éternuements, yeux mouillés qui piquent, nez qui coule et saigne par moments : la totale. D’un air amusé, sans condescendance, le toubib de la famille de Dècaff me fit savoir que le médicament antipaludéen qui me donnait des hallucinations (« Ah, voilà mec, t’a-vais des hallucinations ! », me dit une voix, apparemment sympathique, dans ma tête), ce médicament, donc, avait été banni par les armées européennes en service sur le Continent. Il était for-surpris de me le voir prescrire, raison pour laquelle il voulut savoir depuis quand j’avais débarqué ici, sur le Continent. Silence : je n’aurais pas dû prendre ce Larialm, même si j’en avais ramené de Britland et avais besoin de me soigner, je le savais, chère lectrice, mais je ne voulais pas lui répondre. Le toubib insista. Silence radio. Ne voulant prolonger la discussion, ni sur le médicament ni sur la date exacte de mon arrivée sur le Continent, je me contentai de fermer les yeux et l’ignorer.
Je suis toutefois reconnaissant à ce toubib local de m’avoir tiré du pétrin sanitaire où je m’étais retrouvé. Je ne sentais plus aucune partie de mon corps d’Artiste Martial. Je ne faisais que suer, suer, et encore suer ! Dècaff, qu’elle soit bénite, se chargeait de ma nourriture et de la salubrité de mon cabanon. Ayant dupliqué mes clefs et lui avoir remis les doubles, elle venait régulièrement, avant et après le collège, mais également les week-ends, et je dois avouer que, pour une fois, sa loquacité était utile :
« Guch’, ‘faut que tu te douches aussi : tu pues ! OK ? Je t’ai acheté du bisaap rouge et des fruits de saison, ils te redonneront des forces, tout comme ce riz blanc au poisson épicé de ma tante et ce ngurbaan de ma grande sœur. Tâche de tout manger nak, hein !
— Oui, mer-merci. » Ça, c’est bien ma frangine Daado Dècaff, pensais-je, à elle on ne la fait pas. À titre d’exemple, alors que pendant deux jours de maladie je n’avais voulu voir personne, que j’avais ignoré ou renvoyé tous les visiteurs, y compris Elmaxu Jôop, mon élève prodige en jeu d’échecs, au troisième jour, Dècaff frappa si fort à ma porte (j’avais laissé mes clefs dans la serrure), menaçant de la défoncer, ou de violenter ma fenêtre, qu’en pleines hallucinations je trouvai la force de me traîner jusqu’à la porte pour lui ouvrir. Elle s’était inquiétée, me dit-elle et, en faisant attention à combien je rejoignais difficilement ma couchette, ainsi qu’à mon corps et à mon visage, tous deux amaigris et en nage, des larmes lui montèrent aux yeux. Elle pleura, et son regard en devint si doux que je faillis pleurer à mon tour. Bref, c’est ainsi que Dècaff avait aussitôt mis en marche la machine qui allait me sortir de mon gouffre psychosomatique psychologique et, progressivement, me permettre de reprendre, et mes esprits et mes activités.
De toute façon, même avant mon épisode de palu aigu, tout ou presque dans ma vie avait besoin de changer. J’en suis conscient même si, ce matin, je fais le vide. Il me faut débuter ma troisième journée d’après-maladie par une séance d’entraînement un peu plus poussée que celle de la veille. Séance sur le thème de la Forteresse, ou plus précisément sur le thème du Sortir de la Forteresse, selon ma fiche du jour, une des sept dont je fais usage dans la semaine, soit vingt-huit fiches dans le mois.
Ce matin, méditation de dix minutes, étirement de tous mes muscles, et me voilà élancé sur la plage, comme déjà dit. Dix minutes dans ma course lente de trente, la plage est semi-déserte, les pêcheurs matinaux étant partis et le tohu-bohu quotidien à peine enclenché. Un vent encore frais me fouette le visage, mon corps et mes pas sont encore lourds. « No matter, you’ll get back to normal soon », pas de souci, tu seras vite revenu à la normale, me lance une voix encourageante, dans ma tête. « Ben, on verra ? », lui rétorque une autre, toujours dans ma tête. Revenu près du cabanon, je retrouve une plage un peu plus animée, notamment par des sportifs de tous acabits. Séances de courses rapides, dix fois quatre-vingts mètres, ponctués de petits temps de récupération : qu’est-ce que j’ai mal ce matin ! Je sens tous mes muscles endoloris, cerveau compris. Cependant, tels Muhammad Ali ou Rocky Balboa, « j’ai pas mal ! », me dis-je, cette douleur n’est qu’illusion. Une esbroufe qui fait mal, même si je n’abandonnais pas pour autant. Cycle de courses rapides bouclées. Méditation. Puis, préparation à pénétrer la Forteresse que je dois traverser : kihon ou techniques de déplacement, d’attaque et de défense, et autres simulations de situations de self-défense tirées du Karaté (styles Shotokan et Wado) mais également du Krav Maga basique et de la M Defence System, quarante-cinq minutes. Lourdeur et douleur semblent avoir pris congé de mon corps au moment où je m’apprête à passer au kata, ensemble de techniques préarrangées, du jour, Bassaï-Daï version Shotokan, l’un mes favoris.
Signifiant « Pénétrer la Forteresse » ou « Traverser la Forteresse », Bassaï-Daï figure sur ma liste de Kata préférés parce qu’il contient plus de techniques de défense que d’attaque. Il part d’un principe et scénario de combat défavorable, contre plusieurs adversaires, combat et situation que le disciple doit tourner à son avantage. Bassaï-Daï me parle car il est à la fois relativement court et très puissant et intense. Au-delà même d’avoir en partie inspiré les cinq KataHeian, une excellente base, je trouve que Bassaï-Dai exige du pratiquant un surpassement, une prise d’assaut de la Forteresse hostile. C’est un Kata qui me demande de bloquer, de clore, d’être conscient de l’inimitié collective qui m’entoure et m’encercle, une situation potentiellement périlleuse et de laquelle je ne sortirai qu’en me dépassant. L’état d’esprit que m’inspire la pratique de Bassaï-Dai, et que je m’efforce d’adopter, est celui de quelqu’un d’assailli par plus d’un adversaire redoutable. Au point d’atteindre le seuil de forte détresse d’un scorpion entouré d’un cercle de feu mais qui, au lieu de se donner la mort avec son propre dard, décide de triompher de ce péril en mobilisant toute sa force physique et mentale, ainsi que son entière ténacité. Bassaï-Dai, leçon de vie que je pratique aujourd’hui pendant un quart d’heure, à des rythmes différents : mouvement par mouvement, posture par posture, en pensant au bunkaï ou application pratique, à ma respiration, aux rythmes qu’exige ce Kata, et en y mettant toute la kime, pénétration/décision, ainsi que les alternances dures douces et percutantes lentes qui font son charme. Après ces étirements, suivis de dix minutes de méditation, plongeon dans l’océan pour une baignade de cinq minutes bien méritées. Ma journée peut maintenant commencer, bien commencer, chère lectrice, je me sens bien, très bien même.
Je commence une tout autre phase de ma vie, dans laquelle tout va changer. Je dis cela car me revoilà en passe de faire encore un bilan de circonstances et d’évènements, de questions à élucider, de voyages, de zones d’ombre filiales, qui n’ont cessé, des décades durant, de m’accompagner voire, parfois, de me hanter. Aussi ai-je vu les choses et les êtres changer autour de moi. Ma période de stasis, d’immobilité, a pris fin. Du moins, je le pense et l’espère. Daado, ou Dècaff, y est pour quelque chose, encore une fois, Dècaff, la frangine et élève qui m’aura collé aux basques depuis mon retour ici, dans ce pays que je connaissais bien, jadis, mais qui m’est devenu étranger, pays que j’ai dû réapprendre à connaître, pays qui m’a fait comprendre sans ambages qu’une fois parti de chez soi, une fois avoir émigré et vécu ailleurs, on ne peut plus rentrer au bercail, en tout cas pas des points de vue psychologique, intellectuel, et rationnel.
En effet, une émigration, la mienne, sous-tendue par un désir de partir, désir à son tour animé ou motivé par une révolte, un dégoût, un sentiment d’être trahi par le Système, cette émigration-là accentue la véracité de cet impossible retour chez soi, tel que me l’invoque l’œuvre extraordinaire de Stuart Hall, activiste et penseur Caribéen et Brit, plus précisément ce que j’appelle « la composante identité culturelle » de sa pensée. You cannot go home again, vous ne pouvez rentrer chez vous, disait à raison Hall. Non seulement les composants ce home, ce chez-soi, que l’on a connu ou croyait connaître, que l’on possédait ou croyait maîtriser, ne restent-ils pas figés, mais aussi s’ajoutent-ils et se mixent-ils à du nouveau, pour le pire et pour le meilleur. Pour le pire : j’ai eu mes quarts d’heure de colère, silencieuse et vocale, et je ne crois pas en avoir fini, même si je dois sans cesse me remémorer Fanon (Frantz) afin de ne plus crier les choses mais les dire calmement, mieux, les taire, tout en m’assurant de bien traverser la Forteresse. Pour le meilleur : toute nouveauté peut être une bonne chose ; elle peut même constituer la meilleure des choses, dans le meilleur d’un monde (remis) en question. On doit s’y accrocher, vue la complexe chose de laquelle cette nouveauté participe, à savoir l’identité culturelle, ou l’identité tout court, inexacte, plurielle, gage de l’existence d’un désir d’être, d’un fait d’être (being, selon Hall), mais aussi d’un désir et d’un fait d’être en train de devenir (le becoming de Hall).
C’est que, chère lectrice, les tambours et méandres de ma mémoire me ramènent à la surface de mon présent, un présent qui semble interpréter un essai de Hall devenu célèbre, Cultural Identity and Diaspora (1993), où il dit succinctement et clairement de l’identité culturelle qu’elle « belongs to the future as well as to the past. (…). Cultural identities come from somewhere, have histories. But, like everything which is historical, they undergo constant transformation. », l’identité culturelle appartient autant au future qu’au passé. Les identités culturelles proviennent de quelque part et ont une histoire. Mais, à l’instar de tout ce qui est historique, elles font l’objet d’une transformation constante. Ainsi, pas étonnant qu’à mon retour au pays les choses et les êtres aient eu changé. Ni que ce processus de changement m’ait mis en contact avec le nouveau, ou plutôt la nouveauté, qu’est Dècaff, avec qui, de prime abord, rien ne me liait : Dècaff, incarnation de transformation, fruit et moteur de changement (collectif) autour de ma personne ?
Du temps de mon enfance, Dècaff passerait facilement pour une xale bu waw bët te liibër, enfant qui n’a pas froid aux yeux et est têtue et libertine, en ce sens qu’elle osait approcher des inconnus comme moi, étrangers à son entourage et à son village. Oui, chère lectrice, c’est elle qui fit le premier pas, sans filtre ni hésitation, lors d’une de mes promenades méditatives de fin d’après-midi, m’emboîtant le pas sur près de cent mètres de plage :
— Euh… .
— Moi, c’est Daado, je suis une grande fille et j’aimerais apprendre à vraiment me défendre contre les garçons qui m’embêtent.
— Dis ? Mes amies, Bèmaty, Khadija, Kanni et Daba sont aussi cool que moi (deux pouces levés), alors, elles pourraient venir ? Tu parles Anglais ? Aïe canne spiik juste a litteul, qu’en dis-tu, han ? Je sais déjà où t’habites et je viendrai te voir, OK ? » Et Dècaff de glousser et rejoindre un petit groupe de filles qui sautaient à la corde, en chantant et battant des mains, sur ce bout de plage toujours inhabituellement grouillante de monde à cette heure de la journée, sûrement à cause de la canicule atroce de cet été-là. Yeux grand ouverts d’étonnement, je ne pus que sourire à Dècaff en me disant que « xale bii moo waw bët te liibër ! »
Deux jours plus tard, tôt le matin, alors que je lisais devant mon vétuste et humble logis du moment, un baraquement, cartable d’écolière au dos, Dècaff revint à la charge :
— Euh quoi, Meus-sieur, d’ailleurs ton nom c’est quoi ?
— Guchi.
— C’est un nom, ça ? Pffuit Messieur Chinois.
— Non c’est Japonais, enfin, je crois.
— Comme ça, » rire « t’es pas sûre ? Moi, je suis lebu, ethnie pêcheuse, pure ! Spiik inglish non ?
– Yes…
— Ça fait le compte, je suis nulle en Anglais, je veux des leçons.
— Oui, Madame.
— Je ne suis pas mariée, je ne serai pas marié avant la fin de mes études, et puis il faudra que je trouve le bon homme ! Je n’y pense pas Meus-sieur ! » Je ne pouvais m’empêcher de penser « c’est quoi ce délire ? En tout cas, elle me plaît bien cette ado ou préado de Daado, elle ira loin, très loin ! ».
— Pas besoin monsieur Goû-tchii le Japonais, mes tuteurs savent déjà qui tu es, ils te voient presque tous les jours, et je leur ai dit que tu voulais me donner des cours d’Anglais et ils ont dit oui.
— Quoi ? Ce n’est pas vrai petite, c’est…
— Sauf le respect que je te dois, je ne suis pas ta petite, et puis ce n’est pas grave si…
— Oh si, c’est grave ! Très grave même, parce que tu me fais dire une chose que je n’ai pas dite, je n’en avais aucune idée. Au fait, qui sont tes parents ?
— Ha ha, il faut vraiment que j’y aille, monsieur le Japonais noir, je suis presque en retard. À plus ! » Autant dire que j’étais sur le postérieur. Je sentais, dans mon for intérieur de pessimiste invétéré, que cette gamine au physique qui fera tourner des têtes (fesses encore drues, poitrine déjà en passe d’être généreuse) allait me poser une équation insolvable, mieux, qu’elle serait elle-même ladite équation. Chap-eau et pu-naise ! Toujours est-il que, chère lectrice, c’est ainsi que débuta notre relation platonique fraternelle. Et le reste, comme dirait un Britlandais, c’est de l’histoire.
Aujourd’hui, je peux avouer m’être trompé sur un point, et un seul : l’équation Dècaff n’aura pas été insolvable. Dècaff a tout juste incarné changement et transformation inhérents, jusqu’à devenir une amie et conseillère proche, elle, Dècaff Lady D, petite-fille du patriarche de mon village d’accueil, sur la côte de ce pays qui sourit à l’océan. J’ai vu Dècaff euphorique, déprimée, pensive, en short, robe et habit traditionnel. Des moments de friction, nous les avons eus, par exemple, lorsqu’elle trouvait un aspect de la langue anglaise erroné, ou une technique de self-défense inefficace, ou encore ma méthode de partage de (mes) connaissances gauche et pas claire. Néanmoins, nous sommes toujours parvenus à transcender nos différences de points de vue et avancer ensemble dans ce qui nous lie et nous unit. J’ai dû calmer ses ardeurs, son impatience face à des menstrues qu’elle tardait à voir, alors que toutes ses amies étaient déjà au Freedom, Always ou Nana.
— Parles-en à tes amies, tes sœurs ou ta mère, Dècaff, elles sauront mieux que moi quoi te dire là-dessus. Moi, je sais seulement qu’aucune femme ne semble apprécier l’expérience d’avoir ses règles, et je me garderais de dire que c’est un moment de joie.
— J’ai également eu droit aux sanglots de Dècaff, à la suite de sa première grande déception sentimentale :
— Il m’a trompé, le salaud !
— Tu sais, Dècaff, les hommes tendent à suivre leurs hormones, à penser avec leur bite et à vouloir coucher avec autant de femmes que possible. Si l’homme avec lequel tu sors, toi, Lady Dècaff, va voir ailleurs ou te quitte, c’est qu’il est idiot et ne te mérite pas. Alors, situe tes responsabilités, réévalue tes valeurs et continue d’avancer sur le chemin que tu te seras tracé », lui avais-je dit en substance, ajoutant que c’est en restant elle-même, en refusant par principe de coucher avec quelqu’un pour prouver l’amour qu’elle lui vouerait, tout en poursuivant sa quête d’excellence dans toutes ses entreprises, c’est comme cela qu’elle rencontrera l’homme qu’il lui faut. « La vie est un long fleuve, Dècaff, mais il n’est pas tranquille. Et tant que les chiens aboieront, jamais ne pourront-ils intégrer la caravane qui passe, ils seront toujours dépassés. Toi, tu es dans la caravane, tu es la caravane qui passe : continue de passer, pour atteindre le firmament ! » Câlin, long et intense, et bisou, sincère, me firent ressentir que l’attractivité du corps de Dècaff était certaine. Aux dernières nouvelles, mon Avocat, qui se trouve être son cousin, lui coure respectueusement après. Je suis au courant mais, ni l’un ni l’autre ne le sachant, je me tais.
La plus drastique transformation chez Dècaff semble avoir découlé de la self-défense et des Arts Martiaux : posture (buste) en I, debout et assise, démarche gracieuse, devenue plus confiante (elle marche dans un but précis), mais aussi raisonnement plus mature que celui de ses amies et pairs. Dècaff prend la vie avec philosophie, son quotidien est devenu le théâtre d’application pratique des techniques et enseignements théoriques qu’elle reçoit de moi. « Un esprit sain, dans un corps sain » est sa devise personnelle, une qu’elle aura su nuancer et adapter durant ces années de pratique intense. J’ai réussi, je crois, à lui faire prendre conscience de son corps et ses limites, de la place qu’elle occupe comme être humain au sein de l’univers où elle a autant de droits que de devoirs. J’ai essayé de lui fournir un cadre idéal pour son éclosion existentielle, notamment en étant (elle) non agressive en self-défense et en faisant montre de maîtrise de soi, face aux agresseurs les plus vicieux, ce qui implique, pour se défendre, l’usage de force raisonnable lui permettant de bien traverser cette Forteresse nommée vie, de bien s’en sortir.
Concrètement, des années durant j’ai donné à Dècaff les bases du Shotokan, plus adapté à sa corpulence et son centre de gravité bas, en tirant de ce style des techniques de self-défense combinées à d’autres, issues du Wado et du Krav, le tout étant sous-tendu par le thème « self-défense pour femme ». Ensuite, je me suis arrangé pour que Dècaff prenne une licence sportive et s’entraîne dans l’un des dojo de mon pote Jibédé, 5eDan et sept fois champion poids lourd du Continent. Le but ? Intégrer la Fédération Nationale d’Arts Martiaux, goûter à la compétition sportive, et pouvoir pratiquer avec d’autres karatékas (« pour me mesurer à eux et vérifier tes techniques à deux balles », m’a-t-elle une fois précisé, ricanement à la clé). Je la vois mouiller le gi, kimono, lorsqu’occasionnellement je dirige des séances d’entraînement dans le dojo de Jibédé qu’elle fréquente. « Elle se débrouille bien, » m’a une fois confié le 2eDan et assistant résident de Jibédé, « elle fera bientôt son passage de grade pour devenir ceinture marron, il reste juste son Tekki Shodan, kata à peaufiner, et puis je veux m’assurer qu’elle ne cogne pas comme au Kyukoshinkai, enfin, il n’est plus question qu’elle mette ses adversaires K.O. Elle a déjà perdu deux finales de compète comme ça : assez ! » Rires, de l’assistant et moi.
Jibédé est également satisfait des rapides progrès de Dècaff. En un rien de temps, elle lui a prouvé qu’elle aurait pu intégrer son dojo avec un 3èmeKyu (ceinture verte). Il me l’a confié lors d’une de ses livraisons mensuelles, à mon cabanon, de vingt-quatre bouteilles de sa marque de boisson, Jibédé-Kola, qu’il se faisait le devoir de m’offrir. Jibédé-Kola est exquise ; le design de sa bouteille, plus sensuel que celui d’un parfum Jean-Paul Gaultier, me rappelle les formes d’une jeune doctorante, sexy mais chiante, Kween Kiyâma Adso, qui m’avait déniché, il y a de cela quelques années, pour un entretien sur mes écrits d’universitaire. Bref, Dècaff progresse même si elle stresse à mort pour son passage de grade, elle et moi avons bien travaillé à améliorer sa ma–aï, distance de combat, et son timing en jyu kumite, sparring libre, afin qu’elle puisse affûter ses techniques et mieux assimiler les enseignements avancés de son vrai grand maître : Jibédé.
En fin de compte, de nos jours je ne me fais pas de souci pour ma frangine Dècaff, elle persévérera et réussira. Comme dans ses études, où elle a excellé au point de vouloir tenter, deux ans avant le commun des mortels, le très convoité Baccalauréat Afrançois. Elle parle anglais presque couramment, a toujours été bonne dans toutes les autres matières, et elle vise l’université. « Je ne sais pas encore ce que j’étudierai, l’éducatif ou le social m’iraient bien », m’avait-elle dit un dimanche après-midi caniculaire, lors d’une séance de thé « trois normaux » que nous avions partagé avec le petit Elmaxu, sous le grand arbre qui jouxtait mon premier logis sur cette côte, un baraquement, déjà mentionné. Dècaff, ce n’est que du bonheur, que du changement et de la transformation qualitative. Elle semble avoir cessé d’envoyer ses agresseurs nocturnes à l’hôpital, se contentant de dégager cette énergie positive d’Artiste Martiale disciplinée qui, dans la Forteresse-Vie que Dècaff traverse, sait désarmer les adversaires et agresseurs les plus hardis. Tout cela fait chaud au cœur.
Ma journée commence bien, je finis mon bol de fòondde, bouillie de mil, sans sucre ni lactose, livré à ma porte chaque matin (sauf week-ends) par la fille d’une femme Bamanan qui le prépare mieux que toute autre âme dans ce patelin, j’enfile mon T-shirt blanc et pantalon de survêt noir. Vieux baskets Stan Smith aux pieds, me voilà hors de mon cabanon pour accomplir une partie de ma routine quotidienne. Avant d’aller voir Suléy, le sauveur.
— Ha Haa, ont-ils ri à mes nez et barbe ; tu nous fais marcher là, n’est-ce pas Grand Guch’ ? Toi, taa-fer pour des sous ? a renchéri Elmaxu.
— Non, non, je vous assure que c’est vrai (sourire), j’ai des projets qui l’exigent mais, bien sûr, je ne peux pas vous en parler. En revanche et sans transition, laissez-moi vous féliciter d’avoir maintenant choisi d’apprendre un métier, ce qui vous assurera des boulots à revenu licite, loin de la drogue et autres substances interdites qui écourteraient vos jeunes vies, à coup sûr. Ne baissez pas les bras, assurez-vous de bien traverser toute la Forteresse, enfin, la vie quoi, et tachez de rester sur le droit chemin. Toi, Elmaxu, tu dois retourner à l’école. Je vais en parler à tes parents.
— OK grand Guch’, promis », chantonne Elmaxu.
— Bon, nous verrons ensemble comment caler un autre créneau horaire pour les échecs. Je laisserai aussi à Elmaxu quelques astuces, stratégies, scénarios et théories à méditer, afin que vous puissiez pratiquer davantage, surtout quand je ne serai pas là, étant donné que je vais devoir bientôt m’absenter, même si je ne sais encore pour combien de temps.
— Merci, grand Guch’ !
— Pas de souci les jeunes, prenez soin de vous. Je jette un coup d’œil à la montre déglinguée d’Elmaxu, vois l’heure et réalise que je dois me bouger si je ne veux pas que Suléy ne mette ses meilleures Matières Grises de mécaniciens sur d’autres voitures que la mienne. Très serviable, il est également très sollicité, souvent par des gens qui abusent, mais le sexagénaire ne sait toujours pas dire non. Raison de plus pour que moi, son ami à l’urgence transport et budget négligeable, propriétaire d’une Mercedes 560 SEL W126 d’occasion (carrosserie déjà retapée, cinq pneus flambant neufs achetés) dont le moteur et l’électricité doivent être revus et corrigés, je montre ma tronche pronto.
Son garage se situe non loin du village de pêcheurs où j’habite, sur la grande route qui sépare ce dernier de l’océan et d’où les occupants de voitures qui passent peuvent distinguer les services que Suléy offre, au-delà de sa pancarte bancale, sur laquelle on peut lire, en Afrançois Walluisé (Valafisé), Gaaraasu Suléy, Le Garage de Suléy. Une dizaine de minutes de marche m’attend. Il est 9 h 30.
2
Temps
À environ cinquante mètres du garage, je remarque une dame assise devant. Sur une chaise. Parasol et éventail aux mains. Elle parle aux apprentis de Sulèy, qui s’affairent autour du moteur d’une, on dirait, Nissan Kashskai, l’un d’eux carrément couché en dessous et dont on ne voyait que ses vielles sandales vertes. Trente mètres : je compte, un, deux, trois apprentis. Pour qu’une marque de voiture si récente requière l’intervention clinique du Gaaraasu Sulèy, le problème doit être sérieux. Enfin bref, plus j’avance, plus la silhouette de cette dame me semble familière. L’avais-je déjà vue quelque part ? Où ? Elle se lève, fait trois pas délicats et entre dans la Nissan, côté passager, certainement pour entendre ce que l’autre silhouette, assise côté chauffeur, a à dire sur les réparations. Ce court instant, ces trois pas, suffisent pour me laisser voir son habillement chic, un Wax vert olive tendant timidement vers du vert fluo (sans crever l’œil), cousu façon camisole de Signares du Nord du pays, recouvert d’une sorte de dentelle blanche, à paillettes ou perles argentées, couvrant l’avant et l’arrière du buste de la dame, ainsi qu’une partie de l’épaule, descendant jusqu’au coude ; le reste de la camisole et le bout de pagne que je pouvais apercevoir sont sobrement parsemés desdites perles, disposées de façon à dessiner des feuilles d’arbre triangulaires, impeccablement disposées. La dame porte un foulard de tête vert sans dentelles, expertement attaché et contribuant à faire dégager d’elle une certaine sophistication qui me semblait unique. Et, de ses boucles d’oreilles, collier, et bracelets et chaussures assorties, n’en parlons même pas : c’est juste la classe !
Cela dit, la seule question qui me turlupine présentement est celle de savoir si j’ai déjà rencontré cette dame quelque part, si je la connais, jusqu’à ce que je me retrouve nez à nez avec elle, qui sort de la Nissan en disant à la silhouette qui y est restée (c’est Suléy) : « en tout cas, merci, toi au moins tu fais ton boulot correctement, contrairement à beaucoup de mécanos de cette ville, y compris celui que j’ai appelé hier en urgence : que des nullards et truands, tchiiiiip ! » À entendre ce tchiiiiip singulier, tout me revient. Ça y est, je sais ! C’est la cousine de la jeune doctorante Adso, déjà mentionnée, venue jusque chez moi pour m’embêter. De madame tchiiiiip,je me souviens, en termes de regard qui tue, de xèelu qui traumatise et, vous l’aurez deviné chère lectrice, de tchiiiiip qui achève. Mais, aujourd’hui, je m’en suis rapproché, deux ou trois mètres nous séparent, j’en suis assez près en tout cas pour constater son sourire sublime, presque identique à celui de sa cousine.
« Bonjour tout le monde, salaam, hey Suléy tu t’occupes de moi ou quoi là ? Les réparations sur ma vieille caisse sont terminées ?
— Non Guch’, pas tout à fait. Vois avec Gattax, superviseur des ops. Ta Mercedes est au même endroit. Je termine avec Madame et j’arrive.
— Pas de souci Suléy, » clin d’œil, « à tout de suite. »
Madame tchiiiiip a dû m’entendre et reconnaître ma voix, car elle tourne la tête gracieusement vers moi. Je m’attends à être toisé, mais voilà qu’elle m’adresse l’un des plus gros sourires que je n’ai jamais vus, sourire suivi, gentiment, d’un « mais, je vous connais ? Vous ne seriez pas le sujet de Thèse de ma cousine Kiyâ par hasard ? » Je sens Suléy largué. « C’est Guchi, ou Kanazawa, non ? » Je hoche la tête.
« Moi, c’est Béti Duudu Mam-maty, La Béti, ou bdm, seule et unique. » Elle et Suléy en rient, je souris. « J’ai servi de chauffeur à Kiyâ, pour rallier et quitter ton coin-village paumé-là. Enchantée.
— En effet, je me rappelle. Comment va Kiyâma ?
— Eh bien, superbement ! Elle a fini son Doctorat, Thèse soutenue, quelques corrections requises, confirmée Doc trois mois plus tard. Au fait, apparemment le contrat que vous lui aviez fait signer était si strict qu’après sa Thèse elle ne put faire grand-chose des riches infos recueillies auprès de vous. Je le sais parce qu’elle m’a fait cadeau d’un exemplaire de la version finale de sa Thèse, entre autres. Soit dit en passant, monsieur Guchi, vous êtes une tête » prenant Suléy à témoin, elle ajoute : « très intelligent, machallah !
— Merci, madame, mais c’était il y a si longtemps ! Vous savez, toutes ces choses en moi qui intéressaient votre cousine…
— “Intéressent”, dirais-je plutôt. Parce que, nonobstant le fait qu’elle ait élargi son domaine de recherches, elle désire toujours reprendre contact avec vous, en vue d’autres collaborations potentielles. En ce moment, elle bosse comme chercheuse au Nord-Est de l’Écosse. Bon, assez de ma couz, voici ma carte de visite, je suis assistante personnelle de l’actuel Ministre de la Culture, de la Jeunesse, et des Sports, Tonce Aludba, un Docteur Ès quelque chose comme vous. J’aimerais bien vous entretenir de certaines idées de projets éducatifs que nous voulons mettre en place, et, je le répète, j’ai lu la Thèse de Kiyâ et, par conséquent, je connais vos aptitudes d’intello et de pédagogue. Avez-vous un numéro où je pourrais vous joindre ?
— Non mais, après un petit voyage que je dois effectuer, je vous contacterai. J’ai quitté le baraquement où vous m’aviez trouvé, mais tout traînard de mon village de résidence (et je vous conseillerais de chercher du côté de la Grand-Place, son centre) pourra vous indiquer le cabanon où je réside depuis. À mon retour de voyage, j’aurai déjà acheté un portable, j’en ai besoin. Maintenant, si vous voulez bien m’excuser, madame Béti Duudu Mam-maty, il faut que j’aille voir ma voiture. Ravi de vous avoir revu.
— C’est moi, monsieur Kanazawa. Prenez soin de vous.
— Merci. » Sourire et thumbs up, pouces levés, de ma part, je me dirige vers la cour du Gaaraasu Suléy. Chère lectrice na ngai, mon pote, brûlant est encore une foisce soleil qui ne caresse la peau que dans l’imagination des tubaab fraîchement débarqués d’Europe, malgré le fait qu’il sait tourner ces peaux roses très vite en singes et pangolins du Congo, un peu comme dans un roman de In Koli Jean Bofane, en les boucanant pour consommation effrénée façon bush meat citadine.
Contre ce soleil brûlant, le garage de Sulèy, une concession rectangulaire de la taille d’un terrain de Handball, à peu près, compte seulement quatre petits abris refuges faits de toits en zinc soutenus par des poutres de Bois Rouge et placés aux quatre coins de l’enceinte. C’est sous ces abris que Sulèy place les véhicules en cours de réparation, à court et moyen terme, et sur lesquels ne travaillent pas moins d’une quinzaine d’apprentis au total. Le reste de la concession, en plein soleil, est juché d’autres voitures exigeant un travail à long terme, souvent complexe et désespérant, et sur lesquels Sulèy met les apprentis les moins expérimentés, chaperonnés par de plus anciens dans le métier, précisément ceux qui sont en passe de devenir des superviseurs chevronnés et méticuleux, comme Gattax. Le métier s’apprend durement, les apprentis suent à profusion et doivent vraiment mériter leur place à l’ombre. Suléy les paie bien, il les nourrit durant leurs heures de travail, il les considère comme ses enfants. En même temps, Suléy ne tolère ni laxisme, ni boulot de bas de gamme, sa réputation et celle de son garage sont plus importants à ses yeux que tout autre chose, y compris l’argent.
Une fois par semaine, Suléy choisit deux ou trois apprentis pour travailler avec lui, sur une ou deux voitures de luxe appartenant à des personnalités et/ou munies de systèmes assez-compliquées en termes de mécanique et d’électricité, afin de leur transmettre une ou deux astuces de bonne pratique dans le métier. Tous y passent, et Suléy se fait le devoir de toujours les présenter en personne aux propriétaires de voitures se disant satisfaits de leurs services. De la sorte, lorsque lesdits clients reviennent pour faire faire autre chose sur leur véhicule, ou quand ils recommandent le garage à d’autres, ils citeront le nom d’un apprenti donné qui pourra les tirer d’affaire si le Boss, Suléy, n’est pas disponible (ce qui est souvent le cas). Pour Suléy, c’est une autre façon de permettre à ses protégés de se faire un peu de sous (pourboires) en marge de la paie mensuelle qu’il leur garantit.
C’est comme cela que j’ai fait connaissance avec Gattax, il y a quelques années, à la différence près que je n’avais jamais amené de voiture chez Suléy pour réparation. J’étais venu tout simplement pour lui dire bonjour, en mémoire de son amitié sincère et profonde pour ma défunte mère, Ma’, que lui-même appelait toujours « grande sœur ». « Donc, c’est plutôt une affaire de famille, expliqua Suléy en me présentant à Gattax, j’ai été le mécano de sa mère pendant des années, et cela depuis ses, » il me regarda en souriant « voyons voir, trois ou quatre ans ? Elle avait une Renault 4, je crois, et, lorsque je fis connaissance de grande sœur, qui venait souvent flanquée du jeune homme ici présent, » il me fait une tape amicale « je venais de débarquer fraîchement de notre village commun de Pirud et ne pouvais louer un espace que dans un quartier dangereux et mal famé nommé Sëbër, ce qui ne l’empêcha point d’y venir et, en plus, de m’y amener des clientes. Je suis resté à Sëbër une bonne demi-douzaine d’années. J’ai ensuite changé de perchoir, plusieurs fois, avant de pouvoir acheter le terrain que tu vois là et y installer mon gaaraas : sa mère ne m’a jamais lâché, qu’Esi repose en parfaite paix. Amen. »
Affaire de famille, disais-je tantôt : Ma’ et Suléy avaient été présentés par Tex, mon grand-père maternel, dont Suléy avait longtemps dépanné les véhicules et matériels agricoles à Pirud, avant de monter à la capitale du pays pour s’y faire un nom. Ils étaient devenus de vrais amis. Comme quoi, quand les gens courent après l’argent, vous, sans pour autant déroger sur l’excellence, dirigez-vous vers l’amitié, les relations humaines, la loyauté, parce que tout, y compris l’argent, découle de cet investissement sincère dans l’humain et les relations humaines.
Gaaraasu Suléy est un anachronisme, à plus d’un titre. Il se modernise à faible allure car son propriétaire refuse d’être englouti par les semi-multinationales mondialisées, j’ai nommé les rapaces qui n’en ont rien à faire de l’humain, selon Suléy, ouvrant des stations-service un peu partout, distribuant des uniformes à leur personnel, pour faire cool, personnel très mal formé dans l’ensemble, et sous-payé, insiste Suléy, qui ajoute que ces enseignes ont la réputation de traîner leurs clients insatisfaits dans des tracasseries administratives si énormes que beaucoup de ces derniers se résignent à perdre leurs sous, et/ou à amener leur voiture ailleurs : « j’en reçois un paquet, et beaucoup trop souvent : une vraie peste, ces enseignes-là ! »
Gaaraasu Suléy est également un anachronisme parce que littéralement pris en étau, d’un côté par les agents immobiliers, développeurs d’appartements et autres types de building, ayant pour but de satisfaire cette nouvelle classe bourgeoise de pantins-guignols du Continent, qui, dans leurs habitudes et modes de vie, singent un Occident agonisant ou déjà mort, et de l’autre par des garages hyper modernes munis des toute dernières technologies. De part et d’autre du garage de Suléy, sur cent mètres environ, de chaque type d’enseigne susnommé, il y en a au moins deux. Suléy a même refusé, maintes fois, des offres de rachat de son terrain, de fermer boutique et aller ailleurs, « heureusement que le terrain est à moi, et que je sais un peu lire et écrire », m’a-t-il une fois confié, lui qui, aîné d’une famille de neuf enfants, avait dû quitter l’école à l’âge de onze ans pour apprendre un métier, la mécanique, et ainsi aider ses parents cultivateurs à subvenir aux besoins de leur progéniture. Après quelques épisodes intenses de harcèlement, par des autorités corrompues et non-compétentes, Suléy fit rentrer à l’intérieur de son atelier toutes les voitures et autres bricoles qui gisaient devant, il repeignit le mur extérieur en jaune canaris (« pour leur en mettre plein les yeux ! ») et personnalisa sa pancarte, avec l’aide d’une écriture rose (Gaaraasu Suléy) sur fond noir, aux couleurs de son équipe de football favorite : ASCTas’sa Yaram. Enfin, Suléy devint beaucoup plus strict sur le bruit et l’hygiène de ses apprentis ; il fit construire de nouveaux sanitaires et une salle d’eau au sein de l’atelier, nettoyés par les apprentis selon un rota établi par Gattax, son plus ancien bras droit et le numéro deux du garage. Néanmoins, étant donné que le harcèlement ne s’amenuisait pas pour autant, Suléy dût fouiller dans son carnet d’adresses pour activer « mes relations influentes », dont : Béti Duudu Mam-maty (encore elle !) et son ministre de tutelle ; mon oncle Atéba (aujourd’hui décédé : RIP) ; un Colonel de l’Administration pénitencier ; un sportif de haut niveau ; un Général de Division à la retraite ; une « Madame » (proxénète) ; ainsi qu’un fils-play-boy du Grand Jëwriñ Régional, sorte de chef des chefs coutumiers de toute la capitale. Autant vous dire tout de suite, chère lectrice, que depuis cette activation, on a bel et bien laissé Suléy tranquille ! Et vous m’en voyez ravi : un vrai trésor, cet ami de ma mère.
Ayant pris congé de Béti Duudu Mam-maty et pénétré dans la concession, je m’élance vers le secteur de Gattax, évitant au passage de mettre les pieds dans du iwil bu dèe, huile moteur usé, ou de heurter quelques-uns des outils robustes traînant, çà et là, dans la cour. Le brouhaha est constant : railleries, ricanements, discussions philosophiques entre apprentis sur comment démonter une culasse, ou encore à quel point les concepteurs du moteur d’une certaine marque de voiture afrançoise sont « cons ! », le tout mixé à mes « salut », « ça gaze ? », « nakamu ? », et « quoi de neuf ? » lancés à gauche et à droite.
J’arrive enfin au coin de Gattax, qui se redresse du moteur de ma Mercedes pour m’adresser poignée de main et câlin, graisseux mais cool, façon Black American Hip-Hop :
« tu vas bien, brother, frère, Guch’ ?
— Ouais G, aussi nickel chrome que les gentes de ta Porsche Carrera. » Rires, Gattax et moi.
« Guch’, tu as fait une bonne acquisition là. Nous avons revu et corrigé les suspensions, tes pneus sont top…
— Tu es sûr ? Vous les mécanos, l’on ne peut pas vous faire confiance. » Sans cesser de dégoiser, Gattax feint de m’envoyer un crochet que je fais semblant d’esquiver.
« … cependant », poursuit-il, « la boîte à vitesse était nase, on a dû la remplacer par une vieille, de cinq ans, mais en excellent état. L’électricité est au point, la carrosserie l’est à 95 %…
— Euh, quel est le problème ?
— Eh bien, Moha, que tu connais, » je hoche la tête « dit que le toit doit être refait en de nombreux endroits si tu ne veux pas rouler dans une passoire, lorsqu’il pleut. » Moha, de son vrai nom Mohamed Doomu Ada Baabu, tôlier renommé de sa ville, est aussi un grand ami de Gattax ; il possède son propre atelier non loin de là, travaille quelquefois en collaboration avec Gaaraasu Suléy ; et les deux ateliers se recommandent l’un l’autre à leurs clients respectifs.
« Okay G, boîte et main-d’œuvre vont me coûter combien ? Toi-même tu sais que je suis un pauv’ Chinou qui se débrouille pour joindre les deux bouts. »
— Arrête, yeux-bridés, » me dit Gattax en riant, « et puis, Moha ne compte rien ajouter au prix de tôlerie déjà fixé. Il t’estime beaucoup, je sais, mais mon petit doigt me dit que, » rire « la présente faveur aurait quelque chose à voir avec le fait que Moha se soit récemment mis aux Arts Martiaux et sait maintenant à quel point tu pourrais le tabasser, si jamais tu n’es pas content de ses prestations. Je dis ça, je dis rien hein !
— Gattax, mais qu’est-ce que tu peux être débile ! » Rires, de nous deux, ainsi que de l’apprenti s’activant soigneusement sur ma voiture depuis mon arrivée. »
C’est à ce moment que Suléy nous rejoint, bloc-notes et boîte à reçus en main, pour récapituler toutes les réparations faites sur la Mercedes, le prix de toutes les pièces détachées qu’il aura acheté, la main-d’œuvre, etc.
« Au total, Guch’, 300 000 Francs CFC (Connerie Financière Continentale) mais, comme tu nous avais déjà avancé deux fois 100.000, puis, » Suléy tourne deux pages de son bloc, « 60 000, Gaaraasu Suléy te fait cadeau des 40 000 F restants, SI tu promets de nous revenir pour tout prochain bobo mécanique.
— Mais bien sûr, Grand Suléy, comme d’hab…
— Aah-haa, je t’ai eu p’tit, avoue que je t’ai eu ! » Je hoche la tête et souris. « Sérieusement, rien d’autre à payer : zaat’ssokèy, c’est OK ! » Nous éclatons de rire, tous les quatre, oubliant momentanément la chaleur qui nous accable. Et Suléy de suggérer que je sorte ma voiture faire un petit tour, avec Gattax, en enfilant l’une des combinaisons de mécanicien qu’il avait en rab.
« Les policiers véreux et/ou corrompus te laisseront tranquille, tu auras l’air d’un waacc raxasu, mécanicien, lambda qui essaie la voiture d’un client. Sinon, ne t’en fais pas, le visage de ce vilain Gattax, reconnaissable à cinq mille mètres à la ronde, est également connu de tou-t-e-s et ! » Rires, nous quatre.
— Pas bête, le coup de la combinaison, Suléy, pas bête : merci. »
Petit tour, en effet. Vingt minutes. Autour de la périphérie du marché bordélique local, bout d’autoroute, péage, sortie suivante pour revenir vers Gaaraasu Suléy, via une ruelle rocailleuse qui sert de raccourci, mais également de façon de vérifier les amortisseurs de ma voiture. La rudesse du système de freinage m’a fait tilter. Je trouve la pédale dure : problème de réglage ?
« J’y jetterai un coup d’œil, ne t’inquiète pas », me dit G, « Kéba, l’apprenti qui s’en est occupé, a le pied lourd. Cet enthousiaste de bodybuilding, musculation, oublie souvent que ce qui est léger pour lui ne l’est pas forcément pour le commun des mortels. Gentil garçon, il manque cependant de finesse à mon goût…
— Merci de revoir ça, c’est juste un tout petit peu dur mais me fatiguerait lors des longues distances que je risque de faire. »
Lors de ce tour d’essayage, j’ai également remarqué que G et les apprentis de son coin du garage ont pu adapter à la Mercedes les lecteurs de cassette et CD que j’avais achetés séparément chez un antiquaire de l’audiovisuel. Nous avons même pu écouter une cassette que G sortit de la poche intérieure de sa combi, du son traditionnel, émanant de calebasses sur lesquelles l’on tape avec paumes et doigts, me précise Gattax, et d’un xalam, sorte de petite guitare aux sons nasaux, spécifique à cette partie du Continent, le tout ponctué de voix féminines faisant l’éloge de personnages historiques, de familles nobles, ou encore de quelque épopée. Les voix et rythmes de cette musique sont langoureux, sans être mélancoliques, presque reposants, ils contrastent avec ceux de cette autre musique locale, le mballax, dominante dans les centres urbains du pays, musique majoritairement superficielle en termes de lyrics, mais surtout surbruité au point d’agresser l’ouïe : aucun équilibre entre tempo et rythme, entre instruments traditionnels (comme les tam-tams) et modernes (guitare électrique, orgue, ou encore instruments à vent). Par contre, les sons émanant de la casette de Gattax vous bercent.
« C’est du ngoyaan. Le genre musical et ses interprètes sont originaires de Xabas, bourgade située pas très loin de Pirud, d’où est originaire ta mère, je crois. Suléy raffole de cette musique, mais chut, je n’ai rien dit. » Rires, nous deux.
« Tu sais Gattax, je crois bien que ma mère écoutait ces sons-là, enfin, j’en suis presque certain car les noms ngoyaan et Xabas (mieux, Anidém Xabas) et ce que j’entends aujourd’hui ont jadis empli notre logis. Je devais être très jeune, enfant, mais, oui, cela me revient ndaankk-ndaankk, progressivement, Ma’ les imitait parfois, en les écoutant sur son magnétophone ou, plus tard, sur sa chaîne Hi-Fi : elle retournait une calebasse, sur la moquette ou dans une bassine remplie d’eau (selon le type de son de Bass qu’elle voulait produire avec la base de ses paumes), mettait une bague en argent à chaque Majeur pour créer un son léger qui contrastait, en alternance, avec le Bass, et accompagnait la troupe avec une dextérité que j’admirais, même si je ne restais jamais jusqu’au bout de leurs longs morceaux (dix minutes, en moyenne). Je préférais aller jouer, ou lire. Ma’ connaissait bien les paroles du ngoyaan et donnait de la voix à sa performance.
— Moi, je dis que ta mère avait un goût raffiné ! Que la terre lui soit légère, amen.
— Merci beaucoup, cher ami. Amen !
Rentrant la Mercedes dans Gaaraasu Suléy, je me rends compte à cet instant précis que je connais G depuis longtemps, qu’il a affûté ses armes de jeune apprenti en travaillant sur les voitures Renault de Ma’, et que nous avons à peu près le même âge. Il a été ravi de me revoir des décades après m’avoir perdu de vue, c’est-à-dire, lorsque j’ai amené ma Mercedes chez Suléy, qui m’avait aidé à l’acquérir chez une concessionnaire spécialisée en berlines allemandes mourantes (« d’occasion » ne rend pas justice à l’état de déglinguage avancé des voitures vendues par cette dame).
« Celle-là a du potentiel, elle peut être retapée de façon à garantir ta sécurité sur la route, en plus de répondre aux normes requises dans ce pays. Laisse-moi marchander avec cette sangsue de Bukki Wañaar », m’avait dit Suléy en riant. Il m’obtint un excellent prix, du genre à me laisser une bonne marge dans mon budget pour les réparations.
Une fois dans la cour de l’atelier, je me gare dans un coin isolé, de façon à ne pas gêner, vu qu’en plus des dernières vérifications de Gattax et la tôlerie de Moha Doomu Ada Baabu, j’ai l’intention de laisser la voiture ici jusqu’à en avoir besoin pour mon voyage. Je n’ai pas ailleurs où la garer en sécurité. Je n’ai non plus pas encore reçu, ni plaque d’immatriculation ni papiers d’assurance, ce qui prenait un temps fou parce que j’ai refusé de succomber au piège-engrenage des interminables pots de vin versés pour que ces corrompus du service public fassent leur boulot. D’ailleurs, aussitôt mes voyages à l’intérieur du pays bouclés, je m’empresserai de revendre ma voiture parce que je vais bientôt commencer à être short, court, côté argent. Et, parlant d’argent, je trouve que Suléy a beaucoup fait pour moi sur cette Mercedes et je compte lui laisser les 40 000F qu’il ne voulait pas me prendre, mais, il me faut trouver une astuce. À propos, il est 12 h 30. Presque l’heure du déjeuner. Je connais la paasiong, gargote, à très bonne réputation d’où Suléy et compagnie se font livrer leurs bols de riz-plus-quelque chose tous les jours. J’essaie de m’éclipser mais suis remarqué : alors, je dis à G et Suléy que je reviens tout de suite. Cinq minutes plus tard, me voilà en plein dialogue avec la cool Boss du paasiong, une excellente gestionnaire qui me rappelle toujours Naomi Campbell, mais en plus fine, et de loin plus belle que le Top Model Britlandaise : j’ai nommé nulle autre que madame Ada Baabu, fière de sa Bambey natale, ville qu’elle aime bien apposer à son nom. À Madame Baabu de Bambey, donc, je demande gentiment d’enlever la somme de 30.000F de l’ardoise du Gaaraasu Suléy, somme que je lui remets séance tenante.
« C’est fait, monsieur Guchi, long taayim nô si, ça fait un bail !
— Très bien Madame. Cela fait un bail, en effet. Dites bonjour à Moha de ma part, je n’aurai peut-être pas le temps de passer à son atelier. Je vous laisserai le soin de dire à Suléy pour l’ardoise, il n’est pas au courant et me tuerait si je le lui disais en face. » Rire.
« Pour Moha, je n’y manquerai pas. Ces temps-ci, il travaille beaucoup autour du nouvel aéroport, il y a gagné un marché important. Quant à Suléy, je m’en charge. Ne vous inquiétez pas. Je sais que je le lui dirai deux ou trois fois avant qu’il ne l’enregistre dans sa cabeza, tête, mais il y arrivera. Ce mécano extraordinaire est un homme droit, un bon cœur également, mais qu’est-ce qu’il est tête en l’air ! Surtout lorsqu’il s’agit d’argent et de Maths (gros rire) ! À plus, monsieur Guchi, il faut que j’aille superviser le service.
— Bye, Madame Baabu de Bambey, et merci beaucoup. »
Sur le chemin du retour, j’achète cinq paquets de cigarettes (trois de Camélia, surnommé matt gi, le bois sec, un tabac noir sans filtre, prisé des apprentis de Suléy, je ne sais pourquoi, et deux de Marlboro pour Suléy et Gattax), je prends aussi deux grandes bouteilles de Jibédé-Kola et Sprite, ainsi qu’une dizaine de petits sachets d’arachides grillées façon caaf, c’est-à-dire sans coque. Arrivé, je les pose dans le coin VIP de Gaaraasu Suléy, d’où le Boss dirige les opérations.
« C’est quoi ça, mauvais garçon ? T’es en passe de devenir pire que Tex et ta mère (rire) ! Merci, mais ce n’était pas la peine. Ta fidélité à mon garage me suffit.
— No problem Suléy, pas de souci, je te serai toujours redevable de m’avoir tiré d’affaire en me trouvant et retapant cette Mercedes (je désigne ma voiture du menton, sourire naissant aux lèvres). Au fait, j’avais laissé une bâche dans le coffre. Après la tôlerie de Moha et les vérifications de Gattax, prière de me la couvrir, et merci encore !
— Ce sera fait. Mais, eh, rien ne t’empêche de passer de temps en temps, pour manger, papoter avec nous », je hoche la tête « mais enfin, quand tu seras prêt à récupérer ta caisse, donne-nous vingt-quatre à quarante-huit heures de préavis pour qu’on la lave, l’essaye, et la gare ailleurs. De manière que tu puisses la sortir d’ici sans tracas.
— OK. Ah, Suléy, voici 30.000F ! Pourras-tu t’assurer que l’on y mette de l’essence ?
— Donne à Gattax, qui s’en occupera en temps voulu.
— OK. » Je donne les sous à G, dis bye-bye à tout le monde, et leur montre les talons.
Qu’est-ce que le soleil peut brûler la peau, dans cette ville poussiéreuse et outrageusement insalubre par endroits, ville qui m’exaspère dès que je m’éloigne de la côte ! Et qu’est-ce qu’il fait chaud ! Une chaleur qui comprime mon cerveau, tel un barbecue des testicules de bélier sous le soleil de Midi du jour de l’Aïd ! Ma peau café-au-lait grille, en dépit du karité léger enduit dessus ce matin ! La plage, mon cabanon, la Brise marine : tout me manque, mais ce n’est plus qu’une question de minutes. En attendant, je dois essayer de faire fi de la cacophonie de klaxons qui me tympanise, des insultes, de la bousculade, et du désordre. De la tête aux pieds, je sue mais continue de marcher. Je sue davantage mais marche plus vite. Et voilà qu’arrive la cerise sur le gâteau, j’ironise bien sûr, chère lectrice, j’ai nommé les pots d’échappement (gas-oil, diesel) qui me font éternuer pendant que la poussière, soulevée par voitures, badauds, et vendeurs à la sauvette, m’étouffe. Mes yeux mouillent et piquent, et je me rends compte que depuis trois jours je n’ai pas pris de cetrizine : fuck, putain ! Je marche et sue, mon T-shirt me colle à la peau, je marche et le bruit ambiant m’agace, je marche et le bordel sur la voie publique m’énerve. « Courage ! », me dis-je, « plus que cinq minutes, et te voilà arrivé ! » Un temps. Court.
J’ouvre et suis accueilli par cette odeur subtile de vinyles et de vieux livres, mélangée à celle d’une bougie éteinte il y a un peu moins de trois heures, que vient vite balayer cette Brise en provenance de l’océan. Il me faut passer le balai mais, d’abord, où est cette cetrizine ? Ah, la voilà cachée sous le matelas, on aurait dit les sous de mon arrière-grand-mère maternelle. Allez, j’avale. La sueur qui sèche sur mon épiderme me démange ; en caleçon long, je sors me verser un seau d’eau dessus, d’un coup : soulagement ! En mettant mon T-shirt XL rouge-et-blanc, un des cadeaux reçus de la marque Jibédé-Kola, entre autres tasses, verres, et stylos, je passe en revue la pièce unique qui me servait de logis (« un taudis amélioré, je dirais », selon Dècaff l’espiègle) afin de vérifier que rien n’a bougé. Je suis devenu un peu parano depuis mon cambriolage, enfin, cambriolage est peut-être une légère exagération, vu que les intrus, sûrement étrangers au village de pêcheurs où je perche, à en juger par les empreintes de pas que j’ai pu voir à la fenêtre du cabanon, n’avaient pu anticiper que je ne possédais rien qui n’ait une valeur justifiant leur déplacement matinal jusqu’à mon taudis amélioré : au bout du compte, ils n’avaient rien dérobé.