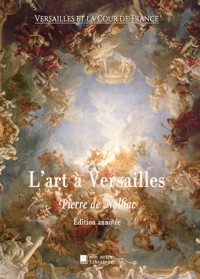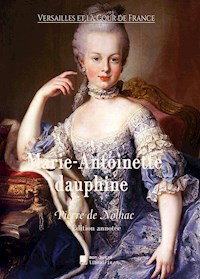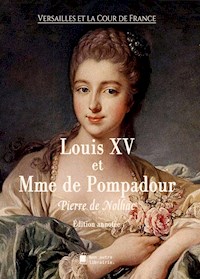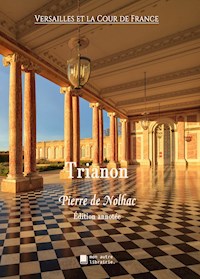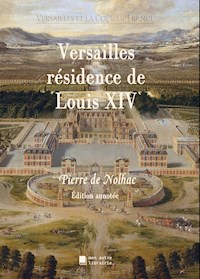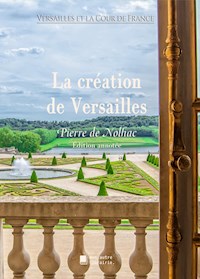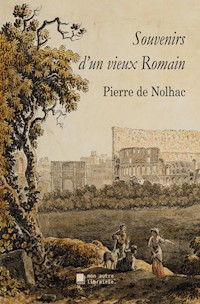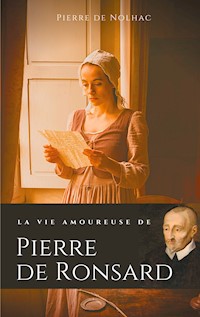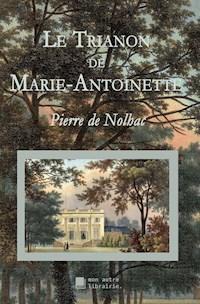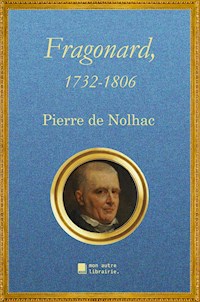
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Biographie tendre et complice d'un immortel artiste par un admirateur fervent, et terriblement documenté. Témoin et acteur privilégié d'une époque bénie des dieux, doué d'un talent rare et reconnu, Fragonard continue aujourd'hui encore de nous ravir par la lumineuse fraîcheur de ses oeuvres. Nolhac apporte avec cette étude certains faits nouveaux qui ont pu orienter les recherches des historiens d'art vers des pistes plus assurées. De plus cette dernière édition comporte quelques rectifications importantes par rapport aux précédentes. Pour les amateurs et les experts, un texte incontournable (37 ill. NB).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fragonard,
1732-1806
Pierre de Nolhac
Fait par Mon Autre Librairie
À partir de l’édition Floury, Paris, 1931.
Les localisations des œuvres sont celles de cette édition
de 1931.
Couverture : Fragonard, autoportrait.
https://monautrelibrairie.com
__________
© 2021, Mon Autre Librairie
ISBN : 978-2-491445-77-5
Table des matières
I. – L’éducation
II. – L’Italie
III. – Le succès
IV. – La famille
V. – Le déclin
Appendices
1 – Le voyage d’Italie
2 – Le voyage de Hollande
3 – Le séjour à Grasse
Note bibliographique
Puisque nul n’ouvre plus le parc aux grilles closes
Où chantaient dans le soir les flûtes de Watteau ;
Puisque Nattier se meurt et qu’au divin coteau
Sa Flore et son Hébé ne tressent plus de roses ;
Puisqu’à Cythère, afin d’y prodiguer ses poses,
Vénus la blonde a pris Boucher dans son bateau ;
Puisque le bon Chardin vieillit et va bientôt
Fermer ses yeux épris de la beauté des choses...
Avec tes clairs pinceaux trempés dans du soleil,
Tu restes le dernier, cher Frago ! sans pareil
Pour coiffer un minois et trousser une guimpe ;
Et le siècle survit en toi, qui sais toujours
Dans les bois du printemps promener ses amours,
Et qui mêles sa grâce aux grâces de l’Olympe.
Le billet doux
Coll. J. S. Bache, New-York
I. – L’éducation
Une âme ouverte à la vie et qui veut l’exprimer tout entière ; un art savant et souple, qui cache sa science en étalant sa virtuosité ; une technique sûre, incomparable dans l’esquisse, égale aux plus habiles dans l’achèvement ; une imagination riche et profonde, qui s’apparente d’un côté à la fantaisie décorative de Boucher, de l’autre à l’observation intime de Chardin, pouvant ramasser des sujets dans la bassesse d’un Baudouin pour les faire accepter des honnêtes gens, capable aussi de monter d’un vol assuré jusqu’aux régions de poésie où Watteau semblait sans rival ; toutes les grâces d’un génie, qui reflète une époque élégante, rêveuse, sentimentale, sensuelle, familiale et sincère ; tout l’esprit d’un temps, tout l’esprit français au bout d’un pinceau... Tel est Fragonard, fils de la Provence et de Paris, un des grands peintres de son siècle et celui qui en a laissé la plus complète image.
On a dit amplement, et non sans excès, ce que Fragonard a pu tirer de sa province natale. Il faut en parler avec plus de mesure, sans oublier que le jeune Provençal fut transplanté à Paris dès ses quinze ans et qu’ainsi se trouva interrompu le contact avec son pays. Ses jeux d’enfant, l’éveil de son adolescence, ont eu pour théâtre cette petite ville de Grasse, qui étage ses vieilles maisons et ses rues étroites parmi les jardins d’orangers, de grenadiers et de lentisques, à mi-hauteur entre les montagnes sèches qui la dominent et les collines qui se pressent devant elle jusqu’à l’horizon étincelant de la mer. C’est un des coins les plus riants de la province ensoleillée, un de ceux où les sens ont leur fête complète dans l’abondance de la lumière, des fleurs et des parfums.
Tout est sain sur ces chemins de Provence, sous ce ciel généreux qui fait, par la vigne et par l’olivier, la vie aisée et le travail sans fatigue. L’homme ne s’épuise, ni ne s’aigrit ; la nature s’efforce pour lui et l’enchante de beaux spectacles, lui présentant à profusion les joies faciles. Fragonard tient de sa race la bonne humeur décidée devant l’ouvrage, cette sobriété dans les désirs qui simplifie l’existence, et l’habitude de savourer fortement ce que la fortune offre d’heureux. Il a aussi, comme tous les riverains de la mer classique, la compréhension vive et rapide de la beauté éparse en l’univers. Simple de goûts, raffiné de sensations, équilibré et lyrique, Frago est de jugement sérieux et d’imagination vibrante. Il y a peu de provinces françaises qui dotent aussi richement leurs fils, car tels sont bien les présents de la Provence au meilleur peintre qu’elle nous ait donné.
Il reçoit par d’autres influences les caractères de son art, le choix de sa vision et les formes que revêt son œuvre pour traduire la vie. Il les doit aux exemples de quelques maîtres, à l’école très libre et très diverse de Chardin, de Boucher et de Vanloo ; il les doit surtout à l’Italie, qui l’a nourri aux heures de la formation suprême et qui a parlé à ce méridional, préparé par des affinités profondes, le langage qui convenait à son génie.
Grasse, ville épiscopale, siège de sénéchaussée et de viguerie, peuplée de gens aisés, aimant à bien vivre et sans morgue pour le pauvre monde, était déjà le centre d’une petite industrie de luxe qui a prospéré. La profusion des roses, des jasmins et des tubéreuses cultivés dans les jardins y permettait la fabrication des essences. Parmi les familles qui s’adonnaient à cette industrie, était celle de Claude Gérard, venue d’Avignon pour faire fortune dans l’aimable cité, et dont l’histoire se trouvera intimement liée à celle de notre peintre. François Fragonard, père d’Honoré, exerçait lui-même un métier délicat : il était gantier. Au reste, notre artiste sort d’une bonne souche bourgeoise, et l’acte de mariage de ses parents suffit à en fournir la preuve :
Le vingt-cinquième mai, après la première publication et la dispense des deux autres accordée par M. le grand vicaire, dûment contrôlée et insinuée, a été célébré mariage entre François Fragonard, fils de Jean-Honoré, qui nous a donné par écrit son consentement, et de Élisabeth Ricord, présents sr Joseph Doussan, son cousin, et Estienne Mandine, d’une part ; et dlle Françoise Petit, fille de sr Joseph, marchand, qui, à cause de ses grandes incommodités, n’a pu se trouver audit mariage, et de feue Marguerite Gaitte, présents Mr Charles Gaitte, procureur, et Mr Christofle Gaitte, ses oncles, d’autre part, tous de cette paroisse, qui ont signé : Françoise de Petit(sic),Fragonard, Doussan, E. Mandine, Gaitte, Gaitte, J.-Joseph Laugier, Martin, curé.
À quelle famille appartenait ce François Fragonard qui se mariait, étant âgé de trente-deux ans, avec une fille de sa condition ? La réponse ne laisse pas que d’être d’un intérêt curieux. Le père, Jean-Honoré, a épousé, en 1681, Élisabeth Ricord ; le grand-père, Étienne, a épousé, en 1637, Pierrette Yssautier, et l’aïeul, Jean-Pierre, a épousé, le 28 octobre 1594, Honorade Brunegou. Celui de ces actes qui regarde Jean-Pierre nous révèle un détail important : c’est qu’il est étranger, venu d’Italie, de Truga ou Bruga, « bourg du Milanais ». Il y a un village de Bruga au pays de Come, et un autre appelé Fregona, dans le Milanais, qui rappelle le nom de famille transplanté en Provence. Bien que ce nom n’existe plus en Italie, on peut assurer qu’à la fin du XVIe siècle un Lombard, Gianpietro Fregonardo ou Fregonardi, a épousé une fille de Provence et a fait souche en ce pays. Son petit-fils fut le grand-père de notre peintre.
Ce grand-père de Jean-Honoré, celui-là même qui, en qualité de parrain, lui imposa ses prénoms, était marchand gantier comme le fut son fils. Le négoce ne l’empêchait nullement de se prévaloir de l’ancienneté de sa famille et de prendre des armes, car il présentait aux commissaires royaux, en 1696, pour être enregistrées, des armoiries « d’azur à trois aigles d’or », qui figurent à l’Armorial de France, au tome premier de la Généralité de Provence. On ne voit pas que le peintre ait revendiqué les armoiries qu’il avait le droit de porter.
Ce fut le 5 avril 1732, dans la rue de la Porte-Neuve, vers le haut de la ville, près de la Place-aux-Herbes, que Jean-Honoré fut mis au monde par la demoiselle Françoise Petit, épouse de François Fragonard. Le curé qui le baptisa le lendemain, à la paroisse, inscrivit dans l’acte les noms du parrain, « sieur Jean-Honoré, son aïeul », et de la marraine, « demoiselle Gabrielle Petit, sa tante ». Les deux Fragonard signèrent au registre. L’enfant ne devait avoir ni frère ni sœur, et le frère aîné de son père, nommé Honoré, devait seul continuer dans le pays, pendant un siècle environ, la descendance française des Fregonardi.
Jean-Honoré eut l’enfance des citadins de son pays. Il alla sûrement chez une de ces maîtresses d’école qu’il devait plus tard peindre si exactement, avec son petit monde de bambins joufflus, à la mine éveillée, et fut sans doute parmi les plus espiègles. Les futurs artistes ne s’attardent pas au grimoire ; on voit plutôt Jean-Honoré jouant dans les rues tortueuses, où le soleil inonde brusquement la partie de billes commencée à l’ombre, escaladant avec ses camarades les remparts abandonnés, s’échappant pour marauder les figues et les muscatelles, courant à travers les vergers, que garde si mal la haie de cactus et qui semblent à tout le monde. Des circonstances inattendues interrompirent la vie joyeuse et simple que Fragonard était appelé à vivre, et, en l’amenant à Paris, décidèrent de sa destinée.
La famille quittait Grasse à la suite d’affaires malheureuses. Le père, assez entreprenant, avait, si l’on en croit la tradition locale, placé ses économies entre les mains de compatriotes établis dans la capitale, les frères Perier. Ceux-ci avaient obtenu l’entreprise de la construction de la pompe à feu de Chaillot ; l’affaire semblant mal engagée, le gantier vint à Paris pour surveiller ses intérêts, pensant au surplus, comme tant de gens de son pays, y faire fortune. Le foyer, père, mère et fils de quinze ans, était facile à transporter au loin. On assure, à Grasse, que le garçon fit à pied tout le voyage, accompagné de Claude Gérard, le distillateur ami de son père, et dont il devait plus tard devenir le gendre. Ce détail, impossible à vérifier, n’est que de mince importance ; Fragonard chemina sur beaucoup d’autres routes, en son temps d’Italie, et à un âge où ses yeux surent bien davantage en profiter.
La vocation du jeune homme ne se manifesta point tout d’abord. Le père Fragonard, qui avait décidément perdu tous ses fonds dans la pompe à feu, avait dû entrer dans la maison d’un marchand mercier et faire accepter les services de son fils chez un notaire du Châtelet. On ne sait en quelle étude fut employé le futur peintre. En celle de Me Dutartre, notaire de la Surintendance des Bâtiments du Roi, fréquentaient quelques artistes et les commis de M. de Tournehem, qui auraient pu s’intéresser au « saute-ruisseau ». Ce mot marque bien les fonctions du bonhomme sans importance, qui porte les plis, fait les commissions et court la ville à toute heure ; emploi agréable, au reste, pour une nature d’observateur, propice aux flâneries et aux musardises, permettant de badauder aux spectacles de la rue et de la rivière, de s’arrêter devant les guinguettes et les rôtisseries, et de suivre d’un pas hardi les jolies filles.
Le petit Provençal y gagna de connaître, en tous ses coins, le Paris pittoresque d’alors, que l’accroissement des fortunes recommençait à transformer, et que Louis XV et Madame de Pompadour songeaient à embellir encore. Parmi tant de merveilles qui sollicitaient la curiosité de l’adolescent, on peut croire qu’il s’émerveilla des peintures vues dans les églises, où les chefs-d’œuvre de Le Brun et de Jouvenet apprenaient au peuple l’existence du grand art, et aussi dans les palais du Roi, où le public était facilement admis et où la bonne humeur d’un suisse pouvait introduire un jeune garçon. Est-ce en remplissant son petit métier, à l’escalier de l’hôtel d’un grand seigneur ou dans l’antichambre d’un financier, que sa vocation, devant une toile décisive, lui fut révélée ? Est-ce dans la boutique d’un marchand d’estampes, chez un des brocanteurs de tableaux qui se multipliaient alors à Paris de façon extraordinaire, ou en contemplant la célèbre enseigne du sieur Gersaint, qui vivait encore ? Les occasions ne manquent jamais à l’éveil des instincts profonds ; mais on doit trouver la plus vraisemblable dans l’ouverture du Cabinet du Roi, au palais du Luxembourg.
C’est une date mémorable, et trop oubliée, de l’histoire de l’art en France que celle de la première exposition permanente, publique et gratuite des tableaux du Roi, au Luxembourg, le 14 octobre 1750. Lépicié, secrétaire perpétuel de l’Académie de peinture et sculpture, et Jacques Bailly, garde des tableaux du Cabinet du Roi, avaient choisi à Versailles et transporté à Paris, dans les salles nouvelles, de célèbres morceaux, parmi lesquels les Raphaël, les Vinci, les Titien, que le Louvre possède encore. Un catalogue fut publié et la galerie chauffée pendant l’hiver aux frais du Roi, pour que les études ne fussent pas interrompues. Au reste, la curiosité du public parisien fut grande, et l’exposition, dès cette première année, eut un nombre extraordinaire de visiteurs.
L’étude des maîtres, que Fragonard devait pratiquer bientôt avec tant de scrupule, se présenta pour lui à l’heure où il cherchait sa voie ; avant même de prendre en main les pinceaux, il put enflammer son imagination au contact des vrais chefs-d’œuvre. Les dates confirment cette hypothèse, car la décision prise par le jeune homme concorde exactement avec cet événement considérable, qui dut décider d’autres carrières moins illustres que la sienne.
Le consentement de son père obtenu, il s’agissait pour lui de trouver un maître qui le voulût prendre en apprentissage. Sa hardiesse méridionale lui fit choisir, du premier coup, l’atelier du peintre à la mode, de l’académicien à grands succès, du fournisseur de la Cour et du favori de la favorite. Mais François Boucher ne prenait point d’élève ignorant les éléments de l’art ; il les lui fallait dégrossis, et lui-même indiqua Chardin pour cette besogne. Honoré resta six mois près de Chardin, en cette maison de la rue Princesse que les œuvres du maître de l’intimité ont peinte si souvent, dans ce milieu honnête et familial où la vie de l’artiste, non moins que son œuvre, donnait une leçon de conscience, de droiture et de vérité. Ses qualités n’étaient point de celles qui retiennent un garçon si jeune, soumis à des tentations diverses, et attiré, comme on l’est à cet âge et comme il l’était plus que tout autre, par l’art brillant et superficiel. Ses premiers travaux ne montrent pas qu’il ait profité des leçons de Chardin, et peut-être l’opposition de leur esprit explique-t-elle, si toutefois le fait est exact, que le maître ait congédié sans peine un écolier à qui on ne pouvait reprocher la paresse, mais qui ne travaillait que suivant son gré. On observe, d’ailleurs, en plusieurs tableaux de la maturité de Fragonard, qu’il a su apprécier plus tard la haute maîtrise de son premier professeur, et qu’il lui a demandé plusieurs fois, avec bonheur, le secret de sa force recueillie et de ses harmonies lumineuses.
Le bonhomme Chardin avait du moins appris à Honoré la grammaire du dessin et le maniement de la palette. Il est sûr, en tout cas, que celui-ci n’avait pas perdu son temps rue Princesse, et qu’il y avait fait autre chose que copier des estampes ou préparer les couleurs du maître ; la rapidité de ses progrès par la suite est la preuve que le vaillant petit peintre avait utilement travaillé pendant ces six mois, et s’était mis en mesure de réaliser son rêve.
On ne paraît pas avoir remarqué le contraste qu’offre la formation première de Fragonard avec celle des peintres français, ses contemporains. Ceux-ci ont commencé leurs études en suivant les cours professés par l’Académie selon des règles immuables ; ils ont, dès le commencement de leur carrière, vécu dans un concours perpétuel, en vue des médailles d’argent données par le Roi et des avantages divers que comporta, dès son origine, une institution qui n’a guère changé jusqu’à nos jours. Fragonard n’a pas, comme la plupart de ses confrères, orienté sa vie d’artiste vers le grand prix de peinture. On voudrait savoir pour quelle raison ce tout jeune homme semble renoncer par avance aux avantages officiels, qu’il obtiendra seulement par une voie inattendue et fort incertaine. Gardons-nous cependant de déductions promptes ; ne voyons pas trop tôt, chez Fragonard, un artiste indépendant et frondeur, bien rare espèce dans la société hiérarchisée du temps ; contentons-nous de noter qu’il entre chez l’académicien Boucher, en refusant les leçons de l’Académie.
Boucher n’habitait plus alors la rue de Grenelle-Saint-Honoré ; il venait de s’installer rue de Richelieu, près le Palais-Royal, où il demeura de 1750 à 1752, à proximité du local qu’il avait obtenu à la Bibliothèque du Roi, au-dessous du Cabinet des médailles, pour exécuter ses travaux de décoration de l’Opéra. Lorsqu’il eut son logement au Louvre, cet atelier fut occupé successivement par Restout, Vien et Houdon. C’est là que travailla Fragonard. La blonde Madame Boucher, née Buseau, n’y venait guère à ce moment ; mais les minois féminins y abondaient, pour la joie des jeunes gens appelés à les peindre. L’atelier de la Bibliothèque du Roi faisait avec celui de la rue Princesse un étrange contraste. Les ménagères du Bénédicité étaient remplacées par des nymphes faciles, fort goûtées de l’homme extraordinaire qui faisait marcher de front le plaisir et le labeur sans mesure. Selon le mot d’un contemporain, « Boucher n’avait pas vu les Grâces en bon lieu », et il ne ramassait pas en meilleur endroit celles qui lui servaient de modèles.
On y rencontrait cependant, au temps de l’apprentissage de Fragonard, les sœurs Murphy, dont une danseuse à l’Opéra et une autre modèle en titre à l’Académie ; la troisième, la plus jolie, ne laissa multiplier sur les toiles de Boucher que les formes adolescentes d’une beauté à laquelle Louis XV ne tarda pas à s’intéresser. On apprit un beau jour qu’elle ne reparaîtrait plus chez le peintre, et peut-être sut-on bientôt qu’elle habitait, à Versailles, la petite maison du Parc-aux-Cerfs, inaugurée par elle. L’aventure de la petite Murphy, parmi tant d’autres, était de celles qui durent assez vite déniaiser le jeune homme et le préparer au scepticisme des choses de l’amour. Tout le poussait à se corrompre, dans le milieu nouveau où il vivait et où se portait à l’extrême le dévergondage du siècle ; et l’on ne saurait exagérer la part qu’eut l’atelier de Boucher en cette étrange insouciance morale qu’on aura trop d’occasions de reprocher à Fragonard.
L’influence professionnelle fut plus grande encore, et aurait pu devenir dangereuse, si elle se fût prolongée trop longtemps ; réduite à deux années à peine, elle garda son utilité. Boucher ne laissait point ignorer que les avantages dont il tirait aujourd’hui les commandes et la fortune lui venaient du sérieux travail qu’il avait accumulé dans sa jeunesse. Si Fragonard vit de près avec quelle aisance naissait sous le pinceau de son maître les imaginations légères, il put se rendre compte que cette extrême facilité représentait une grande science acquise et une longue préparation. Il apprit le secret véritable de cette fécondité surprenante, si rare dans l’histoire de la peinture et que lui-même ne devait pas dépasser.
Il vit achever ou commencer sous ses yeux des compositions fameuses, qui sont de la meilleure période de Boucher, par exemple la Réunion des Génies des Arts, aujourd’hui au musée d’Angers, et le Lever et le Coucher du Soleil, toiles qui ne furent montrées au public qu’au Salon de 1753, mais qui avaient été livrées auparavant à la manufacture des Gobelins, en vue de laquelle l’auteur les avaient conçues. Frago participa aux études nombreuses qu’exigèrent ces morceaux, achetés par Madame de Pompadour. On peut croire qu’il fit le voyage de Bellevue, où l’atelier venait de terminer la galerie de la marquise, et celui de Fontainebleau, où l’on entreprenait la décoration de la salle du Conseil ; Frago s’est assimilé à merveille les délicatesses vaporeuses de ce plafond et de ces panneaux, les tons légers des étoffes, le rose chair des enfants qui représentent les Saisons ; bien souvent il a semblé se souvenir de ce chef-d’œuvre, auquel son pinceau d’élève a peut-être collaboré.
Il n’a pu travailler aux cartons commandés à Boucher pour la manufacture de Beauvais. Il n’était pas encore à l’atelier quand le maître composait, en 1749, la tenture des Amours de Diane, une des plus importantes de son œuvre. En revanche il fut employé à préparer plusieurs décorations d’hôtels que les particuliers demandaient de tous côtés à Boucher, et celui-ci lui fit faire des répétitions de ses tableaux, par exemple celle d’Hercule et Omphale, livrée à M. de Sireul, qui avait vu l’original chez Randon de Boisset. Frago acquit ainsi, en peu de temps, la manière de Boucher, et l’on a, de sa façon de peindre à cette époque, des spécimens curieux qui ont été attribués indifféremment à l’un ou à l’autre artiste. Deux pastorales notamment, la Bascule et le Colin-Maillard, qui sont aujourd’hui en Amérique, ont trompé jusqu’aux graveurs et ont été restituées à Fragonard, après avoir été données à Boucher. La jeune paysanne aux yeux bandés, qu’un galant chatouille d’une paille, fut un sujet favori de celui-ci, ainsi que le jeu de la bascule qui, cette fois, renverse le joueur en élevant la joueuse ; les enfants sont de pures figures du maître ; enfin, les feuillages et les accessoires achèvent d’expliquer une méprise qu’on peut dire honorable pour l’écolier, puisqu’il n’a point persévéré dans l’imitation.
De cette période de formation datent sans doute les dessins, têtes de vieillards de grandeur naturelle, qui furent vendus après le décès du peintre Baudouin, et que celui-ci tenait peut-être de son beau-père ; le portrait peint d’un philosophe appuyé sur sa main, haut de trois pieds, est dit par le catalogue « plein de ragoût, d’une touche claire et facile », et Basan achetait à la même vente une Récréation dans unparc, qui pouvait être une des premières peintures de Frago. Vers le même temps, et sous la même influence, il a composé aussi dans le genre mythologique ; il y a de lui un tableau authentique, représentant Diane et la nymphe Calisto, où il s’approprie le genre de Boucher avec une habileté égale à celle que montrera plus tard Deshays lui-même.
Boucher était trop content de Frago pour ne pas lui réserver une récompense, et trop honnête homme pour user indéfiniment, à son profit, du jeune talent si rapidement formé. Il lui conseilla de concourir pour le grand prix de Rome. Frago ne remplissait pas les conditions réglementaires, n’ayant pas suivi les cours de l’Académie. « Cela ne fait rien, dit Boucher, tu es mon élève ! » Le maître était, en effet, fort influent ; le règlement fléchit en faveur du disciple exceptionnel d’un confrère important, et Frago concourut avec les élèves de l’Académie, pour la première esquisse, au début d’avril 1752. L’usage était de tirer le sujet de la Bible. Carle Vanloo, professeur, s’enferma avec les élèves et leur lut les versets du Livre des Rois se référant à l’histoire de Jéroboam. Parmi les esquisses retenues se trouvèrent celles de Fragonard et de Gabriel de Saint-Aubin. On entra en loges pour l’exécution des tableaux définitifs et, le dernier samedi d’août, les académiciens assemblés donnèrent leur suffrage à Fragonard. Saint-Aubin, découragé, renonça à la peinture ; le siècle y gagna un exquis dessinateur et perdit un peintre d’histoire, ce qui se remplace aisément.
Nous avons, dans les collections de l’École des Beaux-Arts, le « concours » de Fragonard, qui remporta le prix. C’est un des meilleurs tableaux d’école de cette époque ; le jeune artiste semble avoir voulu montrer qu’il savait s’émanciper de la manière de son maître. Loin de rappeler Boucher, la composition est plus proche de De Troy et de Le Moyne ; d’autre part, le roi d’Israël, le grand prêtre, le suppliant, pourraient être dessinés par Cazes ou par Galloche. Mais, dans le choix et le groupement des tons, un sentiment personnel se révèle, les blancs et les jaunes pâles jouent heureusement dans les draperies du premier plan ; les fumées d’encens montant devant le Veau d’or annoncent les vapeurs dont le peintre usera si souvent ; enfin, ses larges trouées de lumière affirment déjà son désir de peindre en clarté.
Depuis quelques années, le grand prix de peinture ne conférait plus le droit d’aller directement à Rome. On avait eu à déplorer des choix prématurés, et l’insuffisante préparation de beaucoup d’artistes ne leur permettait point de faire honneur aux libéralités du Roi. Pour voir « refleurir le temps de Colbert », ainsi que le demandait Lépicié à M. de Tournehem, directeur général des Bâtiments, celui-ci avait proposé au Roi d’imposer une sorte de stage à Paris pour les futurs pensionnaires de Rome. Le premier peintre, Charles Coypel, suggéra l’idée d’un établissement spécial destiné à donner, sous la direction d’un maître autorisé, ce que nous appellerions aujourd’hui l’enseignement supérieur des Beaux-Arts. Cet établissement, qui fut l’École royale des Élèves protégés, s’ouvrit le 1er janvier 1749, ayant pour gouverneur Dumont le Romain, presque aussitôt remplacé par Carle Vanloo. Les élèves, au nombre de six, quatre peintres et deux sculpteurs, y restaient trois ans ; c’était, pour les grands prix de peinture et de sculpture, une période excellente de préparation au séjour en Italie.
Fragonard entra à l’École royale le 20 mai 1753. Il y rencontra Deshays de Colleville, qu’il avait connu chez Boucher et qui allait partir pour Rome ; ses compagnons furent Charles Monnet, élève de Restout, Guyard, sculpteur, élève de Bouchardon, les deux frères Brenet, dont l’un était sculpteur, élève de Slodtz, l’autre, élève de Coypel et de Boucher, le sculpteur Delarue, élève d’Adam, et son frère aîné, peintre, élève de Parrocel. Ce dernier venait d’être par faveur, et au grand mécontentement des académiciens, chargé de peindre les « Conquêtes du Roi », commencées par son maître, et, de ce chef, « dispensé du voyage de Rome ». Frago put connaître aussi Dhuez, d’Arras, élève de Le Moyne, et le fils de Chardin, le jeune Sébastien, qui devait mourir misérablement à Venise. Pajou était déjà en Italie, et Clodion n’entra à l’École qu’après le départ de Frago.
Les élèves, dont l’aîné n’avait pas plus de vingt-cinq ans, vivaient dans une maison appartenant au Roi, qui touchait au palais du Louvre, entre la place du Vieux-Louvre et la rue Fromenteau. Elle communiquait, par l’appartement de Lépicié, aux salles de l’Académie qui contenaient les plâtres d’après l’antique, à l’usage des études. « Monsieur le Gouverneur des élèves protégés par le Roi », Carle Vanloo, recevait quinze mille livres par an pour subvenir à la cuisine, au service, au chauffage, au modèle vivant, aux moulages pour les sculpteurs. Une gratification annuelle de trois cents livres était délivrée, par le premier peintre du Roi, aux élèves qui n’avaient pas démérité.