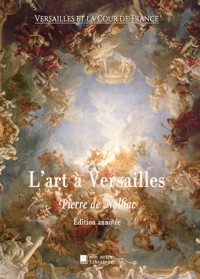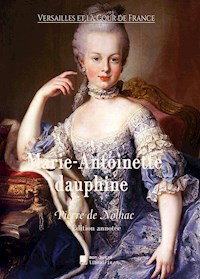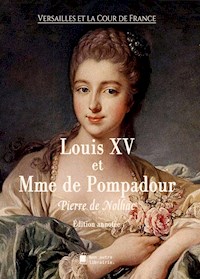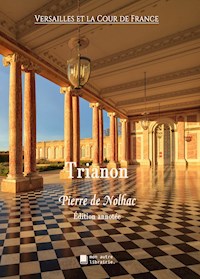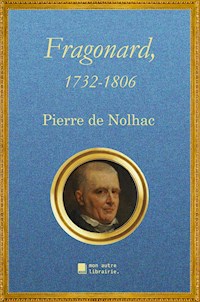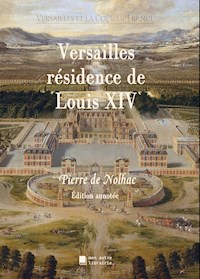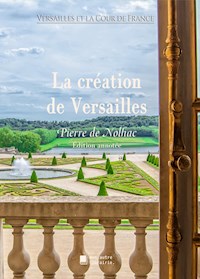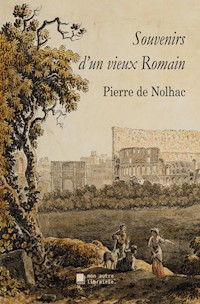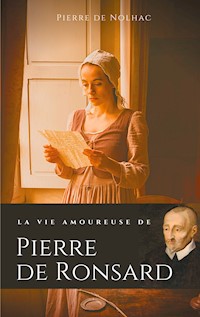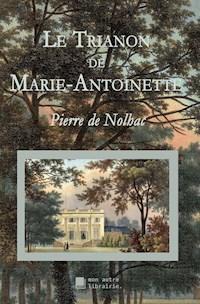Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
L'auteur revient sur ses années en tant que conservateur du château de Versailles, et sur les difficiles combats qu'il a dû mener pour sauver du délabrement ce qui est aujourd'hui l'une des splendeurs de la France. Il nous fait découvrir cette période ambigüe où le château désert louvoyait entre musée et parlement, un récit qui nous fait d'autant plus apprécier les merveilles du Versailles retrouvé.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fait par Mon Autre Librairie
D’après l’édition Plon, Paris, 1937
__________
© 2020, Mon Autre Librairie
Édition : BoD – Books on Demand
12/14 rond-point des Champs-Élysées, 75008 Paris.
Impression : BoD - Books on Demand, Norderstedt, Allemagne
ISBN : 978-2-491445-19-5
Dépôt légal : janvier 2020
la résurrection
de Versailles
Souvenirs d’un conservateur, 1887-1920
Pierre de Nolhac
Table des matières
Introduction
I – L’ACCUEIL DE VERSAILLES
II – LES PREMIERS TRAVAUX
III – LE NOUVEAU MUSÉE
IV – PREMIERS PRINCES EN VISITE
V – QUAND VERSAILLES RENAISSAIT
VI – l’ère des combats
VII – LE PARLEMENT DANS VERSAILLES
VIII – LE TSAR ET LES ROIS
IX – LES VISITEURS
X – VERSAILLES À LA MODE
XI – VERSAILLES ET SES AMIS
XII – ANNÉES DE GUERRE ET DE PAIX
Introduction
J’emporte dans l’oubli des milliers de visages,
Mes maîtres, mes parents, mes héros, mes amis.
Des noms, des souvenirs que je n’ai pas transmis,
Un trésor de secrets, de récits et d’images.
Le Rameau d’or.
Si j’écrivais les mémoires de ma vie littéraire, j’amuserais assurément mes vieux jours, mais je ne rendrais service à personne ; il se trouve au contraire qu’un long labeur parallèle m’a fait participer à la rénovation de Versailles et à ce mouvement d’esprit qui a réintégré son art et ses souvenirs dans l’âme nationale. Voici sur cette grande œuvre le témoignage de celui qui a pu en apparaître alors comme le principal ouvrier. De ce rôle dont ma jeunesse eut l’honneur immérité, je dirai les origines, les responsabilités et les combats ; j’évoquerai surtout des temps, des hommes et des circonstances qu’il convient de sauver de l’oubli, et c’est par des anecdotes et des récits que je ferai mieux sentir sans doute l’évolution spirituelle qui nous a restitué Versailles.
Au moment de les livrer au public, ils m’apportent pourtant un scrupule : un historien de métier a trop pratiqué la littérature des souvenirs pour ignorer quelle part d’erreurs ajoute le travail inconscient de l’imagination aux incertitudes de la mémoire. Je n’échapperai pas au sort commun ; d’autres assureront le lecteur de leur exactitude, je ne lui promets que la sincérité.
PREMIER SOUVENIR
Un jeune voyageur vient voir Paris en 1878. C’est l’année où les provinces lointaines envoient à l’Exposition universelle des millions de visiteurs. Celui-ci n’a que dix jours pour dévorer Paris, ses monuments, ses musées, ses théâtres, sans parler des merveilles assemblées au Champ-de-Mars et au Trocadéro. L’avidité de ses dix-huit ans n’est pas épuisée quand il réserve à Versailles son dernier après-midi.
Est-il attiré par ce grand nom ? Sans nul doute ; mais il tient aussi à y rencontrer un poète qu’il admire entre tous et près de qui doit l’introduire une lettre d’ami. Les deux Chambres siègent encore au Château, et Leconte de Lisle est bibliothécaire au Sénat. Le jeune homme, tout à son désir littéraire, franchit la grille royale, la grande cour que dominent les statues colossales placées par Louis-Philippe, et se dirige vers l’aile de la chapelle. Des galeries encombrées de moulages de tombeaux historiques, partout des inscriptions destinées à MM. les sénateurs et à leurs commissions, des portes capitonnées que gardent des huissiers à gilet rouge et, en haut d’un escalier, en lettres énormes, le mot : bibliothèque. Peut-on se douter que, derrière les rayons de la vaste salle, se cachent les toiles d’Horace Vernet sur les campagnes d’Algérie, le siège de Constantine ? Et le jeune visiteur pourrait-il prévoir qu’il aura à effacer un jour sur ces murs toutes ces inscriptions parlementaires ?
Ce jour-là sa déception est vive : le Sénat ne tient pas séance et M. Leconte de Lisle n’est pas venu de Paris. Il faut se contenter de Louis XIV. On ne voit dans les intérieurs que la Galerie des Glaces et les salons voisins, mais les jardins sont publics et c’est un enchantement. Ces façades majestueuses, ces perspectives, cette promenade sur la terrasse à la recherche des marches de marbre rose : voilà de quoi faire de belles heures. Plus loin, devant le hameau de Trianon où le souvenir de Marie-Antoinette le rappellera si souvent, voici que, pour l’écolier d’hier, une ligne de ses manuels d’histoire devient vivante. Que d’horizons de l’esprit se sont ouverts à lui en cette journée ! Il part, bien décidé à revenir, ayant savouré dans la solitude un des grands moments de sa vie ; et le soir, sur son carnet de voyage, il écrira, l’imagination pleine de ces images : « Ce qu’il y a de plus beau à Paris, c’est Versailles. »
I – L’ACCUEIL DE VERSAILLES
Le Versailles que j’ai connu, – avant l’époque d’action que j’ai à raconter, – était une ville infiniment noble, majestueuse et triste. Son château, où les foules ne venaient plus que pour le jeu des eaux, gardait dans le silence le reliquaire de ses souvenirs. Ses avenues conçues pour des temps de gloire devenaient prairies le long des chaussées trop larges, et ce vaste désert de la Place d’armes semblait séparer deux villes distinctes, tant il était long à franchir. Les rues régulièrement dessinées n’offraient nulle part cet enchevêtrement des vieux quartiers des villes de France ; l’herbe y poussait parfois entre les pavés, comme dans la cour du Château. La paix qui y régnait étalait à leur dignité une mélancolie dont l’amour-propre des habitants ne voulait pas convenir, et dont les étrangers de passage ne sentaient pas la douceur.
Il était plus facile qu’aujourd’hui de retrouver les lignes de l’ancienne ville de cour. On voyait mieux les nobles hôtels du dix-septième et du dix-huitième siècle, çà et là défigurés par une bourgeoisie confortable qui les occupait depuis la Révolution, mais indemnes de l’outrage des immeubles modernes qui les supplantent ou les écrasent. Versailles avait par exemple pour hôtel-de-ville ce charmant hôtel de Conti, aux salons intacts, qu’a remplacé si pompeusement une bâtisse sans style. C’était un édifice municipal digne de son histoire. Partout régnait encore la consigne du grand Roi, qui avait voulu que toutes les perspectives de son palais s’achevassent sans rupture sur l’horizon des bois et des collines. Celle du canal, qui mène le regard jusqu’à l’infini de la plaine, est la seule qui demeure à peu près sans altération et garde l’harmonie que le siècle créateur a conçue.
Cette cité du passé retombait dans le silence, après avoir vu la guerre, la Commune et le séjour des Assemblées lui ramener pendant plusieurs années les bruits de l’histoire. Quelques érudits, quelques cœurs fidèles en cultivaient les souvenirs, attiraient les gens paisibles, les officiers à la retraite, les fonctionnaires déchargés de leur fardeau, et il existait autour de l’église Saint-Louis, bâtie sous Louis XV, toute une société de familles anciennes qui cultivaient à l’écart de l’autre ville, dans une réserve un peu hautaine, ses préjugés et ses espérances. C’était auprès d’elle que le comte de Chambord avait fait ce séjour secret et inutile, dernière tentative pour rendre à la France la dynastie royale, à laquelle s’unit indissolublement le nom de Versailles.
Ces souvenirs, ceux de l’Assemblée nationale et de la répression de la Commune, étaient évoqués sans cesse, ainsi que l’occupation allemande. On se rappelait que la Préfecture était la résidence du roi de Prusse ; l’hôtel du Gouvernement, le quartier général du prince Frédéric-Charles. On montrait la maison où Bismarck avait imposé à Jules Favre les dures conditions de l’armistice. Au Château, personne n’oubliait que la grande galerie, toute parée des victoires de Louis XIV, avait vu sanctionner notre défaite dans une cérémonie solennelle et voulue, la proclamation de l’Empire par les États confédérés de l’Allemagne. L’Orangerie rappelait aux Versaillais l’emprisonnement de ces communards ramenés sous les huées après la prise de Paris, et bien des gens se souvenaient d’avoir entendu les fusillades justicières sur le coteau de Satory.
L’histoire avait vraiment beaucoup visité Versailles. Un gouvernement en fuite, puis la grande assemblée réparatrice de 1871 y avaient siégé. Enfin les deux Chambres établies par la Constitution de 1875 avaient légiféré côte à côte, trois ans à peine, le Sénat dans l’ancien Opéra de la Cour, la Chambre dans une salle neuve construite pour elle et qui ne sert plus que pour élire le Président de la République. On était sous le règne du premier élu, M. Grévy, et déjà le retour définitif du Parlement à Paris ne laissait plus dans le Château que les abus d’une occupation tenace et le désordre imposé pour longtemps aux collections du musée de Louis-Philippe.
Ce musée, logé tant bien que mal dans un palais d’habitation, se trouvait plein de richesses insoupçonnées ; mais le public en avait perdu le goût, du moins celui que n’attirait plus la peinture militaire qui paraissait le remplir tout entier. On n’y voyait que les zouaves d’Horace Vernet et les Napoléon de la galerie des Batailles. Les grandes toiles par lesquelles le Second Empire venait de continuer une tradition picturale remontant à Louis XIV, ne parlaient plus aux cœurs français accablés par le désastre de Sedan ; et Versailles pâtissait d’un dédain explicable, sinon justifié par les circonstances du temps.
L’indifférence de l’État pour Versailles se marquait encore au délabrement où on laissait les bosquets. Les bassins continuaient à se disjoindre et les jeux d’eaux se ruinaient peu à peu. Un seul chantier restait ouvert, considérable, il est vrai, celui de Neptune. Peu visité des étrangers, le parc, ou plutôt le jardin, selon le terme ancien, appartenait uniquement aux habitants de la ville. Les retraités et les enfants avaient pour lieu de rendez-vous l’allée très abritée qu’on appelait la « Petite Provence ». La jeunesse jouait au pied de l’Hiver de Girardon, tout près des charmants bronzes des Marmousets. Aux beaux soirs de l’été, des familles se retrouvaient à la « plage », c’est-à-dire au perron qui domine Latone et qui, après le coucher du soleil, recevait de tous côtés la fraîcheur des bois.
Ce n’était pas un poste bien enviable que confiait un ministre au jeune savant désireux de s’attacher à l’administration des Beaux-Arts. L’arrêté que signait une main indifférente ne conférait que peu de prestige et peu de droits. Mais ce papier, daté d’octobre 1887, qui ouvrait une carrière, était la consolation d’un échec. Stagiaire à la Bibliothèque nationale depuis mon retour de Rome, j’avais pris part au concours institué pour une place d’attaché au Cabinet des Estampes. Mais, rompu au commerce des manuscrits grecs et latins, j’étais mal préparé à répondre sur Rembrandt ou sur les procédés de la gravure au burin. Sur trois concurrents, on me classa troisième ; mes vainqueurs étaient : Courboin qui méditait de devenir, comme il le fut en effet, conservateur en chef du département ; l’autre, Paul Leprieur, qui devait finir conservateur des peintures au Louvre. Leur avenir pouvait être le mien. La chance m’envoya au poste le moins recherché : celui d’attaché à Versailles.
Veut-on savoir comment on pénétrait alors dans ce service des Musées nationaux qui est aujourd’hui devenu si important ? Le hasard d’une conversation, l’appui d’une amitié y pouvaient suffire. Gabriel Monod, un de nos respectés anciens de l’École des Hautes Études, me dit un jour :
– La situation qu’on vous fait à l’École est insuffisante. En voici une qui va être vacante ; Léonce Bénédite quitte le Musée de Versailles pour celui du Luxembourg ; vos titres d’ancien romain l’emporteront ; c’est fort peu payé, mais on est logé, et l’air de Versailles sera bon pour vos jeunes enfants.
Le conseil était à suivre ; il fallait seulement l’agrément du directeur des Musées qui pesait les titres : Louis de Ronchaud, un lettré d’autrefois, d’un caractère amène et ferme, qui avait souffert pour la cause libérale et orné son existence par le culte de Lamartine et celui de Mme d’Agoult. Mes références de paléographe l’eussent laissé froid, mais il apprit que je faisais aussi des vers, ce qui le décida en ma faveur. Qu’on ne dise pas que la poésie ne sert à rien : ma vieillesse lui doit la joie d’une amitié innombrable, et, sur le seuil de l’avenir, elle m’accueillait en la personne de ce lamartinien fervent, qui souhaitait de voir naître des sonnets parnassiens dans les bosquets de Le Nôtre.
La fonction ne s’annonçait point accablante. Tandis qu’on préparait au nouvel attaché un appartement assez somptueux dans une des ailes des ministres, faite sous Louis XIV pour l’habitation des secrétaires d’État, je venais de Paris trois fois par semaine et, après une courte promenade, écoutais docilement les instructions du conservateur, le peintre Charles Gosselin. Ce Parisien cultivé, homme d’esprit, se jugeait en exil à Versailles. Fils de l’éditeur des romantiques, la faveur de la famille Hugo et du ministre Lockroy lui avait valu une place occupée avant lui avec plus d’éclat par Eudore Soulié et le comte Clément de Ris. Ami de sa tranquillité, il peignait dans l’atelier des paysages qu’achetait l’État, et se fût satisfait de cette sinécure s’il n’avait eu à soutenir une lutte quotidienne contre le service qui gouvernait alors le Château.
Nous faisions petite figure à côté de ce potentat qu’était le régisseur de Versailles. Il portait le nom de famille de Mme de Pompadour et l’on se demandait s’il ne devait point à la protection posthume de la favorite les fonctions qu’il grossissait de son importance. Conservateur du palais et des jardins, chef du personnel tout entier, M. Poisson commandait à cent cinquante agents, surveillants militaires, gardiens et portiers. Il pouvait regarder de haut le collègue chargé de la conservation des tableaux et sculptures, qui disposait pour tout personnel d’un brigadier sans brigade, d’un « peintre de lettres » inoccupé et d’un garçon de bureau somnolent. C’était entre les deux services des contestations sans fin pour le déplacement d’une toile, l’ouverture d’une porte ou la réception d’un visiteur. Les notes aigres-douces s’échangeaient d’un pavillon à l’autre ; les rapports irrités allaient solliciter l’arbitrage du ministère pour des niaiseries. Chargé de rédiger cette littérature, j’appris dès lors l’usage de ce style administratif qui insinue le grief avec courtoisie, dénonce les « empiétements regrettables » qui compromettent « la bonne marche des services » et sollicite sans illusion « la fin d’un état de choses qui ne peut durer ».
Je faisais cet apprentissage dans un entresol de la conservation éclairé de bas en haut par une imposte de la cour royale, et situé au-dessus d’un atelier à demi historique. C’était celui où le peintre de Guillaume Ier, Anton von Werner, avait fait son tableau de la proclamation de l’Empire allemand, dont un agrandissement orne les murs de l’Arsenal de Berlin. La toile, placée au Palais-Royal dans la galerie qui conduit à la salle Blanche, fournit une illustration exacte et, pour nous, émouvante à l’histoire de notre Versailles.
Ce local était meublé d’une collection reliée de la Revue des Deux Mondes. J’avais tout loisir de feuilleter les livraisons buloziennes de l’âge romantique, de goûter les récits des Temps mérovingiens et les Lettres d’un Voyageur. Au mur quelques portraits anonymes posaient devant mon esprit les premiers problèmes d’iconographie que je devais par la suite rencontrer et résoudre en si grand nombre.
Les magasins du musée étaient pleins de ces incertitudes. Le résidu des collections non utilisées par Louis-Philippe s’y mêlait aux séries déménagées pour l’installation des Chambres ; des sculptures de toutes sortes s’entassaient ailleurs, et l’on sentait aisément que des trouvailles intéressantes devaient, là aussi, se faire un jour.
Mes grandes surprises étaient de découvrir tant de morceaux précieux inscrits au catalogue, mais soustraits depuis bien des années au public qui ne les réclamait pas. Ces « Attiques » du nord et du midi, où les attributions fausses frappaient même des yeux ignorants, laissaient deviner bien des chefs-d’œuvre sur les murs, dans l’affreux entassement que rappelle encore à Florence l’arrangement des portraits historiques, dans le passage qui va du Palais Pitti aux Offices, par-dessus le Pont-Vieux. C’était pour ma naïveté de débutant un objet de scandale dont je faisais part à mon conservateur :
– N’y avait-il pas quelque triage à faire ? Ne devrions-nous pas présenter, sauver peut-être, quelques morceaux de prix dans ces galeries que l’état des services ne permettait pas de rouvrir ?
– Jeune homme, disait mon chef, ne vous emballez pas. Sachez bien que je n’ignore pas les richesses que nous avons là-haut ; mais il n’est aucun moyen de les mettre en valeur ; croyez-moi, n’en ébruitons pas l’existence, notre fonction est de les conserver, ce qui est d’autant plus facile qu’elles se conservent toutes seules.
– Mais, dis-je, elles se conservent fort mal ; nos attiques, peu chauffés l’hiver, ont trop de chaleur en été...
– C’est la faute de Louis-Philippe et non la nôtre ; il n’y a point de péril urgent et, si je soulevais une question aussi grave, l’administration ne m’en saurait aucun gré. Pas de zèle, jeune homme ; écrivez des livres sur Versailles, si cela vous amuse, mais laissez en paix ce musée qui n’intéresse plus personne.
Réduit à m’occuper d’histoire, j’abandonnai toute velléité de labeur professionnel. À peine installé dans mon aile, je cherchais à savoir qui avait habité aux mêmes lieux et dépouillais d’anciens états de logements sous Louis XVI, que le hasard avait laissés dans nos archives. Je les imprimais même sans retard dans les mémoires de la Société des Sciences morales de Seine-et-Oise, avec une série d’études sur l’ancienne topographie du Château où se rectifiaient maintes légendes introduites par l’ouvrage de M. Dussieux. Professeur de géographie à Saint-Cyr, auteur d’un atlas estimé et de compilations utiles, ce brave homme avait cru aisé d’improviser en un an ou deux un gros travail sur le Château. Un éditeur dévoué à la ville en avait fait deux volumes ornés de gravures et de plans où rien ne manquait, sauf la méthode et l’exactitude.
Quand parut pour cinquante personnes l’opuscule sur Versailles au temps de Marie-Antoinette, je soulevai l’indignation dans la cité. Habitué aux comptes rendus sévères de la Revue critique et aux polémiques sans aménité de la philologie allemande (stultissime dixit Mommsen), j’avais cru user des plus grands ménagements en signalant en quelques chapitres de Dussieux la légèreté du travail et l’insuffisance de l’information. En cette province ouatée qu’était Versailles, cette franchise parut déplacée ; et j’ai gardé l’article virulent par lequel un ami anonyme de l’écrivain réfuté exprimait son indignation et remettait à sa place ce nouveau venu, jaloux des gloires locales les plus assurées.
On devait en voir bien d’autres, car, étudiant dans la suite le Château sous Louis XV, puis sous Louis XIV, je dus m’apercevoir que les erreurs foisonnaient de plus en plus, et qu’il devenait impossible de comprendre les anecdotes royales et la vie même de la cour dans cette confusion de désignation et cette chronologie de fantaisie. J’en ai voulu longtemps au « bon père Dussieux » pour avoir usurpé ma confiance et jeté mon travail sur tant de fausses pistes. Il est mort à temps pour ne pas souffrir de voir démasquer sur tous les points son érudition trop facile.
Une aventure plus littéraire tentait ma plume. La somptueuse revue les Lettres et les Arts, qui avait pourdirecteur Frédéric Masson, m’avait demandé deux articles sur les Trianons. Ils parurent, brillamment illustrés, dans ces livraisons coûteuses dont les bibliophiles ont gardé mémoire. C’était la première fois que j’écrivais pour un autre public que celui des érudits, et je ne me doutais pas de l’engrenage où cette coupable faiblesse allait m’entraîner. Masson satisfait persuada à Manzi, qui dirigeait alors avec Joyant les éditions de la Maison Goupil, de publier un volume sur Marie-Antoinette, qu’illustreraient les procédés de la maison. L’auteur était tout trouvé, mais il se montra d’abord récalcitrant : écrire pour le grand public, quelle déchéance pour un philologue !
– Comment voulez-vous, disais-je à Masson, que j’abandonne mes études sur Pétrarque pour faire votre livre d’étrennes ? Elles sont infiniment plus belles, et je n’ai pas de temps à perdre pour des lecteurs qui ne m’intéressent pas.
– Voyons, insistait Masson, vous avez déjà un chapitre fait, il suffit d’en écrire trois autres ; cela viendra plus facilement que vous ne croyez ; Versailles où vous vivez, sa cour et ses fêtes, suffiront à vous inspirer. Et puis, ajoutait-il, vous en ferez ensuite une petite édition à 3 fr. 50 ; cela vous amusera d’être lu par d’autres que vos clercs de Sorbonne.
– Vous me tentez, dis-je en protestant, mais c’est un péché où je ne retomberai plus.
Le livre fut assez vite garni de nouveautés, grâce aux recherches locales qui l’avaient précédé, et la Reine me parut assez séduisante pour être évoquée avec exactitude dans les détails de sa vie. Le succès du volume exigea bientôt une édition anglaise avec les mêmes héliogravures, et Alphonse Lemerre mit le texte sous la jolie couverture jaune où « l’homme à la bêche » présentait alors les poètes que nous lisions. Ce petit livre, le moins bon des Études sur la cour de France, est naturellement celui qui a eu les faveurs du public. On l’a vu reparaître sous tous les formats et on le pille encore. J’aurais pu le refondre ; j’ai préféré n’en retoucher que les détails, afin de lui laisser, à défaut d’autres mérites, le charme d’une œuvre de jeunesse écrite avec enthousiasme et lucidité, et qui m’a fait, à travers le monde, bien des amis.
Tout mince qu’il soit, il a marqué un progrès dans les études sur Marie-Antoinette. Alors que la critique mondaine classait commodément l’auteur parmi les « amoureux de la Reine », des esprits mieux avertis savaient voir dans le résumé d’un règne et la définition d’un caractère des sévérités à peine dissimulées. Le livre réagissait évidemment contre cette apothéose sentimentale qu’avaient écrite les Goncourt, pour complaire, assurait-on, à l’impératrice Eugénie.
Dirai-je que je contristai à cette occasion un ménage qui m’était bienveillant et dont l’amitié m’a été toujours chère : Mme Alphonse Daudet, puis le bon maître lui-même, me transmirent, non sans gêne, une commission inattendue :
– On dit que vous écrivez sur Marie-Antoinette ; ce projet contrarie beaucoup M. de Goncourt ; vous savez combien nous l’aimons ; ne pourriez-vous choisir un autre sujet ?
Je respectais les Goncourt, en qui nous admirions une sensibilité d’artiste sans égale (chez les écrivains) et dont l’étrange légèreté en histoire ne m’était pas encore apparue ; mais cette prétention de confisquer un sujet me parut intolérable : un bon esprit d’érudit qui aperçoit des erreurs à rectifier ne pouvait le concevoir. Nos études sont de celles qu’on révise sous cape et chacun a le droit de les répandre pourvu qu’il y apporte des documents ou un esprit nouveaux. J’essayai de faire comprendre ce point de vue à mes grands amis, qui eurent la bonne grâce de ne pas insister. Mais l’auteur de Chérie me battit froid pendant longtemps, et quand Alphonse Daudet eut la gentillesse de m’amener un jour au « grenier d’Auteuil », je ne sentis pas le désir d’y retourner.
Beaucoup plus tard, Edmond de Goncourt fit une visite au Château, qu’il paraissait ne point connaître. Je le guidai avec déférence, un peu étonné de ses étonnements ; mais j’ignore dans quelle partie inédite du célèbre journal se cachent les impressions de cette journée.
Je ne quitterai pas le souvenir d’Alphonse Daudet sans le remercier de m’avoir accordé une faveur bien rare et qui coûtait un pénible effort à l’héroïque malade, si indulgent pour les débutants, si tendre conseiller de leur jeunesse. Mme Alphonse Daudet nous l’amena à déjeuner avec ses enfants. Il ne put nous suivre dans la visite habituelle, mais il eut pour compagnon dans le petit salon blanc de la Loggia un autre de nos amis. René Bazin m’avait demandé de le présenter à celui de nos maîtres qu’il admirait le plus. Dans l’heure qu’ils passèrent en tête à tête, Bazin goûta pleinement l’enchantement qu’il attendait et qu’il m’a rappelé plus d’une fois.
Parmi les premières visites, il en est une qu’a rappelée en 1926 le maréchal Lyautey au dîner de la Revue des Deux Mondes. Après une réunion chez les Baignères, la compagnie se dirigea vers le Château. Je vois dans le groupe Albert Vandal, Étienne Lamy, déjà retiré de la vie parlementaire, Ferdinand Brunetière, qui venait de m’accueillir, – il y a de cela quarante-quatre ans, – dans la Revue, et un jeune capitaine de chasseurs à cheval, venu à franc étrier de sa garnison de Saint-Germain, qui prenait aisément et avec activité le dé de la conversation. Lyautey a raconté avec malice cette rencontre, qui fut la première, avec le directeur de la Revue. Dans l’intimité, son souvenir avait un accent plus vif encore :
– Vous rappelez-vous, me disait-il, combien Brunetière me regardait de travers pendant la promenade que vous conduisiez après le déjeuner. Il me coupait sans cesse la parole ; il n’admettait pas, évidemment, qu’un militaire eût des idées sur l’art et sur l’histoire. C’était pour lui un privilège de professeur.
Cette petite rancune, chuchotée à voix haute à l’Académie pendant une séance du dictionnaire, témoignait combien le maréchal gardait vivants en son esprit les moindres détails de sa jeunesse.
Anatole France a inséré dans la Vie littéraire une de ses plus jolies chroniques du temps sous le titre : Une journée à Versailles. Elle date de cette année 1890 et atteste la chaude amitié d’esprit qui nous unissait alors. De tous les poèmes du Parnasse, les Noces corinthiennes était celui que j’aimais le plus, et maintes fois mes camarades romains les avaient entendu réciter dans mon logis de la place Navone, ou sous les pins de la villa Pamphili. À Paris, nos ménages s’étaient liés malgré la différence de l’âge, et s’y adjoignaient ceux de mes amis Frédéric Plessis et Jean Psichari. C’est un déjeuner de ce petit groupe et la promenade qui suivit à Trianon que raconte France en ce délicieux morceau que je ne puis relire sans être ému. Toute une heure de notre jeunesse y revit. Un article de France marquait alors pour ces débutants le seuil de la gloire. De quelle gentille admiration n’entourions-nous pas un maître fraternel ! Dans les pantoufles pacifiques du bon Silvestre Bonnard ne pointait pas encore le pied fourchu de M. d’Astarac, et nous savions que le modèle du vieux savant était, sans que celui-ci s’en doutât, le vénérable Henri Weil, l’éditeur d’Euripide et le bon chorège de notre hellénisme. Disciple préféré de Leconte de Lisle, rival de Hérédia dont circulaient en manuscrits les impeccables sonnets, Anatole France n’appartenait point encore au monde qui nous l’a ravi ; sa modestie avait un charme exquis et son scepticisme ne pontifiait pas ; il restait avant tout un de ces humanistes qu’il définissait si bien dans la causerie de Versailles, en parlant de ceux de la Renaissance « qui aimèrent les lettres mortes d’un vivant amour et retrouvèrent, dans la poussière antique, l’étincelle de l’éternelle beauté ».
Ces humanistes qui ont fait séjour à Versailles, pendant tant d’années, occupaient à peu près seuls mon esprit. Les origines intellectuelles de la Renaissance faisaient le sujet de mes cours des Hautes-Études, où j’initiais de jeunes philologues à des recherches nouvelles en France, et que l’Allemagne et l’Italie m’avaient ouvertes. Vers le grand précurseur, celui qui avait tracé toutes les voies du monde nouveau, vers le poète de Vaucluse, je guidais leur reconnaissance et leur critique, et je les faisais profiter des trouvailles qu’apportait la préparation d’une grosse thèse sur Pétrarque et l’Humanisme. Je les intéressais aux résultats de mes explorations renouvelées par des voyages en Italie, et mettais sous leurs yeux les manuscrits possédés par le premier humaniste et annotés par lui que renferme notre Bibliothèque nationale. J’obtenais aisément le prêt de ceux que je commençais à identifier, quand je travaillais à même sur les rayons, et qui n’étaient pas encore protégés contre toute sortie par la révélation d’une écriture illustre. Ils ont surchargé longtemps ma table de Versailles, mêlés à ces premiers dossiers sur le dix-huitième siècle qui peu à peu s’y constituaient.
Mon ignorance de l’art français était extrême. Il n’y avait en ce temps-là aucun enseignement qui pût guider les étudiants, orienter leur esprit, mettre entre leurs mains les instruments de travail et leur ouvrir les sources de l’art national. Quand l’écolier de province rencontrait Le Brun, Mansart, Girardon dans une page de Voltaire, ces noms ne lui disaient rien, alors que toutes figures du grand siècle étaient pour lui familières et respectées. On pouvait passer ses examens secondaires sans connaître le nom d’un artiste. L’archéologie médiévale était seule enseignée à l’École des Chartes, et ce fut un événement de voir la sculpture française mise à sa place et réhabilitée avec une chaleur rayonnante dans les premières leçons de Courajod ; encore cet apôtre s’arrêtait-il au seuil du siècle de Louis XIV, qu’il avait en horreur et flétrissait du nom d’académisme. Nous revenions d’Italie, mes camarades et moi, suffisamment instruits sur l’art de ce pays, et nous distinguant seulement par une tendresse donnée aux maîtres de Sienne ou de Florence, ou encore aux chefs-d’œuvre de la Renaissance romaine, sans aller toutefois jusqu’aux Bolonais et au Bernin, que l’esthétique à la mode nous interdisait. Comment eussions-nous osé franchir les barrières posées par Ruskin ! Notre formation était bien de première main, mais tendait, par les joies même que nous lui devions, à nous rendre dédaigneux de l’art de notre pays.
De fait, je m’intéressais peu aux sculpteurs de Versailles, qu’effaçaient pour moi par avance Michel-Ange et Donatello, et il me suffisait de savoir que les peintures de Le Brun étaient un modèle du style pompeux et conventionnel. Le mot qui me fit réfléchir vint de Puvis de Chavannes : un jour que l’honneur m’était fait de le rencontrer à la table du critique du Figaro, Philippe Gille, très dévoué aux choses de Versailles, le grand peintre daigna s’intéresser à mes premières impressions ; je lui avouai que je n’avais jamais levé les yeux vers le plafond de la Grande Galerie.
– C’est un bien grand tort, cher monsieur, dit-il, d’un ton sévère ; vous vivez parmi des chefs-d’œuvre de l’art français et vous refusez de les connaître. Regardez-les et tâchez de les comprendre.
Venant de l’artiste que notre génération vénérait le plus, la semonce ne pouvait être perdue. Je regardai le célèbre plafond, puis les autres, puis la décoration de grand style qui les entoure ; je tâchai d’y démêler ce qu’ils gardaient de l’art italien et en quoi ils peuvent l’égaler. Je devais plus tard, en réunissant les esquisses de Le Brun qui sont au Louvre et en les faisant servir à mon enseignement de l’art français classique, rendre à la décoration de Versailles un hommage que personne ne lui conteste aujourd’hui.
Cette inquiétude jetée en ma conscience par Puvis de Chavannes s’étendit naturellement aux jardins ; Girardon, Coysevox, Tubi, Legros, Le Hongre me devinrent familiers et chers ; un peu de fierté française aidant, et aussi le besoin de défendre le prestige de Versailles contre les assauts vivaces de Courajod, j’en vins à vivifier ma science de fraîche date par l’amour, ce qui est, suivant le mot de Léonard, la vraie façon de connaître.
Il y a dans Versailles, comme dans la plupart de nos châteaux du dix-huitième siècle, tout un décor de finesse et de grâce où nos sculpteurs sur bois et nos doreurs ont répandu à profusion les trésors d’un goût raffiné qui n’appartient qu’à nous. On ne les apprécie pas du premier coup et sans les avoir comparés ; ce qu’on trouve dans ce genre à l’étranger peut donner le change sur l’originalité de notre merveille. Un œil exercé ne s’y trompe pas, mais là encore, il faut un peu d’expérience. À force de traverser quotidiennement ces intérieurs royaux, où de tout temps les artistes ont prodigué le plus pur de leur talent, présenté leurs productions les plus nouvelles, j’acquérais cette instruction tout élémentaire, dont aucun jeune Français instruit n’est entièrement privé aujourd’hui. Je voyais nos trois grands styles partout se succéder sous les trois règnes et aboutir à ce cabinet de la garde-robe de Louis XVI, dernier travail, je l’ai appris depuis, exécuté chez le Roi avant la Révolution : cinq panneaux blancs où jouent en trophées dorés les instruments de l’agriculture et des sciences, des bronzes, dignes de cette sculpture, ciselés par Gouthière, telle est la parure exquise de la pièce de choix qui m’a servi souvent par la suite à éprouver le goût de mes visiteurs, y compris les rois.
L’année 1889 fut marquée par quelques événements versaillais. L’Exposition historique de la centennale de l’Art français, qui devait trouver place au Champ-de-Mars, avait fait découvrir notre musée à quelques commissaires qui y trouvaient sans peine des morceaux significatifs autant qu’ignorés. En tête de la liste fut le tableau du Couronnement à Notre-Dame commandé par Napoléon à David. Il était fort bien installé depuis Louis-Philippe dans l’ancienne salle des gardes, au milieu d’une décoration faite pour le mettre en valeur, ainsi que la Distribution des aigles à l’armée qui lui fait pendant. Des gens qui n’avaient jamais fait le voyage de Versailles, où l’immense tableau était en si belle lumière, y découvrirent pour la première fois à Paris le génie de David. Après l’avoir beaucoup célébré, sous le nom inexact du Sacre, la presse mit le Louvre en demeure de s’annexer ce chef-d’œuvre. Mon conservateur ne sut pas défendre les droits du peintre dont on disloquait le diptyque napoléonien, et qui ne devait jamais retrouver l’éclat dont Versailles l’entourait. Aurais-je fait mieux à sa place ? Je me le suis souvent figuré, en me désolant devant la peinture de Roll que l’État avait commandée pour remplacer le Couronnement, et qui constitue encore dans ce lieu le plus fâcheux anachronisme.