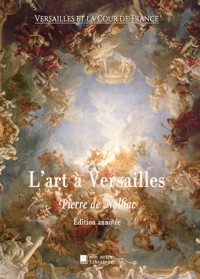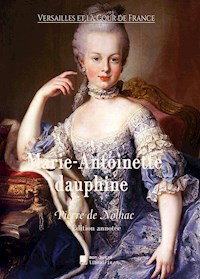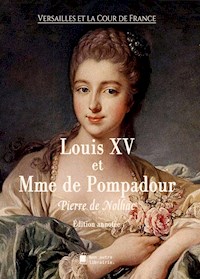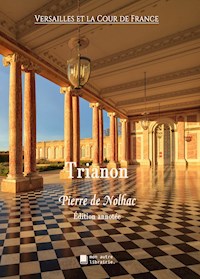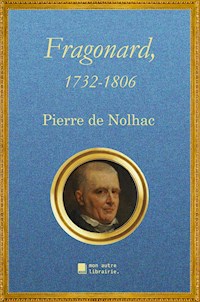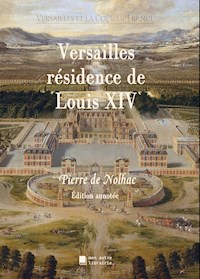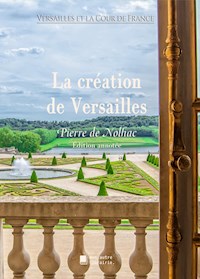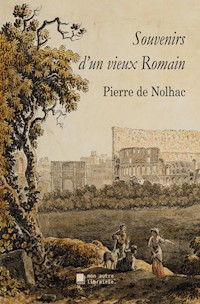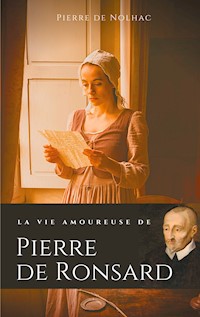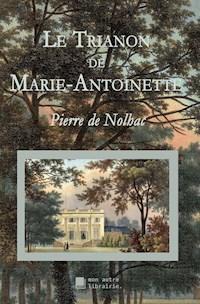Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Versailles et la Cour de France
- Sprache: Französisch
Après Louis XIV les travaux se poursuivent sans discontinuer à Versailles. Louis XVI quant à lui en fera peu, et c'est donc, mise à part la touche charmante de Marie-Antoinette, en grande partie le château de Louis XV que nous avons sous les yeux. L'auteur suit minutieusement toutes ces transformations, ce qui permet, en particulier lorsqu'on est sur place, de pouvoir revivre précisément en imagination les préoccupations et les rituels quotidiens d'une cour pour laquelle l'emplacement, la destination et jusqu'à l'agencement des pièces étaient d'une importance cruciale. (Édition annotée.)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Versailles au XVIIIe siècle
Pierre de Nolhac
Édition annotée
Fait par Mon Autre Librairie
À partir de l’édition Louis Conard, Paris, 1925.
Les notes entre crochets ont été ajoutées pour la présente édition. Les extraits de Luynes ont été repris directement de l’édition du XIXe siècle.
Couverture : Versailles, Trianon, temple de l’Amour.
https://monautrelibrairie.com
__________
© 2021, Mon Autre Librairie
ISBN : 978-2-38371-002-8
Table des matières
Préface de la première édition
I. – Versailles sous Louis XV
II. – Le Versailles de Gabriel
III. – Les cabinets de Louis XV
IV. – Les appartements historiques
V. – Versailles sous Louis XVI
VI. – Les appartements de Marie-Antoinette
VII. – Les jardins au dix-huitième siècle
Versailles et la Cour de France
par
Pierre de Nolhac
La création de Versailles
Versailles résidence de Louis XIV
Versailles au xviiie siècle
Trianon
Louis XV et Marie Leczinska
Louis XV et Madame de Pompadour
Marie-Antoinette dauphine
La reine Marie-Antoinette
Madame de Pompadour et la politique
L’art à Versailles
Préface de la première édition
La menace qui a pesé sur la patrie rend ses enfants plus attentifs et plus fidèles. Désormais, chaque page que nous écrirons de l’histoire de France portera les marques visibles de notre amour. Nous ne laisserons plus, sous de vains prétextes d’esthétique ou de parti, abaisser nos traditions d’intelligence ou diminuer l’honneur de notre passé. Quelque modeste que fût le présent ouvrage, ces idées l’inspiraient déjà. On l’achève dans les sentiments d’une tendre piété, après les périls qu’a courus Versailles devant la barbarie moderne. Cette grande œuvre de l’art français nous est devenue plus chère et paraît à tous plus précieuse. Il faut veiller à la conserver, à l’étudier, à la mettre en lumière dans ses moindres parties, puisqu’il n’est aucune d’elles qui ne rende témoignage, aux yeux du monde, des qualités propres de notre génie.
La méthode de ces recherches et les sources qui ont permis de les poursuivre ont été suffisamment expliquées dans la préface des premiers volumes, consacrés à Versailles sous Louis XIV. Celui-ci a exigé parfois plus de minutie, quand on a dû dater et décrire ces merveilles de décoration intérieure, qui ont joint au premier trésor d’art accumulé à Versailles l’apport d’un siècle nouveau. Il faut se rappeler, en effet, que le Château n’est plus tout à fait celui du Grand Roi. Hors la Galerie de Le Brun, la Chapelle de Mansart, l’Escalier de marbre, les Grands Appartements du Roi et une partie de ceux de la Reine, presque tout ce qui reste d’ancien dans cette maison royale est postérieur à la mort de Louis XIV. Le règne de Louis XVI n’ayant touché qu’au détail c’est en réalité le Versailles constitué par Louis XV qui nous est demeuré. Les jardins même ont subi, après Le Nôtre, des modifications capitales qu’il importait de ne point omettre.
L’interruption des travaux entrepris sous Louis XV a sauvé des morceaux essentiels du Versailles de Louis XIV, qu’on ne se consolerait pas d’avoir perdus. Les parties nouvelles nous laissent aussi rattacher bien des souvenirs à des lieux précis et à un décor intact. C’est là qu’ont été préparées, parmi tant d’autres desseins dignes de la France, la campagne de Fontenoy, la réunion de la Lorraine, l’acquisition de la Corse, la participation à la guerre de l’Indépendance américaine. Car ce Versailles du dix-huitième siècle, où trop souvent s’attarde l’anecdote, sait aussi rappeler magnifiquement notre plus vivante histoire.
Château de Versailles, décembre 1917.
I. – Versailles sous Louis XV
Louis XIV avait mis près de cinquante ans à construire, à perfectionner, à parer des merveilles de tous les arts la maison définitive de la royauté française. Jamais le monde n’avait vu pareil ouvrage, et nulle demeure souveraine ne soutenait de comparaison avec celle que le Grand Roi bâtissait pour glorifier sa couronne et loger ses descendants. Les splendeurs de la Cour, dont elle faisait le cadre, devaient, dans la pensée de celui qui les avait réglées, durer autant que la France elle-même. Elles survécurent à peine trois quarts de siècle. La Révolution bouleversa en un instant ce spectacle magnifique, chassa les acteurs, renversa le brillant décor. La scène seule resta debout ; elle atteste encore, par les débris de sa grandeur, ce que signifia la création de Louis XIV et ce qu’un tel rêve eut d’immortel.
Le premier septembre 1715, le Roi mourut dans sa chambre placée au milieu du Château, qui figurait, pour l’imagination de ses sujets, le centre visible de la monarchie. Ses derniers jours y firent admirer la fermeté du prince et l’humilité du chrétien. Louis XV ne put jamais oublier l’instant où, tout enfant, amené auprès du lit royal, il reçut la bénédiction de son aïeul et ses paroles suprêmes : « Mignon, vous allez être un grand roi ; mais tout votre bonheur dépendra d’être soumis à Dieu et du soin que vous aurez de soulager vos peuples. Il faut pour cela que vous évitiez, autant que vous le pourrez, de faire la guerre ; c’est la ruine des peuples. Ne suivez pas le mauvais exemple que je vous ai donné en cela ; j’ai souvent entrepris la guerre trop légèrement et l’ai soutenue par vanité ... Soyez un prince pacifique... » C’étaient des conseils bien différents que suggéraient dans Versailles tant d’orgueilleuses peintures. Le petit Roi, cependant, n’y passa point son enfance. Le 9 septembre, jour où le corps de Louis XIV était emmené à Saint-Denis, la Cour se transporta à Vincennes, dont l’air était jugé meilleur que celui de Versailles par les médecins de Paris et dont le château se trouvait tout meublé. Le Régent eut ainsi le temps de faire aménager les Tuileries, que le Roi vint habiter à partir du 30 décembre.
Versailles fut abandonné par la Cour pendant près de sept ans. D’abord presque déserte, la ville retrouva assez vite des habitants nouveaux, grâce à l’exemption de la taille, à la modicité des loyers et aussi au prix des vivres, « qui y sont meilleur marché qu’à Paris ». On faisait jouer les eaux tous les quinze jours et les ambassadeurs, qui venaient voir le Château et les jardins, « attiraient beaucoup de compagnie1 ». Mais peu d’événements méritent d’être rappelés. Le plus notable est le séjour du tzar Pierre le Grand, au mois de mai 1717. Il habita trois jours l’ancien appartement de la Reine, occupé en dernier lieu par la duchesse de Bourgogne2 ; pendant un second voyage, il logea à Trianon-sous-Bois. Les nouvellistes rapportent qu’il se promena en calèche dans les parcs, en gondole sur le Canal, assista au jeu des eaux, visita la Ménagerie, le château de Clagny, Marly, le grand aqueduc et la Machine ; il fut aussi à Saint-Germain, au Val, à Saint-Cyr. On le vit examiner « les jets d’eau, les cascades et les statues avec une attention surprenante3 ». Il serait curieux de savoir ce qu’un tel prince apprécia de préférence dans les maisons de Louis XIV ; il ne leur consacra pas moins d’une douzaine de jours, passés hors de Paris à les parcourir, et l’on sait comme il se plut à s’en inspirer dans les bâtiments et les jardins qu’il ordonna à Petrograd.
Le retour de la Cour n’eut lieu que le 15 juin 1722, à la grande joie de la population de Versailles, qui s’était fâcheusement ressentie de son absence : « Le Roi revint à Versailles, note le commissaire Narbonne, pour y faire son séjour habituel. Dans son carrosse se trouvaient Mgr le Duc d’Orléans, régent, M. le duc de Chartres, son fils, M. le duc de Bourbon, chargé de son éducation à la place du duc du Maine, à qui elle fut ôtée, M. le maréchal de Villeroy, son gouverneur, et l’évêque de Fréjus, son précepteur. Le Roi arriva sur les cinq heures du soir et, en descendant de carrosse, il alla d’abord à la Chapelle faire sa prière et se rendit ensuite à son appartement. Les bourgeois de Versailles avaient eu l’idée de faire tirer un feu d’artifice pour célébrer l’arrivée du Roi ... mais Son Altesse Royale4 ne l’ayant pas jugé convenable, le feu d’artifice n’eut pas lieu ».
La ville reprit de l’animation, vit augmenter sa population et renaître son commerce. Au Château, qui n’avait jamais cessé d’être entretenu, divers aménagements nouveaux furent nécessaires. Les plus intéressants se firent chez le Roi ; on consacra à sa commodité et à son divertissement, dans le comble de l’appartement privé, quelques pièces auxquelles plus tard devaient s’en ajouter tant d’autres. Les premières dépenses de ces installations remontent précisément à 1722.5 En 1723, le sculpteur Hardy pose sur les murs de la petite cour, autour de laquelle se développent les Cabinets du Roi, « vingt-quatre têtes de cerfs en plâtre », pour une somme de 1.550 livres ; et cette commande assez singulière donne l’explication véritable de la désignation attribuée jusqu’à nos jours à la fameuse « cour des Cerfs6 ». Cette décoration de fantaisie porte la première atteinte au décor sévère de Louis XIV ; mais elle se borne à une partie retirée du Château, où le public ne pénètre pas.
Louis XV amenait à Versailles la petite Infante, âgée de cinq ans, qu’on avait demandée pour lui en mariage et qu’il devait bientôt renvoyer à son père Philippe V.7 Le Roi et l’Infante, dit Saint-Simon, « occupèrent les appartements du feu Roi et de la feue Reine, et le maréchal de Villeroy fut logé dans les derrières des Cabinets du Roi. Le cardinal Dubois eut toute la Surintendance entière pour lui seul, comme M. Colbert l’avait eue et après lui M. de Louvois8 ... M. le duc d’Orléans prit l’appartement de feu Monseigneur en bas, et Mme la duchesse d’Orléans demeura dans celui qu’elle avait en haut auprès du sien et qui resta vide9 ».
Le Régent habita donc l’appartement du rez-de-chaussée, qu’avaient eu aussi le duc de Bourgogne, puis le duc et la duchesse de Berry ; il avait été jadis celui de Monseigneur et devait redevenir, au cours du siècle, celui du Dauphin. C’est dans cette partie du Château qu’on doit évoquer le gouvernement du duc d’Orléans et ses plaisirs pendant les dix-huit derniers mois de sa vie. On l’avait restaurée avec soin en 1722, et le sieur Baudrey avait réparé les marqueteries des fameux « cabinets » de Boulle. La chambre à coucher, qui fut celle du duc de Bourgogne, restait à l’emplacement où l’on créa depuis deux petites pièces, dont l’une fut la bibliothèque du Dauphin. Le grand cabinet était la belle pièce d’angle à six fenêtres, sous le Salon de la Paix (salle 51) ; La Martinière10 l’a vu « décoré de lambris très riches, dorés en plein, qui renfermaient en symétrie des tableaux originaux des différents maîtres anciens, le tout mêlé de consoles qui portaient aussi des porcelaines ; le plafond de ce cabinet était peint par La Fosse ».
Saint-Simon en fait une autre description, d’ailleurs peu exacte, lorsqu’il raconte le piège tendu au maréchal de Villeroy,11 arrêté par La Fare, capitaine des gardes du Régent et d’Artagnan, capitaine des mousquetaires gris : « Au delà de la chambre à coucher de M. le duc d’Orléans, était un grand et beau cabinet, à quatre fenêtres (sic) sur le jardin et de plain-pied à deux marches près, deux en face en entrant, deux sur le côté vis-à-vis de la cheminée, et toutes ces fenêtres s’ouvraient en portes depuis le haut jusqu’au parquet. Ce cabinet faisait le coin, où les gens de la Cour attendaient, et en retour était un cabinet joignant,12 où M. le duc d’Orléans travaillait et faisait entrer les gens les plus distingués qui avaient à lui parler13 ». C’est par une des portes-fenêtres de ce salon que Villeroy, jeté dans une chaise à porteurs, fut entraîné par les mousquetaires et mené hors des jardins, vers la route de Saint-Cyr.
Le cabinet de travail du Régent est celui où le prince mourut subitement, auprès de la duchesse de Fallary,14 le 2 décembre 1723. On peut encore citer le récit de Saint-Simon, qui marque la disposition des lieux : « La Falari ... redoubla ses cris. Voyant que personne ne répondait, elle appuya comme elle put ce pauvre prince sur les deux bras contigus des deux fauteuils, courut dans le grand cabinet, dans la chambre, dans les antichambres, sans trouver qui que ce soit, enfin dans la cour et dans la Galerie Basse15 ». La pièce, qui rappelle ce souvenir tragique, servit aussi de cabinet de travail à M. le Duc, qui succéda au Régent dans son appartement comme au ministère.16 Les travaux de 1747, qui la transformèrent en chambre à coucher pour le Dauphin, fils de Louis XV, en firent disparaître l’ancien décor, comme dans toutes les pièces voisines.
Le directeur général des Bâtiments du Roi, qui ordonna la nouvelle installation de la Cour, était le duc d’Antin, fils unique du marquis de Montespan et de la marquise. Il avait reçu la charge à la mort de Mansart, étant encore marquis d’Antin ; elle lui arrivait un peu diminuée, puisque son prédécesseur portait le titre de surintendant. L’ambitieux courtisan montra pourtant des « transports de joie », raconte Saint-Simon, et déclara « que c’était à ce coup que le sort était levé, qu’il n’était plus en peine de sa fortune ; il eut toutes les entrées qu’avait Mansart, il les élargit même, et bientôt il sut subjuguer le Roi et l’amuser. » Le personnage, fait duc et pair en 1711, n’eut pas l’occasion de se distinguer sous Louis XIV en enrichissant Versailles de morceaux assez importants pour faire honneur à son administration. Le règne nouveau allait, au moins une fois, le lui permettre.
Il décida de terminer, sur un plan digne du feu Roi, la vaste pièce inachevée qui reliait les Grands Appartements au « salon de la Chapelle ». Cette pièce de majestueuses dimensions, alors éclairée par trois fenêtres sur les jardins et quatre sur la cour de la Chapelle,17 n’avait reçu qu’une décoration provisoire. Louis XIV en voulait faire une salle de fêtes pour agrandir et compléter les Appartements, et l’on avait préparé dans cette pensée une provision de marbres de couleur, qui restait inutilisée.18 Le projet ajoutait au Château un salon pour les bals ; comme, d’autre part, il servait au passage continuel de la Cour se rendant à la Chapelle, aucun emplacement ne justifiait mieux d’amples et magnifiques travaux.
L’aménagement architectural du futur Salon d’Hercule est assumé par Robert de Cotte, Premier architecte du Roi. Il a pour principal collaborateur un neveu du grand Mansart, Jacques Gabriel, chargé depuis 1709 du contrôle des « dedans » de Versailles. Jacques Gabriel doit obtenir, en décembre 1734, à la retraite de Robert de Cotte, la charge de Premier architecte et, à sa mort, la direction de l’Académie royale d’Architecture. Ils trouvent, pour exécuter les nouveaux ouvrages, des artistes qui ont débuté aux dernières années du règne de Louis XIV et donnent à présent la pleine mesure de leur talent. C’est Antoine Vassé, sculpteur toulonnais, élève et collaborateur de Puget, qui mène dès l’année 1729 l’ensemble de la décoration du « salon de marbre » ou « nouveau salon près de la Chapelle ». L’artiste est un de ces maîtres d’alors, instruits dans toutes les parties de leur art, qui traitent indifféremment le plâtre, le marbre ou le bronze. Les Comptes des Bâtiments du Roi mentionnent de lui les ouvrages les plus divers ; on l’a vu travailler aux boiseries et aux petits bronzes qui ornent l’édifice religieux de Mansart, et il vient d’obtenir la faveur de placer, dans une niche du salon qui le précède, un marbre important, qui représente la Gloire.19 Robert de Cotte a pu juger mieux que personne de l’admirable souplesse de Vassé. Les documents enregistrent avec régularité, durant cette année et les suivantes, les acomptes à lui payés pour travaux de marbre, de plomb et d’étain, pour « vingt bases de pilastres et autant de chapiteaux de bronze doré », pour les ouvrages de bronze de la cheminée,20 etc.
Les sculptures en bois et en stuc, comprenant les fines consoles dorées de la corniche, les petits trophées alternés de paix ou de guerre, et l’immense cadre aux Armes de France, occupant toute la paroi du fond, sont l’œuvre d’un anversois fixé en France, Jacques Verberckt. Ancien associé de Dugoulon et Goupil pour la sculpture en bois dans les maisons royales, il travaille depuis quelque temps à Versailles, où il doit obtenir bientôt une place prépondérante.21 Les portes dorées qui flanquent la cheminée sont de style Louis XIV ; placées à l’époque où Robert de Cotte ordonnait le salon de pierre, elles contrastent avec les ornementations nouvelles, dont certaines formules, comme celles des cartouches ailés, auront une assez longue fortune.
Le plus beau morceau est la grande cheminée de marbre d’Antin, « venant des nouvelles carrières ouvertes dans les Pyrénées depuis quelques années, dont le travers qui est d’une seule pièce a dix pieds de longueur ; les jambages sont ornés de grosses têtes de lions, avec des pattes entrelacées qui tombent au-dessous. Au milieu du cintre ... on voit une tête d’Hercule sur un cartouche, d’où naissent des espèces de cornets qui répandent des fleurs et des fruits. On remarque au-dessus un attique avec deux consoles qui supportent un grand tableau ; on aperçoit dans le milieu un trophée de carquois et d’une rondache22 sur laquelle on a exprimé un des travaux d’Hercule. On peut être satisfait du bon goût de ces différents ornements de bronze doré au feu, qui sont de Vassé, sculpteur très habile en ornements ». Cette description de La Martinière indique l’importance accordée par les contemporains à la partie ornementale du Salon d’Hercule.23 Au-dessus de la cheminée est un tableau attribué à Paul Véronèse, Eliezer et Rébecca, que remplacera au dix-neuvième siècle un Louis XIV à cheval couronné par la Victoire, de Pierre Mignard.24 En face, on installe dans la bordure de Vassé la plus importante toile du maître vénitien que possède la collection royale ; c’est le Repas chez Simon le Pharisien, offert à Louis XIV en 1664 par la République de Venise. Mais Blondel, parlant de l’admirable plafond qui vient compléter cet ensemble, n’hésite pas à déclarer que les « ouvrages même de Paul Véronèse, placés dans cette pièce, ne servent encore qu’à relever l’éclat de cette merveille de l’art ». C’est, en effet, la composition de l’Apothéose d’Hercule qui est ici le morceau principal ; et, de même que le décor monumental s’harmonise, malgré ses nouveautés de détail, avec le style général de Versailles, le plafond de François Le Moyne continue, par ses nobles proportions, l’ensemble des plafonds du Château, tout en révélant, dès qu’on l’analyse, un art profondément éloigné de celui de Le Brun et de son école.
Le grand peintre, qui a laissé les modèles les plus purs de la décoration mythologique à la française et a formé le talent de Boucher et de tant d’autres disciples, venait d’achever pour Versailles plusieurs œuvres importantes, quand le duc d’Antin se décida à lui confier la voûte du nouveau salon. Il avait peint, à son retour d’Italie, un panneau pour l’hôtel du Grand-Maître, Aurore et Céphale, puis, en 1727, un tableau d’autel, Saint Louis en extase, destiné à la paroisse du quartier neuf, dite « nouvelle église du Parc-aux-Cerfs ». Au Château, Le Moyne avait été chargé de l’ovale du Salon de la Paix, commandé en 1728 et placé, en juillet 1729, sur la cheminée du mur adossé à la chambre de la Reine. On paya 7.000 livres pour ces allégories un peu subtiles, qui avaient le mérite de s’appliquer exactement aux premiers événements de la vie de Louis XV : « Il représente, écrit le comte de Caylus, le Roi tenant de la main gauche un gouvernail, en foulant aux pieds la figure du Luxe, et présentant de la main droite une branche d’olivier à l’Europe, qui paraît environnée des attributs qui la distinguent des autres parties du monde ... Sur un plan plus éloigné, on voit le temple de Janus ; la Discorde fait des efforts pour en ouvrir les portes. Minerve, assise sur un nuage, étend le bras vers le temple et donne ordre à Mercure, symbole de la négociation, de voler pour s’opposer aux efforts de la Discorde ... La Piété présente à l’Europe deux enfants, que la Fécondité tient dans ses bras et que l’Europe regarde avec d’autant plus de satisfaction que ce sont les deux princesses, filles aînées du Roi.25 Le devant du tableau est orné des Génies des Arts et du Commerce, enfants de la Paix.26 » Cette peinture, qu’a gravée Laurent Cars, reste un morceau tout à fait charmant du décor royal de Versailles.
De plus hautes ambitions émurent l’artiste quand on lui livra l’énorme surface du plafond, sur lequel, dès la fin de l’hiver de 1732, étaient marouflées les immenses toiles qu’il aurait à peindre. Il se hâta de jeter ses idées sur le papier, rêvant d’abord de représenter « la Gloire de la Monarchie française établie et soutenue par les belles actions de nos plus grands rois ». Au centre devaient apparaître Clovis, Charlemagne, saint Louis et Henri le Grand, « jouissant du séjour de l’immortalité ». Les quatre côtés, en forme d’éventails, auraient contenu les hauts faits de ces princes, « pour lesquels la nation entière conservera toujours une mémoire pleine d’admiration, de reconnaissance et de respect ». On aimerait trouver dans Versailles une commémoration nationale de cette importance. Le peintre Donat Nonnotte a vu ce projet, pour lequel son maître Le Moyne inclinait beaucoup ; « mais, soit que la nouveauté de ne faire qu’un seul morceau dans une si grande étendue plût davantage, ou que, par des raisons particulières au surintendant, un sujet de la fable fût plus de son goût, il choisit l’Apothéose d’Hercule, dont le vrai sens allégorique est sans contredit la Vertu héroïque récompensée27 ».
Il y avait des raisons à ce choix, qui permettent d’écarter l’opinion de Voltaire sur une flatterie peu vraisemblable envers Hercule de Fleury, cardinal et premier ministre.28 Depuis que Le Brun avait projeté de célébrer Louis XIV sous la forme d’Hercule, au plafond de la Grande Galerie, et exécuté de nombreux dessins sur ce sujet, cette allégorie hantait la pensée des surintendants. L’occasion semblait bonne de réaliser au moins le principal motif, conçu par le peintre du Grand Roi, et de ne pas priver plus longtemps Versailles d’une glorification d’Hercule.
François Le Moyne, artiste aussi consciencieux que son prédécesseur et enflammé par la rivalité glorieuse qu’on lui proposait, avait multiplié les esquisses et les études de tout genre. Il monta sur les échafaudages du salon le 14 mai 1733, et commença ce jour-là à tracer à la craie ses premières figures. Nous savons par le récit du peintre Nonnotte, qui collabora aux parties secondaires de l’ouvrage, quelles vicissitudes accablèrent son maître et les difficultés cruelles qu’il rencontra. Il se fit un jeu de compenser par des habiletés techniques les irrégularités que présentait l’éclairage de la voûte ; mais, ayant dû reconnaître une erreur initiale dans les proportions de ses premiers groupes, il n’hésita pas à recouvrir entièrement le travail de trois mois pour recommencer environ quarante figures déjà esquissées. L’ébauche générale une fois terminée, et les ornements d’architecture confiés à des peintres de pratique, Le Moyne se mit à exécuter de sa main toute la peinture, en commençant par le côté de la cheminée et en prodiguant l’outremer dans le ciel, de façon à alléger le ton et à lui faire « percer la voûte, au point que cela fit voir qu’il n’y a rien dans tout le Château qui fasse autant d’illusion ». Le travail s’avançait ; les princes, les grands seigneurs, les amateurs montaient, pour en venir juger, dans l’atelier suspendu et ne ménageaient pas les compliments au peintre. Le duc d’Antin, malgré ses infirmités, voulut plusieurs fois le voir travailler ; il reçut aussi l’affable visite du roi Stanislas, beau-père de Sa Majesté, venu de Chambord pour passer quelques jours à Versailles, qui s’entretint avec lui en connaisseur et « comme ferait un artiste avec son ami ».
« L’année 1736, raconte Nonnotte, mit le comble à la gloire de M. Le Moyne et aux faveurs du Roi qui lui avaient été réservées. La place de Premier peintre de Sa Majesté était vacante depuis le mois de novembre 1733, et elle ne fut remplie que le 26 septembre 1736. Ce jour-là, le Roi, allant à la messe comme à l’accoutumée, vit l’ouvrage de M. Le Moyne avec un air de satisfaction qui annonçait le bonheur de l’artiste. Au retour, le Roi s’arrêta de nouveau et, plein de la bonté qui fait son caractère, il lui déclara lui-même qu’il le nommait son Premier peintre. Une récompense si flatteuse et si honorable fut accordée comme le serait le bâton de maréchal à un officier qui serait sur la brèche ; ce sont les termes dans lesquels un seigneur qui suivait le Roi fit son compliment à M. Le Moyne.29 » Le peintre atteignait le sommet le plus élevé où les artistes d’alors pussent prétendre ; mais il demeurait tourmenté de scrupules de métier, aussi aigri par la discussion que surexcité par les éloges. À peine eut-il son brevet qu’il tomba dans une profonde mélancolie et donna les signes du délire de la persécution. La mort de son protecteur, le duc d’Antin, et le surmenage excessif de ces quatre années furent assurément pour beaucoup dans ce malheur ; on accusa même la façon de travailler très gênante, le corps renversé, que l’emplacement avait imposée à l’artiste. C’est, en tout cas, une pure légende qui attribue l’origine de sa folie à l’insuffisance de la récompense reçue, car les témoignages de son entourage la démentent. Malgré son goût pour l’économie, le cardinal de Fleury n’avait point eu l’idée de lésiner sur le paiement d’un ouvrage qui intéressait si fort l’honneur de son maître. Le Moyne eut 55.000 livres de gratification, dont il avait reçu 12.000 par les excédents régulièrement compris dans ses rôles de dépenses, et sa pension de Premier peintre allait ajouter 3.200 livres à ses revenus. Quoi qu’il en fût, abandonné à des idées sombres, vivant seul et mal soigné, le pauvre artiste succomba. On le trouva mourant en son logis, au matin du 4 juin 1737 ; il baignait dans le sang, s’étant par neuf fois traversé le corps de son épée. Ce fut une perte singulière pour l’École française que la mort prématurée du peintre qui s’annonçait comme son chef et qui, à quarante-neuf ans, dans sa composition de Versailles, avait révélé les ressources de son génie.
Le siècle s’émerveilla devant le plafond du Salon d’Hercule, et Voltaire résuma en ces mots l’éloge universel : « Il n’y a guère dans l’Europe de plus vaste ouvrage de peinture que le plafond de Le Moyne, et je ne sais s’il y en a de plus beau ». C’était rejeter au second rang l’œuvre même de Charles Le Brun ; et le cardinal de Fleury l’entendait ainsi, quand il disait : « J’ai toujours pensé que ce morceau gâterait toutes les peintures de Versailles30 ». On avait renoncé aux surcharges du stuc ornemental, à la division par encadrements de la surface à recouvrir, à tous ces usages imposés jusqu’alors par l’art italien dans nos maisons royales. La seule peinture se chargeait d’occuper toute la voûte et d’y créer les perspectives des nuages et de l’azur. L’équilibre de l’ensemble et le recul des figures aériennes étaient assurés par un motif très simple d’architecture peinte courant au-dessus de la corniche ; c’est une sorte de balustrade de marbre blanc veiné rehaussé d’or, que coupent des panneaux de brèche violette et des cartouches dorés. À ces cartouches, où sont représentés les travaux d’Hercule, s’enlace une lourde guirlande de feuilles de chêne soutenue par des génies, tandis que de grandes figures assises aux quatre angles symbolisent les vertus du héros. C’est au delà de ce décor, qui semble couronner les parois du salon, que se développe l’immense scène allégorique jetée dans les profondeurs du ciel.
L’effort n’a peut-être jamais été renouvelé d’une composition réunissant cent quarante-deux figures mythologiques, admirablement liées et toutes d’un symbolisme assez clair pour être aisément compris.31 Hercule a conquis l’immortalité par ses périlleux exploits et les services qu’il a rendus aux hommes, et c’est la récompense d’une vertu sans seconde qui lui est offerte parmi les splendeurs de l’Olympe. Il arrive au pied du trône du maître des Dieux, sur un char tiré par les génies de la Vertu, précipitant derrière lui les monstres et les Vices. Afin de lui faire accueil, la majesté des Immortels s’assemble dans les nuées ; mais la grâce surtout y sourit avec la jeunesse des dieux, des demi-dieux et des déesses toujours belles. Est-il une plus parfaite image de l’âge heureux que l’Hébé couronnée de roses présentée au héros par Jupiter, comme prix délicieux de ses travaux ? Partout l’œil se repose sur des groupes d’un grand style et d’un caprice charmant, tels que celui de l’Aurore cheminant au milieu des étoiles, que personnifient de souriantes jeunes femmes, Zéphyre et Flore s’entretenant tendrement parmi les fleurs nées de leurs soupirs, Pandore et Diane invitant Comus, dieu des banquets, à disposer la fête, ou le chœur des Muses au seuil du Temple de Mémoire, s’apprêtant à exécuter le concert qu’ordonne un Apollon juvénile et radieux.
Il semblerait que l’artiste a dû rêver dans la paix d’une solitude bienfaisante l’épanouissement de tant de symboles de félicité. Comment croire qu’ils furent exprimés, au contraire, au prix de difficultés infinies, avec des reprises douloureuses, imposées au maître par son excès de conscience et qui ont épuisé ses forces avant l’heure ! L’œuvre reste du moins une des plus importantes de la peinture française. Pour la première fois peut-être depuis la Renaissance, elle présente une vaste décoration, dont la seule peinture suffit à remplir tout l’espace ; en même temps, elle atteste la rupture accomplie avec la dernière survivance de l’École de Le Brun et le triomphe définitif des coloristes instruits aux exemples de Venise et des Flandres. Ce n’est pas sans raison que les tableaux admis sur les murs du Salon d’Hercule furent choisis parmi ceux de Véronèse. La composition lumineuse de notre Le Moyne, équilibrée sans effort, pleine sans encombrement, renoue les fortes traditions des Vénitiens et n’y sacrifie rien des qualités nationales ; elle met en œuvre déjà toutes les ressources de la peinture décorative du siècle, et l’art même d’un Tiepolo ne la dépassera point.
Les Grands Appartements du Roi, qui aboutissent au Salon d’Hercule, n’ont point été modifiés au dix-huitième siècle. Il n’en fut pas de même des Grands Appartements de la Reine, où s’exécuta le deuxième travail important de l’intérieur de Versailles, lorsqu’on dut refaire, à l’usage de Marie Leczinska, la chambre à coucher occupée successivement par la reine Marie-Thérèse, la dauphine de Bavière et la duchesse de Bourgogne.
En 1735, Ange-Jacques Gabriel travaillait depuis longtemps avec son père et se préparait à lui succéder dans sa charge de Premier architecte. Ce sont eux qui dessinèrent le décor mural pour la Chambre de la Reine, destiné à remplacer celui de Le Vau qu’accompagnait un plafond peint par Gilbert de Sève. Il existe de ce projet deux beaux lavis en couleur, revêtus du bon du Roi et dont l’un porte sa date : « Élévation du côté de la cheminée de la Chambre de la Reine, comme elle est résolue de faire lambrisser en 173532 ». Les trois trumeaux de glaces de la pièce, dont un seul subsiste, étaient surmontés de la couronne royale et entourés de tiges de palmier, laissant dans le haut de la bordure la place d’un portrait ovale. Le palmier se retrouve au-dessus des portes, dans l’encadrement des tableaux ; mais les déplorables arrangements du musée de Louis-Philippe ont exigé la destruction des parois latérales.33 La cheminée ornée des bronzes de Vassé avait déjà été remplacée au temps de Marie-Antoinette.34 Le fond de la pièce, où se voient encore les pitons ayant soutenu le lit, était recouvert de tapisseries qui revenaient sur les angles jusqu’au balustre doré. Les fragments de boiseries restés en place donnent une idée de la richesse de décoration déployée dans cette pièce principale de l’appartement de la Reine.
Le travail des sculptures offre la plus grande ressemblance avec celui de Jacques Verberckt dans les Cabinets de Louis XV et dans sa chambre à coucher, qui date de 1738 ; mais les Comptes en permettent nettement l’attribution à cet artiste.35 Le sculpteur anversois, qui s’est déjà fait connaître par des travaux dans la bibliothèque du Roi et aux petits appartements du second étage, prend à cette heure la première place parmi les décorateurs de Versailles. On peut supposer que les belles boiseries de la Chambre de Marie Leczinska, le plus ancien ensemble qui reste de cet artiste, ont servi sa réputation et achevé d’accréditer son talent auprès de l’administration des Bâtiments.
Les tableaux en dessus de portes, dont la bordure est remarquée par La Martinière comme de « forme singulière », furent ordonnés dès l’année précédente à deux peintres en renom. Les Comptes de 1734 mentionnent, en effet, ce payement du 25 avril 1733 : « Au sieur Natoire, pour un tableau allégorique représentant la Jeunesse et la Vertu présentant les deux princesses à la France, qu’il a fait pour l’appartement de la Reine, 1.800 livres. Au sieur Detroyes pour un tableau allégorique représentant la Gloire qui s’empare des Enfants de France, qu’il a fait pour id., 1.800 livres ». Les tableaux sont signés par les deux peintres avec la date de 1734. Dans celui de Natoire, placé du côté du Salon de la Paix, figurent Mesdames Élisabeth et Henriette, nées jumelles le 14 août 1727 et, par conséquent, âgées de sept ans. L’une s’appuie sur la France au manteau fleurdelisé ; l’autre est soutenue par la Jeunesse à genoux, ayant près d’elle le génie de la Vertu. Dans la composition de Jean-François De Troy, il y a trois enfants, parmi lesquels on reconnaît à son costume le Dauphin, né en 1729 ; la Gloire l’amène par la main aux pieds de la France assise et tenant près d’elle les deux jeunes sœurs. Ce tableau, d’une coloration chaude et où l’éclat des étoffes fait penser aux peintres vénitiens, est parmi les meilleurs de l’artiste.
Un troisième peintre, Boucher, a travaillé dans cette chambre, mais seulement au plafond, où quatre compositions en camaïeu sont de lui. Elles représentent, portées chacune sur des nuages, la Charité entourée d’enfants, l’Abondance répandant des fruits autour d’elle, la Fidélité auprès d’un autel et tenant un cœur enflammé, la Prudence avec un miroir où s’enroule un serpent. Ces morceaux peu connus ont pu subir quelque restauration, lors des réparations du plafond, mais ils gardent le charme du maître. Les Bâtiments ont donné, en 1738, « au sieur Boucher, pour son payement de quatre tableaux en grisaille, qu’il a faits pour la Chambre de la Reine en 1735, 1.000 livres36 ». Ils remplaçaient ceux où Gilbert de Sève avait peint des reines illustres : Didon bâtissant Carthage, Nitocris, reine d’Assyrie (sic), faisant construire un pont sur l’Euphrate ; Rhodope, reine d’Égypte, élevant une des Pyramides ; enfin, sujet moins édifiant, un festin de Cléopâtre avec Antoine. Ces ouvrages avaient fort noirci ; d’ailleurs, les vertueuses figures de Boucher convenaient mieux que ces compositions pompeuses au caractère de Marie Leczinska. Les camaïeux furent encadrés de bordures chantournées ovales, « couronnées d’un cartouche avec une tête au-dessus » et soutenues par « deux enfants de carton sculptés, assis sur la corniche, avec des palmes et des festons ». Ces bordures sont intactes et, du décor de 1735, reste encore cette coupole, « qui s’élève en perspective dans le haut du plafond, remplie par une mosaïque tournante, garnie de roses fleuronnées37 », et qui avait remplacé le Soleil, accompagné des Heures, de Gilbert de Sève. Le reste du plafond a subi de grands changements et n’a pris son aspect actuel qu’en 1770, lorsque la Dauphine Marie-Antoinette est venue occuper la chambre royale.
L’œuvre de Gabriel et de Verberckt, hardiment inspirée d’un goût nouveau, devait trouver des résistances. On lui préféra dédaigneusement la chambre que Mansart avait faite pour Louis XIV et qui fournissait, à Versailles même, une fort intéressante comparaison. L’écho de ces critiques se retrouve, en 1748, dans le morceau suivant : « Que les architectes du dernier siècle en savaient davantage ! Quoi de plus auguste que la chambre de parade du Roi à Versailles ! Tout y est d’une simplicité sublime ; en la voyant, on se croit au milieu de l’ancienne Rome, dans le palais des Césars. On n’a rien fait de notre temps qui en approche, et ceux qui ont été chargés de la décoration de celle de la Reine eussent mieux fait de s’en tenir à copier exactement ce qu’on venait de détruire. Quand une chose semblable a reçu l’approbation générale des connaisseurs, ne devrait-on pas chercher à la perpétuer ? Ne serait-ce pas dommage, si la nécessité obligeait de refaire la chambre de parade du Roi, qu’on substituât d’autres pensées à celles de ce superbe morceau ?... Nos modernes, prodigues en ornements, sont de médiocres décorateurs38 ! » Gabriel allait fournir d’abondantes preuves, pendant toute la première période de ses travaux, du parti qu’on pouvait tirer de cette décoration tant discutée et qui n’est autre chose que le grand style Louis XV de la bonne époque.
L’administration du duc d’Antin ordonna une dernière grande commande de sculpture qui fut destinée à la Chapelle et distribuée à un groupe d’artistes, pour la plupart jeunes pensionnaires du Roi, revenant de Rome avec un commencement de réputation. Il s’agissait de remplacer par des bas-reliefs de bronze, représentant des scènes de la vie des Saints, ceux de plâtre placés provisoirement sur les petits autels en 1710, et qui s’y trouvaient encore.39 C’était, dans le noble édifice, le seul détail laissé inachevé par Robert de Cotte, et la direction des Bâtiments, tenant pour règle la continuité des desseins, avait pour mission d’assurer l’achèvement des entreprises commencées. On doit voir dans la commande de 1734 un nouvel exemple de ce travail collectif périodiquement réparti entre plusieurs mains et destiné à se fondre dans l’unité rigoureuse d’un ensemble. Mais les choses avaient changé, depuis le temps où les sculpteurs employés à la Chapelle de Versailles travaillaient sous une telle discipline et avec des façons si pareilles qu’il restait difficile, et presque impossible, de distinguer les ouvrages de chacun d’eux. La personnalité des artistes commençait à s’affirmer davantage ; nul ne voulait plus restreindre les droits de son imagination et les recherches originales de son métier ; et la parure charmante, mais inégale, qui s’apprêtait pour notre Chapelle, allait déployer, au milieu de sa riche décoration partout sagement réglée, une variété d’inspiration qui ne s’y trouvait pas prévue.
La commande du duc d’Antin s’exécuta avec lenteur. Les sculpteurs n’avaient pas reçu la fourniture du bronze lorsque le directeur des Bâtiments mourut, le 2 novembre 1736. Les premiers acomptes, datés de 1737, appartiennent à l’administration de son successeur, Philibert Orry, qui prit fin le 6 décembre 1745, les travaux n’étant point terminés. Les bas-reliefs ne furent posés qu’au commencement de l’année 1747, sous la direction de Le Normant de Tournehem. Si l’on songe que les premiers modèles destinés à garnir les autels remontent à l’époque où fut entreprise la décoration de la Chapelle, on constate qu’on avait mis quarante ans à terminer l’unique partie qui y fût restée en suspens. Nous y avons gagné plusieurs morceaux excellents et variés, qui n’altèrent en rien l’harmonie générale et viennent seulement souligner la transformation de l’art.
Il y a six autels dans les bas-côtés, outre les deux de l’étage des tribunes, l’un à la chapelle de la Vierge, l’autre dédié à sainte Thérèse. Au-dessous du crucifix qu’accompagnent les délicieux angelots de bronze de Cayot, variés pour chaque autel, une double bordure de marbre et de bronze contient des bas-reliefs fondus à cire perdue.40 On trouve, dans le bas-côté de droite, sainte Adélaïde quittant saint Odilon, abbé de Cluny, par Adam l’aîné, le seul signé de nos bas-reliefs (Lamb. Sigisb. Adam natu maior invenit et fecit, 1742) ; sainte Anne instruisant la Vierge, fondu par les soins de Verberckt ; saint Charles Borromée demandant, dans une procession solennelle, la cessation de la peste de Milan, par Bouchardon ; dans le bas-côté de gauche, le Martyre de sainte Victoire, par Nicolas-Sébastien Adam, dit le cadet ; saint Louis servant les pauvres, à l’autel de la chapelle dédiée à saint Louis, bas-relief fondu par les soins de deux des frères Slodtz, Sébastien-Antoine et Paul-Ambroise ; le Martyre de saint Philippe, par Ladatte. Le bas-relief représentant la Mort de sainte Thérèse, entourée de ses compagnes, est de Vinache, et celui de la Visitation, qui est au-devant de l’autel de la Vierge, de Guillaume Coustou le fils. Ces attributions sont celles que permettent de vérifier les documents d’archives. Il est aisé de voir que deux de ces bas-reliefs offrent avec les autres des différences de style considérables et se réclament plutôt de l’art de la fin du règne de Louis XIV. On peut penser que Verberckt et les frères Slodtz n’ont fait qu’assurer l’exécution en bronze de deux des plâtres anciennement posés, l’un, celui de l’autel de sainte Anne, modelé par Cayot, l’autre, celui de saint Louis, modelé par Sébastien Slodtz le père. La froideur est surtout sensible dans ce dernier, où le roi, en culotte courte et manteau fleurdelisé, apporte des aliments à trois pauvres attablés, tandis que des serviteurs s’empressent et que des pages admirent cet acte de charité, rappelant peut-être la cérémonie royale qui avait lieu à Versailles le jeudi saint. Les six autres bas-reliefs, d’une composition bien plus riche et plus vivante, nous font voir comment, en ce moment du dix-huitième siècle, des éléments pittoresques et d’un réalisme moins discret qu’autrefois prennent place dans le bas-relief décoratif.
Les deux Adam ont traité avec une imagination presque picturale les beaux sujets qui leur étaient offerts. Dans le bas-relief consacré à sainte Adélaïde, reine d’Italie, puis impératrice d’Allemagne, et patronne de la duchesse de Bourgogne, mère de Louis XV, le contraste est fortement marqué entre le groupe de la reine agenouillée avec ses suivantes et celui que forment, sur le seuil de l’abbaye, saint Odilon entouré de ses moines. Le Martyre de sainte Victoire, qu’Adam le jeune exposa deux fois au Salon, le plâtre en 1737, le bronze en 1743, fut regardé par les contemporains comme son œuvre la meilleure. La scène mouvementée qu’il a conçue justifie cette opinion : au milieu la vierge chrétienne, qui a refusé de sacrifier à Jupiter, vient de se frapper du glaive ; sa grâce et sa faiblesse sont mises en valeur par les figures de violence qui l’entourent, le bourreau qui la délie de ses cordes, le grand-prêtre qui lui montre d’un geste impérieux la statue du dieu, dont seul le pied apparaît sur le socle, l’esclave qui maintient auprès de l’autel un taureau furieux ; dans le fond du tableau de bronze, apparaissent les terrasses d’un palais. Pour une composition plus paisible, la Procession de la peste de Milan, Bouchardon n’a pas été moins bien inspiré ; l’ardeur extasiée de l’archevêque chantant des prières, la noble marche du clergé qui soutient ou précède le dais, l’aspect lamentable des suppliants, forment une scène d’une majesté émouvante et d’une curieuse vérité. Le plâtre du sculpteur parut au Salon de 1739, à côté du modèle en terre cuite de sa statue fameuse de l’Amour se taillant un arc dans la massue d’Hercule. La Visitation de Guillaume Coustou le fils, de qui ce fut l’œuvre de début à son retour de Rome, et la Mort de sainte Thérèse de Vinache ne sauraient être comparées à d’aussi brillants chefs-d’œuvre ; mais le premier bas-relief se recommande par la distinction des figures principales, le second, par la sincérité de l’émotion. Il n’y a guère que le saintPhilippe de Ladatte qu’on puisse trouver médiocre, avec l’expression grimaçante des visages et la surabondance des draperies, qui exagèrent et défigurent le style dramatique des Adam.
Un ensemble de sculpture, plus considérable encore que les bronzes de la Chapelle, est installé dans les jardins de Versailles. Ce sont les grands ouvrages de plomb du Bassin de Neptune. Cette commande, postérieure à la précédente, quoique terminée avant elle, paraît être la première à l’exécution de laquelle préside Philibert Orry, qui succède au duc d’Antin en 1736. Mais elle a été préparée, en 1735, par un concours pour la composition centrale, le Triomphe de Neptune, où fut préféré le projet de Lambert-Sigisbert Adam. C’est aux Comptes de 1737 que figure le paiement des trois « modèles de la pièce de Neptune » commandés à Edme Bouchardon, à Adam l’aîné et à Jean-Baptiste Lemoine. En 1738, les acomptes donnés aux artistes indiquent que l’ouvrage en plomb se trouve déjà en cours d’exécution, et les parfaits paiements sont de l’année 1742 pour Adam et pour Lemoine ; le premier reçoit 30.000 livres pour l’ensemble où figurent Neptune et Amphitrite ; le second, 13.500 livres pour son groupe de l’Océan, d’importance égale à celui de Protée, par Bouchardon.41 C’est celui-ci qui a été terminé le premier, si l’on s’en tient aux inscriptions ainsi conçues : Edmundus Bouchardon faciebat Ao Di 1739. – Jean Bap. Lemoine faciebat 1740. — Lai Sigisbertus Adam natu maior ini et fecit 1740.42
Le Triomphe de Neptune est un morceau d’une importance exceptionnelle, et la description qu’en donna le Mercure de France, au cahier de janvier 1741, témoigne de l’intérêt qu’il inspira aux contemporains. Même sous Louis XIV, on n’avait pas osé entreprendre une aussi vaste fonte de plomb.43 Les figures ont quatre mètres de proportions et l’ensemble quatorze mètres de long. Sigisbert Adam ne l’a point exécuté seul ; il était associé à son frère Nicolas-Sébastien, qui l’aida à son retour de Rome, et le jeune François-Gaspard Adam prit une part assez active dans « la pratique du modèle des nombreux accessoires qui décorent ce groupe ». Dès le début des travaux, les sculpteurs se plaignirent de ne pas recevoir à temps l’argent qui permettait de payer leurs ouvriers. Le groupe mis en place, Sigisbert Adam ne cessa de réclamer auprès du directeur général, fournissant un mémoire de 45.000 livres et prétendant n’y trouver aucun bénéfice. Son dernier placet paraît faire appel à une gratification du Roi, qui se contenta de lui accorder une pension de 500 livres, pour marquer sa satisfaction du travail de Neptune.44 Ce chef-d’œuvre des artistes lorrains soutient la comparaison avec un autre triomphe marin, celui d’Apollon par Tubi, placé à l’extrémité des jardins.
Une véritable reconstruction du Bassin de Neptune avait précédé les travaux des sculpteurs. Elle fut achevée au mois d’août 1741, et les eaux jouèrent le 11 de ce mois, devant le Roi et la Cour, après une interruption de plusieurs années.45 Ce grand ouvrage était annoncé au public par Piganiol de la Force, dans son édition de 1738 ; il y rappelait fort exactement les projets de Louis XIV sur le Bassin de Neptune : « On vient de rebâtir la tablette qui domine sur ce bassin, et on l’a construite avec plus de solidité et avec des ornements d’architecture et de sculpture qu’elle n’avait pas auparavant. Dès le vivant du roi Louis XIV, on avait formé le dessein d’orner ce bassin de quelques morceaux de sculpture qui fissent connaître que c’était ici le triomphe de Neptune ; mais ce projet n’a point eu d’exécution. Dans la face de cette tablette sont trois massifs de fondement ou plateaux, sur lesquels seront des groupes de figures de métal bronzé, qui représenteront Neptune accompagné d’Amphitrite, de néréides, de tritons, de chevaux et de monstres marins. Les modèles de tous ces groupes sont fixés et il ne reste plus qu’à les jeter en fonte, ce qui sera incessamment exécuté46 ». Le remaniement architectural complet, exécuté par Jacques Gabriel, fut entrepris dès 1733. À ce moment commença la réfection du chéneau supérieur, dont les plombs étaient en mauvais état, et des canalisations qui n’avaient pas moins souffert. Les trois gradins de pierre, dont Mansart avait encadré la partie circulaire, furent remplacés par une simple margelle. On restaura les vases, vasques et coquilles de plomb, que leurs armatures oxydées laissaient s’affaisser et se fendre. Le long mur fut reconstruit entièrement ; mais le décor se trouva renouvelé surtout par ces plateaux, presque à fleur d’eau, sur lesquels se posèrent les groupes colossaux de plomb doré.
À la distance où ils sont placés, ils produisent un effet grandiose. Ils sont cependant de valeur inégale ; le morceau un peu maniéré de J.-B. Lemoine se ressent de la jeunesse du sculpteur et de l’influence italienne qu’il subissait encore. C’est le groupe de gauche, qui représente Protée dans la nudité d’un jeune dieu, penché sur un monstre marin ; sous l’énorme coquillage qui les porte apparaissent d’autres têtes du troupeau de Neptune, dont Protée est le gardien. Sur le plateau de droite est l’Océan lui-même, vieillard couché sur une licorne, entouré de poissons et de plantes de mer. Au centre du bassin, supporté par le dos d’un monstre dont la gueule jette une ample nappe d’eau, règne le couple des grandes divinités : Neptune, presque nu, brandit le trident sur les flots ; Amphitrite, gracieusement étendue, avec un enfant auprès d’elle, reçoit des mains d’une néréide une branche de corail, qui symbolise les richesses des eaux. Une vache marine, un cheval cabré que dompte un triton, occupent encore le vaste plateau, que deux dauphins soulèvent, tandis qu’un triton puissant nage au-devant, sonnant de la conque.
À ces grands ouvrages, disposés pour servir de motifs aux gerbes jaillissantes des eaux, s’ajoutent de chaque côté du bassin deux Amours chevauchant des dragons géants. Bouchardon, qui est l’auteur de ces groupes et les a signés comme le Protée, y interprète l’enfance, en dépit de leurs proportions colossales, dans le sentiment gracieux du dix-huitième siècle. Les mains potelées nouent une écharpe au col du monstre, qui se redresse avec vigueur, bat le sol de sa queue, essaie de se débarrasser du petit cavalier ; mais celui-ci soutient l’effort en souriant et maîtrise avec aisance la bête en furie. Malgré le style accusé du temps, particulièrement sensible en ces derniers morceaux, la nouvelle décoration du Bassin de Neptune prend place sans disparate auprès de l’ancienne. Réalisant une pensée d’autrefois au milieu d’un siècle bien différent de celui qui l’a conçue, elle s’y adapte aisément, parce que le sens de la grandeur n’est point perdu. Nul exemple n’enseigne mieux la continuité de l’art français et la manière dont les générations les plus diverses ont enrichi tour à tour le trésor national, en restant fidèles aux principes essentiels de notre génie.
II. – Le Versailles de Gabriel
Si Mansart domine l’histoire architecturale de Versailles, les noms de son prédécesseur Le Vau et de son successeur Gabriel doivent cependant être placés à côté du sien. Les trois grands artistes ont marqué sur nos édifices royaux l’empreinte du style de leur temps et celle de leur art personnel, et chacun d’eux revendiquerait à bon droit une part certaine dans la création du Château. Quoique venu le dernier, Ange-Jacques Gabriel put se flatter un moment que ses ouvrages y prendraient autant de place que ceux de Mansart ; les plans de reconstruction qu’il a dressés, l’amorce des travaux qu’il a entrepris témoignent, en effet, que le dix-huitième siècle fut tout près de voir, à son tour, une complète transformation de Versailles.
Dès l’époque de l’installation de la Cour, à l’heure même où se réalisait le rêve de Louis XIV, une question s’est offerte à la décision du souverain et à l’ingéniosité de ses architectes. Avec le temps, elle s’est faite plus pressante. La noble façade du Château sur les jardins, où Mansart a remanié savamment les constructions de Le Vau et jeté sur leur flanc les longues ailes, donne toujours matière à l’admiration. Les théoriciens d’un art plus strict et plus soumis aux règles classiques lui adressent bien quelques reproches ; mais sa majestueuse grandeur ne peut être contestée. En revanche, les façades qui regardent les avenues présentent avec celles des jardins une disproportion choquante et imposent à l’esprit un fâcheux contraste. Là, des bâtiments assez bien liés, quoique d’âge diffèrent, où la brique se mêle partout à la pierre, mènent l’œil au centre de l’habitation royale par des cours peu à peu rétrécies. Ils marquent trop visiblement la suite irrégulière des agrandissements du Château. La pente du sol, qui alors n’est point rectifiée, contribue même à détruire l’effet de la cour de Marbre, dont le bas demeure caché aux arrivants. On n’hésite pas à déclarer ces aspects indignes du prince magnifique qui réside en ces édifices mal équilibrés, et le sentiment public s’offense pour lui de leurs grâces médiocres. Nul n’apprécie plus l’élégance des façades anciennes aux balustrades chargées de statues, ni l’harmonie colorée de la brique et de la pierre, que rehausse l’or des balcons et des plombs des combles et dont nous saurons goûter sans remords le pittoresque heureux. L’ancien Versailles est âprement critiqué. Dans l’architecture comme dans les lettres, le dix-septième siècle finissant est impitoyable pour les beautés, pourtant de qualité si française, qu’a su créer sa jeunesse.
Les architectes ont depuis longtemps conçu des plans plus réguliers. Déjà Claude Perrault, suivant l’anecdote rapportée par son frère Charles, dressait un projet complet, afin d’« abattre ce petit château pour achever tout le palais du même ordre et de la même construction que ce qui est bâti de nouveau47 ». Plus tard, au cours de ses propres travaux, Mansart, qui pense aussi grandement que son maître et l’encourage à donner à Versailles entier les mêmes proportions, s’est hâté de dessiner une réfection générale de la cour Royale, qui dissimulerait la cour de Marbre derrière une riche colonnade et préparerait l’élargissement et l’embellissement de l’avant-cour. Divers projets du même genre se succèdent, tellement paraissent inacceptables, dans la maison de nos rois, le désaccord entre les deux faces et « le vaste et l’étranglé cousus ensemble », dont s’indigne Saint-Simon. Nous ne savons rien sur les intentions définitives de Louis XIV et sur le sort qu’il eût réservé aux anciens bâtiments jusqu’alors respectés ; les malheurs de la fin du règne et la détresse financière qui les accompagna écartèrent toute idée de cette reconstruction de Versailles, sans éloigner des esprits les critiques qui l’avaient fait proposer.
Voltaire a plus d’une fois l’occasion de les exprimer. Au cours des fantaisies souvent judicieuses de son Temple du Goût, dont la première édition est de 1733, il place sur l’autel de cette divinité le dessin de Versailles : « Mais, ajoute-t-il, il est accompagné d’un arrêt du dieu, qui ordonne qu’on abatte au moins tout le côté de la cour, afin qu’on n’ait point à la fois en France un chef-d’œuvre de mauvais goût et de magnificence ». La même observation sur la création jugée incomplète du Grand Roi se retrouve, en 1748, dans les Anecdotes sur Louis XIV : « Malgré son goût pour la grande et noble architecture, il laissa subsister l’ancien corps du Château de Versailles, avec les sept croisées de face et sa petite cour de Marbre du côté de Paris. Petit à petit, il en fit le palais immense dont la façade du côté du jardin est ce qu’il y a de plus beau dans le monde, et dont l’autre façade est dans le plus petit et le plus mauvais goût ».
Voici enfin, dans le Siècle de Louis XIV, paru en 1751, le résumé en quelques paroles de l’opinion du temps sur Versailles : « La nation désirait que Louis XIV eût préféré son Louvre et sa capitale au palais de Versailles, que le duc de Créqui appelait un favori sans mérite. La postérité admire avec reconnaissance ce qu’on a fait de grand pour le public ; mais la critique se joint à l’admiration quand on voit ce que Louis XIV a fait de superbe et de défectueux pour sa maison de campagne48 ».
Voltaire, comme d’ordinaire, n’était que l’écho des artistes et des amateurs les plus autorisés, et l’avis de ceux-ci se trouve formulé, avec toute la précision désirable, dans une page de Blondel. Ce maître des jeunes générations d’architectes a institué une véritable critique de Versailles et distribué, au cours de ses descriptions, l’éloge et le blâme aux artistes de l’époque précédente. La façade des jardins ne trouve pas grâce devant lui ; il en juge l’ordre ionique mesquin et même « intolérable » dans un bâtiment de cette étendue ; il se dit choqué par la répétition du plein cintre aux arcades des deux étages, par la hauteur outrée de la balustrade qui écrase l’attique, etc. : « Quelque estime, dit-il, que nous fassions d’ailleurs des talents d’Hardouin-Mansart, nous n’avons pas cru devoir passer sous silence autant d’inadvertances ; plus cette façade en impose au vulgaire, plus il nous a paru important de relever les licences qu’on y remarque ». Si Blondel est aussi sévère pour une œuvre conçue, en somme, avec une certaine unité, on peut s’attendre à le voir plus dur encore pour « ce qu’on appelle communément l’ancien Château ». Il s’y constate, croit-il, « tant d’irrégularités et de dissonances », parce qu’on a tenu à conserver les vieilles constructions de Louis XIII49 ; et c’est en vain que les restaurations des divers architectes ont essayé d’y remédier :
Dans le nombre de ces restaurations on doit compter les colonnades pratiquées au-devant des pavillons des extrémités de ce bâtiment et les cinq balcons portés par des colonnes doriques, d’un plus petit diamètre que celles qui soutiennent le grand entablement, mais toutes deux sont exécutées avec une irrégularité également condamnable. La balustrade, les vases et les figures, qui sont posés sur l’attique de l’avant-corps du milieu et l’amortissement qui les couronne, sont encore des additions, aussi bien que la plupart des combles, qui, malgré les ornements dont on les a revêtus, n’en paraissent pas plus supportables par leur excessive hauteur, ni plus convenables à la décoration de ce Palais, ayant prouvé ailleurs combien il était contraire à la bienséance de pratiquer des combles apparents au-dessus de la résidence d’une tête couronnée ; couverture qui ne présente toujours à l’idée du spectateur que des logements en galetas, contraires à la dignité d’un édifice tel que celui dont nous parlons, et qu’Hardouin-Mansart a su éviter dans l’ordonnance de la façade de ce même Palais du côté des jardins. Sans doute les augmentations, dont nous venons de faire mention, ont rendu cette ancienne façade plus supportable ; mais il faut convenir que, quelque amélioration que cela lui ait procurée, cette alliance de l’Architecture moderne avec celle semi-gothique qui y régnait auparavant forme un contraste qui présente une ordonnance trop imparfaite pour nous déterminer ici à en relever tous les abus.50
Ces observations, qui ne nous paraissent pas aussi fondées qu’aux contemporains de Blondel et en tout cas ne nous émeuvent plus, amenaient périodiquement dans le service des Bâtiments du Roi de nouvelles études sur Versailles. La reconstruction des cours, dont la tradition sera léguée par le comte d’Angiviller aux architectes de Napoléon, parut trouver sa formule définitive sous le crayon d’Ange-Jacques Gabriel. Cet architecte sut obtenir de Louis XV l’ordre de réaliser ce que ses confrères anciens avaient rêvé ; dans des conférences intimes, il en entretint plus d’une fois le souverain, dont il pouvait flatter librement les manies de bâtisseur. Dès 1739, le marquis d’Argenson note en son journal : « Le Roi fait continuellement dessiner devant lui en particulier le jeune Gabriel, de ses Bâtiments51