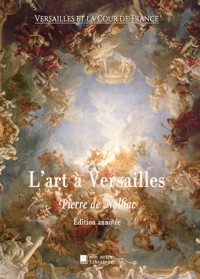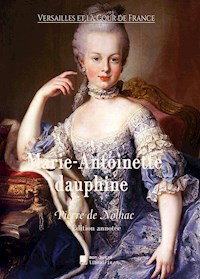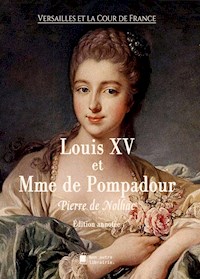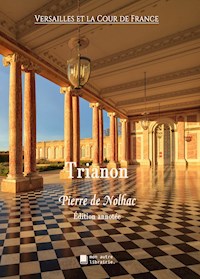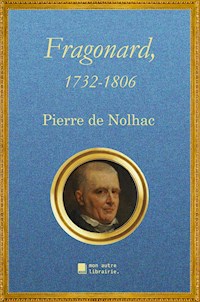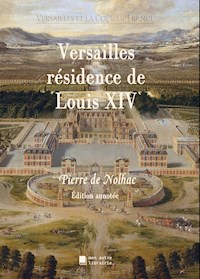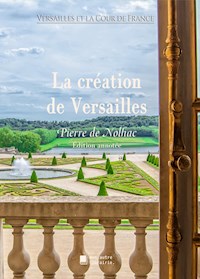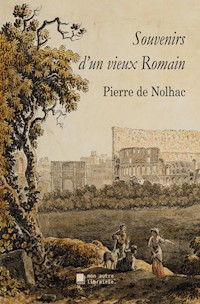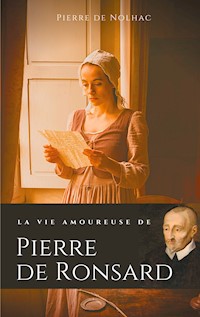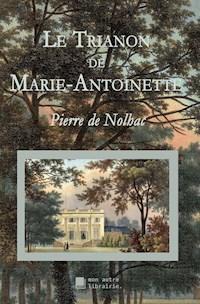Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Versailles et la Cour de France
- Sprache: Französisch
Fille, épouse, mère et reine parfaite - trop, peut-être - Marie Leczinska n'était pas de taille à lutter contre la cruauté des intrigues de Versailles. Poussée peu à peu dans l'ombre par les retentissantes frasques de son époux, sans une plante, sans un reproche, sans une révolte, elle parcourut une à une les douloureuses étapes de l'abandon, jusqu'à presque sortir de l'Histoire. Par le portrait de ce couple fortement contrasté, à l'image d'ailleurs de nombre d'autres dans les sphères de pouvoir, l'auteur éclaire pour nous une poignante réalité humaine. (Édition annotée.)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Louis XV et Marie Leczinska
Pierre de Nolhac
Édition annotée
Fait par Mon Autre Librairie
À partir de l’édition Louis Conard, Paris, 1928.
Les notes entre crochets ont été ajoutées pour la présente édition. Les extraits de Luynes ont été repris directement de l’édition du xixe siècle.
Couverture : Marie Leczinska par Alexis Simon Belle (détail)
https://monautrelibrairie.com
__________
© 2021, Mon Autre Librairie
ISBN : 978-2-38371-035-6
Versailles et la Cour de France
par
Pierre de Nolhac
La création de Versailles
Versailles résidence de Louis XIV
Versailles au xviiie siècle
Trianon
Louis XV et Marie Leczinska
Louis XV et Madame de Pompadour
Marie-Antoinette dauphine
La reine Marie-Antoinette
Madame de Pompadour et la politique
L’art à Versailles
Table des matières
I. – Le mariage
II. – Les années heureuses
III. – L’abandon
IV. – La bonne reine
Sources
Appendices
I. – Le mariage
En 1725 vivait sur terre française, à Wissembourg en Basse-Alsace, la famille d’un roi détrôné, dont le nom, plus d’une fois mêlé à l’histoire guerrière du commencement du siècle, semblait voué désormais au complet oubli.
Stanislas Leczinski (Leszczynski), simple palatin de Posnanie, élu roi de Pologne en 1704, grâce à l’amitié du grand Charles XII, avait partagé la fortune du héros de la Suède. Les revers de Charles avaient mis fin à ce règne, la Pologne ayant dû accepter à nouveau la royauté d’Auguste, électeur de Saxe, appuyé par les armées du czar Pierre. Le vaincu de Pultawa,1 fidèle à la fraternité des armes, ne laissait point sacrifier entièrement l’allié qui avait conduit au service de sa gloire la vaillance polonaise. Il lui donnait à gouverner la petite principauté de Deux-Ponts,2 sur la rive gauche du Rhin, rattachée momentanément à la couronne de Suède ; il lui permettait ainsi d’attendre l’heure où ils rentreraient ensemble dans Varsovie et reprendraient à l’usurpateur le sceptre des Jagellons.3
La mort de son protecteur ruinait bientôt les espérances de l’exilé et celles du parti qui le soutenait encore en Pologne. Une prompte détresse suivait ce malheur ; Leczinski devait abandonner Deux-Ponts, réclamé par l’héritier légitime, et la sœur de Charles XII, devenue reine de Suède, cessait de lui servir sa pension. Il vivait quelque temps de secours plus ou moins déguisés et d’emprunts aux banques de Francfort. Mais son existence même n’était pas en sûreté : les agents du roi Auguste, qui avaient tenté à plusieurs reprises de l’enlever ou de le tuer, recommençaient leurs complots avec des facilités nouvelles. Il fallait trouver à tout prix un asile. La place française de Landau le recevait en fugitif, avec les siens. Bientôt après, sa demande de séjour était accueillie par le Régent, au nom du petit roi Louis XV, et on lui laissait choisir la ville de l’intendance d’Alsace où il lui plairait de résider, sous la sauvegarde bienveillante de la France. C’est ainsi qu’au début de 1719 il s’était installé à Wissembourg. Il y gardait le reste de petite cour que conservent aux rois sans royaume le dévouement exalté par l’infortune et aussi l’indéracinable vanité des titres sonores.
Rien ne faisait prévoir que la vie déjà si agitée de Leczinzki dût avoir des revirements encore plus étranges que ceux qu’elle avait subis. De simple gentilhomme vivant sur ses terres, il était devenu roi et chef d’armée ; banni maintenant et réduit à mendier sa vie, l’avenir lui ménageait des retours extraordinaires, une royauté encore, puis, de nouveau, la chute, les émotions d’un proscrit, enfin, pour mettre à leur comble ces aventures, une espèce de trône honoraire et les studieux loisirs d’un philosophe couronné. Les circonstances et les hasards seuls avaient fait et devaient continuer cette étonnante carrière ; elle ne sortit point, comme on l’a cru longtemps, des mérites d’un homme capable de s’élever aux destinées les plus hautes et digne d’attirer sur sa tête les coups les plus violents de la fortune.
La légende faite autour du nom du roi Stanislas a été entretenue par les flatteries dues à une reine de France et soigneusement préparée par lui-même pendant la dernière partie de sa vie. Il ne fut, dans la réalité, ni le héros désintéressé, ni le pur philanthrope que ses biographes ont toujours dépeint. L’étude nouvelle des documents le montre atteint d’ambitions inguérissables, et médiocrement doué pour en soutenir les prétentions. Roi à vingt-sept ans par la volonté d’un grand capitaine, il s’est cru des titres personnels à le rester, et cette conviction orgueilleuse, qu’il s’imaginait tempérer suffisamment par l’humilité chrétienne, a pesé sur toutes les décisions de sa vie. Les chimères de son imagination le jetaient des enivrements de la vanité satisfaite aux défaillances du découragement. Honnête homme toutefois, dans tous les sens du mot, d’un esprit vif et lettré, plein de qualités privées fort respectables, affectueux et bon, capable de sentir très vivement l’amitié et de l’inspirer, dévoué et chevaleresque à la polonaise et bien pourvu de bravoure, Stanislas n’est accablé que par le rôle où il a voulu se hausser devant l’histoire. Il était né pour mener avec dignité la noble existence seigneuriale de son pays et pour les tendres devoirs du père de famille, plus que pour l’autorité et la responsabilité d’un grand royaume. Jamais, du reste, il ne mérita mieux la sympathie que pendant son exil à Wissembourg ; l’excès de son malheur anéantissait alors ses rêveries ambitieuses, et il supportait avec résignation et courage une disgrâce cette fois imméritée.
Stanislas et sa famille habitaient une modeste maison particulière, l’hôtel de Weber. La misère qui les accablait n’avait point pour décor la pittoresque commanderie en ruine dans laquelle les historiens ont aimé à la décrire, mais elle n’en est pas moins lamentable. Aucun secours n’arrivait de Pologne, où les biens du roi déchu étaient confisqués et où ses parents même l’abandonnaient ; les pierreries de la reine étaient en gage chez un prêteur ; quant à la pension du roi de France, elle ne venait pas avec exactitude, et il fallait souvent la réclamer des ministres par des lettres suppliantes et douloureuses.
Cette détresse d’argent était d’autant plus pénible à Stanislas qu’elle l’empêchait de remplir ses devoirs envers des serviteurs demeurés fidèles et qui entretenaient autour de lui l’apparence d’une vie royale. Tout espoir de restauration prochaine ayant disparu, ses compagnons de bannissement s’étaient peu à peu dispersés ; il ne restait plus auprès de lui que cinq ou six gentilshommes, dont le vieux baron de Meszeck, qui conservait, dans cette maison étrangère, le titre de grand maréchal du palais, et deux prêtres polonais, confesseurs de la reine et de la jeune princesse Marie. Un seul parent, le comte Tarlo, habitait avec Stanislas, ainsi que la mère du roi, que son grand âge et ses infirmités isolaient un peu de la famille. On vivait à l’écart du monde et presque ignoré de lui, recevant seulement quelques visites de la noblesse de la province. Le roi de Pologne avait noué cependant des relations d’amitié avec le cardinal de Rohan, évêque de Strasbourg, et le maréchal du Bourg, commandant de la même ville. Le prélat et le maréchal venaient assez souvent à Wissembourg, attirés par une infortune aussi intéressante, et proclamaient leur admiration affectueuse pour les vertus qu’ils y rencontraient.
Dans cet intérieur d’exilés, où la reine montrait plus de force de caractère que de douceur, et qu’attristait encore la morose vieillesse de la mère du roi, tout le sourire et toute la grâce venaient des vingt ans de la princesse Marie. À mesure que l’espoir de retourner en Pologne s’effaçait, les préoccupations de Stanislas se concentraient sur l’avenir de cette enfant, devenue fille unique par la mort récente d’une sœur aînée. Elle tenait de lui, non les traits de son visage, mais son humeur enjouée, son cœur passionné et son goût des occupations de l’esprit.
Il l’avait élevée lui-même, pendant les dernières années, dans les longs loisirs de Wissembourg, et lui avait donné une instruction forte, l’habitude des lectures solides, une religion sans bigoterie, non sans dévotion, et fort appuyée sur les pratiques. Destinée, comme il le semblait, à mener une vie modeste, elle avait reçu l’éducation qui se prête le mieux à en faire supporter la médiocrité et à en augmenter le charme. Elle dansait, chantait, jouait du clavecin, tout cela avec un goût naturel et sans avoir eu de maître de premier ordre pour l’y perfectionner. Il manquait à sa personne le don suprême de la beauté ; mais elle était agréable, bien faite, avec des yeux expressifs, un grand front, une jolie bouche et la jeunesse d’un teint dont l’eau fraîche faisait tout le fard. Une telle fille était de celles dont un cœur paternel s’enorgueillît et qu’il croit promises, par un droit spécial, à toutes les formes du bonheur.
Les seuls plaisirs que Marie eût goûtés jusqu’alors se réduisaient à l’intimité de son père, aux visites des rares amis et aux œuvres de charité, qui remplissaient ses journées et celles de sa mère et lui valaient l’affection des pauvres gens du voisinage. Le malheur persistant qui avait frappé autour d’elle avait développé ses sentiments de pitié et mûri par la souffrance son jeune esprit. Elle se rappelait le temps des guerres désastreuses, l’attente anxieuse des nouvelles, les inquiétudes continuelles sur une vie chère, les départs précipités, ces voyages qui ressemblaient à des fuites, enfin toutes ces années tragiques ou incertaines vécues par la famille en Posnanie, en Suède, en Poméranie, jusqu’à l’asile misérable qui l’abritait maintenant. Un jour, au château de Posen, lorsque Marie était tout enfant encore, les Russes étaient arrivés pendant une absence du père et avaient enfoncé les portes ; on l’avait fait fuir par une fenêtre sur les jardins ; au village où l’on s’était réfugié, un paysan l’avait cachée dans son four, et elle y avait attendu, sans bouger, de longues heures, que les ennemis redoutés fussent partis. De tels souvenirs n’étaient pas rares dans la mémoire de Marie et lui faisaient remercier Dieu et le roi de France de cette tranquillité présente qui ne suffisait point à son père.
L’exilé, qui signait encore « Stanislas roi », comme il le fit toute sa vie, subordonnait pour le moment ses ambitions politiques à ses devoirs de paternité. Cette enfant uniquement aimée et si digne d’être heureuse, mais sans fortune et sans patrie, ne pouvait plus attendre l’union qu’il avait autrefois rêvée pour elle. Isolé comme il l’était de son pays, c’était dans la noblesse de France ou des bords du Rhin qu’il devait trouver un protecteur pour cette chère destinée. Il n’oubliait pas, en ce temps où l’honneur du nom était compté dans le patrimoine des familles, que la gloire éphémère de sa royauté donnait à sa fille le droit d’être recherchée par de grands personnages ; mais ce même souvenir obligeait aussi le père à se montrer difficile sur les prétendants et restreignait singulièrement son choix.
Marie avait été demandée par le marquis de Courtenvaux, petit-fils du ministre Louvois, qui avait tenu garnison à Wissembourg et était, à Versailles, colonel des Cent-Suisses. Le jeune officier avait gardé un souvenir assez vif, comme on le voit, des charmes de la princesse ; mais il n’avait pu obtenir le duché-pairie que Stanislas eût souhaité pour son gendre, et le projet n’avait pas eu de suite. Le roi de Pologne avait songé, de son côté, au fils de la margrave de Bade, sa voisine ; mais celle-ci, après les premiers pourparlers, s’était dérobée, non sans laisser sentir qu’elle appréciait peu les avantages d’une alliance avec un roi sans couronne. Stanislas était encore sous l’humiliation de ce refus quand une proposition inattendue vint jeter dans la famille l’idée et l’ambition d’un mariage avec un prince de la maison de Bourbon. Ce prince était celui qu’on appelait M. le Duc4 et qui touchait d’assez près au trône, puisqu’il était le chef de la maison de Condé, la première après celle d’Orléans.
Ce qu’on savait de la cour de Versailles au modeste foyer de Wissembourg se réduisait à peu de chose. Bien rarement un étranger de distinction, traversant l’Alsace et visitant Stanislas, y avait apporté l’écho direct des fêtes et des intrigues de la Régence. Le roi avait jadis, dans ses voyages de jeunesse, entrevu le rayonnement de gloire de Louis XIV ; mais le monde nouveau qui l’avait remplacé lui était entièrement inconnu. Il était cependant trop avisé pour tirer seulement des gazettes et des conversations de gens de province ses informations sur les choses de France et sur les hommes qui les gouvernaient. Un ami très sûr, le chevalier de Vauchoux, le renseignait. Ce Vauchoux, qui avait servi sous ses ordres, au temps de Charles XII, et qui venait quelquefois le voir en Alsace, lui servait d’agent d’affaires à Paris ; et, comme la grande affaire de Stanislas se trouvait être l’établissement de sa fille, c’était le petit gentilhomme qui avait mené à lui seul les négociations que nous allons dire et que rien n’avait ébruitées au moment de la mort du Régent.
Ce ne fut pas sans émotion que Stanislas apprit l’élévation au premier ministère du prince qu’il rêvait pour gendre. Il vit aussitôt, si le projet se réalisait, l’avenir de sa fille assuré de la façon la plus brillante, personne à ce moment ne pouvant prévoir les destins plus glorieux encore qui l’attendaient.
Qu’était alors cette Cour de France où la princesse Marie semblait appelée à vivre, et quelles circonstances singulières lui en avaient ouvert le chemin ? Comment les événements allaient-ils marcher assez vite pour remplacer l’alliance déjà inespérée du sang royal par celle du Roi lui-même ?
Il y a à Versailles un roi de quinze ans, dont tous les goûts sont pour la chasse et qui est fiancé par politique, depuis 1721, à une gracieuse petite Infante,5 vivant à la Cour et attendant l’heure du mariage. Elle doit prendre patience longtemps encore, puisqu’elle n’a pas même sept ans, mais son union est assurée par les plus solennels engagements et par sa présence au Louvre, au milieu d’honneurs presque royaux. Si la princesse espagnole et le jeune Louis XV sont un couple charmant, on le voit rarement réuni, et il ne saurait être bien intéressant. Ce sont deux enfants, autour de qui se fait la politique et qui n’en font pas. Il y a, au contraire, près du trône, deux hommes, d’inégale importance, exerçant tous les deux une part du pouvoir : l’un, M. de Fleury, ancien évêque de Fréjus, se contente pour le moment de conduire l’esprit du Roi, dont il a été le précepteur et dont il reste le seul conseiller ; l’autre, Louis de Condé, duc de Bourbon, gouverne l’État et prend la parole devant l’Europe au nom de son maître.
Aucun choc n’a heurté l’une à l’autre ces deux puissances. C’est M. de Fréjus qui a fait donner le ministère à M. le Duc, au lendemain de la mort du Régent, parce que personne ne pouvait lui porter moins d’ombrage. Ce prince de trente ans, d’intelligence ordinaire, remplace par une infatuation assez discrète l’expérience des affaires, qu’il est incapable d’acquérir. Quant au vieux prêtre, doucereux et poli, son ambition est sans mesure, non sans prudence ; il sait très sûrement qu’il recevra le pouvoir des mains de son élève, lorsque l’heure sera venue ; mais il n’est point pressé : il a soixante-dix ans et peut attendre encore, ayant attendu si longtemps.
Une idée principale domine la politique de M. le Duc et y donne, comme il arrive, une direction fort opposée à celle que suivait le précédent régime. La Régence, sans nuire aux intérêts de la France, a servi à grandir la maison d’Orléans. On rêve aujourd’hui de l’abaisser. Le mariage réalisé d’une fille du Régent, Mademoiselle de Montpensier,6 avec le prince héritier d’Espagne, en échange de la promesse de mariage entre Louis XV et l’Infante, a consacré l’étroite union des deux pays, chère au Grand Roi ; mais elle a été, pour la branche cadette de la maison de France, un triomphe d’ambition, suivi bientôt d’un autre succès, le projet d’union entre une seconde princesse, Mademoiselle de Beaujolais,7 et cet Infant don Carlos, dont on compte faire un duc de Parme. En même temps que ces couronnes sont promises à des princesses d’Orléans, le très jeune âge de la petite Infante-Reine maintient, pour de longues années encore, les chances de succession au trône de France en faveur du duc d’Orléans, premier prince du sang.
Le titre est porté, à cette heure, par un jeune homme de vingt ans,8 dont le rôle demeure assez effacé et qui, occupé de charités et d’affaires religieuses, promet d’être en contraste absolu avec son père. S’il semble peu fait pour inspirer une grande haine, il est du moins assez jaloux de ses prérogatives et assez fidèle aux traditions de sa famille pour n’en rien abandonner aux prétentions rivales de la maison de Condé, la plus rapprochée du trône après la sienne. Le hasard peut avoir mis le pouvoir suprême dans les mains d’un Condé sans qu’il ait cessé de le regarder comme son inférieur par la naissance. La lutte de deux mères orgueilleuses, la duchesse d’Orléans et la duchesse de Bourbon, ajoute à l’hostilité entre les deux princes. La première a refusé avec hauteur la main de la sœur du ministre pour son fils et vient de lui faire épouser une princesse de Bade9 ; ce mariage a fait l’occasion d’un redoublement de froideur et d’impertinences, et tout un parti de Cour assez nombreux s’est empressé de rappeler que le jeune duc d’Orléans, tant que Louis XV n’est pas marié, doit être regardé comme l’héritier présomptif de la couronne.
Le Régent a eu le mérite, au milieu de ses pires débauches, de ne jamais abandonner aux mains des femmes la politique du royaume. Il n’en va pas de même avec M. le Duc, qui continue seulement par ses pitoyables mœurs les traditions de Philippe d’Orléans. Il accorde à sa maîtresse, Mme de Prie, une autorité si grande sur son esprit qu’elle est devenue en peu de temps plus puissante dans l’État que le premier ministre lui-même ; et c’est une singulière figure que celle de cette femme, d’une ambition si âpre et d’une destinée si courte, qui ouvre, dès l’adolescence de Louis XV, la série des maîtresses politiques du 18e siècle.
Fille d’un riche entrepreneur de vivres, Berthelot de Pléneuf, elle a été mariée de bonne heure, pour sa jolie taille et ses écus, au marquis de Prie, de fort bonne et même grande maison, proche parent de la duchesse de Ventadour, gouvernante du Roi. Elle a jeté son premier éclat à la Cour de Turin, où son mari a soutenu, avec l’argent du mariage, une brillante ambassade. Mais la ruine est arrivée, Berthelot ayant été « recherché », pour l’origine de sa fortune et ayant dû donner ses biens pour sauver sa tête. La marquise de Prie, sous les grâces de sa jeunesse et la vivacité de ses yeux chinois, cache l’âme d’un roué de la Régence ; l’impiété cynique s’y mêle à une avidité sans mesure et à cette galanterie qui se passe de sentiment. Elle a tenté, en plus d’une expérience, de retenir un cœur qui pourrait lui rendre la fortune. Celui du duc de Bourbon s’y est laissé prendre, ce qui est déjà pour elle une belle aventure ; puis la chance échue à son amant de devenir premier ministre lui a donné à elle-même le goût de diriger l’État. M. le Duc étant laid, borgne et borné, il semble juste à Mme de Prie que les répugnances qu’il lui cause soient payées par la pleine satisfaction de sa cupidité et de son orgueil. Le prince n’a rien à refuser à une maîtresse déclarée, dont l’intelligence, lucide et ferme, le domine. Voilà comment, en ce moment du règne où le Roi, quoique légalement majeur, ne gouverne pas, c’est Mme de Prie qui tient la France.
Jamais peut-être les affaires nationales n’ont été confiées avec moins de contrôle à des mains plus indignes de les manier. La preuve n’est point faite que Mme de Prie reçoive, pour servir l’Angleterre, la pension payée, dit-on, à Dubois, ni qu’elle ait mérité du cabinet de Londres d’aussi flatteuses marques de confiance. Mais si les erreurs diplomatiques du moment peuvent s’expliquer par d’autres causes, les fautes intérieures qui ont rendu très vite impopulaire le gouvernement de M. le Duc sont justement imputables à sa conseillère. Elles portent surtout sur les mesures destinées à se procurer de l’argent. Un de ces trois frères Pâris, qui ont été les collaborateurs financiers du Régent, Pâris-Duverney, a mis son activité hardie au service du nouveau régime et s’est tout dévoué à la favorite. Quand on a, sur l’avis de Duverney, diminué la valeur légale des monnaies et l’intérêt de l’argent, imposé du cinquantième tous les revenus, rétabli la vieille taxe féodale de joyeux avènement, le mécontentement public a pu voir avec raison, en toutes ces fâcheuses mesures, la main de Mme de Prie.
D’une liaison aussi avantageuse, la marquise compterait profiter longtemps encore, si elle n’était menacée par un vieux projet de la duchesse de Bourbon. Dès avant le ministère, celle-ci s’était mis en tête d’obliger son fils à se marier. Il était naturel que le petit-fils du vainqueur de Rocroy, qui n’avait pas eu d’enfant d’une première union, assurât par lui-même la transmission du nom des Condé. C’était le moyen le plus sûr de balancer l’augmentation d’influence que devait procurer son mariage au fils du Régent ; c’était aussi, aux yeux de la mère, une occasion de délier le sien des liens peu honorables qui le retenaient. Mme de Prie ne l’entendait point de cette façon et, quand elle vit cette idée trop raisonnable entrer dans l’esprit de M. le Duc, elle s’avisa du moins de mener les recherches elle-même et de trouver une épouse suivant ses convenances. Pour que la marquise gardât, le mariage fait, sa situation et les avantages qui en découlaient, il fallait que la nouvelle duchesse n’eût point de qualités trop séduisantes ; il importait aussi qu’elle fût d’origine assez modeste pour ne se jamais soustraire à ses obligations de reconnaissance.
Ce fut dans ces dispositions d’esprit qu’une conversation de salon fit savoir à Mme de Prie l’existence de la fille de Stanislas. Le chevalier de Vauchoux était en relations avec la veuve d’un ancien caissier de Berthelot de Pléneuf, une dame Texier, qui avait ses entrées chez Mme de Prie et qui l’y présenta un jour, dans l’hiver de 1722. Vauchoux saisit l’occasion de parler de la petite cour polonaise qu’il fréquentait et du désir qu’avait Stanislas de fixer l’avenir de sa fille. Ce qu’apprit la marquise de l’éducation simple et des qualités de la princesse Marie retint aussitôt son attention : elle entrevit que cette alliance, fort acceptable pour son amant, pourrait le lui laisser tout entier. Elle aperçut aussi des avantages plus immédiats et que son avidité explique. L’affaire fut aussitôt engagée et Mme de Prie promit, moyennant une somme importante, de faire épouser M. le Duc.
Les conditions de la promesse étaient trop ordinaires à cette époque pour pouvoir étonner Stanislas, mais il est un peu surprenant qu’il ait entièrement ignoré le rôle de la singulière protectrice qu’il agréait pour sa fille. Dans son empressement à accepter cette aubaine inespérée, ses lettres, destinées, il est vrai, à être montrées, débordent de reconnaissance pour la marquise : « La réputation de cette dame, jointe au portrait que vous m’en faites, me fait considérer infiniment son amitié. Je suis très persuadé que son désir de voir l’union de ma fille avec M. le Duc est un suffrage puissant pour accomplir nos intentions communes... » « Je voudrais que nous soyons déjà là à traiter sur cet article ; je ne crois pas que nous nous y arrêterions longtemps. Cela sera, je vous assure, bientôt débattu, quand madame la marquise de Prie aura frayé les chemins et levé les autres difficultés. Rien n’est plus avantageux à ma fille que l’idée favorable que cette dame en a conçue. Si je ne craignais de blesser la modestie, je pourrais dire qu’elle ne se trompe pas, aussi bien que sur l’amitié de la reine et sur l’ardent désir que nous avons de la convaincre par toutes les occasions qui se pourront présenter. Au reste, mon cher Vauchoux, répondez en tout de moi ; vous n’en aurez jamais le démenti. »
Les choses furent loin de marcher aussi vite que l’espérait l’impatient Stanislas. Dix mois plus tard, elles n’avaient pas fait un pas, et il apprenait avec appréhension qu’un parti de cour voulait marier M. le Duc à Mademoiselle de Modène. Mme de Prie n’avait donc réussi à rien auprès du prince. Les lettres de Stanislas à Vauchoux montrent qu’on l’avait fort inquiété lui-même au sujet de cette bonne amie : « Je suis averti d’une main très sûre qu’on se donne tous les mouvements pour nous contrecarrer en faveur de la duchesse de Modène, et, ce qu’il y a de pire, qu’on s’est attaché à Mme de Prie pour renverser nos projets, à ce qu’on m’assure qu’on l’a fort ébranlée. Ainsi, mon cher Vauchoux, je recours à votre pénétration pour en être éclairci, sans faire paraître la moindre défiance encore de mon côté, et suivant que vous approfondirez l’affaire, il faut tâcher de remettre Mme de Prie, s’il est possible, dans les premiers sentiments ; car, si c’est l’opiniâtreté de mon sort qui les fait changer, il serait à souhaiter qu’on fixe un temps auquel, si on ne voit pas plus clair dans mes intérêts, qu’on prenne alors d’autres résolutions : si aussi l’intérêt ébranle notre bonne amie, je laisse à votre délicatesse de faire comprendre qu’on trouvera le même avec moi, si on persévère constamment à ce qu’on a commencé. » Une autre lettre, plus intime sans doute, appuyait sur la question d’argent : « Ils marchandent l’affaire avec de l’argent comptant, pendant que je demande du crédit pour un peu de temps, et, quoique je le veux avoir à un plus haut prix que ceux qui me le disputent, j’ai besoin de bons répondants... »
La mort du Régent, à la fin de 1723, et la remise du pouvoir au prince si disputé suspendit les négociations. M. le Duc eut des soucis d’autre genre, et la marquise des profits plus sérieux à espérer. Stanislas, fidèle à ses engagements, ne chercha point de nouveau parti pour sa fille. Il se fit un mérite de n’avoir point attiré le duc d’Orléans, à l’époque où celui-ci trouvait des difficultés à conclure son mariage à Bade et où le comte d’Argenson, allant essayer de les régler, s’arrêtait à Wissembourg et se montrait fort enthousiasmé de Marie Leczinska. Au reste, le chevalier de Vauchoux ne se décourageait pas et préparait le moment propice, qui parut venir au début de 1725.
L’affaire durait depuis deux ans et demi quand M. le Duc, convaincu par sa mère de la nécessité de se marier, se décida pour la princesse de Pologne. Il adopta même le projet avec une certaine ardeur, pensant, à ce qu’on peut croire, que le roi Stanislas n’avait pas perdu toutes ses chances de restauration et que son gendre pourrait être appelé, le cas échéant, à recueillir ses titres à la couronne. On fit faire à Wissembourg quelques ouvertures par le maréchal du Bourg en personne. Stanislas fut naturellement prié de n’en point parler ; mais sa joie, dès lors, lui sembla certaine et l’avenir de sa fille assuré.
Mme de Prie ne tarda pas à se mettre avec lui en correspondance directe. Il recommençait à la considérer comme sa plus sincère amie, quand elle mit le comble à ses bontés en envoyant un peintre faire, pour elle, le portrait de la princesse. Ce Pierre Gobert était un artiste de l’Académie royale, portraitiste en renom, qui venait à Wissembourg fort mystérieusement ; on avait raconté à Paris, pour donner le change, qu’il allait exécuter, au château de Saverne, des travaux commandés par le cardinal de Rohan. Il arriva le 24 février ; l’impatient Stanislas, qui croyait voir la toile finie en une semaine, s’assurait que le maréchal du Bourg la ferait partir par une voie prompte et discrète. Mais Gobert tenait à bien faire et ne se pressait point. Vingt jours lui furent nécessaires, et le roi annonça l’envoi par un billet qui révèle bien tout l’espoir qu’il y mettait : « Voici, mon cher Vauchoux, le portrait que j’ai voulu adresser à M. le cardinal de Rohan ; mais j’ai songé depuis que, si vous le rendez, cela fera moins d’éclat. Je vous prie donc de le remettre en mains propres à Mme de Prie. Je suis persuadé par avance du bon usage qu’elle en fera. Je laisse le soin du reste à la sainte Providence. Vous avouerez que j’ai raison d’être charmé de l’ouvrage du portrait, car vous jugerez vous-même en le voyant qu’il est parlant et qu’on n’en saurait faire de plus ressemblant. Je voudrais encore qu’on puisse tirer son intérieur et son caractère, comme vous les connaissez ; c’est votre ouvrage, et le mien d’être de tout mon cœur votre très affectionné... »
Quand le précieux paquet, confié à la poste d’Alsace, parvint à destination, ce fut au milieu de circonstances fort imprévues. La Cour de Versailles était en émoi : Mme de Prie avait complètement oublié son peintre, sa princesse et son ami le roi de Pologne, et M. le Duc s’était mis sur les bras une trop grave et trop fâcheuse affaire pour avoir le temps de songer à se marier.
Un autre mariage, plus important que celui du duc de Bourbon, préoccupait les esprits. Il s’agissait de la personne même du Roi, et le changement qui se produisait, dans des projets considérés jusque-là comme certains, entraînait d’étranges conséquences.
Ce fut un intérêt égoïste, la crainte de perdre trop tôt leur pouvoir, qui poussa Mme de Prie et M. le Duc à renverser le mariage avec l’Infante. Il y avait une parole solennellement donnée ; la présence de la princesse en France depuis trois ans était un gage tellement éclatant que son renvoi en Espagne devait être l’insulte la plus grave que pût recevoir la cour de Madrid ; la rupture des alliances, la guerre même pouvaient s’ensuivre. Rien de tout cela ne pesa longtemps sur l’esprit du ministre le jour où il trembla de voir le duc d’Orléans arriver au trône. L’âge de l’Infante-Reine exigeait de longues années avant que le mariage pût s’accomplir. Jusque-là, la vie de Louis XV était à la merci d’un accident de chasse ou d’une de ces crises de santé que le jeune homme, bien que beaucoup fortifié depuis son enfance, subissait encore de temps en temps, aux grandes alarmes de son entourage. On accusait la duchesse d’Orléans d’y songer avec trop de complaisance et de ménager à son fils, par l’alliance qu’elle lui avait procurée, le soutien de l’Angleterre et de l’Allemagne, en cas que le Roi vînt à manquer. M. le Duc vivait donc dans une peur continuelle de devenir le sujet d’un rival qu’il détestait tous les jours davantage.
Le seul remède à de tels soucis était le prompt mariage de Louis XV avec une princesse en état de mettre au monde un dauphin. Il eût rassuré en même temps des conseillers plus sincères de la couronne, qui n’envisageaient pas sans inquiétude la pensée du célibat prolongé du jeune roi. On pouvait déjà prévoir, par le peu d’intérêt qu’il prenait aux gentillesses enfantines de sa cousine, que ce mariage imposé ne serait pas heureux ; en attendant qu’il se réalisât, de nombreux écueils se présenteraient. Les hommes autorisés que M. le Duc convoqua à ce sujet en réunion secrète furent d’un avis unanime sur les périls qu’il y avait à courir. M. de Fréjus reconnut que le salut de l’âme de son élève était engagé en cette affaire, et le maréchal de Villars, avec la franchise d’un soldat et l’expérience d’un vieillard, résuma tous les avis dans le sien : « Dieu, pour la consolation des Français, nous a donné un roi si fort qu’il y a plus d’un an que nous en pourrions espérer un dauphin. Il doit donc, pour la tranquillité de ses peuples et pour la sienne particulière, se marier plutôt aujourd’hui que demain. »
M. le Duc hésite cependant devant la gravité des conséquences, lorsqu’un événement le vient décider. Le Roi tombe malade à Versailles ; sa fièvre est violente et il est un instant près du danger. Le ministre entre le voir vingt fois le jour, couché dans la grande chambre où est mort Louis XIV, et il montre à tous les regards un visage qui révèle des anxiétés. Une nuit, l’imagination plus surexcitée que d’habitude, ne pouvant dormir, il se relève en robe de chambre, monte chez le Roi par son petit escalier, une bougie à la main, et trouve dans l’Œil-de-bœuf un valet qui veille. Cet homme voit son trouble, lui parle, essaie de le rassurer ; mais lui, absorbé, répond entre haut et bas à son bonnet de nuit : « Que deviendrai-je ?... Je n’y serai pas repris... S’il en réchappe, il faut le marier ! » Et le valet de chambre, témoin de cette scène instructive qu’il racontera à Saint-Simon, a beaucoup de peine à envoyer le pauvre prince se remettre au lit.
Après d’aussi vives émotions, le sort est jeté : M. le Duc va signifier à Philippe V qu’on se trouve dans l’obligation, au nom de l’intérêt du Roi, son neveu, de lui renvoyer sa fille. Il y met sans doute tous les ménagements possibles ; il arrose de larmes le papier diplomatique et prodigue au petit-fils de Louis XIV les excuses les plus humiliées. Il essaie de lui faire accepter comme raisonnable et religieux un acte où il ne peut voir qu’une déloyauté outrageante. Mais rien n’a fait soupçonner à l’avance un coup si violent, et la colère qui l’accueille est sans exemple à la cour d’Espagne. Le roi et la reine refusent de recevoir des mains de l’ambassadeur les lettres officielles qui les instruisent. On chasse de Madrid ce pauvre abbé de Livry, qui venait d’être nommé pour les apporter. On renvoie en France, avec sa sœur, veuve du roi Louis 1er, cette Mademoiselle de Beaujolais, qui devait épouser don Carlos. Ces dernières représailles tombent sur la famille d’Orléans, ce qui touche peu M. le Duc ; mais il va se trouver aux prises avec des soucis plus directs. Les ministres d’Espagne en France sont rappelés ; tous les consuls français ont l’ordre de quitter les ports espagnols dans les vingt-quatre heures. C’est la rupture complète entre deux pays qui avaient cru supprimer les Pyrénées, et bientôt l’alliance incroyable de Philippe V avec la Maison d’Autriche porte dans la politique générale de l’Europe les résultats de sa rancune.
Qu’a fait cependant le premier ministre pour préparer le mariage de son roi ? Une excuse à sa conduite précipitée, et aux dangers auxquels elle expose la France, pourrait être dans l’heureux choix qui remplacera la petite Infante. Mais il cherche et négocie de tous côtés sans aucun succès. Il a fait demander la main de la fille aînée du prince de Galles ; la différence de religion a été le prétexte du refus, et l’affaire n’a pas été assez secrètement menée pour n’être pas jugée dans les chancelleries comme un échec. Des propositions antérieures étaient venues de la czarine Catherine, qui aurait été heureuse d’unir sa fille Élisabeth au roi de France, au prix même d’une abjuration de l’orthodoxie ; Mme de Prie a trouvé que le sang violent de Pierre le Grand ne lui promettait pas une reine assez dépendante, et le ministre, après des tergiversations prolongées, a fini par refuser, au risque de détruire de cordiales dispositions de la Russie pour l’alliance française. Il a écarté de principe la charmante fille du duc de Lorraine, catholique, d’âge excellent, parce que la mère est Orléans, sœur du Régent, et que les Condé ne peuvent supporter l’idée de fournir au parti rival l’appui de la reine future.
Les meilleurs choix étant rejetés, M. le Duc a beau faire dresser une liste de toutes les princesses de l’Europe, qui ont de treize à vingt-deux ans, et y réunir les détails précis sur leur religion, leur famille, leurs qualités physiques, aucun nom ne s’y rencontre qui puisse concorder à la fois avec l’âge du Roi, la dignité de la couronne et les convenances personnelles du ministre. Marie Leczinska figure dans cette liste, avec la remarque qu’elle a des parents peu riches et que son père et sa mère voudraient sans doute s’établir en France, ce qui serait un inconvénient : « On ne sait rien, d’ailleurs, ajoute le mémoire, qui soit désavantageux à cette famille ». Parmi les personnes consultées par le ministre et invitées à lui faire tenir leur avis par écrit, nul ne s’avisera de songer à une princesse de naissance aussi modeste.
On acceptera, au contraire, par égard pour M. le Duc, le sentiment vers lequel il penche lui-même et qui favorise une de ses propres sœurs, Mademoiselle de Vermandois.10 Quoique plus âgée de huit ans que le Roi, elle réunit toutes les conditions de beauté, d’esprit et de vertu qui peuvent justifier l’honneur qu’on lui fait ; elle est, de plus, d’une santé excellente. Mais Mme de Prie, qui se sait détestée par la jeune fille, aide M. le Duc à réfléchir que l’opinion en France et en Europe s’indignerait d’un choix où l’on verrait le poids de sa volonté égoïste sur son jeune maître. L’Espagne, d’autre part, n’attribuerait-elle pas l’humiliation qu’elle a reçue à l’intérêt de la maison de Condé et les conséquences du renvoi de l’Infante ne retomberaient-elles point plus durement sur M. le Duc ? Le prince prévoit de tels soucis, pour une satisfaction de vanité, qu’il retire, après quelques jours, sa proposition.
Cependant le temps s’écoule. On ne peut exposer plus longtemps le Roi au ridicule de chercher femme, et tout exige qu’une solution soit apportée aux difficultés où la France a été engagée par une imprudente impatience. Après les éliminations prononcées autour de la table du Conseil ou dans le cabinet de Mme de Prie, après l’échec de la demande anglaise et l’abandon des prétentions des Condé, la liste des princesses est épuisée. On aboutit à cette constatation extraordinaire, qui condamne la légèreté de M. le Duc et n’est point pour relever son prestige : il n’y a pas en Europe de princesse qui puisse épouser le roi de France.
Au milieu de ces embarras aigus, Mme de Prie reçoit à Versailles le portrait de la jeune Polonaise que M. le Duc s’est promis d’épouser. Les grâces de son âge s’y trouvent agréablement marquées : on voit que la princesse Marie n’est point déplaisante et que, s’il lui manque le charme de la beauté, elle semble, du moins, avoir tous les autres. Une idée inattendue naît de cette coïncidence. L’aimable modèle du peintre ne pourrait-il faire une reine de France très suffisante ? La question se pose aussitôt dans l’esprit de la favorite. Aucun obstacle dans la négociation n’est à prévoir ; la demande, restée tout à fait ignorée, qui a été faite par le duc de Bourbon, permettrait de substituer celle du Roi le plus aisément du monde.
Mme de Prie voit d’un coup d’œil le parti qu’elle pourra tirer de cet heureux arrangement. C’est elle qui aura fait la nouvelle reine ; quoi qu’il arrive, son avenir est garanti par la gratitude qui lui sera due. Elle pousse M. le Duc à se décider et rien ne se trouve moins difficile. Le prince s’accommode d’une combinaison qui lui apporte, en échange d’un insignifiant sacrifice, la fin de tant d’affaires embrouillées.
Si les objections sont assez nombreuses, aucune ne paraît irréfutable. « La Polonaise », comme on dit, a six ans et demi de plus que le Roi ; mais Mademoiselle de Vermandois est plus âgée encore, ce qui n’a point arrêté, quand il s’est agi de la sœur du ministre, selon la propre déclaration faite à ce propos par le Conseil secret : « Les mœurs d’une personne de cet âge promettent bien davantage que ceux d’une personne plus jeune, et cet âge la rend plus propre à donner des héritiers bien constitués. » On dira aussi que la situation de Stanislas est fort modeste dans la hiérarchie des monarques et que, jadis roi électif, il est tombé au rang de simple pensionnaire de la France ; il a régné du moins sur un grand pays et porté une illustre couronne. Si l’on peut craindre, d’autre part, qu’il veuille la revendiquer un jour par les armes et entraîner la France dans ses projets, il semble facile de lui faire comprendre qu’en devenant le beau-père du Roi Très-Chrétien, son devoir est de sacrifier ses ambitions aux intérêts du pays qui sera désormais celui de sa fille. D’ailleurs cette pensée ne peut être que lointaine et M. le Duc n’est pas d’humeur à s’inquiéter de demain, s’il a le moyen de sortir des difficultés d’aujourd’hui. Il embrasse le projet avec ardeur et, de ce jour, le sort de Marie Leczinska est décidé.
C’est peut-être la première fois en France que, dans le choix si important d’une épouse royale, des convenances égoïstes ont passé avant l’avantage de la nation. Aucun des ministres du passé n’avait eu la pensée de s’inspirer d’un autre intérêt que de celui de la couronne et n’avait subordonné la raison d’État à ses raisons particulières. Les motifs qui font le mariage de Louis XV montrent l’abaissement des caractères et l’oubli des devoirs du gouvernement. Malgré cela, les circonstances sont devenues si pressantes que M. le Duc n’a pas d’opposition à redouter dans le Conseil. Pendant la séance tenue à Marly, le 31 mars, il remet sous les yeux du jeune Roi l’état détaillé des princesses d’Europe qu’on a déjà examiné en vain, et il prouve que, seule, la fille du roi de Pologne peut être proposée sans inconvénient.
La discussion qui suit ne produit point d’objection sérieuse ; M. de Fréjus lui-même, sans opiner favorablement, se garde d’en formuler aucune, affectant de laisser à d’autres une responsabilité aussi grave, et le Roi est enfin appelé à se prononcer. Le portrait de la princesse Marie lui a été présenté. Bien que les charmes de la future reine soient un objet fort secondaire en cette décision toute politique, Louis XV se sent porté à écouter les personnes qui disposent de son cœur ; il déclare au Conseil qu’il consent à épouser la princesse de Pologne. Le soir même, les ordres sont donnés pour le départ de l’Infante et le courrier d’Alsace emporte la lettre de M. le Duc pour le roi Stanislas.
La reine Marie Leczinska racontait elle-même comment elle avait appris l’événement extraordinaire de sa vie. Elle était dans une chambre de Wissembourg, occupée avec sa mère à leurs ouvrages de charité ; elles causaient des nouvelles de Pologne, qui semblaient plus décourageantes que jamais, puisque le roi Auguste venait de refuser définitivement à Stanislas toute restitution de ses biens patrimoniaux. Dans la chambre où se tenaient les deux femmes, le roi entra, le visage rayonnant d’une joie singulière et tenant une lettre à la main : « Ah ! ma fille, s’écria-t-il, tombons à genoux et remercions Dieu ! – Quoi ! mon père, seriez-vous rappelé au trône ? – Le ciel nous accorde mieux encore, dit Stanislas : vous êtes reine de France ! »
Le père, la mère et la fille s’embrassèrent en pleurant et s’agenouillèrent, pour recevoir par une prière reconnaissante la nouvelle qui mettait fin à tant de douloureuses incertitudes.
Pas un instant la princesse Marie n’hésita à accepter la grâce qui lui était envoyée et qui apportait la consolation à ceux qu’elle aimait. Son jeune cœur s’attachait déjà de toute sa force au bel adolescent royal, dont les estampes lui avaient fait connaître les traits et pour le bonheur de qui elle avait souvent prié, en retour de l’hospitalité reçue par les siens. Les sentiments de ses parents étaient sans mélange ; « on étouffait de joie », écrit Stanislas. Ce projet, qu’il fallait tenir secret pendant quelque temps, resserré au cercle le plus étroit de la famille, y dédommageait de bien des misères. C’était le rêve auquel rien n’a préparé et qu’on savoure avec la seule crainte de le voir s’évanouir.
Stanislas adresse au duc de Bourbon une réponse, où se peignent l’émotion ressentie et cette gratitude sur laquelle sont en droit de compter les auteurs du mariage : « Monsieur mon frère, que puis-je dire à Votre Altesse Sérénissime pour répondre à une lettre qui, me saisissant le cœur et m’ôtant la parole, me mettrait dans toute l’insuffisance de lui exposer mes sentiments, s’ils étaient nouveaux et inconnus à Votre Altesse Sérénissime ? ... Puisque la sainte Providence l’a tellement décidé et que votre incomparable sagesse le juge ainsi, Votre Altesse Sérénissime sait que je suis voué à Elle avec toute ma famille ; qu’Elle dispose d’un bien dont je l’avais rendue entièrement maître. Je vous cède mon droit de père sur ma fille, en remplaçant celui d’époux qui vous était destiné. Que le Roi, qui la demande, la reçoive de vos mains ... Plaise au Seigneur Tout-Puissant qu’il en tire sa gloire, le Roi son contentement, ses sujets toute la douceur et Votre Altesse Sérénissime la satisfaction de son propre ouvrage ! » En attendant la glorieuse réalisation de cet ouvrage, le roi de Pologne avait à trouver en quelques jours treize mille livres, pour achever de retirer ses pierreries chez le Juif de Francfort où elles étaient engagées. Il était forcé d’avoir recours à l’amitié du gouverneur de Strasbourg, qui lui en obtenait discrètement le prêt sur la recette de la ville. Il échappait ainsi aux graves chicanes qu’il avait un moment redoutées, et qui auraient mis le comble aux âpres tourments d’argent qui l’accablaient.
Des soucis d’un autre genre allaient suivre, pendant de longues semaines, la joie de l’heureuse nouvelle. Le chevalier de Vauchoux avait très promptement apporté à Wissembourg les remerciements du duc de Bourbon et traité confidentiellement avec Stanislas les questions politiques et personnelles sur lesquelles il était nécessaire de s’entendre. Il avait trouvé chez le roi de Pologne, racontait-il, les sentiments d’un « bon Français » et le parfait désir de se soumettre aux volontés de son futur gendre. Le secret toutefois rendait encore incertain le grand projet. Chacun avait compris qu’une haute convenance exigeait, avant d’en parler, que l’Infante eût été remise aux envoyés de Philippe V chargés de la recevoir à la frontière ; mais cette remise avait eu lieu depuis longtemps, et rien n’arrivait à Wissembourg tranquilliser les esprits.
Sans doute, à Versailles, dès la fin d’avril, les douze dames du palais étaient nommées, ainsi qu’une partie de la maison de la Reine, « semblable, écrit Marais dans son journal, à ce temple qu’on avait élevé à Rome avec cette inscription Deo incognito, au dieu inconnu ». Le cardinal de Rohan, le maréchal du Bourg, venus en amis passer quelques jours chez le roi Stanislas, se considéraient déjà comme les sujets de leur chère princesse Marie. Celle-ci était presque traitée en reine, et l’on remarquait que ses parents lui laissaient la droite. Cependant la déclaration publique du mariage n’était pas faite, et il ne pouvait être regardé comme assuré tant que cette formalité ne serait pas venue engager la parole royale.
L’événement qui se préparait avait fini par transpirer dans les pays rhénans. Tant d’allées et venues inusitées avaient excité les soupçons, et le bonheur deviné de Stanislas déchaînait la haine. Des agents saxons rôdaient dans les environs et venaient encore d’essayer de lui faire acheter du tabac empoisonné. Ils se mirent à l’œuvre pour empêcher, par tous les moyens, un changement de situation qui devait si puissamment servir sa cause en Pologne. À Paris même, où le projet s’ébruitait, beaucoup de gens étaient mécontents. De divers côtés, des dénonciations parvinrent au duc de Bourbon, l’inquiétant sur la santé de Marie Leczinska. « Le bruit est grand, dit Marais, d’une lettre écrite par le roi de Sardaigne, comme grand-père du Roi,11 qui s’oppose au mariage avec la Polonaise, par la mésalliance et parce qu’on dit qu’elle a des défauts corporels. Il y a aussi des lettres anonymes qui ont grossi ces défauts. On dit qu’elle a deux doigts qui se tiennent et des humeurs froides ; mais cela vient de la faction d’Orléans, à qui ce mariage et tout mariage du Roi déplaît. »
Un avis plus grave prétendit que la princesse était épileptique et désigna même une religieuse de Trêves, que la reine Catherine aurait été consulter plusieurs fois sur cette maladie. Rien ne pouvait causer à M. le Duc plus de souci pour sa conscience et pour ses intérêts. Il dut faire chercher une personne de confiance en relation avec le couvent de Trêves ; on put établir qu’en effet la reine de Pologne y était allée plusieurs fois voir la religieuse désignée, mais que c’était à propos d’une demoiselle de trente ans qu’elle aimait beaucoup et qui était attachée à son service. Pour sûreté meilleure, le ministre chargea le cardinal de Rohan et le chevalier de Vauchoux d’informer Stanislas des bruits répandus et de lui faire accepter la visite de deux médecins envoyés de Paris. Le roi ne s’étonna point des calomnies acharnées contre le bonheur de sa fille et se prêta à ce qu’on voulait de lui. Les médecins constatèrent que la princesse avait une santé particulièrement vigoureuse et firent justice de tous les mensonges. Les inquiétudes de la famille touchaient à leur terme ; les lettres arrivaient enfin, apportant la nouvelle de la déclaration, et un détachement du régiment de Berry prenait la garde de la maison de Wissembourg.
Le dimanche, 27 mai, à son petit lever, en présence des grands officiers de la couronne et des entrées, Louis XV déclara son mariage, suivant l’usage, en donnant à ses sujets tous les renseignements qu’ils étaient en droit de connaître : « J’épouse, dit-il, la princesse de Pologne. Cette princesse, qui est née le 23 juin 1703, est fille unique de Stanislas Leczinski, comte de Lesno, ci-devant staroste d’Adelnau, puis palatin de Posnanie, et ensuite élu roi de Pologne, au mois de juillet 1704, et de Catherine Opalinska, fille du castellan de Posnanie, qui viennent l’un et l’autre faire leur résidence au château de Saint-Germain-en-Laye avec la mère du roi Stanislas, Anne Jablanoruska, qui avait épousé en secondes noces le comte de Lesno, grand général de la Grande-Pologne. » Quand le Roi eut fini, le petit duc de Gesvres, Premier gentilhomme de la Chambre en exercice, passa dans l’Œil-de-Bœuf plein de monde et prononça les mêmes formules, livrant la grande et décisive nouvelle aux commérages de la Cour et aux discussions des partis.
« La Cour a été triste, écrit un nouvelliste, comme si on était venu dire que le Roi était tombé en apoplexie. » Les compliments d’étiquette qu’il reçut manquèrent de sincérité. Personne ne montra d’enthousiasme pour une alliance où rien ne flattait l’amour-propre national. « Leczinski ! Voilà un terrible nom pour une reine de France. » Cela était indifférent au Roi, fort enchanté de se marier et, en attendant, malgré la pluie et le temps affreux, on le voyait chaque jour aller à la chasse et prendre plaisir à ce que tout le monde fût mouillé. Il ignorait entièrement que les cours d’Europe et les chancelleries parlaient couramment de sa mésalliance. La duchesse de Lorraine, par exemple, qui avait, il est vrai, quelque dépit de mère dédaignée dans son enfant, écrivait son humiliation de fille de France : « Comme bonne Française et étant de la famille royale, je ne puis voir cette mésalliance pour le Roi sans en ressentir, je vous l’avoue, une peine mortelle, et je ne puis comprendre comment toute la France ne s’y oppose pas, à commencer par les princesses de la maison royale. Il me paraît que les mésalliances sont bien à la mode en France, puisqu’elles vont à présent jusqu’à la personne sacrée du Roi. Il sera, à ce que je crois, le premier de nos rois qui aura épousé une simple demoiselle ! »