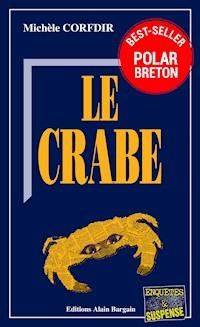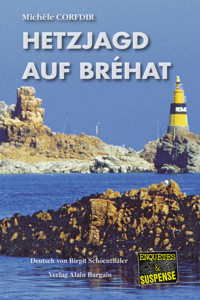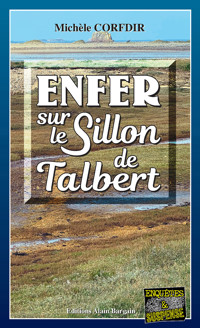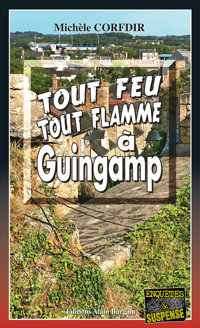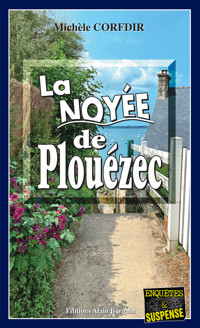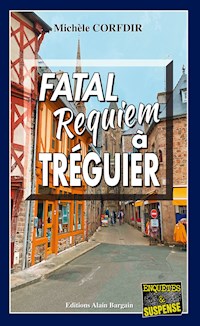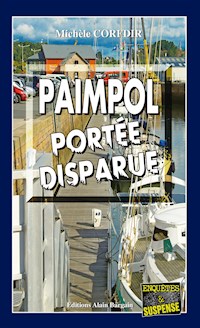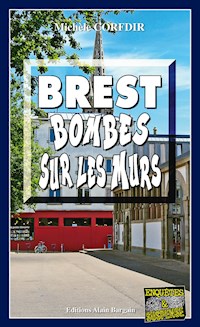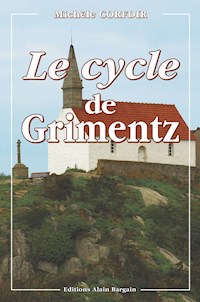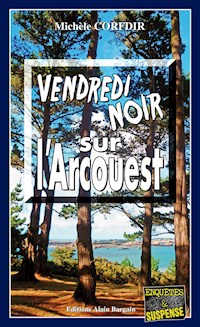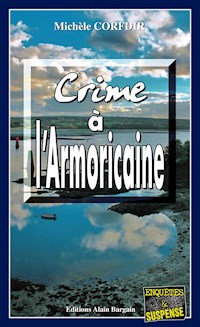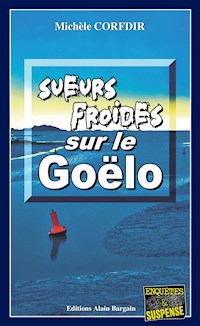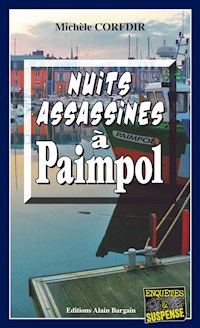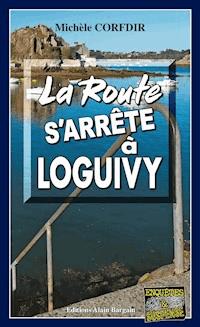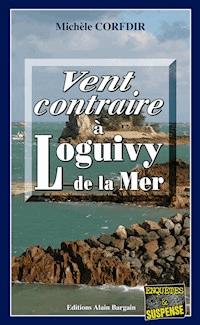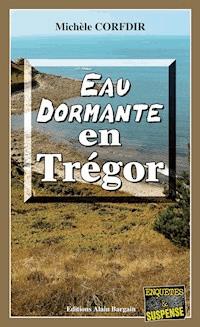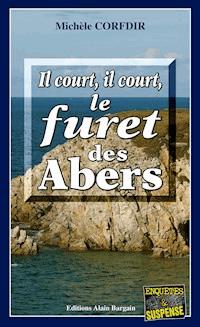Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
La vie d'une Bretonne charitable risque de se transformer en cauchemar...
La plage Bonaparte, haut lieu de baignade en Baie de Saint-Brieuc, a de tout temps été un point d’embarquement clandestin pour l’Angleterre.
En automne 2015, le bruit court que des marins pêcheurs et des skippers se livrent au transport illicite de migrants à travers la Manche. Adèle Lemberg, une habitante du voisinage, n’est donc pas vraiment étonnée lorsqu’un soir, elle découvre une réfugiée à bout de forces, au fond de son jardin. N’écoutant que son bon cœur, elle la recueille, la réconforte et lui offre l’hospitalité.
Adèle aurait-elle agi ainsi, si elle avait pu deviner les suites dramatiques qu’entraînerait pour elle son geste secourable ?
Non ! Assurément non ! Elle aurait claqué sa porte ou se serait enfuie en courant.
Cette intrigue bouleversante tiendra le lecteur en haleine jusqu’à la dernière page !
EXTRAIT
Le vent bousculait tout, les arbres et les ombres, dans un spectacle baroque et acrobatique. Debout, les mains dans les poches, le capuchon rabattu sur son front, Adèle avait l’impression d’être au centre d’un panorama circulaire. Comme un pivot. Comme une sentinelle.
Soudain, un éclair éblouissant effaça les fantasmagories, puis un roulement de tonnerre se mêla aux grondements du vent et de la mer toute proche.
Par réflexe, Adèle ferma les yeux. Lorsqu’elle les rouvrit, l’opéra burlesque avait repris, mais elle gardait, au fond des prunelles, l’image d’une autre sentinelle, d’un autre témoin figé dans l’éclat de la foudre.
Il y avait quelqu’un dans le jardin.
Elle en était sûre.
Elle glissa la main droite derrière son dos et actionna la poignée de la porte. Lorsque celle-ci s’entrouvrit, elle se coula à l’intérieur, referma le battant et tourna la clé. Sans allumer, elle monta à l’étage et se posta derrière une fenêtre. Mais elle ne vit rien d’autre que la tempête dans la clarté décadente de la lune.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Editions Bargain, le succès du polar breton. -
Ouest France
À PROPOS DE L'AUTEUR
Michèle Corfdir est née et a grandi en Suisse. Elle y a fait ses études et a enseigné quelques années dans le Jura et à Bienne. Elle a publié alors un recueil de poèmes couronné par le Prix des Poètes Suisses de Langue Française, ainsi que des contes pour enfants qui obtiennent le prix de l'Office Suisse de la Lecture pour la Jeunesse. Après son mariage avec un marin pêcheur breton, elle s'établit à Loguivy de la Mer. Elle collabore comme nouvelliste à diverses revues et met sa plume au service des marins pêcheurs, au cours de la crise qu'a connue cette profession au début des années 90. En 1998, elle publie aux Éditions Alain Bargain, son premier roman,
Le Crabe, un thriller maritime très bien accueilli tant par la critique que par le public. Face à ce succès, elle édite d'autres ouvrages dans la collection Enquêtes et Suspense.
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -
Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nous remercions tout particulièrement “Photo Yann” de Paimpol pour le prêt de la photo de couverture.
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
I
Octobre 2015
Lorsqu’Adèle Lemberg reçut au courrier de midi, une lettre lui demandant si elle possédait des œuvres de peintres postimpressionnistes suisses ayant fait partie de la collection de son grand-père, elle crut à une plaisanterie.
Mais en y regardant de plus près, elle se ravisa.
Le texte avait été rédigé à la main, chose de plus en plus rare de nos jours. L’écriture était très lisible et légèrement penchée vers la droite. La mise en page obéissait aux règles épistolaires classiques. En haut figurait le nom de l’expéditeur, un certain Charles Amiel, galeriste à Lausanne, ainsi que ses adresses postale et électronique. Une formule de politesse alambiquée terminait la lettre.
Ces indices trahissaient un homme âgé, sans doute maladroit et importun, avec qui Adèle ne tenait pas à entamer une correspondance. Elle lui répondit par un mail laconique, l’informant qu’elle avait bien reçu son courrier mais n’était pas en mesure de satisfaire sa demande. Puis elle envoya le message et saisit son téléphone mobile qui venait de se mettre à sonner.
C’était Magda, sa belle-mère, qui l’enjoignait de venir la voir au plus vite. Adèle n’en avait aucune envie mais ne pouvait décemment refuser. Elle tenta donc de biaiser en promettant de passer, dès que ses obligations le lui permettraient.
— Quelles obligations ? lança Magda d’un ton tranchant. Tu es divorcée, sans enfant et Croaz Hent n’est qu’à une heure de route de chez toi. Tu peux bien me consacrer un peu de ton temps, il me semble !
— Bien sûr, seulement dites-moi d’abord ce qui ne va pas. C’est votre santé qui pose problème ?
— Évidemment, mais j’en ai l’habitude et je règle cette question avec mon médecin et mon aide ménagère. S’il fallait compter sur toi pour ce genre de chose, Dieu sait ce que je deviendrais !
Le côté manipulateur et hypocondriaque de Magda ne tardait jamais à se manifester. Mais Adèle refusa de se laisser entraîner sur ce terrain et ne releva pas.
— Il y a plusieurs jours que je pense à t’appeler sans oser le faire, de crainte de t’importuner…
Le soupir et le ton larmoyant étaient plus qu’Adèle n’en pouvait supporter. Elle allait abréger lorsque Magda, délaissant brusquement le mode mineur, déclara qu’il s’agissait de la débarrasser des affaires d’Henri, qu’elle avait triées et remisées dans une pièce du deuxième étage.
— Vous y êtes parvenue, en dépit de vos douleurs ?
— J’ai pris sur moi et j’ai un nouveau traitement qui semble me soulager. Du moins pour le moment… Je n’ose penser aux effets secondaires. À en croire la notice, je ne devrais pas survivre très longtemps.
— Il ne faut pas prêter foi à tout ce qui est écrit sur les notices. Pour les fabricants, c’est une façon de se prémunir contre d’éventuels procès. En outre, j’imagine que votre médecin sait ce qu’il fait.
— Je me le demande justement !
— Quelle drôle d’idée ! Mais si vous avez des doutes, allez consulter quelqu’un d’autre.
— Il n’en est pas question ! Personne ne me connaît aussi bien que lui, depuis le temps qu’il me soigne… Mais revenons à ce qui nous occupe ! L’autre jour, comme je me sentais mieux, je me suis dit qu’il fallait en profiter pour mettre de l’ordre dans tout ce qu’Henri a laissé derrière lui. Peut-être n’en aurai-je plus l’occasion. À mon âge, qui sait ce qui peut arriver.
— Je vois, répondit Adèle qui se souvenait qu’après le décès de son père, l’été précédent, elle s’était proposée pour cette corvée, initiative à laquelle Magda s’était catégoriquement opposée.
Elle avait été la femme d’Henri ces dix dernières années. Elle le connaissait mieux que quiconque et rien ne pourrait la surprendre ni la choquer, dans ce qu’elle serait peut-être amenée à découvrir. « Il s’agit de préserver sa mémoire et il existe certaines choses, certains secrets qu’un père ne voudrait pas que sa fille apprenne, même après sa mort. » Devant ces propos sibyllins, Adèle n’avait pas insisté.
— Je croyais que cette question était réglée depuis longtemps, dit-elle.
— Eh bien non. J’ai essayé de m’y mettre à plusieurs reprises. Mais le chagrin et ma mauvaise santé m’en ont empêchée. Sans une lettre que j’ai reçue il y a peu, je ne m’y serais peut-être jamais résolue.
— Une lettre… Et de qui ?
— Oh ! Un galeriste suisse qui voulait savoir si, par hasard, je possédais des tableaux ayant appartenu à Casimir Lemberg, ton grand-père.
— Vous lui avez répondu ?
— Non. Ton père et moi avons eu plusieurs fois affaire à ce genre de vautours. Nous n’avons jamais donné suite. Néanmoins, ce courrier m’a décidée d’en finir une bonne fois avec le bric-à-brac d’Henri. Mon aide ménagère a accepté de me donner un coup de main et nous en sommes venues à bout en quelques jours. Tout ce qui n’a pas été donné ou jeté est maintenant réuni dans une pièce du deuxième étage. À toi de venir prendre ce que tu veux garder en souvenir de ton père. Mais ne te fais pas d’illusions, je n’ai rien déniché d’intéressant. Pas de trésor caché ni de papiers compromettants, et évidemment, aucune œuvre d’art venant de ton grand-père.
— C’est normal puisqu’il n’a jamais vécu en Bretagne. Ce qu’il a pu nous laisser se trouve en Suisse, dans sa maison de Gléresse, avec ce que mon père a ramené de Paris avant de vous épouser. Tout est entassé à la Marcotte. J’imagine que ce doit être un sacré bazar, là-bas aussi…
— Peut-être, mais ça ne me regarde pas et je n’ai pas envie d’en parler, lâcha Magda avec aigreur. La raison pour laquelle je te demande de venir le plus vite possible, est que je veux récupérer la pièce du deuxième étage afin d’en faire une chambre supplémentaire. Les enfants d’Évelyne grandissent et elle envisage de passer les vacances scolaires ici avec eux. Croaz Hent est bien situé, tout près de la mer, entre Morlaix et Roscoff. C’est attractif pour des ados… Je veux que ma fille et mes petits-enfants se sentent à l’aise dans ma maison. Aussi, ne tarde pas, sinon les vieilleries d’Henri iront à la déchetterie !
— Ça va, j’ai compris, inutile de me lancer un ultimatum !
— Ne t’énerve pas, j’ai toujours plaisir à te voir. Il y a plusieurs cartons et un cahier de dessins auquel j’aimerais que tu jettes un coup d’œil. Je n’y connais rien, mais ça m’intrigue, surtout après ce qu’a laissé entendre le galeriste suisse dont je t’ai parlé.
— Ça ne peut être qu’un carnet de croquis de Casimir, datant du temps où il faisait des études de peinture à Paris. Henri n’a jamais touché ni à un pinceau ni à un crayon.
Adèle se tut, réfléchit quelques instants et reprit :
— Écoutez, Magda, il se trouve qu’aujourd’hui est mon jour de congé. Puisque toutes ces histoires vous tracassent, je vais en profiter pour faire un saut à Croaz Hent. Attendez-moi en milieu d’après-midi.
*
À l’extérieur de la Clio, la pluie et la nuit noyaient la chaussée, les talus, les bosquets. Dans l’habitacle, l’humidité embuait les vitres car les ventilateurs étaient défectueux. Les essuie-glaces et une raclette étaient les seuls moyens de voir la route et d’espérer rentrer à Kervézec sans encombre.
Adèle enrageait. Cette bagnole n’était plus bonne qu’à rouler de jour et par beau temps, il fallait vraiment qu’elle se décide à en acheter une autre.
Pourtant, quand elle avait quitté Croaz Hent, le soleil couchant embrasait le ciel, spectacle si somptueux que même Magda s’en était émue. Puis, très vite, des colonnes de nuages avaient muré l’horizon et une pluie oblique s’était mise à tomber.
La Clio avançait péniblement. Tout était opaque et se liquéfiait dans le cône jaune des phares lorsque soudain, une voiture surgissant en sens inverse, déversa sur Adèle un déluge de reflets éblouissants. Elle fit une embardée, freina. Quand l’obscurité revint, elle ne savait plus exactement où elle était. Avait-elle dépassé l’embranchement pour Kervézec ? Elle poursuivit néanmoins sa route et, peu après, elle repéra le panneau signalant la plage de Bonaparte. C’était là qu’elle devait bifurquer. Elle actionna son clignotant et s’engagea dans une voie étroite et mal goudronnée, à travers la lande qui s’étend jusqu’aux falaises surplombant la Manche. Au moment où elle arrivait à l’entrée de son jardin, Adèle crut apercevoir une silhouette dans l’ombre déjetée d’un arbuste mais elle n’y prit pas garde. Comme la pluie redoublait, elle gara la Clio devant la porte et se précipita à l’intérieur. Le déchargement serait pour demain.
Dans le vestibule, elle se débarrassa de ses baskets qui avaient pris l’eau et de ses chaussettes complètement trempées. En sortant de chez Magda, elle avait marché dans les flaques que provoquait la moindre averse. Les gravillons de l’allée avaient été dispersés depuis longtemps, laissant la boue et les herbes folles gagner du terrain. Un jour qu’elle en faisait la remarque à sa belle-mère, celle-ci avait répondu qu’elle n’avait pas les moyens d’entretenir un jardin où elle ne mettait jamais les pieds.
Adèle était persuadée du contraire mais, connaissant la pingrerie et l’entêtement de sa belle-mère, elle n’avait pas cherché à la contredire.
Sa maison de Kervézec n’avait ni le charme ni la valeur de Croaz Hent mais lui appartenait en propre. Elle l’avait payée de ses deniers et emprunté à sa banque les fonds nécessaires aux travaux de rénovation. Elle était petite, confortable mais d’apparence tout à fait ordinaire. « La coquille du bernard-l’ermite », avait un jour déclaré Antoine. Comparaison qu’elle trouvait assez juste et pas du tout péjorative.
Quand elle pénétrait chez elle, elle avait l’impression de se fondre dans un monde qui n’était qu’à elle. Elle retrouvait les choses telles qu’elle les avait laissées et le joyeux désordre qui tenait lieu de décoration intérieure. Un désordre où elle seule savait se reconnaître et dont ses amis faisaient souvent les frais. Ce qu’ils oubliaient chez elle devenait bizarrement introuvable. Et quand l’objet perdu finissait par réapparaître, il retournait rarement chez son propriétaire. C’est ainsi qu’elle s’était emparée des délicieuses pantoufles en peau lainée dans lesquelles elle était en train de glisser ses pieds frigorifiés.
Après avoir suspendu son kabig au portemanteau, Adèle monta le thermostat du chauffage puis alluma la bouilloire électrique.
Ce soir, un bol de thé lui suffirait. La collation qu’elle avait partagée avec Magda l’avait rassasiée jusqu’au lendemain. Canapés, crème anglaise, salade de fruits et gâteaux feuilletés dont la vieille dame raffolait et dont elle s’était empiffrée en dépit du régime préconisé par son médecin… Adèle avait goûté à tout car tout était exquis. Sa belle-mère qui n’était pas regardante pour ce qui touchait à son assiette, se servait chez les meilleurs traiteurs et confiseurs de Morlaix.
Au cours de cet intermède, les deux femmes en étaient venues à parler de Gléresse et des mois qu’Henri avait décidé d’y passer, l’année précédant sa mort. Adèle n’avait jamais exactement compris pourquoi. Elle soupçonnait une mésentente au sein du couple – c’était du moins ce que son père lui avait laissé entendre – mais elle désirait connaître le point de vue de Magda.
Une fois la collation terminée, alors que la vieille dame poussait un soupir satisfait et s’adossait confortablement à son fauteuil, elle avait jugé le moment propice à des confidences.
— Magda, j’aimerais que vous me parliez de mon père. Surtout des derniers mois de sa vie…
— Je ne vois pas ce qu’il y a à en dire.
— Pourquoi a-t-il passé à la Marcotte le temps qui lui restait à vivre, plutôt qu’ici où je sais que vous l’auriez soigné avec dévouement ?
Voyant un début de somnolence alourdir les paupières de sa belle-mère, elle avait poursuivi d’une voix plus forte :
— Pourquoi ? Dites-le-moi ! Je ne partirai pas avant de le savoir. Allons, faites un effort !
Magda avait poussé un soupir résigné puis déclaré que ce qui ressortait des propos décousus que tenait Henri à cette époque-là, semblait être des regrets, voire des remords, comme s’il avait envie de se décharger d’un fardeau, sans pouvoir y parvenir.
Mais cela n’intéressait pas Adèle. Au seuil de la mort, qui ne déplore une partie de ses actes et ne souhaite alléger sa conscience ?
— Cela n’explique pas pourquoi il a quitté Croaz Hent pour aller vivre comme un clochard à la Marcotte.
— Je ne sais pas. À dire vrai, c’est une idée qui devait le travailler depuis un bon bout de temps. Un soir, quelques mois avant qu’il ne prenne sa décision, il a parlé de Gléresse. Il voulait que nous y retournions ensemble. Mais j’ai refusé.
— Pourquoi ?
— Je n’y suis allée qu’une fois, peu après notre mariage, et ça m’a suffi ! La situation de la Marcotte au milieu des vignes, avec sa terrasse et la vue sur le lac de Bienne, était magnifique. Par contre, l’intérieur… une horreur ! Un fatras de meubles et d’objets entassés les uns sur les autres, dans une pénombre qui empestait le moisi et le renfermé. Quand ton père a ouvert les volets, ça a été pire. Partout de la poussière, des toiles d’araignée, des vieilleries à ne savoir qu’en faire… Lorsqu’il m’a dit qu’il avait envie d’y passer quelques jours, je lui ai demandé s’il était tombé sur la tête. Je n’étais pas venue là pour faire le ménage ! Il a reconnu que j’avais raison. Il a fait le tour du propriétaire et nous sommes repartis… Et toi, est-ce que tu es retournée là-bas ?
— Non, pas vraiment. Je suis juste allée y jeter un coup d’œil, après l’enterrement de papa, en juin dernier. La maison était devenue un garde-meubles, presque un taudis. C’est la raison pour laquelle je remets sans cesse à plus tard mon voyage en Suisse.
— Je comprends, mais rien ne t’y oblige.
— Si ! J’ai besoin de rencontrer le notaire. De plus, il faut que j’examine et inventorie tout ce qui est accumulé là-bas.
— Eh bien, je te souhaite bon courage ! Vider un tel bric-à-brac, nettoyer cette immense maison… Je préfère être à ma place qu’à la tienne !
Elle avait eu un sourire aigre-doux avant d’ajouter qu’évidemment, ce que lui rapporterait la vente de la Marcotte compenserait largement le travail et les tracas. Adèle avait haussé les épaules.
— Qui vous a dit que je vendrais ?
— Personne, seulement ça semble tomber sous le sens.
— En fait, je n’ai pas encore pris de décision.
— C’est toi que ça regarde. Maintenant, si je peux me permettre un conseil… Quand tu seras Gléresse et que tu trieras le contenu de la maison, fais bien attention ! Il y a probablement des objets et des œuvres de valeur perdus dans tout ce bazar. Ne les laisse pas partir pour rien chez un vulgaire brocanteur !
Alors que l’eau de la bouilloire se mettait à chanter, Adèle débarrassa un coin de la table, y déposa un bol et sa théière. Puis elle alluma la télévision et tomba sur le bulletin météo. La pluie et le vent n’étaient pas près de cesser. La dépression qui s’était creusée au sud de l’Irlande arrivait droit sur la Bretagne. Les marins pêcheurs ne seraient pas à la fête et Adèle eut une pensée pour Antoine, à bord de son bateau.
Les infos avaient succédé à la météo et des rafales de plus en plus violentes secouaient la maison quand un martèlement assourdissant couvrit la voix du journaliste. La grêle avait remplacé la pluie. Adèle craignit un instant pour les Velux des chambres, mais le grain s’arrêta aussi brusquement qu’il avait commencé.
Par curiosité, elle écarta le rideau. Dans la lumière blanche de la lune, des millions de perles glacées recouvraient le sol. En un instant, la bourrasque avait transformé le jardin en paysage d’hiver. Elle trouva cela si stupéfiant qu’elle passa un anorak, des socques et sortit sur le pas de la porte.
Le vent bousculait tout, les arbres et les ombres, dans un spectacle baroque et acrobatique. Debout, les mains dans les poches, le capuchon rabattu sur son front, Adèle avait l’impression d’être au centre d’un panorama circulaire. Comme un pivot. Comme une sentinelle.
Soudain, un éclair éblouissant effaça les fantasmagories, puis un roulement de tonnerre se mêla aux grondements du vent et de la mer toute proche.
Par réflexe, Adèle ferma les yeux. Lorsqu’elle les rouvrit, l’opéra burlesque avait repris, mais elle gardait, au fond des prunelles, l’image d’une autre sentinelle, d’un autre témoin figé dans l’éclat de la foudre.
Il y avait quelqu’un dans le jardin.
Elle en était sûre.
Elle glissa la main droite derrière son dos et actionna la poignée de la porte. Lorsque celle-ci s’entrouvrit, elle se coula à l’intérieur, referma le battant et tourna la clé. Sans allumer, elle monta à l’étage et se posta derrière une fenêtre. Mais elle ne vit rien d’autre que la tempête dans la clarté décadente de la lune.
Elle regrettait amèrement de ne pas avoir écouté son menuisier quand il lui conseillait de munir les ouvertures du rez-de-chaussée de solides volets en bois. Elle se rassurait cependant en se disant qu’un cambrioleur ne resterait pas debout sans bouger, sous une pluie battante mêlée de grêle. Scrutant le jardin, elle croyait voir, par instants, des silhouettes se glisser entre les arbustes et se fondre dans l’obscurité. Mais elle savait que ce n’était qu’un effet de la tempête. Ce que son regard cherchait était noir, debout, immobile.
Alors qu’une accalmie s’amorçait, elle décida qu’elle ne pouvait rester indéfiniment derrière sa fenêtre. Il fallait qu’elle en ait le cœur net, faute de quoi elle risquait de passer une très mauvaise nuit. Elle gagna l’entrée, alluma une lampe torche et ouvrit la porte.
Il avait cessé de pleuvoir et les grêlons commençaient à fondre. Des nuages plus denses masquaient la lune. Hors du faisceau lumineux, l’obscurité était complète. Elle parcourut la cinquantaine de mètres qui la séparaient du portail, éclairant le pied des arbustes et les trous d’ombre. Son jardin n’était pas grand, elle en fit vite le tour. Alors qu’elle s’apprêtait à rentrer, elle promena une dernière fois le pinceau de lumière dans l’allée et aperçut, tout au bout presque sur la route, une silhouette émergeant de la nuit.
Adèle sentit sa gorge se serrer mais elle prit sur soi et se dirigea résolument vers le portail. Bientôt, elle reconnut une femme, ce qui la rassura un peu. En s’approchant, elle nota les cheveux dégoulinants, les vêtements trempés, les mains inertes, le jean tirebouchonné et l’eau de pluie qui mouillait ses joues comme une coulée de larmes.
— Seigneur ! s’exclama-t-elle en courant vers l’inconnue. Qu’est-ce que vous faites là ? Vous êtes perdue ?
Pas de réponse. Regard fixe et bouche entrouverte.
— Venez ! Venez vous réchauffer chez moi !
Elle la saisit par le bras et la sentit se raidir puis trembler et vaciller. Si elle s’effondrait, Adèle ne parviendrait pas à la relever. Alors elle la prit par l’épaule et fit mine de se mettre en marche. La femme l’imita. Un pas en avant, puis un autre. Lentement, pesamment. À cette allure, le rectangle jaune de la porte paraissait presque inaccessible.
— Allons ! Encore un effort, nous y sommes presque.
Le vent qui avait sauté au noroît déboulait maintenant directement de la Manche, plus froid, plus mordant. Les bourrasques les poussèrent en avant.
— Ça y est, on arrive !
L’inconnue se redressa, souffla bruyamment puis, d’un pas mécanique, franchit les quelques mètres qui la séparaient de la maison. Les deux femmes passèrent le seuil. Sur leur lancée, elles traversèrent la pièce et s’effondrèrent comme une masse sur le canapé.
Adèle reprit son haleine et courut refermer la porte par où s’engouffrait le vent. Alors qu’elle poussait le battant, elle distingua les phares d’une voiture.
Qui pouvait bien passer par là, à cette heure et à cette saison ? Cette petite route n’était empruntée que par les riverains, propriétaires de résidences secondaires, toutes inoccupées en ce moment.
Elle n’approfondit pas et claqua la porte dont elle tourna la clé. Puis, comme elle jetait un coup d’œil par la fenêtre, elle constata que la voiture roulait maintenant lentement, très lentement, devant le portail de Kervézec.
II
Pour Adèle, le début de la journée se déroulait toujours de la même façon. Elle descendait à la cuisine en robe de chambre, préparait son petit-déjeuner, allumait son ordi pour regarder les informations et consulter son courrier. Comme elle était une lève-tôt, elle prenait tout son temps. Ensuite, elle passait sous la douche, s’habillait se coiffait, se maquillait. Quand elle était prête, elle embarquait dans sa Clio et gagnait Saint-Brieuc. L’agence Immo-Goëlo dont elle partageait la gérance avec son amie Laurence Dubois, ouvrait à neuf heures trente.
Ce mardi matin, malgré les événements de la soirée et la présence d’une inconnue dormant dans la chambre d’amis, elle ne changea rien à ses habitudes. Elle en était à sa deuxième tartine lorsqu’elle ouvrit sa messagerie. Il n’y avait qu’un seul e-mail et il était de Charles Amiel, le galeriste de Lausanne.
« Charles Amiel - [email protected] - Octobre 5 à 6 h 39 PM
À Adèle Lemberg
Chère Madame,
À la lecture de votre mail, j’ai pris conscience de l’incorrection dont j’ai fait preuve en m’adressant à vous de façon aussi cavalière. J’aurais dû deviner que vous ignoriez tout de la relation amicale et professionnelle que j’ai eue avec votre père, les derniers mois de sa vie.
J’aimerais vous en entretenir aujourd’hui afin que vous compreniez mieux l’objet et la raison de ma malencontreuse première lettre dont je vous prie humblement de m’excuser.
La première fois que j’ai rencontré votre père, Henri Lemberg, c’était à Gléresse, dans un café du bord du lac, un samedi après-midi de mai 2014.
Il faisait beau, nous étions assis dehors, à l’une des tables de la terrasse. Il y avait du monde car les bateaux de tourisme déversaient, toutes les demi-heures, un flot de promeneurs qui revenaient de l’île Saint-Pierre. Nous nous étions donné rendez-vous à cet endroit pour faire connaissance. Je voulais qu’il sache qui j’étais, avant d’essayer de le convaincre de me laisser visiter sa maison. Je n’avais pas une idée précise de ce que je pourrais y trouver mais j’avais l’intuition que je ne serais pas déçu.
Seulement Henri m’avait vu venir et savait parfaitement que j’étais collectionneur et marchand de tableaux. Un peu déconfit, je n’ai pu que confirmer. Je lui ai alors appris qu’au tout début de ma carrière, j’avais eu l’occasion et l’honneur de rencontrer son père, Casimir Lemberg. Je lui ai dit que, dans le milieu de l’art, son nom n’était pas oublié, pas plus que le rôle éminent qu’il avait joué, durant l’entre-deux-guerres, dans le rayonnement de la peinture contemporaine en Suisse.
Votre père a eu l’air étonné. Il ne pensait pas que le souvenir de Casimir Lemberg perdurait, presque cinquante ans après sa mort.
Sur quoi nous avons bu nos bières en regardant la nouvelle fournée de touristes débarquer d’un bateau. Votre père les observait sans mot dire, attendant sans doute que j’en vienne à l’objet de notre rencontre. Il n’avait pas l’air pressé et semblait apprécier cette terrasse, l’ombre des platanes et même la présence bruyante des enfants qui couraient parmi les tables. Moi par contre, je trouvais l’endroit peu approprié pour lui exposer ce que j’avais à lui dire. Mais, comme j’étais venu tout exprès de Lausanne et que je ne voulais pas m’éterniser à Gléresse, je suis entré dans le vif du sujet et lui ai demandé s’il était possible d’aller jeter un coup d’œil aux toiles et aux dessins qui avaient pu être conservés chez lui, à la Marcotte. »
— Dans quel but ? fit-il d’un ton agacé.
— La curiosité et le fait que je m’en porterais acquéreur, si vous désirez vendre.
— Eh bien voilà ! La chose est dite ! Je me demandais si vous finiriez par vous décider.
— Alors ?
— Cher Monsieur Amiel, ma maison n’est pas visitable. Je n’occupe qu’une partie du rez-de-chaussée et ne mets pas mon nez ailleurs. Les œuvres d’art, s’il y en a, ne m’intéressent pas. Pour dire la vérité, mon père m’en a dégoûté jusqu’à la fin de mes jours. Et, croyez-le si vous voulez, j’ai suffisamment de quoi vivre sans avoir à me dessaisir de quoi que ce soit. J’aime cette maison, sa situation au milieu des vignes, la vue sur le lac. Mais à l’intérieur y règne un effroyable désordre. Une accumulation de meubles et d’objets amassés par mes parents au cours de leur vie, et que j’ai eu la mauvaise idée d’accroître en y ajoutant tout ce que contenait mon appartement parisien lorsque je l’ai vendu. Pour dire la vérité, l’encombrement est tel qu’il y a des pièces où il est impossible de pénétrer.
Je n’ai pas mis sa parole en doute mais cela ne m’a pas découragé, je mourais toujours d’envie de me rendre à la Marcotte. Une rumeur persistante courait dans le milieu des marchands d’art, selon laquelle des œuvres de peintres postimpressionnistes suisses dont Casimir Lemberg était un spécialiste reconnu, y étaient entreposées, peut-être dans des conditions préjudiciables à leur bonne conservation. C’est l’argument que j’avançai pour tenter de faire céder Henri. Mais il n’a rien voulu entendre.
Je suis donc rentré à Lausanne passablement déçu et énervé. Je n’aime pas qu’on me résiste, surtout quand ça n’a pas de sens. L’entêtement de votre père m’était incompréhensible. En outre, l’idée que des œuvres de grande valeur étaient en train de se détériorer dans la poussière et l’humidité, en proie aux insectes dévoreurs de papier, aux champignons, à la moisissure, aux vers, me rendait malade.
Le désir de forcer la citadelle et de convaincre Henri Lemberg me taraudait. Et faites-moi l’honneur de croire, chère Madame, que ce n’était pas uniquement par goût du lucre.
En octobre, alors que je me trouvais près de Gléresse pour une rencontre avec un client, j’en ai profité pour monter jusqu’à la Marcotte. Voyant les volets et les portes fermés, j’ai compris qu’il n’y avait personne. Je me suis alors adressé à un voisin que je voyais jardiner non loin de là, en me faisant passer pour un vieil ami du propriétaire, désireux de le rencontrer.
— Il a séjourné tout l’été ici et doit être reparti chez lui, en Bretagne…
— Vous a-t-il dit s’il reviendrait prochainement ?
— Non.
— Existe-t-il un moyen de savoir quand il sera de retour ?
— Oui. Les volets seront ouverts et je l’apercevrai sur sa terrasse.
— Ce serait gentil à vous de m’en informer. Est-ce que vous pensez cela possible ?
— Bien sûr, pas de problème.
— Dans ce cas, voici mon numéro de téléphone. Mais ne lui dites rien, je veux lui faire la surprise.
C’est ainsi que grâce à l’obligeance de ce voisin, j’ai rencontré votre père pour la deuxième fois. C’était en novembre 2014.
J’avais décidé d’aller frapper à sa porte sans prévenir. Le temps était exécrable et quand il m’a vu debout sous la pluie, il n’a pu faire autrement que de m’inviter à entrer. Il m’a introduit dans la cuisine, nous nous sommes assis à une grande table et il a sorti deux verres ainsi qu’une bouteille de blanc, du Schaffiser, le vin produit sur les coteaux du Lac de Bienne. Contrairement à ce que je craignais, votre père ne paraissait pas mécontent de me voir. Oh ! Je ne me faisais pas d’illusions. Ma visite n’était sans doute qu’un dérivatif à l’ennui, au désœuvrement et à une météo détestable. On était loin du beau samedi de mai et des terrasses ensoleillées.
Nous avons bu nos verres en parlant du mauvais temps et de la cote des œuvres d’art qui ne cessait de grimper, malgré la mauvaise conjoncture économique. « Les riches s’enrichissent quand les pauvres s’appauvrissent. C’est dans l’ordre des choses… », lâcha Henri d’une voix morne. Puis, saisissant la bouteille, il fit mine de vouloir remplir mon verre. Je refusai d’un signe de tête. Ce vin âpre et sec n’était buvable qu’accompagné d’un plat de poisson ou en apéritif pour faire passer les amuse-gueules. Mais là, en milieu d’après-midi, sans rien pour en diluer l’acidité, je craignais qu’il ne me cause des brûlures d’estomac. Votre père n’a pas insisté, il a considéré son verre sans rien dire et c’est alors que j’ai remarqué sa mauvaise mine. Son teint était terreux, ses yeux enfoncés dans leurs orbites, ses joues creuses, ses cheveux clairsemés, son dos voûté… Il avait pris un sacré coup de vieux depuis notre dernière rencontre. Et quand il s’est levé pour aller jusqu’à la fenêtre donnant sur le lac, j’ai eu la fulgurante intuition que cet homme-là ne vivrait plus longtemps.
Souffrait-il d’un cancer ou d’une autre maladie incurable ? Et si c’était le cas, le savait-il seulement ? Soudain, j’ai regretté d’être venu.
Comme pour démentir mes sombres pressentiments, il s’est rassis en face de moi et m’a dit d’un ton où perçait le sarcasme :
— J’imagine que ce n’est pas par amitié ou pour prendre de mes nouvelles que vous êtes venu jusqu’ici… Vous n’avez pas renoncé à l’idée que cette maison recelait des trésors cachés, trésors que vous verriez volontiers tomber entre vos mains. Allons ! Soyez franc, reconnaissez-le !
— Sincèrement, c’est surtout leur éventuelle dégradation qui me tracasse. Je n’ose imaginer dans quel état peuvent être des objets fragiles tels que des dessins, peintures, aquarelles, gravures… Ma principale motivation serait de pouvoir les sauvegarder tant qu’il en est encore temps.
— Oh ! Quel désintéressement de la part d’un marchand d’art !
— Il y a aussi la curiosité intellectuelle et un certain goût pour la chasse aux raretés. Tout cela mis bout à bout…
Votre père a affiché une moue dubitative. Alors qu’une rafale plus violente que les autres fouettait les carreaux de la fenêtre, il a poussé un soupir impatient avant de lâcher :
— Écoutez, même si je le voulais, je ne pourrais rien faire. C’est ma fille Adèle qui est propriétaire de la Marcotte et de tout ce qu’elle contient. Elle en a hérité à la mort de ma mère, en 1997. Depuis, je n’y suis revenu qu’à de rares occasions. Le printemps dernier, pour une raison qui ne vous regarde pas, j’ai demandé à ma fille l’autorisation de séjourner dans cette maison, ce qu’elle m’a accordé, à condition que je me cantonne au rez-de-chaussée. Dans ce contexte, vous comprendrez qu’il m’est impossible de vous vendre quoi que ce soit et même de vous faire visiter les lieux. Je ne suis, ici, qu’un invité à peine toléré. Cela dit, je suis persuadé qu’il y a dans le fourbi entassé à la Marcotte, des choses qui pourraient vous intéresser… mais rien n’ayant trait aux génies avant-gardistes du début du XXe siècle. Pas de cubistes, pas d’abstraits, pas de surréalistes. Mon père ne touchait pas à ça.
Je lui ai répondu que j’étais au courant. Henri a hoché la tête puis repris le fil de son récit :
— Vous l’ignorez peut-être, mais Casimir Lemberg est né en Pologne, aux environs de Varsovie, en 1893. Il ne parlait jamais de son pays d’origine, pas plus qu’il n’y est retourné. Au début parce qu’il n’en avait ni le temps ni les moyens, plus tard à cause du Rideau de Fer qui coupait l’Europe en deux. Les pays satellites de l’URSS n’octroyaient jamais de visas à leurs ex-ressortissants. Il ne m’a pas donné non plus la raison exacte de son départ de Pologne. Je sais juste qu’il avait dix-huit ans quand il a débarqué à Paris. Sans un sou, sans relation et sans connaître un traître mot de français. En quoi il ne se distinguait pas de la foule des migrants qui arrivaient en France, dans ces années-là. Il a trimé jour et nuit durant des mois puis, avec ce qu’il avait dû économiser, il s’est inscrit à l’Académie Julian, une alternative à l’École des Beaux-Arts. Elle a été fréquentée par un grand nombre de jeunes artistes devenus célèbres par la suite. La plupart des Nabis sont passés par là. Casimir a étudié la peinture jusqu’au début de la Grande Guerre. Je n’ai pas de détails sur sa façon de vivre. J’imagine une bohème sympathique et parfois difficile qu’il partageait avec la plupart de ses condisciples. C’est là qu’il s’est lié d’amitié avec des peintres suisses établis dans la capitale. Félix Vallotton, Cuno Amiet, Ernest Bieler et bien d’autres. Lorsque la guerre de 14 a éclaté, la plupart des artistes suisses ont quitté Paris et sont rentrés dans leur pays. Pour quelle raison Casimir les a-t-il suivis ? Je n’en ai aucune idée. Ce que je sais par contre c’est que ces peintres étaient assez cotés ou assez fortunés pour vivre de leur art. Ce qui n’était pas le cas de mon père. Il m’a raconté que, grâce à l’entremise de Vallotton, il avait été engagé par un marchand genevois, à la fois courtier et galeriste, à qui il avait servi de grouillot puis de rabatteur, de prospecteur, d’intermédiaire. Cette activité lui a permis de rester en contact avec ses condisciples de Paris qui lui ont fait confiance et l’ont bientôt chargé de les représenter auprès des galeristes et de toutes les instances culturelles auxquelles étaient attribuées l’organisation des grandes manifestations artistiques et les commandes d’œuvres destinées aux édifices publics. Sa connaissance de la peinture, acquise à l’Académie Julian, et un sens inné du commerce ont fait merveille. Dès la fin de la guerre, il avait fait son trou dans ce milieu. Quelques années plus tard, il était devenu marchand à son tour. Comme il n’était ni rêveur ni idéaliste, il savait qu’il perdrait son temps et son argent à vouloir vendre des œuvres d’avant-garde aux bourgeois conformistes qui formaient alors sa clientèle. Il s’en est donc tenu au style académique, mâtiné de symbolisme et d’expressionnisme, courants picturaux en vogue à ce moment-là. C’est ainsi qu’il a commencé à gagner très convenablement sa vie. Lorsqu’il a rencontré celle qui devait devenir sa femme, il ne restait aucune trace du Polack misérable qui avait immigré à Paris, vingt ans plus tôt. Rien, sinon l’accent dont il n’a jamais pu se départir mais qui faisait, paraît-il, partie de son charme. Un charme auquel ma mère n’a pas résisté longtemps. Il faut noter qu’elle était la fille de Frédéric Zeiss, un éditeur neuchâtelois connu pour avoir publié d’innombrables dessins d’Albert Anker et de bien d’autres graphistes suisses de la même époque.
— C’est précisément à ce genre d’œuvres que je pense, quand je parle de trésors cachés en train de se dégrader.
J’avais dû manifester un peu trop d’enthousiasme et un intérêt trop visible car Henri a paru se recroqueviller dans sa coquille.
— Oui… possible… Je sais que ma mère avait récupéré tout un fonds de gravures, dessins et lithos avant que l’imprimerie Zeiss ne soit fermée. Casimir a dû en vendre une bonne partie. Pour le reste, j’ignore ce que mes parents en ont fait. Je ne me suis jamais posé la question. L’art et tout ce qui tourne autour me rebutent à un point que vous n’imaginez pas. On m’en a trop rebattu les oreilles durant mes jeunes années. Quant aux artistes, croyez-moi, ils ne valent pas la curiosité qu’ils suscitent et je…
Une quinte de toux l’a interrompu et je n’ai pas eu le plaisir d’entendre ce qu’il avait à dire à ce sujet. J’aurais bien voulu pourtant… Lorsqu’il est parvenu à reprendre son souffle, son air exténué s’était aggravé. Il respirait par à-coups, haletait, reniflait. Il a tiré un mouchoir de sa poche pour s’essuyer les yeux et le front. Puis il a versé du vin dans son verre et l’a bu d’un trait, comme pour s’éclaircir la voix.
— Écoutez, reprit-il, j’étais à peu près sûr que vous reviendriez me voir. Je connais les marchands d’art, quand ils ont flairé quelque chose, ils ne renoncent jamais. De véritables hyènes… Ah ! Ah ! Ah !
Le croassement de son rire a résonné dans la cuisine. Par politesse, je lui ai fait écho. Je trouvais sa plaisanterie un peu lourde mais bon, s’il fallait en passer par là pour être dans ses petits papiers, pourquoi pas ?
La suite m’a donné raison. Votre père s’est levé et a quitté la pièce. Je l’ai entendu ouvrir une porte donnant sur le couloir puis revenir en traînant les pieds. Il a allumé la lampe car le ciel bas plongeait la pièce dans la pénombre puis a déposé une enveloppe cartonnée devant moi.
— J’ai enfreint les ordres d’Adèle et je suis allé fouiller dans les affaires de Casimir. Tenez ! J’ai mis cela de côté pour vous.
J’ai dû avoir l’air déconcerté et heureusement surpris car il a marmonné :
— Prenez ce carton et rentrez chez vous ! La visite est terminée. Je suis fatigué.
La troisième fois que j’ai rencontré Henri Lemberg, c’était en mai 2015 et à sa demande. Cela tombait bien car, après avoir fait expertiser le contenu de la chemise cartonnée, j’avais très envie de m’en porter acquéreur et je voulais le faire dans les formes.
Il s’agissait d’œuvres sur papier, chacune signée d’un artiste différent. Certains noms étaient célèbres, Anker, Vallotton, Segantini… d’autres moins. Mais l’ensemble m’enchanta. L’expert à qui je les avais confiées confirma mon jugement, sans toutefois se prononcer sur leur valeur pécuniaire, ce que je ne lui demandais pas car je connaissais la fourchette des prix qu’elles pouvaient atteindre.
J’avais donc apporté l’enveloppe contenant les dessins avec moi. Je l’ai sortie de mon sac en disant que c’était là un superbe échantillonnage de la collection que devait posséder Casimir Lemberg, et que je désirais l’acheter. Henri a paru surpris.
— J’ai trouvé cette chemise par hasard, dans un panier d’osier, au milieu de bouquins dépareillés. À mon avis, elle a échoué là sans que personne ne sache ni pourquoi ni comment. Vous pouvez la garder, je vous l’offre.
Je me suis récrié qu’il n’en était pas question. Cela valait beaucoup trop d’argent pour que j’accepte un tel cadeau.
— Que voulez-vous que j’en fasse ?
— Vous avez une fille et une femme qui ne seraient certainement pas d’accord pour que…
Il a balayé cet argument d’un geste qui en disait long. Indifférence, agacement, dédain… Je n’ai pas insisté.
L’état d’Henri s’était beaucoup détérioré depuis ma visite de l’automne précédent. Il me recevait, à demi allongé dans un fauteuil, les pieds sur un pouf et les jambes recouvertes d’une couverture qui pendouillait de part et d’autre. Il avait le teint jaunâtre, les yeux cernés, l’haleine fétide. Ses mains décharnées où s’entremêlait un lacis de veines bleu noir reposaient immobiles sur le plaid.
— Prenez ces dessins et gardez-les ! répéta-t-il. On n’emporte rien avec soi quand on nous met dans le trou…
— Vous n’en êtes pas encore là !
Ma protestation était de pure forme car il paraissait évident que les portes du néant n’allaient pas tarder à s’ouvrir devant lui. Dans l’immédiat, une idée me troublait davantage, celle de le savoir seul dans cette maison, malade, à bout de forces et apparemment sans soins médicaux. Il avait une femme et une fille. Pourquoi n’étaient-elles pas à ses côtés ? Mon visage a dû traduire ma perplexité car il a repris d’une voix plus ferme :
— Ne vous inquiétez pas pour moi. Si je suis ici, tel que vous me voyez, c’est que je l’ai décidé en toute connaissance de cause. J’ai failli passer l’arme à gauche, il y a trois mois, en Bretagne. J’allais vraiment mal, physiquement mais aussi mentalement. Magda, ma femme, a bien cru qu’elle allait être enfin débarrassée de moi. Mais, contre toute attente, j’ai repris du poil de la bête… Une rémission, comme disent les médecins. C’est là que j’ai résolu de venir mourir ici, ce qui ne devrait plus tarder maintenant.
Qu’aurais-je pu répondre ? Je n’étais ni un parent ni un ami, même pas une véritable relation d’affaires. Si j’avais pris contact avec lui, c’était dans un but purement mercantile. Et voilà qu’aujourd’hui, cette démarche m’amenait à recueillir les confidences d’un mourant et faisait de moi le témoin involontaire d’une fin quasi programmée.
Pour moi, c’était insupportable. La mort et ce qui tourne autour m’ont, de tout temps, inspiré de la peur et du dégoût. Ne voulant pas en entendre davantage, j’enfilai ma veste, saisis la chemise cartonnée et m’apprêtai à le laisser seul puisque c’était ce qu’il voulait.
— Attendez ! Je n’ai pas fini… D’abord, vous boirez bien un dernier coup de blanc avec moi… Prenez la bouteille sous l’évier, et deux verres dans le buffet ! Pendant que vous y êtes, allez dans le couloir ! Il y a un tableau que je voudrais vous montrer. Il est posé par terre, contre la cloison.
J’ai fait ce qu’il me demandait et j’ai rapporté une grande toile rectangulaire que j’ai placée sur une chaise, face au jour qui entrait par la fenêtre. C’était une huile de jolie facture, dans les tons pastel. Elle représentait une mère et son bébé. En arrière-plan, on reconnaissait le lac et le vignoble.
— C’est un tableau de mon père. Dans ses vieux jours, Casimir s’était remis à la peinture. Qu’est-ce que vous en pensez ?
— Si c’est l’avis du marchand que vous sollicitez, je vous dis d’emblée que ça ne m’intéresse pas. Les œuvres de ce style n’entrent pas dans ma ligne de vente. En dehors de ce préambule, celle-ci ne manque pas de qualités. Elle dénote un savoir-faire et une technique incontestables dans le trait comme dans les coloris. Même si le sujet est bateau, il est traité avec délicatesse et sensibilité. Actuellement, les tableaux de ce genre n’ont pas la cote. Personne n’en veut, ce qui ne signifie rien. Le goût du public est cyclique. Ce qui est décrié aujourd’hui sera porté aux nues demain… Savez-vous qui sont la femme et l’enfant qui figurent sur cette toile ?
Henri a émis un grognement qui ne voulait dire ni oui ni non. Les yeux à demi fermés, il paraissait perdu dans ses pensées. De mon côté, je ne comprenais pas pourquoi il avait tenu à me montrer cette œuvre. J’ai rempli nos verres et lui en ai tendu un. Il l’a saisi et avalé d’un trait.
— Manifestement, ce tableau a été peint à la Marcotte. Le paysage en arrière-fond est celui que l’on voit de la terrasse. Mais il n’est ni signé ni daté.
— Non, mais je sais que c’est mon père qui l’a peint au cours de l’été 1958.
— Vous étiez présent ?
À nouveau, Henri a éludé la question en marmonnant des mots incompréhensibles. Je commençais à trouver ses dérobades agaçantes. S’il ne voulait pas m’en dire davantage, libre à lui. Mais dans ce cas, je n’avais plus rien à faire ici. J’ai regardé ma montre et me suis exclamé que je n’avais pas vu l’heure passer et que j’avais rendez-vous avec un client à Neuchâtel, dans quarante-cinq minutes.
Votre père n’a rien répondu, il n’a même pas fait semblant de me croire.
— J’ai un service à vous demander. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je vous ai prié de venir me voir. C’est à propos de cette toile. Je ne veux pas qu’elle soit vendue, donnée ou jetée après ma mort. Je tiens à ce que ma fille Adèle la conserve. Qu’elle la mette dans son grenier si elle ne lui plaît pas, mais elle ne doit en aucun cas s’en défaire. Je vous charge de lui transmettre personnellement ce message. D’autre part, je souhaite que vous soyez présent à ses côtés, au moment où sera inventorié le reliquat des collections ayant appartenu à mes parents – si tant est qu’il en reste quelque chose naturellement. Je veux que ce soit vous qui en dressiez le catalogue et en fassiez l’estimation. Je vous sais honnête et compétent. À mes yeux, vous êtes la personne qu’il faut pour mener à bien cette opération. J’ai mis ce que je viens de vous dire par écrit dans cette enveloppe, vous en prendrez connaissance une fois rentré chez vous. J’ajoute qu’un duplicata sera adressé à maître Rebetez, mon notaire à Neuchâtel. Inutile de me répondre. Inutile aussi de revenir me voir, même si votre bon cœur ou des scrupules vous y poussent. Je n’ai besoin de personne pour ce qui me reste à faire.
Je l’ai regardé en fronçant les sourcils.
— Henri, à quoi pensez-vous là ?
— Oh ! À rien de dramatique, rassurez-vous ! Seulement, je ne veux pas d’une bonne âme pour me tenir la main quand ça ira vraiment très mal. Je m’en voudrais d’imposer une telle corvée à qui que ce soit.
— Et… Et qu’est-ce que vous ferez quand vous sentirez que… que…
— Eh bien, je prendrai mon téléphone, j’appellerai les pompiers ou une ambulance… Et j’irai finir mes jours à l’hôpital. Comme tout un chacun. »
Voilà, chère Madame, ce que j’aurais aimé vous raconter de vive voix, si cela n’avait supposé un voyage trop long et trop fatigant pour moi. J’ai donc pris le parti de vous retracer l’historique de ma relation avec votre père dans ce très long mail, en espérant que vous aurez la patience de le lire jusqu’au bout. Vous trouverez en pièce jointe, le contenu de l’enveloppe que m’a remise votre père et dont je fais mention à la fin de mon récit.
Je vous prie de ne voir, dans cette démarche, aucun désir d’ingérence dans vos affaires familiales. Seul m’a motivé le sentiment de devoir vous transmettre les directives clairement exprimées d’un homme au seuil de la mort.
Maître Rebetez m’a annoncé qu’il me tiendrait informé de votre arrivée à Gléresse lorsque vous aurez décidé de procéder à l’inventaire de la Marcotte et, plus particulièrement, à celui des œuvres d’art qui pourraient s’y trouver. J’aurai sans doute alors le plaisir de faire votre connaissance…
Dans l’attente de cette rencontre, je vous prie de croire, Chère Madame, à l’expression de mes sentiments respectueux.
Charles Amiel »
Adèle quitta l’écran des yeux. La lecture de cet interminable mail suscitait en elle des sentiments mitigés. Émotion, perplexité, agacement. Quoi qu’il en dise, son auteur se mêlait d’une affaire qui ne le regardait pas et cela la contrariait vraiment.
Son père était mort d’un cancer généralisé, en juin dernier, à l’hôpital de Neuchâtel. Seul comme il l’avait voulu. Qu’il ait fui la présence de Magda et se soit réfugié à la Marcotte, elle pouvait le comprendre. Pour le reste, chacun est libre de choisir la fin qui lui plaît. Ils n’avaient jamais été proches. Pourquoi devrait-elle se sentir coupable, aujourd’hui, de ne pas s’être suffisamment inquiétée de lui alors qu’il vivait ses derniers jours ?
Après des funérailles civiles, ses cendres avaient été dispersées dans le lac. Elle y avait assisté puis regagné la Bretagne. La maison de Gléresse était restée fermée et le règlement de la succession différé.
Adèle décida d’imprimer le mail de Charles Amiel. Elle le relirait plus tard si elle en éprouvait l’envie. Dans l’immédiat, elle avait un problème plus urgent à régler, celui de l’inconnue qui dormait au premier étage. La veille, elle avait paré au plus pressé sans poser de questions. Bain chaud, repas et un lit dans la chambre d’amis. Elle se demandait maintenant comment se déroulerait la suite. Elle avala un deuxième bol de café puis alla prendre sa douche. Lorsqu’elle en ressortit, le soleil rougeoyait à l’horizon. Sa lumière éclairait la cage d’escalier d’une insolite lumière cuivrée. À cet instant, elle entendit un léger bruit de pas à l’étage, puis l’inconnue apparut au haut des marches, flottant dans un pyjama trop grand pour elle, et toute rosie par l’éclat du soleil levant.
Adèle constata alors qu’elle était beaucoup plus jeune qu’elle ne l’avait pensé hier soir.
— Bonjour ! Vous avez bien dormi ?
— Oui, merci.
Un sourire incertain s’esquissa sur ses lèvres.
— Est-ce que vous voulez déjeuner ?
— Oui, merci.
— Mais d’abord, enfilez cette robe de chambre et ces pantoufles. Elles sont sûrement trop grandes pour vous, mais vous aurez les pieds au chaud. Qu’est-ce que vous prenez ? Thé, café, chocolat ?
— Cela m’est égal.