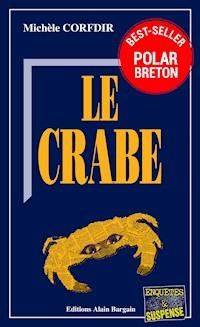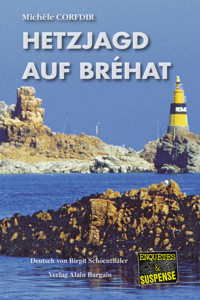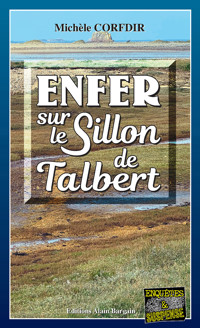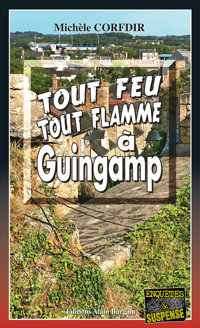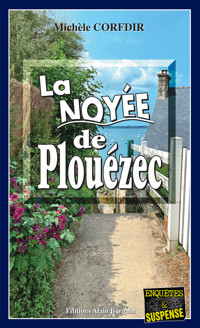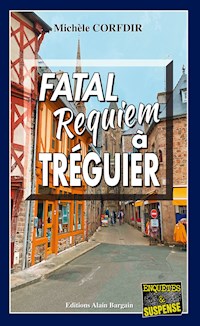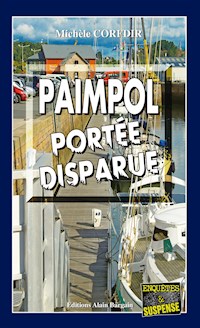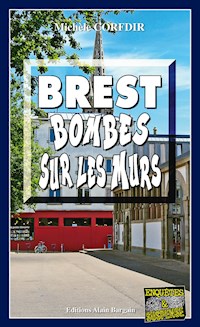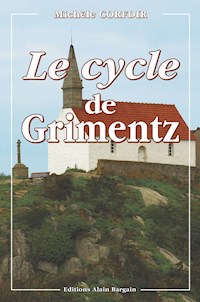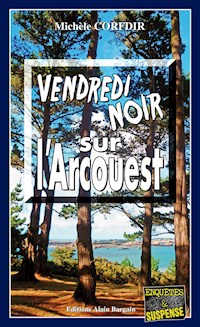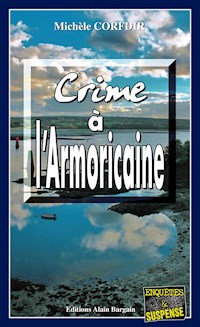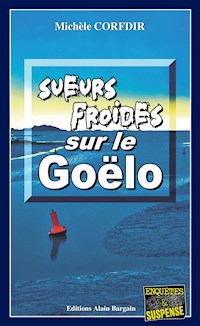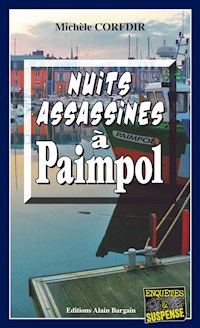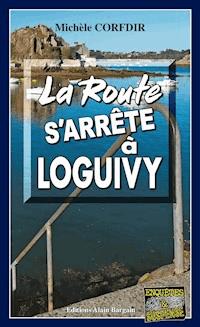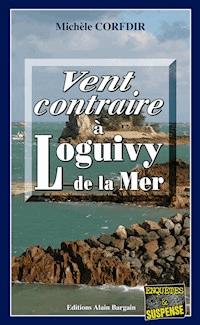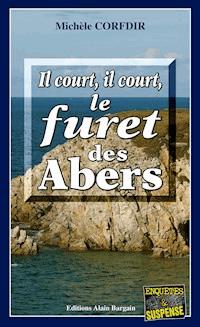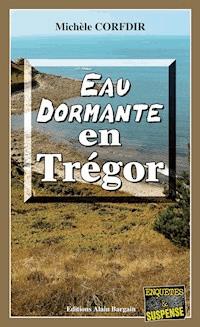
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Quand les fantômes du passé ressurgissent…
Les énigmes de son passé, Pauline ne veut plus en entendre parler ! Voyagiste à Lannion, elle mène une vie paisible que rien ne troublera plus, du moins le croit-elle jusqu'au jour où un revenant force sa porte et la fait changer d'avis.
Un roman plein de suspense qui trace le portrait d'une femme, Pauline Miossec, et de ceux qui ont bouleversé son existence : sa mère, astrophysicienne de renom. Son maître, un photographe misanthrope. Un Allemand au passé incertain. Des soldats perdus et retrouvés. Autant de personnages surprenants d'une histoire qui débute en Bretagne, en 2004, puis remonte par étapes jusqu'en 1951, au moment où, petite fille, l'héroïne livre la clé des secrets qui marqueront sa destinée.
Plongez dans ce thriller qui fait voyager du présent vers un passé troublant !
EXTRAIT
Il serait excessif de prétendre que cette agonie me bouleverse profondément. Ma mère et moi ne nous aimons pas assez pour ça. Je la plains sincèrement d’avoir échappé à une mort rapide et d’errer dans cette zone intermédiaire et mystérieuse où nul ne peut l’atteindre. Elle aurait dû être foudroyée et ne l’a pas été, ratant de peu la sortie fracassante que chacun de nous se souhaite.
Dans la voiture qui me ramène chez moi, je me dis que c’est là un des rares échecs d’un parcours par ailleurs jalonné de succès. Cette constatation me procure une satisfaction douteuse, comme si cette fin lamentable compensait un tant soit peu le prodigieux contraste entre ce qu’a été sa vie et ce qu’est la mienne.
Ce sentiment ne se fonde ni sur la rancœur ni sur des regrets. Je sais depuis longtemps qu’Hélène est une personnalité hors norme qui va son chemin sans se soucier des contingences. Elle n’a jamais voulu affronter que les obstacles qu’elle jugeait dignes d’elle. Elle ne s’est intéressée qu’à des questions qui échappent au commun des mortels, laissant à son entourage le soin de s’occuper du reste.
CE QU’EN PENSE LA CRITIQUE
Editions Bargain, le succès du polar breton. –
Ouest France
À PROPOS DE L'AUTEUR
Michèle Corfdir est née et a grandi en Suisse. Elle y a fait ses études et a enseigné quelques années dans le Jura et à Bienne. Elle a publié alors un recueil de poèmes couronné par le Prix des Poètes Suisses de Langue Française, ainsi que des contes pour enfants qui obtiennent le prix de l'Office Suisse de la Lecture pour la Jeunesse. Après son mariage avec un marin pêcheur breton, elle s'établit à Loguivy de la Mer. Elle collabore comme nouvelliste à diverses revues et met sa plume au service des marins pêcheurs, au cours de la crise qu'a connue cette profession au début des années 90. En 1998, elle publie aux Éditions Alain Bargain, son premier roman,
Le Crabe, un thriller maritime très bien accueilli tant par la critique que par le public. Face à ce succès, elle édite d'autres ouvrages dans la collection Enquêtes et Suspense.
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -
Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
À Pierre.
NOTE DE L’AUTEUR
Au cours du mois de juin 1940, alors que le 45e corps d’armée français bat en retraite devant la Wehrmacht, plusieurs bataillons ainsi qu’une division polonaise, la “Deuxième Division de chasseurs à pied” commandée par le général Prugar-Ketling, se trouvent engagés dans de violents combats le long du Doubs et de la frontière helvétique.
Encerclés, piégés, ce sont environ quarante-trois mille soldats français et polonais qui demandent alors asile à la Suisse et pénètrent sur le territoire de la Confédération, les 19 et 20 juin 1940.
Si les Français ne restent que quelques mois avant d’être rapatriés, la division polonaise (treize mille hommes) demeurera en Suisse durant toute la guerre.
On a attribué à ces soldats le statut d’interné militaire et ils ont été répartis dans des centaines de camps, à travers tout le pays. La plupart étaient affectés à des travaux agricoles ou d’intérêt collectif comme la construction de routes et de ponts.
Les normes de travail auxquelles étaient soumis ces hommes étaient les mêmes que celles de leurs collègues suisses. Le montant de leur salaire était fixé par l’État et ils bénéficiaient d’une prise en charge médicale et d’une assurance contre les accidents. Il est à noter qu’un millier de ces soldats ont pu poursuivre leurs études dans les universités ou les écoles techniques suisses.
C’est ce chapitre peu connu de l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale qui sert de toile de fond à ce roman.
PREMIÈRE PARTIE
2004
LANNION.
Non ! Il n’en est pas question ! Je refuse de rentrer. Je m’y refuse absolument ! Mon travail en Crète n’est pas terminé. J’ai un contrat à remplir, des obligations envers mon employeur. Je ne peux pas tout lâcher sur un simple coup de fil… même s’il provient du centre hospitalier de Lannion où ma mère, Hélène Vitorski, a été admise à la suite d’une attaque cérébrale.
Me précipiter à son chevet ne servirait à rien. Pour l’heure, c’est aux médecins de gérer la crise, comme me l’a d’ailleurs laissé entendre le gériatre au téléphone. Des examens sont en cours, l’état de la malade stabilisé, la situation sous contrôle. Un retour en urgence ne s’impose pas.
Je n’en demande pas plus. Mais en vérité, c’est un mauvais prétexte. L’idée d’assister à la déchéance physique de ma mère me cause une peur panique et les milliers de kilomètres qui me séparent d’elle me permettent de repousser à plus tard une confrontation qui me terrifie.
Je décide donc lâchement de rester en Crète quelques jours encore.
Maurice Perez, le patron de l’agence de voyages qui m’emploie, m’a chargée de prospecter les régions les plus reculées de l’île afin de dénicher quelques-uns de ces petits paradis dont les clients raffolent et où ils se précipitent, sans avoir conscience que leur présence en altérera très vite et à jamais le charme.
Après une semaine d’allées et venues dans une Clio de location, j’ai d’ores et déjà découvert quelques sites encore intacts mais cela ne suffit pas. Je poursuis donc mes recherches, le temps de calmer mes angoisses.
Quand enfin je me sens prête à affronter la réalité, je prends l’avion et rentre chez moi, à Lannion.
En pénétrant dans la chambre d’hôpital, je comprends aussitôt pourquoi le médecin n’a pas insisté pour me faire revenir plus vite. Je dois dire que je n’avais pas mesuré non plus la gravité de l’AVC dont ma mère avait été victime. Je pensais, au pire, à une hémiplégie en voie de régression. Des lèvres un peu tordues, un bras inerte posé sur le drap, quelques chuintements dans la voix…
Mais pas ça ! Pas cette moribonde à demi chauve, aux joues creuses et aux lèvres comme aspirées à l’intérieur de la bouche.
— Vous n’étiez pas prévenue de son état ? chuchote l’infirmière en m’entraînant dans le couloir.
— Si, mais je n’avais pas réalisé à quel point elle était atteinte. Je… je ne l’ai presque pas reconnue.
— Madame Vitorski approche des quatre-vingts ans. À cet âge, la dégradation est souvent rapide. Êtes-vous très proches l’une de l’autre ?
— Euh… oui et non.
Je n’ose lui avouer que jusqu’à la minute précédente, j’ignorais que ma mère portait un dentier et que sa masse de cheveux blancs était due à un postiche.
— Je retourne travailler. Si vous avez besoin de moi, n’hésitez pas à m’appeler, je reste à l’étage.
L’infirmière m’adresse un sourire encourageant et je regagne à pas lents la chambre 317. Là, je contemple l’effrayante momie étendue sur son lit. J’effleure ses mains puis sa joue… Que faire d’autre ? Déjà, l’ennui m’envahit. Je vais jusqu’à la fenêtre, observe les allées et venues des visiteurs sur le parking et la fuite des nuages qui met un semblant de mouvement dans toute cette immobilité.
— Photosphère.
Je me retourne, incrédule. Un mot vient de sortir de cette bouche fendue… comme un sou qui roule hors d’une tirelire.
— Céphéide.
Effarée, je fonce jusqu’au bureau de l’infirmière.
— Ma mère a parlé ! Venez vite !
Sans s’émouvoir, elle m’apprend alors que, depuis peu, la malade s’est mise à lâcher des mots, par intermittence. Bien entendu, le médecin est au courant.
— Plutôt encourageant, non ?
Elle acquiesce puis me suit jusqu’à la chambre.
— Ère particulaire.
À nouveau, je sursaute. Ce visage statufié, ces lèvres desséchées… comment est-ce possible ?
— Je ne connais pas la signification des termes qu’énonce madame Vitorski. Pourtant, ils existent ! J’ai vérifié dans mon dictionnaire. Curieusement, ils se rapportent tous à l’astronomie.
— Ça n’a rien d’étonnant ! Ma mère est astrophysicienne. Vous ne le saviez pas ?
L’infirmière hoche la tête, pas particulièrement impressionnée.
— Nous nous trouvons face à un cas tout à fait intéressant. Même le gériatre ne se l’explique pas vraiment. Jusqu’à avant-hier, nous avons cru que votre mère avait complètement perdu l’usage de la parole… et de la communication en général. Mais voilà qu’elle a commencé à articuler des mots, de manière totalement incohérente et décousue.
— Quels sont ses espoirs de guérison ?
— Ce pronostic n’est pas de ma compétence. Il faut savoir que le désir de communiquer par un geste, une parole ou un regard, est la première manifestation du réveil de la conscience. Votre mère va peut-être revenir à elle.
Encore faudrait-il qu’elle en ait envie…
La connaissant, je sais qu’elle ne supporterait pas de voir son intelligence dégradée et qu’elle préférerait s’enfermer dans un mutisme absolu plutôt que de donner le spectacle de sa décrépitude.
Mais qu’y a-t-il de commun entre Hélène Vitorski et cette pauvre vieille grabataire qui ne reconnaît personne, même pas sa fille ?
Je me demande alors pourquoi tout le monde s’acharne à vouloir la tirer de sa bienheureuse inconscience, état qui à mes yeux est le meilleur pour elle.
Les semaines suivantes, je vais la voir presque tous les jours, contre l’avis de Rozenn, ma fille, qui trouve que j’exagère.
Durant ces visites, je parle à ma mère beaucoup plus que je ne l’ai jamais fait jusqu’ici. De tout et de rien, de mon travail, de mes voyages, des gens que je croise, de l’argent que je gagne… comme si ce genre de choses pouvait l’intéresser !
De loin en loin, sans que rien ne le laisse présager, des mots savants s’échappent de sa bouche. Le gériatre a émis l’hypothèse que ce sont là les résidus d’un savoir qui n’existe plus, les balbutiements d’une mémoire saccagée par la maladie. Il ne fallait leur chercher ni un sens ni un message quelconque.
— Ma mère les articule distinctement alors qu’elle semble incapable de formuler les termes les plus courants.
— Oui, je sais… Ce phénomène est très curieux et pas vraiment compréhensible. Comparez-le aux effets d’un séisme qui détruit les murs les plus solides, tout en épargnant des objets très fragiles.
— Je vois… Pensez-vous qu’elle ait encore une chance de récupérer ?
— Impossible à dire.
— Facule… Accrétion…
Le médecin affiche un sourire attristé.
— Hélène Vitorski était une intellectuelle de haut niveau. C’est peut-être là l’ultime façon de nous le rappeler et d’affirmer qu’elle appartient encore à notre monde. Simple supposition de ma part parce qu’en fait, je n’en sais strictement rien !
Après son départ, Hélène a prononcé plusieurs mots d’affilée.
— Hadron… Bolomètre… Chondrites…
Ils ont quitté son corps et sont restés suspendus dans l’air comme les dernières feuilles qui se détachent des arbres en automne et qui planent calmement avant de toucher le sol. Alors, je me lève et, à nouveau, je scrute le visage immobile, les yeux entrouverts, bleus et vides. Comment ces paroles arrivent-elles à se frayer un passage dans ce cerveau ravagé pour parvenir jusqu’à moi ?
Brusquement, la colère me saisit. Je prends la main inerte et la tapote plus fort que d’habitude. Puis, penchée vers l’oreille, je crie : « Hélène ! Hélène ! » J’ai envie de pincer ses joues, de tirer ses cheveux. Mais naturellement, je n’en fais rien. Je patiente encore un peu, puis je m’en vais, fuyant cette chambre où, vieux gréement à bout de souffle, ma mère attend la tempête ou l’imperceptible marée qui viendra l’arracher à la vasière où elle s’est échouée.
*
Il serait excessif de prétendre que cette agonie me bouleverse profondément. Ma mère et moi ne nous aimons pas assez pour ça. Je la plains sincèrement d’avoir échappé à une mort rapide et d’errer dans cette zone intermédiaire et mystérieuse où nul ne peut l’atteindre. Elle aurait dû être foudroyée et ne l’a pas été, ratant de peu la sortie fracassante que chacun de nous se souhaite.
Dans la voiture qui me ramène chez moi, je me dis que c’est là un des rares échecs d’un parcours par ailleurs jalonné de succès. Cette constatation me procure une satisfaction douteuse, comme si cette fin lamentable compensait un tant soit peu le prodigieux contraste entre ce qu’a été sa vie et ce qu’est la mienne.
Ce sentiment ne se fonde ni sur la rancœur ni sur des regrets. Je sais depuis longtemps qu’Hélène est une personnalité hors norme qui va son chemin sans se soucier des contingences. Elle n’a jamais voulu affronter que les obstacles qu’elle jugeait dignes d’elle. Elle ne s’est intéressée qu’à des questions qui échappent au commun des mortels, laissant à son entourage le soin de s’occuper du reste.
J’ai maintes fois essayé d’expliquer cela à Rozenn, mais ma fille refuse catégoriquement de partager mon point de vue.
— Ta mère est une égocentrique qui n’a pris en compte que son ambition !
— Elle aurait été un homme, nul ne le lui aurait reproché.
— Arrête ! Ton féminisme simpliste date un peu ! En outre, tu sais très bien que ce n’est pas de ça qu’il s’agit. Quel âge avais-tu quand elle t’a abandonnée ?
— Elle ne m’a jamais abandonnée…
— Bon ! D’accord ! On connaît l’histoire, inutile d’y revenir… N’empêche que ce sont tes grands-parents qui t’ont élevée. Hélène t’a mise au monde et puis elle s’est barrée.
— Elle n’avait que dix-huit ans !
Dix-huit ans, une gamine. Bien plus jeune que Rozenn aujourd’hui. Ou que moi, lorsque mes enfants sont nés…
Sans y prendre garde, je me laisse aller à ce jeu de l’esprit qui consiste à calculer l’âge qu’avaient nos proches à un moment précis de notre propre existence. Je pense à Paps et Moumi, mes grands-parents qui me semblaient si vieux quand j’étais petite mais qui, en fait, avaient à peine cinquante ans. Je me souviens aussi de ma mère lorsqu’elle était en pleine activité. L’image que je garde d’elle est celle d’une femme austère et vieillissante. Pourtant, ceux qui l’ont connue à cette époque, affirment qu’elle était élégante, affable et capable de tenir l’assistance sous son charme chaque fois qu’elle prenait la parole en public.
Je veux bien les croire, mais cela ne change rien. Pour moi, elle a toujours été une personne inaccessible et lointaine, qui ne s’intéressait ni à moi ni aux miens.
Nous ne la voyions d’ailleurs pratiquement jamais, sauf au mois d’août quand nous allions en vacances à Ti Coz, sa propriété de l’Arcouest, au bord de la Manche, qu’elle mettait à notre disposition. Elle s’arrangeait alors pour nous rejoindre une petite semaine, jouant du bout des lèvres le rôle de grand-mère pour lequel elle n’était visiblement pas faite.
Rozenn et Matthieu qui ignoraient, bien sûr, la place éminente qu’elle occupait dans le monde de l’astrophysique, adoptaient à son égard une attitude circonspecte. Entre elle et eux, il n’y avait ni tendresse ni complicité. Jamais elle ne les questionnait sur leurs occupations ou leurs résultats scolaires. Elle leur apportait des cadeaux, bavardait avec eux le temps du déballage et des remerciements, puis passait à autre chose.
Avec Gérald et moi, elle se montrait courtoise. Nos conversations se bornaient à des sujets d’ordre général. Elle écoutait mon mari avec une attention un peu distraite, opinait généralement à ce qu’il disait, sans jamais engager de controverse.
Ces quelques jours en notre compagnie lui apportaient-ils un vrai délassement ou était-ce une corvée qu’elle s’imposait ? Je n’en savais rien. J’ignorais même pourquoi elle avait acheté Ti Coz puisqu’elle n’y venait pour ainsi dire jamais. Lorsque je le lui demandai, elle me répondit qu’elle aimait la région et envisageait d’y passer sa retraite.
— Il me faut un point de chute, un endroit où je pourrai vieillir en paix.
— Quoi ? Mais tu n’as vécu qu’en ville, au milieu de tes étudiants et de tes confrères… sans cesse entre deux congrès, toujours à courir le monde ! Imagine-toi seule ici, en hiver… Tu périras d’ennui !
— Qu’en sais-tu, Pauline ?
J’étais persuadée d’avoir raison. Pourtant, je me trompais.
En 1989, à soixante-deux ans, elle a pris congé du CNRS, est devenue professeur émérite de plusieurs universités et s’est installée à Ti Coz. Loin de rompre les ponts, elle a accepté pratiquement toutes les invitations, rédigé d’innombrables articles scientifiques, reçu ses anciens collègues et les relations qu’elle avait un peu partout, et leur a fait découvrir les beautés de notre région.
Mais nous qui habitions Saint-Jacut-du-Mené, à moins de cent kilomètres de l’Arcouest, jamais elle ne nous invitait. Les quelques jours du mois d’août étaient tout ce qu’elle concédait à ses obligations familiales. Le reste de l’année, nous nous téléphonions de temps à autre et il lui arrivait de faire un crochet par Saint-Jacut quand elle se rendait à Rennes en voiture.
Ces liens distendus nous suffisaient et c’est sans doute la raison pour laquelle, aujourd’hui, je n’éprouve pas de véritable chagrin en la voyant si gravement atteinte. Le fossé qui nous sépare existe depuis si longtemps que j’y suis accoutumée.
*
En arrivant chez moi, je note qu’il est encore trop tôt pour appeler Rozenn. Téléphoner tous les soirs à ma fille est une habitude que j’ai prise alors qu’elle faisait ses études à Rennes, et que j’ai gardée, sans vraiment savoir pourquoi.
Les nouvelles que je lui donne de sa grand-mère la laissent de glace et elle me pousse à espacer mes visites.
— Je ne comprends pas pourquoi tu t’imposes cette confrontation quotidienne avec un être qui n’est plus de ce monde. C’est morbide.
Ma fille est quelqu’un d’assez tranché dans ses opinions mais sous ses dehors abrupts, elle a bon cœur et une finesse de jugement indéniable. Voilà pourquoi, malgré quelques coups de gueule sporadiques, nous avons une relation suivie et beaucoup plus intime que celles qu’entretiennent généralement mères et filles.
Une fois débarrassée de mes chaussures et de ma veste, j’allume mon ordinateur afin de consulter ma messagerie. Depuis mon retour de Crète, je reçois un nombre incroyable d’e-mails me demandant des nouvelles d’Hélène. Des inconnus me parlent d’elle, s’inquiètent, me chargent de lui transmettre leurs amitiés ou leurs vœux de prompt rétablissement.
Il y a une quinzaine de jours, face à l’augmentation de ce courrier, j’ai décidé d’y répondre collectivement, en rédigeant deux fois par semaine, un bulletin de santé de ma mère. Rozenn trouve ces communiqués superflus et même inopportuns.
— En admettant qu’elle reprenne conscience, Grand-mère ne redeviendra jamais ce qu’elle était avant. Laisse-la donc sombrer dans l’oubli, c’est le mieux que tu puisses faire pour elle.
Même si je partage ce point de vue, je n’ai pas suivi son avis. Simple question d’éducation… je réponds toujours au courrier que l’on m’adresse.
Comme chaque soir, le nombre de mails concernant ma mère me sidère. Ils arrivent d’un peu partout. La plupart sont rédigés en anglais, les autres en français, mais leur teneur est sensiblement la même.
Ma lecture terminée, j’envoie une réponse type, sur le modèle des précédentes : « L’état de santé d’Hélène Vitorski est stable, sans amélioration ni aggravation notoire. Le pronostic des médecins demeure réservé. » Je termine par une formule de politesse et éteins mon PC. Ensuite, je décachette les deux enveloppes adressées à son nom que j’ai trouvées dans ma boîte aux lettres et les range avec les autres. Je lui remettrai tout ce courrier si, un jour, par miracle, elle revient à elle.
Je m’apprête à écouter mes messages téléphoniques lorsque j’aperçois mon chat, assis sur le balcon.
J’habite le premier étage d’un petit immeuble situé dans un quartier tranquille, à la périphérie de la ville. Juste devant mes fenêtres pousse un très beau tilleul dont une des branches maîtresses est accessible à Éliot. Il en profite pour aller rôder dans les jardins voisins.
J’adore ce tilleul. Son feuillage m’isole de la rue et du regard des voisins. Les oiseaux qu’il abrite et le bruissement du vent dans ses feuilles, compensent largement la lumière qu’il me dérobe. Grâce à lui, je passe la plupart de mes soirées d’été sur mon balcon, immergée dans une enclave de verdure. J’aime tant cet arbre que si, par malheur, il était un jour abattu, je ne le supporterais pas et irais habiter ailleurs.
Après avoir nourri Éliot, je branche mon répondeur téléphonique. Il n’y a qu’une seule communication. Elle provient d’un certain Charles Messier qui se présente comme une vieille connaissance d’Hélène, s’enquiert de sa santé et mentionne la lettre qu’il m’a envoyée, une quinzaine de jours auparavant, et à laquelle je n’ai pas répondu, raison pour laquelle il se permet de me relancer par téléphone. Il espère qu’Hélène est en voie de guérison et ajoute qu’il souhaiterait pouvoir m’accompagner à l’hôpital, afin de lui rendre visite. Il termine en me laissant ses coordonnées.
Je les note dans mon répertoire puis efface le message, bien décidée à ne pas lui donner suite.
Mais il y a dans sa voix quelque chose qui a retenu mon attention, un léger accent que je ne parviens pas à définir, ce qui ne m’arrive pratiquement jamais. En effet, à l’agence de voyages, les coups de téléphone quotidiens avec des étrangers m’ont affiné l’oreille et je peux d’emblée en situer l’origine.
Dans le courant de la soirée, la curiosité finit par l’emporter. Je passe en revue le courrier de ma mère et découvre une lettre qui m’était destinée. Elle est rédigée en allemand et signée Charles Messier. L’écriture est petite et difficile à déchiffrer mais comme je connais assez bien l’allemand et que la lettre ne dépasse pas une page, j’en viens rapidement à bout. Mon correspondant s’excuse d’abord de ne pas s’adresser à moi en français, langue qu’il parle couramment mais dont il ne maîtrise pas la syntaxe. La suite est identique au message téléphonique. Je reste donc sur ma faim, tout en demeurant persuadée que l’accent que j’ai perçu n’était pas purement germanique. Puis je me dis que cela n’a aucune importance et remets la lettre dans le tiroir.
Cet incident me décide pourtant à parler à Rozenn d’une question qui me tracasse depuis quelque temps. Faut-il prévenir Anna ? Ma fille n’est certainement pas la meilleure conseillère en la matière mais, pour ce qui touche à la famille, je n’ai personne d’autre à qui m’adresser.
— Anna ! Pourquoi veux-tu prévenir Anna ?
Au bout du fil, Rozenn semble interloquée. Je réponds que les liens de parenté qui nous unissent justifieraient que…
— Tu parles ! Ça fait des années qu’Anna ne s’est pas inquiétée de nous. Depuis quand n’as-tu pas eu de ses nouvelles ?
— Ce n’est pas une raison. Nous ne sommes pas brouillées et, autrefois, je la considérais comme ma sœur. C’est pourquoi il me semble que… que je devrais peut-être…
— Tu n’as même pas son adresse !
— Si… À vrai dire, j’ai celle qu’elle m’a donnée, la dernière fois que nous nous sommes vues.
— Et ça date de quand ?
— Eh bien… d’une vingtaine d’années, lorsque nous sommes allés à Londres avec ton père consulter un oncologue réputé. Nous en avions profité pour passer à la galerie de Soho où Anna exposait un de ses poulains. Elle nous a reçus à bras ouverts, je dois le dire. Elle semblait si heureuse que nous ayons pris cette initiative…
— Ouais ! Mais ce n’est pas pour ça qu’elle est restée en relation avec toi par la suite !
— C’est vrai et j’en ai été très attristée. Gérald aussi… mais pour une raison plus intéressée. Il pensait à nos carrières de photographes. Anna, avec la position qu’elle occupait dans le milieu de l’art, aurait pu nous donner un coup de pouce. Malheureusement, le pauvre n’a pas eu le temps de…
Rozenn m’interrompt brusquement.
— Tout ça c’est de l’histoire ancienne ! Le fait est qu’Anna n’a jamais manifesté le moindre intérêt pour nous… Est-ce que tu sais par hasard si Grand-mère avait des contacts avec elle ?
— Non ! Elle me l’aurait dit.
— Dans ce cas, laisse tomber !
J’ai beau avoir presque soixante ans et prendre les événements avec un certain détachement, tout ce qui se rapporte à Anna continue à me toucher, comme si le temps n’avait pas passé, comme s’il n’existait aucun intervalle entre notre jeunesse et aujourd’hui. Ce qu’évidemment Rozenn ne peut comprendre.
Au bout du fil, elle me répète d’un ton péremptoire de ne pas essayer de retrouver Anna. Cela ne m’apporterait que chagrin et souci.
La conversation terminée, je demeure indécise, balançant entre le pour et le contre, sans parvenir à me décider.
J’en serais peut-être encore là si, le soir même, Maurice Perez, mon patron, ne m’avait appelée pour me demander d’envisager un prochain retour en Crète car il me restait à tester des hôtels récemment ouverts sur la côte nord.
— Vous n’en aurez que pour une semaine, le temps de finir ce que vous aviez commencé en septembre. Vous passerez dans les hôtels que nous avons répertoriés et me faxerez aussitôt vos appréciations. Nous en avons besoin pour réaliser notre prochain catalogue. Si nous attendons davantage, il sera impossible de combler notre retard.
Je le sais pertinemment. Cela fait des jours que j’y songe sans pouvoir me résoudre à lui en parler, comme si, inconsciemment, je craignais qu’Hélène ne profite de mon absence pour prendre, de son côté, un départ définitif… Je lui réponds donc que je suis d’accord et que je m’envolerai aussitôt que possible pour Héraklion.
*
Dès la descente de l’avion, la lumière, la chaleur, la transparence de l’air s’emparent de moi. Puis il y a les odeurs, le bruit des rues, la voix des gens… Je ne suis pas arrivée à mon hôtel que déjà tout ce que je viens de vivre ces dernières semaines, semble appartenir à un autre monde… un monde en suspens où l’immobilité est la règle et la contemplation de la mort, une contrainte morale.
Mes amis crétois et mes collègues de l’Office du Tourisme m’accueillent comme si je les avais quittés la veille. Par courtoisie, ils me demandent des nouvelles de ma mère puis passent à autre chose. Non par indifférence mais parce que ces Grecs ont gardé un fond de l’antique sagesse qui soumet l’homme à la fatalité. Parler de l’inéluctable ne mène à rien sinon à entretenir le chagrin et assombrir l’existence.
Les jours suivants, je visite une dizaine d’hôtels et établis pour chacun d’eux un dossier que je faxe à mon patron. Mon travail terminé, je décide de passer ma dernière soirée chez mes amis Zarkos, près d’Agios Nikolaos.
En dépit de la nuit qui tombe de bonne heure en octobre, nous mangeons sur la terrasse qui domine le golfe de Mérambélo. La douceur de l’air et les parfums du maquis me donnent une furieuse envie de prolonger mon séjour. Je ne redoute pas de rentrer à Lannion. Inexplicablement, la santé d’Hélène a cessé de m’angoisser. Non ! C’est un pur désir de rester dans ce pays, de rouler sur ces routes bordées de lauriers roses et d’iconostases, d’assister à la cueillette des olives, de me baigner dans l’eau encore tiède de la mer…
Pour me consoler, Georges et Aria Zarkos remettent sur le tapis une question dont nous avons déjà maintes fois débattu :
— Achète-toi une maison ! Tu pourrais y passer une partie de l’année comme le font beaucoup d’Européens du nord. Tu apprécies le climat, tu aimes la mentalité des gens… En outre, je suis certaine que tu ne connais pas la Crète aussi bien que tu le crois. Il te reste plein d’endroits à découvrir, plein de photos à faire.
C’est vrai mais, malgré toute l’amitié que je porte aux Zarkos, je ne dis pas oui.
— Tu as le temps, ajoute Aria. Laisse cette idée mûrir en toi. Si tu dois venir vivre ici, tu viendras…
J’envie ce fatalisme qui permet de prendre la vie comme elle vient, sans se poser de questions inutiles. Moi, je suis tout le contraire. Je déteste être prise au dépourvu et laisse le moins de place possible au hasard. Je gère, je coordonne, je planifie. C’est ma nature, je n’y peux rien sinon parfois soupirer après la bienheureuse insouciance de mes amis grecs.
En revanche, c’est ce trait de caractère qui m’a permis de m’adapter facilement au métier de voyagiste, moi qui n’avais pas été formée pour ça. Combiner, mettre sur pied, préparer les vacances des clients a un côté formel et rassurant qui me convient. Évidemment, les concepts que je manipule ne sont pas d’un niveau intellectuel très élevé. On est loin de la fantaisie imaginative de la photo d’art ou des abstractions vertigineuses de l’astrophysique. Mais ça m’est égal.
Rozenn pense, et ne se prive pas de me le dire, qu’avec ce que je sais et les dons que je possède, j’aurais beaucoup mieux à faire qu’organiser les voyages des autres ! Elle en donne pour preuve les cartons pleins de photos qu’elle conserve jalousement, et les deux albums que nous avons édités, Gérald et moi. Bien sûr, je la comprends… Pourtant, à aucun moment, je n’ai envisagé de revenir en arrière. Je ne lui ai jamais caché qu’à la mort de son père, j’avais dû faire face à d’énormes difficultés morales et financières et que, vu mon inaptitude à travailler en collectivité, j’avais été très heureuse d’accepter l’offre d’emploi que me proposait Maurice Perez. Elle est d’accord mais prétend que, depuis, j’aurais pu trouver quelque chose de plus… quelque chose de moins… enfin une occupation plus gratifiante, culturellement parlant.
Rozenn a encore beaucoup d’illusions sur le monde du travail et sur la créativité personnelle. Il est vrai que j’avais quelques dispositions artistiques et qu’avec Gérald, nous avons réalisé des choses assez extraordinaires, en dépit de notre manque d’argent et de tous les tracas qui en découlaient. Nous avions une telle confiance en nous, un tel feu sacré, que nous finissions par y arriver. Mais à sa mort, mes ambitions comme mes rêves se sont évanouis.
— Un jour, je viendrai certainement habiter en Crète, dis-je aux Zarkos qui fument tranquillement leurs cigarettes turques, dans la pénombre de la terrasse. Je ne sais pas quand, mais je viendrai.
— Pour le moment, tu as d’autres soucis… Rentre chez toi et fais ce que tu as à faire. L’horizon finira par s’éclaircir. Il est toujours vain de vouloir précipiter les événements
Le ciel est obscur et l’on aperçoit, sur l’eau noire de la baie, les feux de position des petits bateaux de pêche qui croisent au large.
— Que pense ta fille de ce projet ? demande Aria.
— Je l’ignore. Je ne lui en ai pas parlé.
Il fait trop sombre pour que je puisse distinguer l’expression de leurs visages. Mais je sais que ma réponse les étonne. Pour eux, un tel silence entre les membres d’une même famille est incompréhensible.
*
En débarquant de l’avion, à l’aéroport de Brest, je décide de rentrer chez moi, sans passer par le centre hospitalier. Ma semaine en Crète m’a comme libérée de l’obligation morale qui me faisait courir chaque jour au chevet de ma mère. J’ai aussi pris conscience qu’en aucun cas, Hélène n’aurait exigé un tel dévouement de ma part.
Dans la soirée, je téléphone à Rozenn qui m’apprend qu’aucun changement ne s’est produit dans l’état de la malade. Puis elle me demande si ça me plairait de passer avec elle le prochain week-end à l’Arcouest.
— Cela nous ferait du bien. On pourrait profiter du jardin et, éventuellement, se baigner…
— On est en octobre !
— Et alors ? Il fait beau et chaud, je suis sûre que l’eau n’a pas encore refroidi… En outre, j’aimerais t’expliquer où en est mon projet de doctorat.
— Ah ! Il se concrétise ?
— Oui, tout à fait !
C’est là une excellente nouvelle. Rozenn est titulaire d’une maîtrise en histoire contemporaine mais comme elle ne veut pas entendre parler d’enseignement, elle a du mal à trouver un emploi correspondant à son niveau de compétence. Si elle veut faire carrière dans le domaine qu’elle a choisi, il lui faut un doctorat. Nous en avons souvent discuté et, aujourd’hui, elle a apparemment franchi le pas.
— Je suis vraiment contente ! Est-ce que tu as déjà un directeur de thèse ?
— Oui, tout est en place. Si je ne t’en ai pas parlé plus tôt, c’est qu’il y avait beaucoup de questions à régler et que je n’étais pas sûre d’y arriver. Mais bon… j’ai obtenu les réponses que je voulais. Je fais ma rentrée à la fac de Rennes, la semaine prochaine.
— Je suis épatée ! Mais tu aurais pu m’en toucher un mot, tout de même !
— Tu avais suffisamment de soucis avec Grand-mère…
Je proteste que cela n’a rien à voir et que, de toute façon, elle passerait toujours avant Hélène. Puis nous convenons de nous retrouver à l’Arcouest, le samedi suivant en début de soirée.
*
Autrefois, quand je débarquais à Ti Coz, avec Gérald et les enfants, Hélène nous cédait sa chambre, au rez-de-chaussée, une grande pièce d’angle dont une fenêtre donnait sur un verger en friche et l’autre, sur la mer que nous apercevions à travers les arbustes plantés au bas de la propriété. Je n’aimais pas cette chambre. Je la trouvais sombre, humide, presque insalubre. Nous nous y installions parce que c’était la seule pièce assez spacieuse pour accueillir un couple et deux jeunes enfants. Gérald et moi dormions dans le grand lit, tandis que Rozenn et Matthieu couchaient sur des lits de camp que nous descendions du grenier.
Dans les années soixante-dix, comme la majorité des maisons de la région, Ti Coz ne possédait aucun confort. Le toit n’était pas isolé et l’huisserie laissait passer le moindre courant d’air. Il n’y avait ni eau chaude ni tout-à-l’égout. L’électricité tombait à tout bout de champ en panne et nous cuisinions sur un antique réchaud à gaz.
Il a fallu attendre 1988 pour qu’Hélène se résolve à entreprendre des travaux de restauration. La fin de sa carrière approchait et elle était décidée à vivre là toute l’année. Elle ne regarda donc pas à la dépense et dota sa maison de toutes les commodités modernes.
Depuis son hospitalisation, j’y suis passée plusieurs fois en coup de vent, afin de prendre des effets dont elle avait besoin. Grâce aux travaux d’assainissement, on n’est plus assailli par l’odeur de moisi dès qu’on pousse la porte. L’air est sec et la lumière entre à flots. Pourtant, jamais je n’ai envie de m’attarder. Comme autrefois, je ne viens ici que par obligation.
Quand les enfants étaient petits, c’étaient les seules vacances à la mer que Gérald et moi étions en mesure de leur offrir. Nos moyens trop limités ne nous permettaient pas d’aller ailleurs. Hélène, toujours aussi égocentrique, ne paraissait s’apercevoir ni de nos difficultés d’argent ni du reste.
Il a fallu attendre que la maladie de Gérald soit devenue flagrante, quelques mois avant sa mort, pour qu’un jour, brutalement, elle en prenne conscience. Elle m’entraîna dans la pièce voisine et me demanda tout à trac de quoi souffrait son gendre. Quand je le lui ai dit, elle m’a regardée d’un air vaguement dégoûté, comme si elle découvrait un phénomène déplaisant dans l’oculaire de son télescope. Puis elle a cillé plusieurs fois, s’est mordu les lèvres, avant de pousser un soupir et de me tourner le dos.
Émotion ou contrariété face aux bouleversements que l’agonie puis le décès de Gérald allaient apporter dans ma vie, et qu’elle craignait de voir se répercuter sur la sienne ? Je l’ignore car nous n’en avons jamais reparlé.
Une chose est sûre, lors de ces lointaines vacances, les enfants eux-mêmes avaient conscience du glacis dont s’entourait leur grand-mère. Ils ne posaient pas de questions et tenaient pour acquis qu’elle n’était pas taillée sur le modèle de celle des autres. Aussi ne mesurèrent-ils pas ce qu’avait d’exceptionnel le geste que fit Hélène, le soir où elle descendit du grenier une vieille valise qu’elle entreprit d’ouvrir devant eux. Cela n’alla pas sans mal et lorsque les serrures cédèrent enfin, elle se redressa et nous annonça que la valise contenait des jouets qui m’appartenaient quand j’étais petite.
— Allez-y, sortez-les ! ordonna-t-elle de sa voix tranchante. Autant qu’ils servent à quelqu’un…
Les enfants ne se décidaient pas et me regardaient, désorientés. Les poupées n’étaient pas des Barbie mais des baigneurs en celluloïd. Les ours en peluche s’appelaient des teddy-bears. La dînette était dépareillée. Les marionnettes et leurs figures de papier mâché avaient un air vieillot qui ne faisait ni rire ni peur.
— Alors, qu’est-ce que vous attendez ? Évidemment, tout ça est un peu démodé. Mais on peut encore s’amuser avec, il me semble !
Voulant éviter un drame, pour une fois qu’Hélène tentait un pas vers ses petits-enfants, je me penchai sur la valise et entrepris de la vider. Montèrent alors en moi des souvenirs que je croyais effacés depuis longtemps. Je revis la chambre que je partageais avec Anna, le dessin du tapis et des couvre-lits, notre coffre à jouets, les berceaux de nos poupées… ces poupées que Rozenn considérait d’un air dégoûté.
Matthieu, le premier, oublia ses réticences en découvrant un jeu de croquet avec maillets, boules et arceaux de différentes couleurs. Puis Rozenn se dérida à son tour devant une cuisinière miniature qui fonctionnait grâce à des bougies pour chauffe-plats.
Accoudée au coin de la table, le menton dans une main, Hélène nous considérait d’un œil pensif. Lorsque Matthieu demanda pourquoi il n’y avait ni legos ni jeux vidéo, elle répondit laconiquement qu’à son époque, ça n’existait pas. Cette explication dut leur suffire car ils poursuivirent l’inventaire sans mot dire.
Quand la valise fut vide, la curiosité qu’elle avait suscitée retomba rapidement. Il était presque dix heures du soir et les enfants, fatigués, se laissèrent emmener au lit sans protester. Lorsque je revins au salon, Hélène avait disparu.
Je me suis assise par terre et j’ai inspecté minutieusement chacun des jouets. Je me retrouvais dans ma chambre, avec Anna. Je me rappelais nos disputes et les moments magiques que nous avions vécus ensemble. Bientôt, j’ai senti sa présence à mes côtés, j’avais l’impression qu’elle contemplait ces reliques avec la même nostalgie que la mienne. Et soudain, cela déclencha en moi des sanglots muets qui me ravagèrent l’âme.
Tard dans la soirée, quand j’émergeai enfin du passé, je mis à part le croquet, la petite cuisinière et les jeux d’extérieur, puis j’enfermai le reste dans la valise que je déposai dans ma chambre, sous mon lit. Quelques jours après, je la remontai au grenier et la cachai derrière un tas de cartons.
Je ne l’ai jamais rouverte depuis.
*
Le samedi suivant, en arrivant à Ti Coz, à la nuit tombée, je vois la maison allumée, le portail ouvert et la Peugeot de Rozenn garée dans l’allée.
— Comment va Grand-mère ? me demande ma fille en sortant sur le pas de la porte.
— Je l’ai vue hier. Toujours pareil.
— Et toi ?
— Ça peut aller… mais je suis épuisée.
— Viens t’asseoir, j’ai débouché une bouteille de Médoc. Je l’ai goûté, il se laisse boire.
Rozenn connaît ma prédilection pour les bordeaux un peu costauds.
J’en avale une gorgée, mange quelques noix fraîches préparées dans un bol, tout en humant le fumet du ragoût de mouton qui mitonne sur la cuisinière.
— Excuse mon retard, j’aurais voulu être là plus tôt. Mais des clients sérieux se sont présentés à l’agence, au moment où j’allais fermer. Et tu sais comme moi qu’une bonne affaire ne se reporte pas.
Nous échangeons un sourire de connivence puis elle me demande ce que devient son frère.
— L’entreprise où il travaille est en pleine extension. Son patron envisage d’ouvrir une succursale en Afrique du Sud. Matthieu pourrait y être nommé à un poste de responsabilité.
— Il mène bien sa carrière. S’il continue, il sera peut-être le premier de la famille à devenir millionnaire !
Rozenn soulève le couvercle de la cocotte, touille un peu puis se retourne.
— Avant ton arrivée, j’ai fait le tour de la maison. C’est vraiment affligeant ! Quand je pense à la notoriété de Grand-mère, à sa réussite professionnelle, je n’arrive pas à comprendre qu’elle puisse se contenter d’une baraque aussi mal fichue ! Ces meubles hideux, cette déco minable… Regarde-moi la cuisine ! C’est le règne du plastique, du linoléum et du formica ! Elle avait pourtant les moyens de se payer quelque chose de mieux !
— Certainement ! Seulement, elle a toujours été insensible à ce qui l’entoure. Une fois les rénovations terminées, elle a dû entrer dans le premier magasin de meubles venu, choisir tambour battant ce dont elle avait besoin… qualité convenable, prix raisonnable, livraison immédiate. Puis elle a pensé à autre chose. C’est ainsi qu’elle a toujours fonctionné.
Un quart d’heure plus tard, nous passons à table. Le haricot de mouton s’avère excellent et j’en fais compliment à Rozenn. Tout en mangeant, nous bavardons de choses et d’autres, puis nous parlons de sa thèse de doctorat.
— Quand j’ai soumis mon projet de recherche au professeur Jean Gauchy, il a tout de suite été d’accord pour être mon directeur de thèse, me dit-elle un sourire au fond des yeux. J’avoue que je ne m’y attendais pas. Il est très sollicité et ça fait cinq ans que je n’ai pas mis les pieds à la fac.
— Tu as dû lui laisser un bon souvenir ! Tu avais des notes brillantes…
— D’accord, mais je n’étais pas la seule. J’ai entendu dire qu’il avait refusé plusieurs candidatures de doctorants. Je me demande pourquoi il a retenu la mienne.
— Ne te pose pas tant de questions ! dis-je en remplissant nos verres. Si Gauchy te prend comme thésarde, c’est qu’il trouve ton sujet intéressant et qu’il a confiance en ton potentiel de travail. Ne cherche pas plus loin.
Rozenn hoche la tête puis nous quittons la cuisine, la bouteille et les verres à la main, pour aller nous installer dans le salon.
À la décharge d’Hélène, il faut reconnaître qu’en dépit de leur laideur, le canapé et les fauteuils sont très confortables. Et si le lampadaire au pied torsadé et à l’abat-jour de mousseline rose est une horreur, il dispense une lumière douce, propice aux confidences.
Ma mère déteste la cigarette et interdit formellement qu’on fume chez elle. Malgré ça, j’en allume une et Rozenn m’imite en disant que ce n’est pas demain que sa grand-mère réintégrera les lieux et que d’ici là, les relents de fumée se seront dissipés. Par une association d’idées assez cynique, je déclare alors que le jour où j’en hériterai, je vendrai sans regret cette baraque et diviserai le capital en trois parts égales.
— Vu la flambée des prix dans l’immobilier, moche ou pas, Ti Coz rapportera un joli paquet de fric !