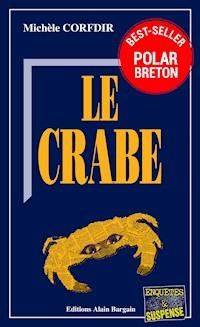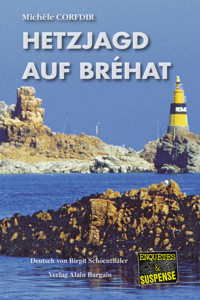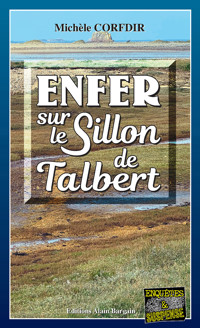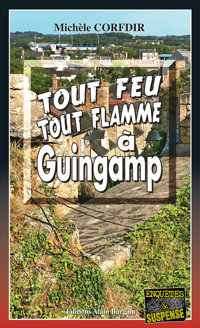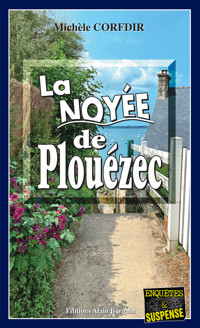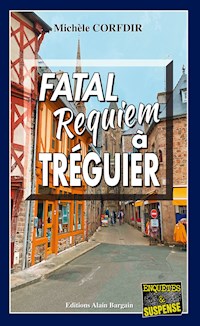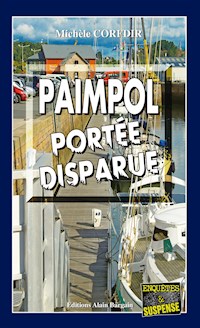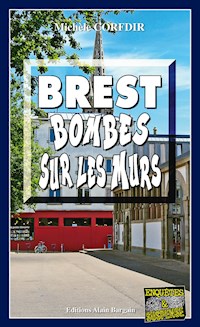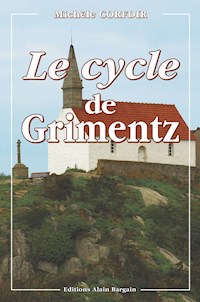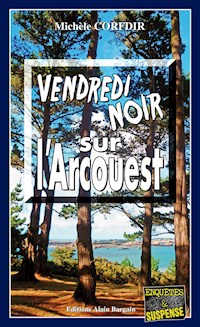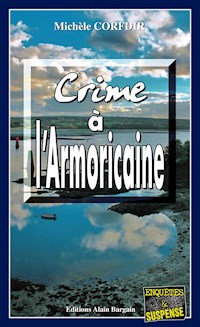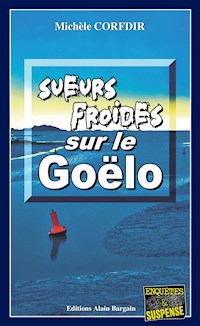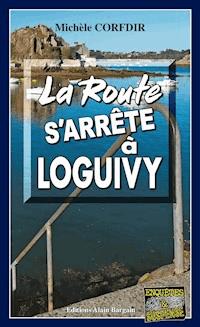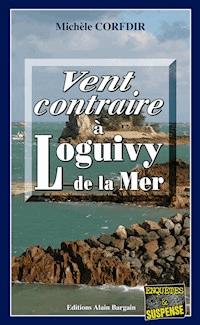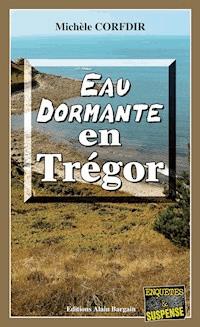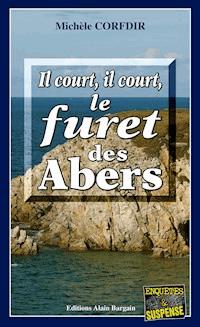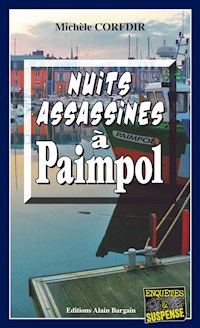
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Atmosphère de terreur en Bretagne
Paimpol, la nuit, l’hiver… et des enfants victimes de farces sinistres, de harcèlement, d’agressions. L’angoisse plane sur la ville. Qui s’amuse à ces jeux cruels ?
« Deux cas de figure se présentent à nous, déclare le criminologue consulté. Ou il s’agit d’un individu qui prend un plaisir sadique à terroriser des gamins, et qui s’en tiendra là. Ou c’est un pervers beaucoup plus dangereux, pour qui cette campagne d’épouvante n’est qu’un début. Bientôt, cela ne lui suffira plus. Sa violence s’intensifiera, pouvant le conduire jusqu’au meurtre. »
Le doute n’est plus permis quand on retrouve le corps d’une fillette noyée dans un étang.
Le capitaine Janvier et son équipe enquêtent tous azimuts, mais c’est sur une piste insoupçonnée que le hasard – et l’intuition d’un vieil homme – vont les entraîner et les amener à découvrir la vérité.
Une vérité odieuse, inattendue, dramatique.
Plongez en plein cœur de ce thriller angoissant qui plaira aux amateurs du genre !
EXTRAIT
Au haut de l’avenue, il traversa le bois et déboucha sur le parking du lycée. Là, il effectua une série de sautillements et quelques exercices de gymnastique puis, retrouvant sa foulée de jogger, il quitta le parc par l’entrée principale et prit le chemin du retour. Il ne se sentait absolument pas fatigué et aurait pu facilement doubler la longueur de la course. Il en avait envie mais ne le ferait pas. Il savait doser son effort et respecter la règle.
Aujourd’hui, c’était un jogging ordinaire, un itinéraire de semaine.
Combien de pas avait-il fait ? Combien de fois avait-il aplati, sous les semelles de ses baskets, ses pensées misérables, et noyé ses angoisses dans l’eau sale des trottoirs ?
Il n’avait pas compté. Il savait seulement que cette méthode n’était qu’un pis-aller et qu’elle ne mènerait à rien. Courir pour écraser ne durerait qu’un temps.
Un jour, il saurait déchiffrer les desseins obscurs de la fatalité. Quand ? Il l’ignorait. Tout à l’heure ou dans mille ans…En attendant, il ne pouvait que courir.
Et il courrait ainsi jusqu’au grand déclenchement.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Editions Bargain, le succès du polar breton. –
Ouest France
À PROPOS DE L'AUTEUR
Michèle Corfdir est née et a grandi en Suisse. Elle y a fait ses études et a enseigné quelques années dans le Jura et à Bienne. Elle a publié alors un recueil de poèmes couronné par le Prix des Poètes Suisses de Langue Française, ainsi que des contes pour enfants qui obtiennent le prix de l'Office Suisse de la Lecture pour la Jeunesse. Après son mariage avec un marin pêcheur breton, elle s'établit à Loguivy de la Mer. Elle collabore comme nouvelliste à diverses revues et met sa plume au service des marins pêcheurs, au cours de la crise qu'a connue cette profession au début des années 90. En 1998, elle publie aux Éditions Alain Bargain, son premier roman,
Le Crabe, un thriller maritime très bien accueilli tant par la critique que par le public. Face à ce succès, elle édite d'autres ouvrages dans la collection Enquêtes et Suspense.
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -
Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près, ni de loin, avec la réalité, et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
I
Vendredi soir 5 février
Il courait. Courait. Courait.
Le capuchon rabattu sur le front. Les mains repliées dans les manches de son coupe-vent.
Les bandes fluorescentes de ses baskets et de son pantalon réfléchissaient la lumière des réverbères.
Flaques d’eau, pavés mouillés, éclaboussures scintillantes au passage des voitures.
Il courait dans la nuit, le froid, la bruine.
Traversait le rond-point du Champ de Foire. Débouchait sur le port. Croisait deux autres joggers qui lui firent un signe de la main auquel il ne répondit pas. Attentif à garder un rythme régulier, il longea les quais. Sur sa gauche, en contrebas, les bateaux de plaisance s’alignaient comme des chevaux à l’écurie. Certains avaient leurs hublots éclairés. Il savait que ceux-là servaient d’habitation. Lui n’aurait pas pu vivre dans un lieu aussi étroit. Il avait trop besoin d’air, d’espace, d’ouverture.
Parvenu au fond du port, il vira à droite selon l’itinéraire qu’il s’était fixé pour ce soir. La place du Martray était déserte. Les gens regardaient les infos de vingt heures à la télé. Personne ne lui jeta de coups d’œil réprobateurs parce qu’il fallait être un peu fou pour courir sous la pluie, un soir de février, alors qu’il faisait si bon chez soi. Mais lui n’avait rien de commun avec ces gens-là.
Au moment où il quittait la place, son pied droit buta contre une aspérité de la chaussée. Une bouffée de rage lui monta à la gorge. Saloperie de pavés ! Mais il se reprit, respira un grand coup et retrouva sa foulée régulière. La rue de l’Église était bordée de vitrines illuminées, boutiques de fringues et de souvenirs sans intérêt. Il aurait préféré prendre la rue des Huit Patriotes où il pouvait lorgner l’intérieur des maisons par les fenêtres du rez-de-chaussée. Minuscules scènes de théâtre, tableautins vieillots dans lesquels il avait envie de s’introduire pour disparaître parmi les objets désuets qui s’y entassaient.
Mais ce soir, son circuit n’allait pas par là.
Ce soir, il monterait à Kerraoul, suivrait l’orée du bois, passerait à proximité de la piscine. Pas trop près car il n’aimait pas voir les corps presque nus derrière les baies vitrées. Et il détestait le turquoise criard des bassins qui leur bleuissait la peau, bouillie bordelaise sur des fruits trop mûrs.
Arrivé au rond-point de la rue Bécot, il aperçut l’église dont la flèche se perdait dans la brume. Il longeait la mairie lorsque carillonna huit heures. Le son de ces cloches l’accompagna jusqu’à l’avenue qui menait à Kerraoul. La pente l’obligea à se concentrer sur son rythme respiratoire. Il n’entendait plus que son souffle et ses baskets qui clapotaient sur le trottoir détrempé.
À la belle saison, les joggers étaient nombreux dans ce quartier. Ça courait partout, à toutes les allures et dans toutes les tenues. On se saluait de la main, on échangeait même quelques mots mais sans jamais s’arrêter. Garder la cadence était une règle que personne n’enfreignait. Parce qu’ici on courait pour se faire du bien, garder la forme, éliminer les toxines.
Pas comme lui.
Lui, ce qu’il voulait, c’était se vider la tête. Dépasser la fatigue physique et atteindre cette contraction de la conscience qui permet de penser à tout, sans penser à rien.
Au haut de l’avenue, il traversa le bois et déboucha sur le parking du lycée. Là, il effectua une série de sautillements et quelques exercices de gymnastique puis, retrouvant sa foulée de jogger, il quitta le parc par l’entrée principale et prit le chemin du retour.
Il ne se sentait absolument pas fatigué et aurait pu facilement doubler la longueur de la course. Il en avait envie mais ne le ferait pas. Il savait doser son effort et respecter la règle.
Aujourd’hui, c’était un jogging ordinaire, un itinéraire de semaine.
Combien de pas avait-il fait ? Combien de fois avait-il aplati, sous les semelles de ses baskets, ses pensées misérables, et noyé ses angoisses dans l’eau sale des trottoirs ?
Il n’avait pas compté. Il savait seulement que cette méthode n’était qu’un pis-aller et qu’elle ne mènerait à rien. Courir pour écraser ne durerait qu’un temps.
Un jour, il saurait déchiffrer les desseins obscurs de la fatalité. Quand ? Il l’ignorait. Tout à l’heure ou dans mille ans… En attendant, il ne pouvait que courir.
Et il courrait ainsi jusqu’au grand déclenchement.
*
Lorsqu’elles quittèrent Musica Nostra, l’école de musique privée qu’elles fréquentaient, Catherine Moreau et Violette David étaient furieuses. La répétition d’orchestre s’était une fois de plus prolongée au-delà de vingt heures, malgré la promesse faite par Régis Landry de respecter les horaires fixés.
Mais quand il se trouvait sur son estrade, la baguette à la main et la tête dans la musique, leur directeur oubliait tout. Les élèves avaient beau lever le doigt et désigner ostensiblement leur montre, il faisait celui qui ne voyait rien. Ce soir, Catherine avait carrément quitté sa chaise et déclaré que son train partait à vingt heures trente-cinq et que c’était le dernier de la journée. Elle était désolée mais elle devait s’en aller. Régis Landry avait affiché un air exaspéré mais néanmoins levé la séance. Les adolescentes ne s’attardèrent pas devant l’école car le temps pressait. Violette rabattit le capuchon de son k-way sur son front, Catherine ouvrit un parapluie et toutes deux affrontèrent la bruine glacée qui montait de la mer.
Après avoir quitté la rue du Ponant où se situait l’école de musique, elles traversèrent l’ancien champ de foire et prirent la direction de la gare.
— Mon coupe-vent est déjà transpercé, je sens l’eau sur mes épaules, gémit Violette.
— Viens sous mon parapluie, tu seras mieux abritée.
Les deux filles marchaient vite en essayant d’éviter les flaques. Elles croisèrent de rares passants en cirés jaunes ou noirs qui se hâtaient sous la pluie.
— J’espère que je ne vais pas louper la dernière micheline, fit Catherine en consultant sa montre.
— Tu viendrais dormir chez moi, ça ne serait pas la première fois, répondit Violette en s’efforçant d’accorder son pas à la longue foulée de son amie.
Elle était aussi menue que celle-ci était grande. Pourtant, elles avaient le même âge, allaient en classe ensemble et appartenaient l’une comme l’autre à l’orchestre de Musica Nostra. Catherine jouait de la flûte et Violette du hautbois.
— La répète n’a pas très bien marché ce soir, Régis n’avait pas l’air content.
— Mmm…
— Tu crois que nous serons au point pour le concert ?
— Va savoir… Avec la bande de morveux qu’on nous impose, comment veux-tu qu’on s’en sorte ?
— Oh ! Ça ira, comme les autres fois.
— Je n’en suis pas sûre. Tous les grands de l’année dernière ont quitté l’école. Maintenant, on ne peut compter que sur nous-mêmes.
— Il y a Aubin Welt. Comme violoniste, il est vraiment excellent.
— Ah oui ! L’enfant prodige… Ce qu’il peut m’agacer celui-là ! s’exclama Catherine.
— Pourquoi ? Il est gentil et il travaille beaucoup.
— Possible, mais il m’énerve quand même avec son allure de petit Mozart. Je me demande s’il portera une perruque poudrée et une jaquette en velours, au concert…
— Tu es injuste.
— Oui, peut-être…
— En plus, il n’est pas gâté. Il paraît que chez lui, on lui mène la vie dure.
— Voilà qui complète le personnage ! fit Catherine avec une mauvaise foi si évidente que Violette n’insista pas.
Elles descendirent en silence la rue de la Marne jusqu’au carrefour où leurs chemins se séparaient. Elles se souhaitèrent un bon week-end et Catherine prit la direction de la gare. Violette la regarda s’éloigner. De dos, avec ses longues jambes et son allure décidée, elle ressemblait plus à une jeune femme qu’à une collégienne d’à peine seize ans. Violette en soupira d’envie. Quand se mettrait-elle enfin à grandir et à prendre des formes, elle aussi ? En classe, elle avait toujours été la plus petite, celle à qui on ne donnait pas son âge. Personne ne devinait combien elle en avait assez d’être traitée comme une demi-portion, de porter des vêtements taille douze ans et de lever la tête quand elle parlait aux autres.
Lorsque Catherine eut disparu parmi les voitures stationnées devant la gare, Violette quitta l’abri du auvent et prit le chemin de Penvern où elle habitait avec sa mère. La tête rentrée dans les épaules, son capuchon rabattu jusqu’aux yeux, elle traversa le passage à niveau puis tourna à droite. Au bout de quelques minutes, elle coupa la route en diagonale, sans voir la voiture qui surgissait du rond-point et fonçait sur elle. Heurtée de plein fouet, elle fut brutalement projetée à plusieurs mètres et alla retomber contre le bord du trottoir.
Elle eut le temps de voir le véhicule déraper sur le bitume mouillé. L’image de deux feux rouges s’imprima sur sa rétine. Puis ce fut le néant.
*
Aubin Welt, l’étui de son violon calé entre ses épaules, pédalait sous la pluie. C’était assez inconfortable malgré le harnais qu’il avait bricolé à l’aide d’un morceau de corde, pour empêcher cette grosse boîte de bringuebaler dans les virages. Pourtant, il aimait mieux ça que d’aller à pied. Plus de six kilomètres séparaient l’école de musique de sa maison. Une bonne heure de marche ou vingt minutes à vélo… Le choix était vite fait, il préférait pédaler. Même en hiver.
Surtout en hiver.
Aubin ne l’avait avoué à personne mais il détestait le dernier tronçon du trajet, quand la petite route s’enfonçait dans les bois de Beauport. À bicyclette, il avait l’avantage de la vitesse pour échapper à un agresseur éventuel. Non pas qu’il ait été attaqué ni même véritablement menacé… pas plus qu’il n’avait entendu parler de rôdeurs, de chiens errants ou quoi que ce soit qui aurait pu le mettre en danger. Mais, à partir de son embranchement avec la départementale, le chemin devenait désert, étroit et pas du tout éclairé. D’abord, il descendait vers l’étang du Danet et côtoyait des maisons isolées. Jusque-là, ça allait. C’est ensuite que les choses se gâtaient, lorsqu’il entrait dans la forêt qui était noire et touffue, avec des troncs énormes, des branchages qui bouchaient le ciel et du vent qui sifflait en faisant craquer les arbres morts.
À en croire ses parents, le chemin qui menait à leur maison de Traou Du ne présentait aucun risque, en tout cas beaucoup moins que la grand-route où des fous du volant ne voient pas les cyclistes, leur brûlent la priorité ou les fauchent en les doublant.
Aubin ne mettait pas leur parole en doute. Pourtant, quand il pénétrait dans le bois, il pesait de toutes ses forces sur les pédales en s’efforçant de ne pas voir les ombres qui bougeaient derrière les buissons ni entendre les bruits bizarres qui montaient des ravins.
Ce soir, il était tard et il pleuvait. La répétition d’orchestre s’était prolongée à cause du concert qui avait lieu dans une semaine et parce que personne n’était vraiment au point. Régis Landry avait dit qu’on allait droit à la catastrophe, il avait ajouté que seul Aubin, le premier violon, connaissait sa partition sur le bout du doigt et que les autres feraient bien d’en prendre de la graine.
Les mains crispées sur son guidon, le dos meurtri par les à-coups de son étui à violon, Aubin s’enfonçait dans la forêt. Les yeux braqués droit devant lui, il guettait la lumière de la lampe extérieure que sa mère laissait allumée au-dessus de l’entrée. Pour lui, elle était comme un phare dans la tempête. Lorsque son regard la captait, il ne la lâchait plus d’ici qu’il mette pied à terre, devant la porte.
Mais hélas, il n’y était pas encore. Bientôt, le chemin se resserrerait, ferait quelques virages avant de traverser la sapinière plus sombre que tout le reste et qu’il redoutait, même en été.
La pluie redoublait, le vélo tressautait sur les cailloux. Une odeur de résine se mit à flotter dans l’obscurité. La sapinière approchait. La lanterne éclaira soudain des troncs alignés et le sous-bois noir et nu.
C’est alors que la chouette ulula. Aubin qui connaissait la nature, savait qu’on l’entendait dès le début février. Sa mère disait que c’était là le premier signe de la fin de l’hiver. Il poussa sur les pédales, les sapins défilèrent, la chouette ulula à nouveau. Tout près. Puis ce fut un oiseau qui se mit à siffler. Un merle, un pinson… Aubin n’identifiait pas le chant des passereaux, seulement il était sûr qu’ils ne gazouillaient jamais durant la nuit ni pendant l’hiver. Ce n’était pas normal ! Sa respiration s’accéléra, la peur lui tordit l’estomac, mais il ne pouvait pas rouler plus vite, ses jambes donnaient leur maximum.
Ce n’était pas la première fois qu’il entendait de drôles de bruits dans la nuit. Il en avait parlé à ses parents. Comme il s’y attendait, son père l’avait traité de trouillard et sa mère lui avait dit de ne pas laisser déborder son imagination.
Il y eut un troisième ululement, suivi aussitôt par les trilles et les roulades du merle. Durant un bref instant, Aubin crut même reconnaître les notes d’un morceau qu’il jouait au violon. « Ce n’est pas possible, pas naturel », eut-il le temps de penser, affolé. Puis son guidon lui échappa des mains et tourna brutalement à angle droit. Perdant l’équilibre, il passa par-dessus son vélo et atterrit dans la boue tandis que son étui à violon lui percutait violemment l’arrière du crâne.
Ce fut alors une cacophonie de cris et de sifflements aigus, de battements d’ailes et de plaintes horribles. Une volée d’oiseaux nocturnes jaillit de l’obscurité. Des tombereaux de plumes s’éparpillèrent en neige éblouissante, puis retombèrent mollement, rémiges et duvets ensanglantés, sur le châssis tordu d’une bicyclette dont la roue tournait, tournait sans fin dans le noir de la nuit.
*
Pour Martial Legrand, l’éloignement n’était pas un problème. Il habitait sur les hauteurs de Kerraoul et il mettait à peine dix minutes à pied pour rentrer chez lui, un peu plus s’il faisait un crochet par l’ancien cimetière de Lanvignec. C’était un endroit où il aimait bien aller s’amuser avec ses petites voitures. Les dalles de marbre qui recouvraient certaines tombes étaient idéales pour y propulser ses bolides. Et personne ne venait le déranger ou lui faire remarquer qu’un cimetière n’était pas un terrain de jeu.
Mais ça, c’était avant… Avant qu’il ne rencontre le type. Depuis, plus jamais il ne franchissait le muret qui barrait l’entrée du cimetière. Et quand il passait à proximité, il pressait le pas. L’idée de croiser à nouveau cet homme lui glaçait les os. Pourtant, celui-ci ne lui avait pas fait de mal. Il ne l’avait pas menacé ni engueulé, ni fait des gestes cochons. Il avait surgi sans bruit derrière lui alors qu’il était accroupi devant une tombe, une voiture à la main, et l’avait empoigné par la nuque. « Eh bien, mon garçon, c’est à ça que tu t’amuses ? »
Martial s’était retourné, vif comme un chat, et s’était retrouvé face à un type qui portait des lunettes noires, un bonnet enfoncé jusqu’aux sourcils et une écharpe qui lui cachait le bas du visage. Il était un peu tassé sur lui-même, les bras écartés comme un piège prêt à se refermer. Martial avait eu un mouvement de recul et était tombé assis sur le bord de la dalle. Soufflant comme un phoque, l’homme s’était penché vers lui. « J’ai envie de faire une partie avec toi… »
Martial n’avait pas compris. L’homme avait alors tendu la main vers la petite Porsche rouge. « Prêtelamoi ! Tu en as bien une autre… » L’autre, une Jaguar argentée, Martial la sentait coincée sous sa fesse droite. Il l’en extirpa et la lui montra. « Parfait ! En piste ! On va voir laquelle est la plus rapide ! » Il s’était baissé et avait donné le départ.
La Porsche avait gagné mais le type n’avait pas eu l’air content. « Tu peux faire mieux. On recommence ! »
Et l’épreuve avait duré, duré… Le bras douloureux à force de catapulter sa Jaguar, Martial priait le ciel pour qu’un passant entre dans le cimetière. Mais il était tard, le jour diminuait et personne n’était venu déambuler parmi les tombes. Alors il avait pris soudain son courage à deux mains et lancé : « Il faut que je rentre, ma mère va s’inquiéter. » L’homme avait secoué la tête. « Tu n’as pas gagné une seule course ! »
Mais déjà Martial s’était relevé. « Je m’en fiche ! » Et il était parti comme une fusée. Il avait couru d’une traite jusqu’à sa maison, avec, au creux du ventre, une crampe qui lui tordait les boyaux, et dans la tête, l’impression d’avoir échappé de justesse à un horrible danger.
Depuis, il ne se sentait plus en sécurité quand il rentrait chez lui, le soir. Il était sûr que quelqu’un le suivait. Il lui arrivait d’entendre des bruits bizarres derrière les haies, une voix confuse qui gémissait ou qui murmurait son nom. « Martial… Martial… » Il y avait des ricanements, des craquements dans les feuilles mortes, des grognements, des sifflements d’oiseaux qu’il ne connaissait pas. Il avait beau jeter des coups d’œil à gauche et à droite, regarder par-dessus son épaule, il ne voyait jamais personne… sauf dans ses cauchemars. Et ceux-ci étaient si affreux qu’il se réveillait en criant et en pleurant dans son oreiller.
Mais ce soir, ce n’était pas la peur qui faisait courir Martial sous la pluie, son étui à violon à la main.
Ce soir, il y avait le match de foot France-Brésil à la télévision. Et il allait en louper une partie à cause de cette connerie de répétition d’orchestre qui s’était éternisée !
Il aimait bien Régis Landry, sauf quand celui-ci prenait des libertés avec l’horaire. Sa mère trouvait, au contraire, cela admirable. « Quelle chance d’avoir un professeur aussi désintéressé qui ne ménage ni sa patience ni son temps ! Le moins que tu puisses faire est de travailler à fond tes partitions ! » Il ne la contrariait pas mais, en fait, il laissait ça à son copain Aubin qui, lui, était vraiment doué. La musique, il adorait… Il n’aimait même que ça et ambitionnait de devenir violoniste professionnel. Martial, quant à lui, préférait de beaucoup sa collection de petites voitures et le football.
En arrivant à la maison, il découvrit avec plaisir que son couvert était dressé sur la table du séjour et qu’il pourrait manger tout en regardant le match.
— Tu n’as rien perdu, lui dit son père, assis sur le canapé, une canette de bière à la main. Zéro à zéro… et il faudrait que les Français se décarcassent un peu plus s’ils veulent espérer marquer !
Sans quitter l’écran des yeux, Martial s’assit devant un plat de spaghettis à la sauce tomate qu’il engloutit en les aspirant directement de l’assiette à la bouche, avec un bruit de succion absolument répugnant. Il terminait son repas lorsque, contre toute attente, un avant français envoya le ballon dans le but adverse. Faisant écho aux vociférations du public, son père se renversa en arrière et poussa un rugissement homérique. Martial courut s’asseoir à côté de lui. Vu la tournure que prenait la rencontre, il ne s’agissait pas d’en perdre une miette. La France menait, plus rien ne comptait, en dehors des joueurs bleus et jaunes qui galopaient d’un bout à l’autre de l’immense rectangle vert.
— Martial !
Collé contre son père, le garçon ne bougea pas.
— Martial, je te parle !
Tous deux se retournèrent, outrés qu’on osât interrompre le spectacle à un moment pareil.
— Baissez le son deux minutes ! Merci… Martial, est-ce qu’Aubin Welt était à la répétition de ce soir ?
— Oui, forcément.
— Tu l’as vu s’en aller ?
— Oui, sur son vélo. Même que, par ce temps, je n’aurais pas aimé être à sa place. Pourquoi tu me demandes ça ?
— Sa mère vient de téléphoner. Il n’est pas rentré chez lui. Elle espérait qu’il se trouvait ici.
— Qu’est-ce qu’il serait venu faire chez nous, surtout si tard ?
— C’est aussi ce que j’ai pensé mais je ne l’ai pas dit. La pauvre avait l’air si inquiète.
— Elle aurait mieux fait de venir le prendre à l’école en voiture, au lieu de le laisser rouler sous la pluie…
— Oui, évidemment. C’est ce que j’aurais fait à sa place. Mais tout le monde n’est pas comme moi. Espérons seulement que rien de grave ne lui soit arrivé.
II
Samedi 6 février
Régis Landry, le directeur de l’école de musique, n’était pas au mieux de sa forme, il le sentit dès qu’il ouvrit les yeux. Un mal de tête diffus, une vague envie de vomir et des courbatures dans les jambes… Il se retourna sous la couette. Un peu de sommeil supplémentaire le remettrait peut-être d’aplomb. Il ferma les paupières et s’efforça de ne penser à rien, ce qui s’avéra bien entendu impossible. Une foule d’images disparates allaient et venaient dans sa tête, entraînant avec elles toutes sortes d’idées auxquelles son esprit s’accrochait, ce qui rompait sa somnolence et le faisait émerger dans le clair-obscur de la chambre. Après plusieurs tentatives infructueuses, Régis décida de se lever.
En ouvrant les volets, il vit que le soleil avait chassé la pluie de la veille, ce qui ne l’étonna pas. Ici, sur la côte, le temps changeait sans cesse. Une saute de vent amenait un grain ou une embellie, un banc de brume ou un coin de ciel bleu. Comme la plupart des gens, Régis sortait rarement de chez lui sans un k-way et il écoutait la météo trois fois par jour. Graziella disait qu’il exagérait et que ce souci quasi obsessionnel du temps qu’il ferait ne lui ressemblait pas. Régis haussait les épaules et rétorquait qu’avec l’âge, on prend de nouvelles habitudes.
Il est vrai que, tout au long de sa carrière de concertiste, le ciel aurait pu lui tomber sur la tête qu’il ne s’en serait pas aperçu. Mais depuis qu’il s’était établi à Paimpol, il avait appris à observer la nature, les couleurs des nuages, l’orientation du vent, le déroulement des saisons… Et au début, il avait ressenti cela comme un véritable luxe.
Dès sa plus tendre enfance, il n’avait vécu que pour le violon et passé son adolescence à travailler chaque jour des heures durant, afin de réussir là où tant d’autres échouaient. Auditions, examens, concours… La compétition était féroce, les verdicts sans appel, les échecs définitifs. Et lorsqu’il avait enfin atteint le niveau d’excellence exigé pour intégrer une formation orchestrale, il avait fallu répéter, jouer, enregistrer, travailler encore et encore.
La bulle avait éclaté douze ans auparavant quand il avait décrété que c’en était assez et qu’il voulait vivre autrement.
Sa démission avait stupéfié ses collègues de l’orchestre et déconcerté les sponsors qui lui en demandèrent la raison. Il n’en donna aucune car il ne pouvait décemment invoquer la monotonie et la stabilité dans un milieu professionnel où la sécurité de l’emploi fait figure d’utopie.
La conscience aiguë d’avoir manqué, durant toutes ces années, quelque chose d’essentiel, lui avait ouvert les yeux. Il s’était mis à contempler ce qui l’entourait… Et, un jour, il avait vu Graziella. Graziella debout derrière son éventaire, dans une foire à la brocante, et qui le regardait venir, un grand sourire aux lèvres.
Depuis, ils ne s’étaient plus quittés.
Ils s’étaient installés à Paimpol. Graziella avait continué son métier de brocanteuse et lui, il avait ouvert une école de musique privée qu’il avait appelée Musica Nostra. Ni l’un ni l’autre n’avaient jamais regretté le brusque tournant qu’ils avaient donné à leur vie.
Assis devant son petit-déjeuner, Régis se sentait mieux. Avoir la maison pour lui tout seul était quelque chose qu’il aimait bien. Graziella était absente depuis deux jours et ne rentrerait qu’en fin d’après-midi. Là, elle en aurait encore pour une bonne heure à mettre de l’ordre dans son stock et à faire ses comptes. Cela se passerait dans le garage aménagé en atelier et local de rangement. Régis n’y mettait presque jamais les pieds, pas plus que Graziella ne montait dans les combles qu’il avait insonorisés et transformés en salle de musique. L’un et l’autre savaient qu’une vie à deux n’est supportable qu’à condition d’avoir chacun son domaine réservé, et qu’une trop grande promiscuité tue l’amour plus vite et plus sûrement que toute autre chose.
Et ce qui valait pour l’espace, l’était aussi pour le temps. En fait, ils ne vivaient que peu d’heures ensemble. La semaine, Régis passait ses journées à l’école de musique, rentrant rarement avant vingt heures, alors que Graziella travaillait dans son atelier où elle restaurait les objets abîmés, dénaturés ou simplement crasseux qu’elle avait achetés. Le week-end, elle allait dresser son stand dans les vide-greniers et les marchés aux puces de la région, tandis que lui se cantonnait à la maison.
Une fois son petit-déjeuner avalé, Régis monta à la salle de musique. La lumière y entrait par de larges Vélux situés trop haut pour qu’on voie autre chose que le ciel. Régis trouvait que la musique méritait cet isolement, cette coupure avec le monde et ses contingences. Il s’assit dans son fauteuil et décida d’écouter l’enregistrement de la Petite Musique de Nuit de Mozart qu’il avait effectué la veille à l’école, au cours de la répétition. La version pour orchestre baroque de l’œuvre n’était pas celle qu’il préférait, loin de là ! Mais c’était la seule à se prêter parfaitement aux capacités des jeunes musiciens dont il disposait cette année.
Les effectifs de l’école étant volontairement limités, le choix des œuvres susceptibles d’être convenablement interprétées par les élèves s’en trouvait d’autant plus réduit. Mais cela n’était pas le plus important. À ses yeux, l’essentiel résidait dans le travail et le souci de la perfection. Pas d’à-peu-près, pas de laisser-aller, mais le respect rigoureux de la partition allié à une interprétation expressive de la musique… L’ambition de Régis Landry n’était pas de donner un vernis musical à des fournées d’écoliers, mais de préparer les élèves naturellement doués à intégrer un conservatoire puis, éventuellement, à s’orienter vers une carrière de musicien professionnel. « À Musica Nostra, nous visons l’excellence, » avait-il coutume de dire aux parents au moment de l’inscription et, vu le prix que ceux-ci payaient, ils n’en attendaient pas moins. Dans cette perspective, Régis s’était adjoint quatre professeurs de haut niveau, pour les classes de flûte, hautbois, violoncelle et trompette, lui-même se chargeant de l’enseignement du violon et de la musique d’ensemble.
Dès la première année, Musica Nostra connut un succès qui dépassa toutes ses espérances. La qualité des professeurs, la formation musicale complète que recevaient les élèves, les progrès de ceux-ci et les deux concerts annuels conférèrent à l’école une réputation qui déborda largement les limites de la commune et ne se démentit jamais.
D’un geste sec, Régis Landry stoppa l’enregistrement de la Petite Musique de Nuit. Ce qu’il venait d’entendre l’accablait. Il savait que le niveau des élèves de cette année était assez bas. Mais pas à ce point ! En dirigeant, il n’en avait pas vraiment pris conscience, mais l’enregistrement avait cruellement remis les pendules à l’heure ! Les défauts d’exécution étaient flagrants. Pour les corriger, il aurait fallu bien davantage que les deux heures de répétition hebdomadaire et des instrumentistes un peu plus motivés, un peu plus talentueux… En dehors du petit Aubin Welt, ce n’était qu’une bande d’enfants gâtés, sans ambition, incapables de soutenir un véritable effort. Que pouvait-il espérer en tirer ?
Son malaise du réveil le reprit. Le moral soudain au plus bas, il repassa l’enregistrement. Pauvre Petite Musique de Nuit ! Pauvre Mozart, une nouvelle fois assassiné ! Et dire qu’il ne restait qu’une semaine jusqu’au concert ! Pas la peine de s’illusionner, ce serait un désastre.
Affalé dans son fauteuil, Régis ne voyait plus le soleil entrer par les Vélux ni l’azur où dérivaient les nuages. Il n’entendait que les gémissements des violons, les accents trop marqués, l’allure trop lente et les attaques imprécises. « Pauvre Mozart ! » se répéta-t-il, « et pauvre de moi, obligé de présenter une exécution aussi minable ! »
Ah ! S’il avait pu convoquer l’orchestre et le faire répéter, répéter d’ici que les instruments tombent des mains des élèves ! Ah ! S’il pouvait leur crier ce qu’il pensait d’eux, de leur médiocrité, de leur paresse. Des vers de terre, des scolopendres, des limaces… voilà ce qu’ils étaient ! Indignes de la musique qu’ils prétendaient jouer, indignes même d’oser y songer ! Oui, voilà ce qu’il hurlerait avant de les chasser de l’école puis d’en boucler définitivement les portes, de tout arrêter et d’en terminer avec sa misérable vie.
C’était ce qu’ils méritaient tous, ce qu’il méritait lui-même. Musicien médiocre, pédagogue incompétent. Un raté, un loser, un pitoyable mythomane…
Dix heures sonnèrent à la pendulette de la salle de musique. Puis onze heures.
Émergeant peu à peu de sa crise de dépression, Régis se sentait nauséeux et fatigué. Il se demandait comment il allait occuper le reste de la journée quand son portable se mit à sonner. Il n’avait pas envie de répondre. Pas assez d’énergie.
Au troisième rappel, il finit par décrocher et mit quelques secondes à comprendre que la voix qu’il entendait était celle d’un officier de gendarmerie l’informant qu’une de ses élèves, Catherine Moreau, n’avait pas regagné le domicile de ses parents, la veille au soir. On l’avait cherchée partout, sans résultat. Les dernières personnes à l’avoir vue étaient le conducteur de la micheline et son amie Violette David qui se trouvait présentement à l’hôpital de Paimpol, victime d’un accident de la route.
Bizarrement, la première pensée qui vint à l’esprit de Régis fut qu’il n’avait plus de soucis à se faire quant à la Petite Musique de Nuit. Avec deux instrumentistes manquant à l’appel, son petit orchestre ne serait pas à même d’interpréter cette œuvre.
— Les parents de Catherine Moreau ont essayé de vous appeler hier soir, vers vingt et une heures, pour savoir ce qui se passait mais ils n’ont pas pu vous joindre…
— J’étais probablement sur le chemin du retour…
— Ils ont fait une autre tentative, un peu plus tard, sans succès.
— Je ne suis pas rentré directement. Mais je ne vois pas le rapport avec ce que vous venez de m’apprendre, répondit Régis, agacé par la pointe de suspicion qui perçait dans la voix de son interlocuteur.
— Vous avez raison, excusez-moi. Seulement l’adolescente n’a toujours pas réapparu et je vous laisse imaginer l’inquiétude de ses parents. C’est pourquoi je vous saurais gré de me faire part de tout ce qui pourrait éventuellement me mettre sur sa piste.
— Vous me prenez de court. Il ne me vient rien à l’idée. Hier, la répétition s’est déroulée normalement, j’ai libéré les élèves un peu après vingt heures. Ensuite, je suis resté un moment à l’école pour mettre de l’ordre, ranger les pupitres et les partitions… Puis j’ai fait le tour des locaux afin de vérifier que les lampes étaient éteintes partout. La routine, quoi…
— Vous avez été le dernier à quitter l’établissement ?
— Oui.
— Et après ?
— Après ? J’estime que cela ne vous regarde pas.
— Votre manque de coopération me surprend. Le fait qu’une de vos élèves ait disparu ne semble vous faire ni chaud ni froid.
— Non ! Ce n’est pas ça. Je pense simplement qu’il ne faut pas dramatiser. Catherine est une ado assez précoce. Si ça se trouve, elle est avec un copain… Ou alors, elle est allée dormir chez une amie, en oubliant de prévenir ses parents.
— Ça paraît peu probable. Nos recherches dans ce sens n’ont rien donné.
— À propos d’amie… qu’est-il exactement arrivé à Violette David ? Rien de grave, j’espère…
— Fracture du péroné, blessures superficielles et ecchymoses multiples. Elle a été fauchée par une voiture et laissée inanimée au bord de la route. C’est un couple de passants qui l’a trouvée. J’ai pu l’interroger ce matin, mais elle ne se souvient de rien. Comme le chauffard s’est enfui et que l’accident n’a pas eu de témoin, ce sera coton pour retrouver le responsable.
— Ça, je l’imagine…
— Encore une fois, vous êtes sûr que vous n’avez rien à m’apprendre ?
— Pas pour l’instant. S’il me revient un détail, je ne manquerai pas d’appeler la gendarmerie. Puis-je vous demander si vous avez interrogé les élèves de l’orchestre et les autres professeurs ?
— C’est en cours. Nous avons informé notre hiérarchie de cette disparition et on nous a envoyé un officier enquêteur.
— A-t-il obtenu quelques renseignements ?
— Cher monsieur, à mon tour de vous répondre que cela ne vous regarde pas !
*
— Dépêchons-nous de charger le reste du matos ! fit Paul Vaugel à sa femme. L’écluse est ouverte depuis neuf heures et nous ne serons pas les seuls à vouloir sortir du port, ce matin.
— C’est presque terminé, répondit Joëlle en déposant un couffin plein de victuailles dans le coffre de la Citroën. Il reste un pack de bières et des bouteilles d’eau.
— Je m’en occupe. Pendant ce temps, fais le tour de la maison pour voir si nous n’avons rien oublié.
Au lever du jour, lorsqu’ils avaient constaté que le vent virait au nord, Paul et Joëlle Vaugel avaient aussitôt décidé de passer le week-end en mer ainsi qu’ils le faisaient toujours quand la météo le permettait. La majeure partie de leur matériel ne quittait pas le bateau, aussi ne leur fallait-il qu’un minimum de temps pour préparer une sortie en mer. Comme ils habitaient le quartier de Kernoa, ils ne mettaient que quelques minutes pour gagner le port où était amarré leur yacht, un voilier de vingt-deux pieds, avec lequel ils pratiquaient la navigation côtière. Ils partaient généralement le samedi matin et rentraient le dimanche, en fin de journée.
Paul affirmait que sans ces journées passées loin de tout, entre le ciel et l’eau, la vie lui aurait été insupportable. C’était une des raisons qui les avait décidés à s’installer à Paimpol, douze ans auparavant, et à accepter les postes de professeurs de flûte et de violoncelle à Musica Nostra.
Avec les diplômes qu’ils possédaient, ils auraient pu prétendre à mieux. Seulement, nulle part ailleurs, ils n’auraient pu exercer leur métier et pratiquer leur passe-temps favori dans des conditions aussi idéales. Aussi supportaient-ils sans trop se plaindre l’intransigeance, les exigences et, surtout, les tendances maniaco-dépressives de Régis Landry, leur directeur. S’ils reconnaissaient volontiers l’efficacité de son enseignement – les résultats qu’il obtenait des élèves dépassaient largement la moyenne nationale – ils avaient de sérieux doutes quant aux méthodes utilisées, son esprit tyrannique, sa manie du détail et, surtout, les violences verbales auxquelles il se laissait aller… Comment pouvait-on espérer faire aimer la musique en usant de procédés pareils ?
Mais ils n’en disaient rien. Les parents se montraient satisfaits et eux, ils tenaient à garder leur emploi.
Paul rangeait les boissons dans le coffre de la voiture lorsqu’il entendit le téléphone sonner dans le couloir et Joëlle qui décrochait. Agacé, il ferma bruyamment le hayon et alla s’asseoir au volant.
— C’était la gendarmerie, dit-elle, quelques minutes plus tard, en le rejoignant. Il paraît qu’une élève de l’école a disparu et qu’on la cherche partout depuis hier soir.
— Qui ?
— Catherine Moreau, une de tes élèves. Elle n’est pas rentrée chez elle après la répétition d’orchestre.
— Ça s’est mal passé ? Régis a encore houspillé les gamins ?
— Je l’ignore. La personne qui était au téléphone voulait savoir si nous avions remarqué quelque chose d’inhabituel hier ou les jours d’avant. Je lui ai dit que non.
— À quelle heure s’est terminée la répétition ?
— Après vingt heures, selon le flic.
— Régis devrait les garder jusqu’à minuit, tant qu’il y est ! s’exclama Paul. Il est cinglé. Je me demande souvent à quoi il marche et ce qu’il cherche vraiment.
— On en a déjà suffisamment discuté, inutile de revenir là-dessus !
— C’est vrai. Il y a eu d’autres questions ?
— Oui. À quel moment nous avons quitté l’école et ce que nous avons fait de notre soirée. J’ai répondu que nous étions rentrés vers dix-huit heures trente et qu’ensuite nous n’avions pas bougé de la maison.
— Tu ne lui as pas dit que j’étais ressorti ?
— Non !
— Tu as bien fait. À quoi bon aller au-devant des complications quand on peut faire autrement !
— J’ai surtout pensé que tu risquais d’être convoqué à la gendarmerie pour de plus amples explications, que cela prendrait du temps et que l’écluse serait refermée quand tu sortirais.
— Tu as eu raison ! De toute manière, cette histoire ne nous concerne en rien. Maintenant, dépêchons-nous d’aller à bord avant qu’un keuf ne nous tombe sur le paletot ! Et une fois passé l’écluse, pas de radio, pas de portables ! Nous serons injoignables comme d’habitude. Et tu verras, quand nous rentrerons demain, la brebis égarée aura retrouvé le bercail !
*
En milieu de matinée, Nathan Welt déclara qu’il en avait assez et qu’il allait à Paimpol faire des courses. Qu’Élise reste dorloter Aubin si ça lui chantait, mais qu’on ne lui demande pas d’en faire autant !
La poule et son poussin. Piailler, s’exciter, dramatiser… Ah ! Ils s’y entendaient ces deux-là pour monter en épingle le moindre incident ! Le gosse avait fait une chute à vélo, la belle affaire ! Les plaies et les bosses… c’est ainsi qu’on s’endurcit et qu’on devient un homme. Mais Aubin n’en tenait pas le chemin.
Nathan enrageait à voir Élise l’encourager à se replier sur lui-même sous prétexte que ses talents musicaux étaient exceptionnels. Exceptionnels peut-être… mais seulement dans le petit cercle d’amateurs qui l’entourait. Une gloire locale qui s’effondrerait lorsqu’elle aurait à affronter une véritable concurrence. Voilà ce que Nathan s’échinait à expliquer à Élise, pour l’empêcher de commettre l’erreur de sa vie : pousser son fils dans une voie qui n’était pas la sienne et se retrouver ensuite avec un raté sur les bras.
Hier soir, quand Aubin était apparu dans la lumière du couloir, crotté, pleurant et reniflant, le visage et les mains écorchés, Élise avait failli tourner de l’œil. Il avait fallu qu’il la secoue afin qu’elle se reprenne et nettoie les blessures qui déjà ne saignaient plus. Ensuite, ils avaient retiré les vêtements du gamin pour une inspection superficielle : une plaie au genou, une bosse au front et une cheville enflée. Il avait ordonné à Élise de placer un sac en plastique plein de glaçons sur l’articulation tandis qu’Aubin geignait en bredouillant une de ses histoires sans queue ni tête dont il avait le secret. Nathan avait alors suggéré de lui donner un cachet d’aspirine et de l’envoyer se coucher. Après une bonne nuit de sommeil, l’incident se résumerait à quelques ecchymoses et des courbatures.
Mais c’était trop demander à Élise ! Elle avait tenu à s’occuper d’Aubin toute la nuit. Gémissements, pleurs, cauchemars, tisanes, compresses… La mère poule n’avait pas cessé de glousser et de caqueter. Nathan avait quand même fini par sombrer dans le sommeil… pour être réveillé, à sept heures, par Élise éplorée, qui l’avisait qu’elle emmenait Aubin au service des urgences, à l’hôpital de Paimpol. Il lui avait répondu de faire ce qu’elle voulait et s’était rendormi.
Plus tard, après avoir pris son petit-déjeuner, il était monté voir Aubin, de retour dans sa chambre.
— Alors, qu’est-ce qu’ils t’ont trouvé, à l’hôpital ?
— Une entorse à la cheville. Le genou et le reste guériront tout seuls.
— Tu as dû te prendre une jolie gamelle ! Comment tu as fait ? Tu as dérapé ?
— Je… j’ai eu peur.
— Peur de quoi ?
— J’ai entendu des drôles de bruits.
— Le vent dans les arbres.
— Non ! Des chants d’oiseaux…
— La nuit, en février… impossible !
— Justement… c’est ça qui m’a fait peur.
— D’accord, mais on ne tombe pas de vélo parce qu’on a peur.
— Je me rappelle que j’ai passé par-dessus le guidon, après je ne me souviens plus de rien.
— Tu as dû rester étourdi par terre un bon moment… Ta mère commençait de s’inquiéter. Elle a même téléphoné à ton copain Martial.
— Quand j’ai rouvert les yeux, j’étais couché dans l’herbe mouillée et je voyais la lampe allumée au-dessus de la porte. Alors je me suis relevé et je suis rentré.
— Et ton violon, tu en as fait quoi ?
Le gamin avait ouvert une bouche toute ronde et un flot de larmes s’était échappé de ses yeux.
— J’sais pas… Je l’ai oublié.
— Il doit être quelque part, près du vélo. On va le retrouver.
— Il est peut-être cassé, fit Aubin en sanglotant de plus belle.
— Pleurer comme un bébé ne te mènera à rien. Serre les dents et conduis-toi en homme, pour une fois !
Après avoir quitté la chambre, il s’était heurté à Élise, les mains chargées de compresses et de médicaments. Sa hargne avait empiré. « Continue à le dorloter si tu veux, moi, j’en ai ma claque ! Je vais jusqu’à Paimpol… »
Arrivé à l’entrée de la sapinière, Nathan aperçut le vélo couché sur le sol, les roues en l’air. Il sortit de voiture et alla le redresser. Apparemment, les dégâts étaient minimes. Il le poussa jusqu’à un châtaignier et l’appuya contre le tronc. Il le reprendrait au retour. Quelques instants plus tard, il découvrit l’étui à violon à demi caché sous un noisetier. Il était resté fermé mais la pluie avait dû pénétrer à l’intérieur et l’instrument était peut-être endommagé. Il le ramassa et le déposa dans la voiture. Puis, en inspectant le chemin, il trouva un bout de ficelle qui serpentait sous les feuilles mortes. Une des extrémités traînait par terre tandis que l’autre était attachée au tronc d’un sapin. Nathan la dénoua, l’enroula et la glissa dans sa poche.
Cela fait, il remonta en voiture et poursuivit sa route vers Paimpol.
*
Jouer de la trompette n’était pas sans inconvénient, Loïc Plesguen l’avait constaté depuis fort longtemps.