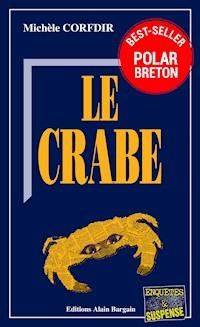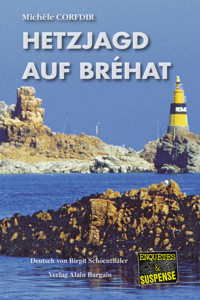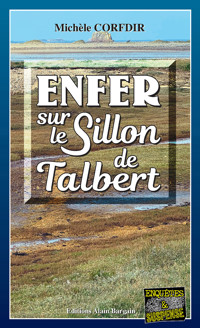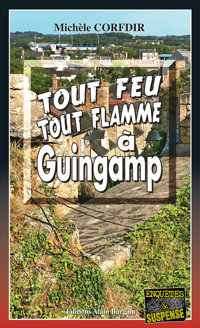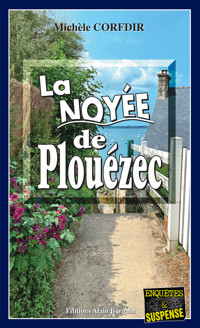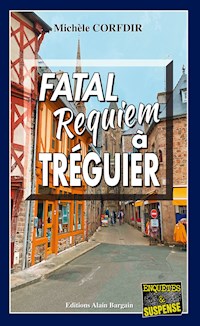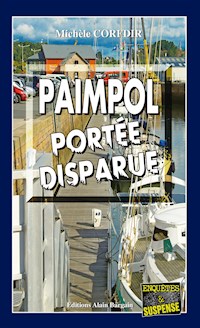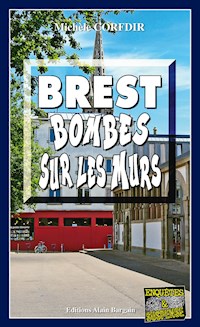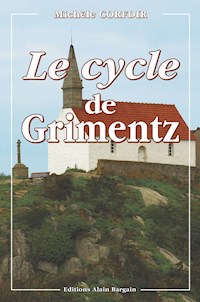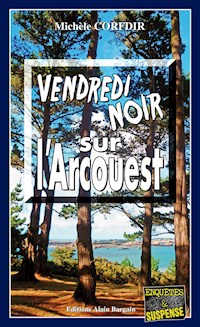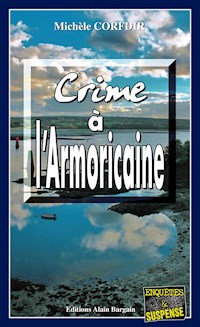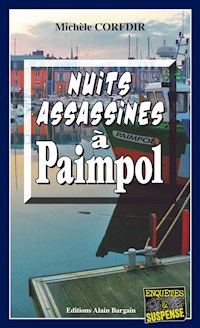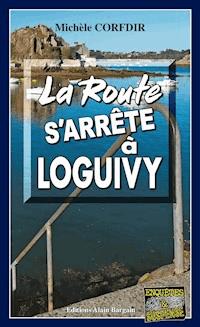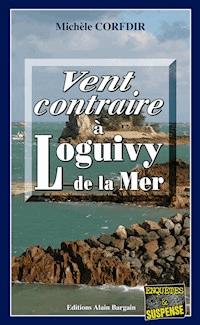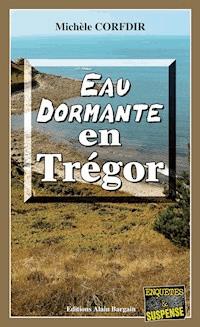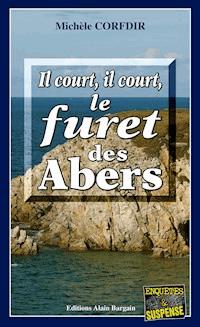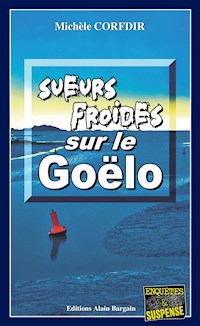
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Une tempête de neige oblige deux sœurs aux caractères opposés à cohabiter avec un bébé à l'identité inconnue...
15 février 2012. Une tempête de neige sans précédent s’abat sur la côte du Goëlo, au nord de la Bretagne. Élise Favre qui arrive de Nantes pour un court séjour dans sa résidence secondaire de Kornog, s'apprête à rester bloquée chez elle, en attendant que la météo s'améliore. Le blizzard fait rage lorsque, la nuit suivante, sa sœur Barbara débarque sans prévenir avec, à l’arrière de son 4x4, un couffin où dort un bébé inconnu.
Connaissant le caractère dangereusement imprévisible de sa sœur, Élise ne s'en étonne pas et compte bien rendre la petite fille à ses parents, dès que le dégel s’amorcera. Mais elle se trompe car rien ne se déroulera comme prévu. Cette enfant dont elle recherchera désespérément l’identité et la folie dévastatrice de Barbara vont l'entraîner dans une descente aux enfers qui donnera des sueurs froides, même au lecteur le plus averti.
Plongez sans attendre dans l'intrigue captivante de ce thriller psychologique !
EXTRAIT
Élise serra les dents, renfila son anorak et ses bottes puis s’apprêta à affronter la nuit glacée.
Du seuil de la porte, elle dirigea sa torche électrique vers le 4x4 et regarda sa sœur retirer du coffre un sac de couchage et un gros cabas qu’elle vint déposer dans le couloir.
Puis elle retourna sur ses pas, ouvrit l’une des portières arrière, en sortit un balluchon informe, revint rapidement et posa son chargement sur la table de la cuisine.
— Qu’est-ce que c’est que ça ?
— Ton cadeau. Vas-y, ouvre-le ! Qu’est-ce que tu attends pour regarder ? aboya Barbara. Ce serait la moindre des politesses, il me semble, surtout après tout le mal que je me suis donné !
Méfiante, Élise souleva un coin de la couverture qui enveloppait le balluchon.
Et ce qu’elle aperçut, dans la faible lumière de la lampe à pétrole, la changea brutalement en statue de sel.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Editions Bargain, le succès du polar breton. –
Ouest France
À PROPOS DE L'AUTEUR
Michèle Corfdir est née et a grandi en Suisse. Elle y a fait ses études et a enseigné quelques années dans le Jura et à Bienne. Elle a publié alors un recueil de poèmes couronné par le Prix des Poètes Suisses de Langue Française, ainsi que des contes pour enfants qui obtiennent le prix de l'Office Suisse de la Lecture pour la Jeunesse. Après son mariage avec un marin pêcheur breton, elle s'établit à Loguivy de la Mer. Elle collabore comme nouvelliste à diverses revues et met sa plume au service des marins pêcheurs, au cours de la crise qu'a connue cette profession au début des années 90. En 1998, elle publie aux Éditions Alain Bargain, son premier roman,
Le Crabe, un thriller maritime très bien accueilli tant par la critique que par le public. Face à ce succès, elle édite d'autres ouvrages dans la collection Enquêtes et Suspense.
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -
Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nous remercions tout particulièrement “Photo Yann” de Paimpol pour le prêt de la photo de couverture.
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
I
La tempête de neige annoncée sur les côtes de la Manche débuta par un après-midi calme et gris. Le ciel était bas, l’air immobile et le temps comme suspendu.
Vers dix-sept heures, quelques flocons commencèrent à s’infiltrer sous le couvert des pins. Ils flottaient, légers et fantasques, tantôt éparpillés, tantôt en essaims compacts qui montaient de la mer et s’humectaient à l’écume des vagues. Cette poussière glacée se déposait sur les arbustes et dans l’allée, caresse cendreuse qui donnait au paysage un aspect paisible, presque endormi.
Alors qu’une lueur orangée annonçait le crépuscule, l’air fut soudain comme saturé de blancheur. D’innombrables flocons minuscules et tourbillonnants mouchetèrent l’espace puis se posèrent sur le jardin.
Debout à sa fenêtre, Élise suivait des yeux le mouvement virevoltant des bourrasques. Dieu merci, elle était arrivée à temps, avant que les petites routes qui menaient au hameau de Coateven, ne soient ensevelies sous la neige. Elle avait pu décharger sa voiture et rentrer dans la maison les provisions qu’elle avait apportées. Maintenant, elle était chez elle, à l’abri, et pouvait tranquillement regarder la tempête qui se préparait.
Elle ne voulait pas penser à l’état des routes, lundi matin, quand elle rentrerait à Nantes. Ni à son installation électrique défaillante, aux conduites d’eau qui risquaient de geler, à sa chaudière capricieuse… Pour le moment, tout fonctionnait sans problème. Elle avait de la lumière et les radiateurs étaient chauds, même si la température des pièces dépassait à peine quatorze degrés. Les murs étaient mouillés par la condensation et les rideaux frémissaient chaque fois qu’une rafale faisait vibrer les carreaux. Pour être saine et agréable, sa maison de Kornog aurait dû être chauffée sans discontinuer de novembre à avril. Il aurait aussi fallu effectuer des travaux d’isolation, remplacer les portes, rénover l’huisserie, doubler les murs intérieurs… dépenses qui dépassaient largement son budget et qu’elle refusait de faire pour une résidence secondaire où elle ne séjournait que l’été ou durant quelques week-ends hors saison, quand il faisait beau et qu’elle avait envie de s’oxygéner. En hiver, elle n’y venait qu’en cas de force majeure.
Et aujourd’hui, ce cas de force majeure s’appelait Barbara, son insupportable sœur qui avait débarqué chez elle, une semaine auparavant, et qui depuis, squattait sans vergogne son appartement.
D’habitude, quand elle venait à Nantes, pour sa visite annuelle à leurs parents, c’était chez eux qu’elle logeait. Mais la mort de leur mère et l’installation de leur père dans une maison de retraite avaient changé la donne. Elle avait alors décrété que, désormais, ce serait chez sa sœur qu’elle séjournerait.
Mise devant le fait accompli, Élise n’avait pu refuser. Ensuite, elle avait essayé de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Mais la bêtise, le comportement imprévisible et la méchanceté de Barbara étaient vite venus à bout de sa patience. En outre, même si elle reconnaissait que son état psychique semblait stabilisé, Élise demeurait sur le qui-vive, persuadée que ce bel équilibre n’était qu’une façade pouvant à tout moment se lézarder.
En quoi elle avait probablement tort. Cela faisait des années que Barbara menait une existence sans histoire, dans sa bergerie des Pyrénées, entre son élevage de chèvres et sa fabrication de produits artisanaux. Ces activités lui rapportaient à peine de quoi vivre, mais elle ne se plaignait pas. Au contraire, elle en tirait même vanité. Prônant à qui voulait l’entendre les bienfaits d’un retour à la nature, aux choses simples et essentielles, Barbara revendiquait haut et fort sa marginalité.
Pour leurs parents vieillissants, cela avait été inespéré. Leur fille aînée leur avait causé tant de soucis au cours de son enfance et de son adolescence que la voir mener une vie d’adulte quasi normale était un réconfort dont ils ne cessaient de bénir le ciel.
Cette transformation s’était produite bien des années auparavant, au cours des vacances d’été que Barbara avait passées dans les Pyrénées. Elle y avait rencontré un Espagnol qui pratiquait l’élevage de chèvres dans la haute vallée du Gave d’Arrens. Elle s’en était entichée et n’était pas redescendue de ses montagnes. Inquiets, ses parents lui avaient rendu visite et étaient revenus à Nantes stupéfaits. Le compagnon de leur fille était un quinquagénaire quasi muet qui passait ses journées sur l’alpage et qu’ils n’avaient qu’entraperçu. Quant à Barbara, elle s’était muée en une chevrière épanouie qui partageait son temps entre la garde du troupeau, la fabrication de chevrotins et son métier à tisser.
Une dizaine d’années plus tard, le berger espagnol avait disparu, personne ne savait où, et Barbara était restée avec les chèvres, les moutons, le chat et quel-ques poules, sans paraître affectée par cette séparation ni par la solitude. Ce constat avait incité leurs parents à acquérir, au nom de leur fille, la bergerie du Mont Perdu et les terres qui en dépendaient. Comme lestée par ce statut de propriétaire et les responsabilités qu’il comportait, Barbara menait depuis, une existence retirée et paisible, qui paraissait parfaitement lui convenir. Chaque hiver, en février, elle confiait son élevage à un vieux berger du coin et venait passer une dizaine de jours à Nantes, dans sa famille.
Contrairement à leurs parents qui croyaient les problèmes de leur aînée définitivement résolus, Élise, sceptique, évitait tout contact avec sa sœur. C’est pourquoi elle avait été catastrophée lorsque celle-ci lui avait annoncé son arrivée à Nantes, le dimanche suivant, en début de soirée.
En lui ouvrant la porte, deux jours plus tard, elle ne put refréner un mouvement de recul. Comme toujours après une longue séparation, elle était choquée par sa stature massive, son mètre quatre-vingts, son visage lunaire piqué de deux yeux noirs, rusés et arrogants. Sa chevelure poivre et sel était hirsute et sa façon de s’habiller toujours aussi négligée. Elle se tenait sur le seuil, deux énormes valises posées à ses côtés.
En la voyant, Élise détesta l’idée de la voir entrer chez elle.
— Alors, sœurette ! On ne s’embrasse pas ?
— Si, bien sûr.
Des mains osseuses l’empoignèrent par les épaules et elle se retrouva le visage plaqué contre une doudoune marron, d’une propreté douteuse.
— Bon… eh bien, entre !
Saisissant ses bagages, Barbara se propulsa à l’intérieur, écrasant de ses grosses chaussures de montagne, le tapis berbère du couloir.
— Où est ma chambre ?
— Au fond à gauche. J’ai fait ton lit, tu trouveras une table, quelques sièges, un placard et des cartons que je n’ai pas encore eu le temps de vider. Comme je te l’ai dit au téléphone, je viens d’emménager et l’ameublement est un peu sommaire.
— Pour une fois que tu m’invites, j’avais pensé que tu ferais un effort, question confort !
Agacée, Élise la regarda longer le couloir puis s’enfermer dans sa chambre, en se disant qu’elle ne manquait pas d’air. Pour ce qu’elle en savait, sa bergerie était des plus rudimentaire et, côté commodités, ne soutenait certainement pas la comparaison avec ce qu’elle trouverait ici.
Au même instant, elle perçut les relents de fumée que Barbara traînait dans son sillage. Ce n’était pas l’odeur du tabac mais celle qui stagne dans les maisons chauffées au bois, dont la cheminée tire mal. Ses vêtements devaient en être imprégnés, ses cheveux aussi, et elle allait empester tout l’appartement.
Élise songea à lui proposer une douche. Après un long voyage en voiture, c’était la meilleure façon de se défatiguer. Mais elle se ravisa. Avec Barbara, les meilleures intentions étaient toujours mal interprétées. Elle s’en tiendrait donc à la tactique qu’elle s’était fixée : aucune initiative, ni remarque ni critique, attendre et voir venir.
Pensant qu’un petit apéro détendrait l’atmosphère, elle prépara des bols de cacahuètes, d’olives et de gâteaux salés qu’elle déposa sur la table basse du séjour. Pour les boissons, on verrait plus tard.
Vers dix-neuf heures, Barbara la rejoignit enfin. Toujours vêtue comme si elle se trouvait en haute montagne, elle avait cependant troqué ses grosses chaussures contre des charentaises doublées de mouton.
— Je me suis dit qu’un apéritif te ferait plaisir. J’ai préparé des amuse-gueules. Qu’est-ce que tu as envie de boire ?
— Tout à l’heure… Viens d’abord jeter un coup d’œil à ce que j’ai apporté !
— Volontiers.
Dès le pas de la porte, l’âcre odeur de fumée qui s’échappait des bagages soulevait le cœur et Élise comprit aussitôt la présence des deux énormes valises. En fait, elles étaient remplies, non pas de vêtements de rechange, mais de la production artisanale de sa sœur. La chambre d’amis avait été transformée en lieu d’exposition : tricots, objets tissés, sculptures sur bois, masques, pots de confiture, fromages de chèvre, boîtes de tisanes, fioles et flacons au contenu indéterminé s’alignaient sur la table, les chaises et les étagères.
— Tu n’en reviens pas, hein ? fit Barbara d’un air avantageux.
Comme Élise, sidérée, ne répondait pas, elle poursuivit :
— Il va sans dire que tout est de ma fabrication, et confectionné à partir de produits naturels.
— Je… je n’en doute pas. C’est magnifique !
Le compliment parut l’amadouer et elle se fendit d’un sourire.
Puis elle désigna, d’un ample geste du bras, l’ensemble de sa production.
— Choisis ce qui te fait envie ! Vas-y, ne te gêne pas !
Embarrassée, Élise considérait toute cette marchandise avec circonspection. Les objets n’étaient pas laids et peut-être avait-on envie de les acheter quand on les voyait dans le cadre d’un chalet d’alpage. Mais ici ne ressortaient que leur rusticité, l’inconfort des tricots, la raideur des tissus.
— Alors ? dit Barbara d’une voix où perçait l’impatience.
— Je… j’adore la confiture de myrtilles, j’en prendrais volontiers un pot.
— Rien d’autre ?
— Un ou deux fromages de chèvre peut-être…
— C’est tout ?
— Oui, je te remercie. Mais qu’est-ce que tu comptes faire de tout ça ?
Sa sœur la regarda d’un air condescendant.
— Les vendre, bien entendu.
— Ah ! Très bien… Et à qui ?
Barbara souffla bruyamment, comme exaspérée par l’incongruité de la question. Elle attendit quel-ques instants pour laisser à Élise le temps de trouver la réponse toute seule puis, comme rien ne venait, elle articula :
— À tes relations, tes amis, tes collègues, tes voisins… Je compte sur toi pour t’investir dans cette affaire.
— Quoi ? Tu voudrais que ce soit moi qui écoule ta marchandise ?
— Exactement ! Moi, je ne connais plus personne à Nantes. Et je ne vais pas m’installer sur le trottoir, comme les traîne-savates qu’on voit partout.
— Bien sûr que non ! Seulement je ne suis pas une revendeuse et il n’est pas question que j’aille importuner mes connaissances en essayant de leur fourguer tes produits.
Barbara écarquilla les yeux, sa bouche s’ouvrit démesurément sur un cri qui ne jaillit pas. Puis elle se reprit et lâcha d’un ton aigre-doux :
— Ah ! C’est comme ça que tu vois la chose ?
— Oui, je regrette.
— Je n’ai pas l’impression que tu mesures la valeur des objets qui sont devant toi. Les boutiques les plus huppées des stations pyrénéennes les exposent et les vendent. Je croule sous les commandes.
— Je t’en félicite, fit Élise qui n’y croyait pas.
— Si je me suis éreintée à traîner ces valises jusqu’ici, c’est uniquement pour donner à tes relations l’occasion de se procurer des produits introuvables à Nantes. Je pensais que tu serais fière de les leur faire découvrir.
— Les gens que je connais ne sont pas nombreux. J’ai peu d’amis, je ne sors pas beaucoup. Je n’ai pas de collègues de travail puisque je bosse à domicile. La maison d’édition où je suis traductrice, est à Paris et je n’ai de contacts avec elle que par Internet ou par téléphone. Quant à l’immeuble où je viens d’emménager, il est tout neuf et la plupart des appartements sont encore vides. Pour le moment, je n’ai pas de voisins. Franchement, avec la meilleure volonté du monde, je ne vois pas comment je pourrais t’aider.
— C’est bon, n’en parlons plus.
Elle semblait s’être calmée, mais Élise savait que le chapitre n’était pas clos et que sa sœur ruminerait sa rancœur jusqu’à son départ. Pour mettre un terme à la discussion, elle quitta la chambre d’amis et gagna le séjour. Elle s’apprêtait à se verser un scotch lorsque Barbara la rejoignit, un sac de jute à la main.
— Qu’est-ce que je te sers ? Porto, pastis, whisky…
— Pas question que j’avale une de ces cochonneries ! J’ai apporté un vin de noix de ma fabrication, tu en boiras bien un verre ?
— Ce serait avec plaisir, mais je meurs de soif et je préfère un whisky-soda.
Barbara lui décocha un regard noir et sortit de son sac une bouteille sans étiquette dont le bouchon avait été scellé à la cire. Elle l’ouvrit et exigea deux verres.
— Je veux absolument que tu goûtes à mon vin de noix. Tu vas voir, c’est autre chose que ta boisson d’Angliche !
Pour ne pas la contrarier, Élise avala sans mot dire la boisson sirupeuse qu’elle fit passer à l’aide d’eau gazeuse. Puis elle alluma une cigarette, ce qui lui valut aussitôt des reproches. Barbara qui puait la fumée à plein nez ne supportait pas l’odeur du tabac ! Elle s’en prit ensuite aux cacahuètes et aux crackers qu’elle déclara nocifs pour la santé, ainsi qu’aux olives cultivées industriellement, à grand renfort d’engrais et de pesticides. Élise ne répondit rien puis, pour changer de sujet, elle lui demanda quand elle comptait aller voir leur père, dans sa maison de retraite.
— Demain après-midi.
— Et tu t’y rendras comment ?
— En voiture. Mon 4x4 est garé dans la rue, à cent mètres d’ici. Tu m’indiqueras l’itinéraire le plus court, j’ai une carte routière dans mon sac.
Elles passèrent ensuite à table. Barbara engloutit sans un mot le ragoût de mouton qu’Élise avait préparé. Elle avait à peine terminé qu’elle déclara qu’elle était morte de fatigue et qu’elle allait se coucher.
Élise la prévint alors qu’elle serait absente le lendemain à midi et qu’elle devrait préparer son repas elle-même.
— Tu peux taper dans mon congélateur, mais il n’y a pas grand choix, je n’ai pas encore eu le temps de le remplir.
Barbara prit un air offensé et marmonna que, question hospitalité, elle avait été habituée à mieux.
— Sûrement, rétorqua Élise. Je me souviens que maman te chouchoutait, mais moi, je n’ai pas le temps.
— Ou pas envie.
— Pense ce que tu veux, ça m’est égal.
La soirée suivante fut plus paisible. Barbara avait préparé le repas, un gratin dauphinois à base de chevrotins provenant de sa provision personnelle. Évitant toute discussion susceptible de soulever une controverse, elles parlèrent de leur père et de “Bel Automne”, la maison de retraite où il vivait.
Un peu avant vingt-deux heures, Barbara déclara qu’elle avait envie d’aller faire un tour en ville.
— À cette heure-ci ? s’inquiéta Élise.
— Pourquoi pas ? La nuit ne m’a jamais fait peur. J’ai envie de me dégourdir les jambes. Je n’ai pas sommeil, un peu d’exercice me fera du bien.
Élise comprit que plus elle soulèverait d’objections, plus sa sœur se cramponnerait à son idée. Elle haussa les épaules et lui souhaita bonne nuit, après lui avoir recommandé de ne pas faire de bruit en rentrant.
Une fois au lit, elle s’assoupit presque aussitôt. Tard dans la nuit, un grincement de porte la réveilla. Elle tendit l’oreille et perçut un bruit de pas puis celui de la chasse d’eau. Soulagée de savoir sa sœur de retour, elle s’enfouit sous sa couette et se rendormit.
Le mardi soir ne se passa pas aussi bien. Élise avait reçu un appel téléphonique de la directrice de Bel Automne qui lui demandait de bien vouloir faire comprendre à madame Barbara Favre que le hall d’entrée de l’établissement n’était pas un marché couvert et qu’il était interdit d’y vendre ou d’y échanger quoi que ce soit.
Comme Élise ne voyait pas de quoi elle voulait parler, son interlocutrice l’avait informée que l’après-midi même, après sa visite à son père, madame Favre s’était installée dans le hall où elle avait ouvert deux valises pleines d’objets artisanaux dont elle s’était mise à faire l’article aux nombreuses personnes qui passaient par là. Cela avait causé un attroupement préjudiciable au calme de l’établissement. On avait prié madame Favre de remballer sa marchandise et de quitter les lieux. Mais elle l’avait mal pris et il avait fallu faire appel au personnel de sécurité. « Essayez d’expliquer à votre sœur qu’une vente à la sauvette n’a rien à voir avec une exposition de peinture telle que celle qui se tient actuellement à Bel Automne. Nous nous sommes évertués à le lui faire comprendre, mais elle n’a rien voulu entendre. Nous comptons sur vous pour la raisonner. » Élise avait balbutié quelques mots d’excuse et promis que cela ne se renouvellerait pas.
Lorsqu’elle aborda le sujet avec Barbara, celle-ci ne nia pas les faits mais s’obstina à les interpréter à sa manière :
— Deux poids, deux mesures, comme toujours ! N’importe quel barbouilleur a droit au titre d’artiste et peut exposer ses œuvres dans les lieux publics. Mais nous, les artisans, sommes toujours regardés de haut et n’avons droit à aucune considération.
— La question n’est pas là ! L’expo qui se tient actuellement à Bel Automne a été programmée depuis longtemps. L’administration a donné son accord, tout a été fait en bonne et due forme. Tandis que toi, tu débarques sans crier gare avec ta camelote…
— Merci pour la « camelote » !
— Excuse-moi, je ne voulais pas te blesser, mais admets tout de même qu’une maison de retraite n’est pas un souk où n’importe qui peut se mettre à vendre n’importe quoi.
Barbara avait pris l’air offensé qu’elle affichait chaque fois qu’elle était sur la défensive.
— Les vrais incompris ne sont pas les artistes mais les gens comme moi, soucieux de préserver les vraies valeurs, et pour qui ne compte que l’essentiel.
Désireuse de la voir se calmer, Élise lui donna raison mais exigea d’elle la promesse de ne pas recommencer.
— Inutile de me le dire, je ne commettrai pas deux fois la même erreur.
Puis elle ajouta d’un air matois :
— Mine de rien, je me suis quand même fait plus de cent euros, cet après-midi. Si on m’avait laissé plus de temps, j’aurais vidé mes valises !
— Tant que ça ? s’exclama Élise. Je comprends que tu aies été de mauvais poil quand on t’a virée.
— Ne te bile pas pour ça, j’ai un autre projet. Je compte organiser un apéro où seront invités les gens de l’immeuble et quelques commerçants du quartier avec qui j’ai sympathisé. J’en profiterai pour exposer mes produits.
— Un apéro… balbutia Élise, abasourdie. Mais où ?
— Ici, chez toi. Ta salle de séjour est assez grande pour ça.
— Tu n’es pas sérieuse.
— Bien sûr que si ! Ce sera une sorte d’opération commerciale. Tu vas voir, j’écoulerai toute ma marchandise, quitte à brader les derniers articles en fin de soirée.
— Non ! C’est hors de question ! Je ne tiens pas à voir débouler une foule d’inconnus chez moi.
— Ce serait une bonne façon de rencontrer tes nouveaux voisins…
— Merci, je n’en ai pas envie.
— Tu pourrais faire un effort quand même ! protesta Barbara d’une voix geignarde. Je ne suis pas riche, ça me donnerait l’occasion de gagner un peu de fric.
— Non, je refuse.
— Pourquoi ?
— Parce que je suis chez moi et que j’y fais ce qu’il me plaît.
— Ça ne suffit pas.
Élise étouffa un soupir.
— Eh bien, je ne veux voir personne parce que… parce que je suis en deuil.
L’incrédulité se peignit sur le visage de Barbara.
— Quoi ? C’est pour ça ? Mais maman est morte depuis plus d’un an déjà. Elle était âgée et malade. Il faut te faire une raison.
— Ce… ce n’est pas de maman que je porte le deuil. Maintenant, excuse-moi mais je vais me coucher. J’ai travaillé toute la journée à une traduction particulièrement difficile et je suis vannée.
— Comme tu veux, sœurette ! Moi par contre, je n’ai pas sommeil. Je vais retourner faire un tour en ville, comme hier.
Le lendemain, Élise s’aperçut que les quelques cartons qu’elle n’avait pas encore vidés et qui s’alignaient dans le couloir, avaient été dérangés. En y regardant de près, elle remarqua que le scotch en avait été décollé puis recollé. Barbara avait fouillé dans ses affaires. Que cherchait-elle ? Probablement rien de particulier, mais elle avait pu tomber sur…
Élise sentit sa gorge se nouer. Penser que d’autres mains que les siennes avaient pu toucher aux petits vêtements soigneusement emballés, lui était insupportable. Et si Barbara voulait en savoir davantage, comment faire pour couper court sans aiguiser sa curiosité ?
Mais quand celle-ci rentra à l’appartement, après sa visite à leur père, elle ne fit pas mine d’aborder le sujet. Elle était d’excellente humeur et évoqua son retour à la bergerie du Mont Perdu.
— Rien ne presse, répondit poliment Élise.
— Taratata ! Pas la peine d’être hypocrite. Je lis en toi comme dans un miroir ! s’exclama Barbara en fourrageant dans ses cheveux ébouriffés et sales.
— Tu devrais profiter de ton séjour ici pour aller chez le coiffeur, tu en aurais besoin, lâcha Élise, oubliant qu’il ne fallait jamais lui faire ce genre de remarque.
— Pourquoi ? Ma coupe ne te plaît pas ?
— Excuse-moi, j’ai dit ça sans y penser. Tu es très bien telle que tu es.
— Ah ! Je préfère… Parce que des critiques blessantes, je pourrais t’en faire, moi aussi ! Ne crois pas que j’aime ta façon de t’habiller ni ta manière de parler ni cet appartement tout neuf avec ses grandes fenêtres et ses murs blancs. Je ne comprends pas comment on peut vivre dans un environnement pareil. Je préférais ton ancien appartement, même s’il était vieillot et plus petit. Pourquoi l’as-tu quitté ? Franchement, ça me dépasse.
Sans répondre, Élise se rendit dans la cuisine où elle se servit un whisky-soda et remplit un verre de vin de noix à l’intention de sa sœur. Lorsqu’elle regagna le séjour, elle trouva celle-ci affalée sur le canapé, ses longues jambes étendues devant elle, les bras pendants et le regard vide. Son silence et son immobilité étaient si inhabituels qu’Élise se demanda aussitôt quelle nouvelle excentricité elle était en train d’échafauder. Elle déposa son plateau sur la table et s’assit dans un fauteuil. Quelques minutes s’écoulèrent, puis Barbara replia ses genoux et croisa ses bras sur sa poitrine.
— C’était une fille ou un garçon ? articula-t-elle d’un ton indifférent.
Coup de poing entre les deux yeux.
Élise ouvrit la bouche et bascula en arrière. Dans le vide et l’étouffement. Dans le silence et dans l’absence.
Puis, déchirée soudain par des éclats d’une lumière perforante, elle bougea un bras, comme pour ramener sur elle le duvet de brume où elle était ensevelie. Mais la cloche de verre s’était brisée. Quelques mots lâchés par inadvertance l’avaient fait exploser.
Elle gémit. Elle avait cru pouvoir et n’avait pas pu. Elle avait voulu mais n’avait pas réussi. Les ombres ogresses, dévoreuses de bébés, l’avaient rattrapée.
Elle sentit soudain qu’on la redressait, qu’on pressait un verre d’alcool contre ses lèvres. Elle ouvrit les yeux. La silhouette massive de sa sœur était penchée sur elle.
— On dirait que j’ai vu juste.
— Tais-toi !
— Tu as eu un gosse…
— Tais-toi !
— …et il est mort.
À nouveau l’interlude. À nouveau le gris et le brouillard.
Une paire de gifles lacéra le crépuscule.
— Ne me refais pas le coup du malaise, j’aime pas ça ! Et dis-moi si c’était une fille ou un garçon !
— Non ! Je ne veux pas en parler, je ne veux plus y penser.
— Tu sais très bien que c’est impossible. Bois ton scotch !
— Pas envie.
— Fais un effort !
Un pantin aux gestes saccadés se découpait devant la baie vitrée. Une voix rauque se heurtait aux murs blancs et nus. Dissonance et cacophonie. Puis brusquement, tout se rassembla. Barbara était assise en face d’Élise et lui parlait :
— Dimanche, quand je suis arrivée, j’ai tout de suite senti que quelque chose n’allait pas. Je savais que ça t’emmerdait de me recevoir chez toi. Mais ce n’était pas ça. Alors j’ai pensé que tu avais peut-être un problème sentimental ou que c’était ton boulot qui te causait des soucis. En tout cas, j’étais sûre que ça clochait quelque part… Ce matin quand tu t’es absentée, j’ai jeté un coup d’œil aux cartons du couloir. Rappelle-toi, j’ai toujours aimé fouiner dans les affaires des autres. Quand je suis tombée sur des habits de bébé, j’ai d’abord pensé à un cadeau que tu devais faire. Mais il y en avait trop et, en regardant mieux, j’ai vu qu’ils avaient déjà servi.
— Tais-toi ! Pour l’amour du ciel, tais-toi !
— Comme la couleur rose dominait, je me suis dit que c’était la layette d’une petite fille. Mais je peux me tromper, je ne suis pas experte en la matière. Allons bon ! Te voilà encore en train de tourner de l’œil ! Finis ton verre que je t’en verse un autre, tu as l’air d’en avoir besoin… Mais ce qui te ferait le plus de bien, serait que tu vides ton sac et que tu me racontes ce qui est arrivé.
Élise secoua la tête. Le sac devait rester fermé, ce qu’il contenait n’appartenait qu’à elle. Partager, c’était déjà trahir. Abandonner. S’éloigner. Oublier.
Les mots demeurèrent à l’intérieur, mais les yeux se mirent à pleurer. On maîtrise mieux la parole que les larmes. Les larmes échappent à la volonté et coulent sans vergogne sur les joues et sur le pull.
— Tu peux pleurer si ça te soulage. Mais parler serait mieux.
— Non.
— Comme tu veux. Je vois que tu as un chagrin terrible et ça ne me plaît pas. Surtout qu’un mioche, ça se remplace… T’as qu’à en faire un autre.
— Arrête ! Tu ne sais pas ce que tu dis.
— Oh moi ! J’essaie juste de te remonter le moral.
— J’en ai assez entendu ! Je ne crois pas que tu aies envie de me réconforter. Tu es seulement curieuse de savoir ce qui est arrivé. Eh bien je vais te le dire… Tu as raison, j’ai eu un bébé, une petite fille qui est morte à la fin de l’année dernière. Malformation cardiaque non détectée à la naissance. Elle avait huit mois. Voilà, c’est tout. Je n’ai pas envie d’en dire plus. Cette histoire m’appartient et je ne veux pas la partager avec toi.
— C’est pour ça que tu as déménagé ?
— Oui, je ne pouvais plus supporter l’ancien appartement.
— C’est moche, mais il faut arrêter d’y penser.
— D’accord, parlons d’autre chose ! Dans l’immédiat, je te préviens que j’ai décidé d’aller passer le prochain week-end dans ma maison de Kornog, à Coateven. Je partirai vendredi vers quinze heures et reviendrai lundi matin. L’appartement est à toi, tu peux y recevoir qui tu veux, et même organiser un apéro pour les voisins, si tu y tiens toujours. Je m’en moque.
Barbara secoua la tête.
— Non ! Par contre, ce qui me ferait plaisir serait de t’accompagner. Je ne suis jamais retournée là-bas. Je me souviens que c’était une chouette maison. Tu as eu une sacrée veine d’en hériter. Ce n’est pas à moi que notre tante l’aurait léguée, elle n’a jamais pu me blairer !
— En compensation, tu as eu la bergerie du Mont Perdu. Quand nos parents l’ont achetée pour toi, ils pensaient corriger une injustice.
— Ouais… Seulement un chalet d’alpage ne vaut pas une villa en bord de mer !
— Une villa qui aurait grand besoin de travaux pour la rendre confortable, ce que mes moyens ne me permettent pas. Crois-moi, tu n’es pas perdante. En hiver, cette maison est tout juste habitable.
— Pourtant, tu comptes aller y passer tout le week-end, lança Barbara d’un ton fielleux.
— Un voisin m’a prévenu qu’il y avait un problème de toiture, il faut que je me rende sur place voir ce qu’il en est, mentit Élise.
— Le bricolage et les réparations en tout genre, c’est mon rayon ! Au Mont Perdu, j’ai acquis une certaine expérience dont tu pourrais profiter.
— Je te remercie, mais c’est non.
— Pourtant, après ton deuil et tout le reste, tu ne devrais pas te replier sur toi-même. Et je n’ai pas l’impression que tu es très entourée. Pas d’amis, apparemment pas d’amant… Je me demande même si quelqu’un est au courant de l’existence et de la mort de ton bébé.
Élise tressaillit. C’était un coup bas, porté méchamment là où ça faisait mal. Sa sœur était une garce, déséquilibrée et imprévisible. Elle le savait depuis longtemps et pourtant, elle se laissait quand même surprendre.
Excédée, elle lui répondit qu’elle n’avait pas besoin d’ange gardien. Sa décision était prise et elle n’y reviendrait pas. Elle irait passer tout le week-end à Kornog, seule.
Barbara resterait à Nantes et se débrouillerait comme elle pourrait. Cela ne la concernait pas.
II
Dehors, la neige voltigeait toujours autour des pins, légère, inoffensive. Chaque flocon était une note isolée d’une musique qui n’avait pas encore été composée. Un pizzicato à peine audible, le son ténu d’une flûte, le pincement d’une corde de guitare…
Élise frissonna. À quoi bon attendre quelque chose qui n’arriverait peut-être jamais ?
Tournant le dos à la fenêtre, elle se mit à ranger les provisions qu’elle avait apportées, en prévision des fortes chutes de neige annoncées par la météo. Puis elle passa dans la salle de séjour contiguë. C’était là qu’elle dormirait, sur le canapé convertible réservé d’ordinaire aux invités de passage. Ainsi, elle n’aurait à chauffer que ces deux pièces du rez-de-chaussée. Puis elle monta à l’étage, prendre dans sa chambre la literie nécessaire et redescendit. En se calfeutrant avec soin, peut-être ne souffrirait-elle pas trop du froid. Élise sourit. Malgré ces inconvénients, elle ne regrettait pas d’être venue à Kornog, loin des criailleries et des récriminations de Barbara, hors de portée de ses discours et de sa malveillance. Avec la neige qui menaçait et ces flocons comme suspendus dans le temps arrêté, c’était une escapade dans un monde inaccessible.
Elle poussa le convertible dans un coin, l’ouvrit et fit son lit. Puis elle sortit son ordinateur portable de sa housse et l’installa sur la table, avec ses dictionnaires, ses lexiques et la série d’articles scientifiques dont elle avait promis la traduction en anglais à son éditeur, pour le milieu de la semaine prochaine. Elle avait en outre apporté Récits à l’Encre Rouge, des nouvelles de Jonas Mantchek, un auteur allemand qu’elle aimait énormément. S’y plonger et les traduire étaient un vrai bonheur, surtout après l’aridité des textes techniques dont elle ne comprenait presque jamais le sens.
Elle s’était attelée à cette œuvre, l’automne passé, y travaillant le soir quand Léna dormait dans son berceau. Et aujourd’hui, elle savait que jamais, nulle part, elle ne retrouverait pareille sérénité. Elle avait alors l’impression d’être au cœur d’une géode, un monde intime et scintillant d’où jaillissait une multitude de reflets colorés qui se posaient sur les bibelots, les livres et le vernis des meubles.
Wer hat Angst vom schwarzen Mann ? qu’elle avait traduit littéralement par Qui a peur de l’Homme Noir ? était le titre de la dernière nouvelle du recueil. Quand elle l’aurait terminée, elle soumettrait l’ensemble à une grande maison d’édition parisienne. Maurice Jumier, l’éditeur des revues scientifiques, avait promis de la soutenir auprès de ses relations dans le milieu littéraire.
« On verra bien ce que ça donnera… pas la peine de rêver », songea Élise en allant à la fenêtre voir comment évoluait le temps. La neige semblait avoir pris possession de la nuit. D’épais tourbillons, chahutés par un vent oblique, passaient derrière les carreaux. Dans la cuisine, elle regarda d’un œil pensif le vieux poêle à bois qu’elle n’utilisait plus depuis long temps. En cas de panne électrique, elle pourrait essayer de l’allumer. Mais elle n’avait aucune idée de ce qui lui restait de bûches et de fagots stockés dans la remise. Elle ne s’en servait qu’à la belle saison, pour faire des grillades en plein air. Elle décida d’aller vérifier.
Quand elle ouvrit la porte, le vent s’engouffra dans le couloir. Elle constata qu’il avait forci et soufflait maintenant du sud-est. La neige avait cessé de jouer, les flocons rangés en ordre de bataille défilaient comme de méchants petits soldats et recouvraient rapidement le sol. Elle enfila un anorak et des bottes, releva le capuchon et courut jusqu’à la remise. Des bûches s’empilaient contre le mur du fond. Elle se souvint alors du grand mimosa dont les branches avaient été cassées, deux ans auparavant, et que des amis avaient débitées à la tronçonneuse. Le bois avait eu le temps de sécher et il y en avait une grande quantité. Elle saisit deux sacs de jute qui traînaient par là, les remplit et les transporta jusqu’à la maison.
Chemin faisant, elle découvrit avec étonnement qu’une fenêtre était allumée à Ti Avel, la résidence voisine, située à deux cents mètres de Kornog. Elle savait qu’elle avait été vendue l’automne précédent, mais n’avait pas encore eu l’occasion de rencontrer les nouveaux propriétaires.
Ce soir, avec le blizzard qui s’annonçait, elle trouva ce rectangle de lumière jaune plutôt rassurant. Puis elle referma sa porte et décida de ne pas attendre que l’électricité soit coupée pour allumer le poêle.
Une heure plus tard, une bonne chaleur s’était répandue dans les deux pièces du rez-de-chaussée. Le feu avait pris sans problème et la cheminée tirait bien. Élise avait alors rassemblé dans la cuisine deux lampes à pétrole et plusieurs chandeliers qu’elle avait garnis de bougies. Si la lumière venait à manquer, elle voulait les avoir sous la main. Elle avait ensuite fermé les grands rideaux, pour tenter de faire barrage aux courants d’air glacé qui s’infiltraient sous les fenêtres, puis s’était installée dans un fauteuil, près du poêle, et avait débouché la bouteille de vin qu’elle avait mise à chambrer.
Elle se sentait bien, nichée au creux de cette vieille maison qui en avait vu d’autres et qui, maintenant, l’abritait comme une forteresse. Elle se versait un verre lorsqu’elle entendit frapper à la porte. Qui pouvait bien venir la voir ? Elle se rappela alors la fenêtre allumée dans la maison d’à côté et alla ouvrir.
— Excusez-moi de vous déranger, fit une silhouette encapuchonnée debout sur le seuil, une torche électrique à la main. Je suis votre voisin et je me demandais…
— Entrez vite, il fait si froid dehors !
— J’espère que je ne vous ai pas fait peur, dit le visiteur, une fois la porte refermée.
— Pas du tout… Mais ne restons pas là, le couloir est glacé, allons dans la cuisine !
La différence de température y était saisissante.
— Ouah ! s’exclama l’inconnu en regardant autour de lui. On voit tout de suite que vous êtes habituée aux intempéries.
— Pas du tout ! Je ne viens pratiquement jamais à Kornog en hiver. C’est tout à fait exceptionnel que je sois ici aujourd’hui. Si vous voulez vous asseoir près du feu…
Elle lui désigna son fauteuil et alla en chercher un autre dans la salle.
— Je m’appelle Marc Blanchard et je suis votre nouveau voisin. Quant à vous, je suppose que vous êtes Élise Favre. Ne soyez pas étonnée que je connaisse votre nom. C’est le notaire qui m’a renseigné. Je sais aussi que vous habitez Nantes.
— Eh bien, puisque les présentations sont faites, que diriez-vous de boire un verre avec moi ? J’ai un petit minervois tout à fait honorable.
— Volontiers, mais je suis un peu gêné…
— Allons ! Allons ! Pas de manières… Dites-moi plutôt ce qui vous amène !
— D’abord, j’ai pensé que c’était l’occasion de faire votre connaissance, répondit-il galamment. Ensuite, je suis à court de bougies.
— Vous êtes en panne d’électricité ?
— Non, mais j’ai peur que ça n’arrive.
— C’est bien possible en effet. Seulement des bougies, je n’en ai pas des quantités.
— Oh ! Juste une ou deux. Demain, j’irai en acheter à l’épicerie.
— Eh bien, c’est d’accord, dit Élise en remplissant leurs verres et en posant une assiettée de noix sur la table. Vous allez me trouver curieuse, mais je voudrais bien savoir ce que vous êtes venu faire à Coateven, en plein mois de février…
— J’ai acheté Ti Avel l’automne dernier et depuis, j’y passe un week-end sur deux. J’habite Rennes, c’est facile. J’aime beaucoup la côte en hiver, le vent, la mer démontée…
— Ce soir, je crois que vous allez être servi !
— Pour moi, le paysage est toujours beau, quelles que soient les conditions météo.
— Je suis de votre avis. Seulement, n’allez pas dire ça aux gens du pays, vous passeriez pour un barjo !
Puis ils se mirent à bavarder de tout et de rien, sans entrer dans le détail de leur vie personnelle. Marc Blanchard parla de Ti Avel et des travaux qu’il comptait y effectuer. De son côté, Élise lui apprit qu’elle avait hérité de Kornog, une dizaine d’années auparavant.
— Une tante veuve et sans enfant me l’a léguée, je me demande encore pourquoi.
Devant l’air étonné de son visiteur, elle expliqua qu’aucune attache particulière ne l’avait liée à cette parente. Au cours de son enfance puis de son adolescence, elle venait y passer une journée, en été, avec ses parents et sa sœur, quand la famille était en vacances dans la région. Elle se souvenait peu de son oncle qui partageait son temps entre son canot amarré dans le petit port de Gwin Zegal, et les parcours de golf des environs.
— Il est mort assez jeune et mes parents ont continué à rendre visite à notre tante, de loin en loin, plus par obligation que par réelle amitié. Pas une seconde, ils n’avaient pensé qu’elle ferait de moi son héritière. Nous avons tous été stupéfaits à l’ouverture du testament. J’avais presque trente ans et j’étais très contente qu’un tel cadeau me tombe du ciel. Seulement, je me suis vite aperçue que cet héritage était à double tranchant. Le capital légué par ma tante avait servi à acquitter les droits de succession. Il n’en restait presque rien et je n’ai jamais eu les moyens d’entretenir la propriété.
— Je vois.
— Vous vous dites que je pourrais la vendre et que ça me rapporterait un joli paquet. Seulement, je suis attachée à cet endroit. Pour le moment, la maison tient debout, mais je crains qu’un jour…
À cet instant, la lumière vacilla et Élise alluma une bougie. Puis la lampe se remit à briller.
— Je devrais peut-être rentrer chez moi avant que nous soyons plongés dans l’obscurité… déclara alors Marc Blanchard.
— Il n’est pas tard, vous boirez bien encore un verre, proposa Élise en allant jusqu’à la fenêtre. La tempête s’est transformée en blizzard. Tout est blanc. Si ça dure toute la nuit, demain, nous serons bloqués à Coateven.
Puis elle ouvrit la porte du poêle, tisonna les braises et rechargea le feu.
— Vous avez une bonne provision de bois, heureusement, dit Marc en désignant un des sacs posés près de la porte. Il faudrait que je m’en procure, moi aussi. Ce serait une sécurité dans un pays pareil !
Élise hocha la tête, puis la conversation tarit. On n’entendit plus que les rugissements du vent dans la cheminée.
— Est-ce que je peux vous demander quel métier vous exercez ? reprit Marc. Je ne voudrais pas me montrer indiscret, mais ça fait un moment que je me pose la question. D’habitude, j’arrive assez facilement à situer les gens…
— Je suis traductrice trilingue, français, anglais, allemand. Je travaille pour une maison d’édition spécialisée dans les textes techniques et scientifiques. Je me consacre essentiellement à des publications destinées à paraître dans des revues internationales. Je traduis aussi des thèses de doctorat en anglais et, plus rarement, des articles de vulgarisation.
— Ce doit être intéressant.
— Oh ! Pas vraiment. La plupart du temps, mes connaissances scientifiques ne me permettent pas de comprendre ce que je traduis… Un des avantages de ce travail est que je peux l’exercer à domicile et que je m’organise comme je veux. Mon éditeur m’adresse les textes par Internet et je lui renvoie les traductions de la même façon. Nous nous téléphonons souvent mais ne nous rencontrons pour ainsi dire jamais.
— Vous ne vous consacrez jamais à des textes littéraires ?
Élise ébaucha un sourire.
— Si ! Mais c’est mon jardin secret… Maintenant, à vous ! Qu’est-ce que vous faites dans la vie ?
— Je suis fonctionnaire.
— Mais encore ?
— Au Ministère de l’Intérieur.
Elle sentit sa réticence et s’en étonna. Puis une intuition la traversa. Ce type était flic, elle en aurait donné sa main à couper.
— C’est un ministère important. Les professions doivent y être aussi multiples que variées, fit-elle d’un ton ironique.
Il comprit qu’elle l’avait percé à jour et sourit à son tour.
— Je suis policier, mais je crois que vous l’aviez deviné…
— Vous avez l’air de vous en cacher.
— Pas du tout ! Seulement l’attitude des gens n’est plus la même quand ils apprennent ma profession.
— Je vois. Et à quel service êtes-vous rattaché ?
— Police judiciaire de Rennes. Seulement, je vous en prie, oubliez ça. Ici, personne n’est au courant. Je n’ai pas envie qu’on vienne me tanner chaque fois qu’il y a un PV à faire sauter ou une embrouille à régler.
— Ne vous inquiétez pas ! Je ne suis ni bavarde ni très sociable. Votre secret sera bien gardé.
— Merci. Sur ce, il est vraiment temps que je m’en aille. On se reverra sans doute demain. Vous aurez peut-être besoin d’un coup de main pour déblayer la neige devant votre entrée…
— Si nous survivons jusque-là ! s’exclama Élise en riant.
Puis elle le raccompagna à la porte et le regarda s’enfoncer dans les rafales tourbillonnantes. Très vite, sa silhouette disparut et il n’y eut plus que le halo de sa lampe torche qui finit par s’effacer lui aussi.
*
…Ils sont à la montagne, dans les Alpes. Goulwen gravit une piste en suivant les marques rouges peintes sur les rochers ou les troncs d’arbres. Élise marche derrière lui. Soudain, ils débouchent sur un replat où se dresse un chalet ancien, noirci par le soleil. Ils déposent leurs sacs à dos et vont jusqu’à la fontaine creusée dans un tronc d’arbre et qui ressemble à une pirogue. Ils trempent leurs bras dans l’eau glacée et s’aspergent le visage. Ça leur fait du bien. Quand ils ont fini, ils entrent dans le chalet, leurs grosses chaussures font du bruit sur le plancher. À droite, il y a la salle commune avec une table et des bancs. Élise voit ses parents assis sur l’un d’eux. Goulwen a disparu, mais elle n’y fait pas attention, parce que sur la vieille cuisinière à bois, il y a un chaudron plein de soupe qui bouillotte. Elle prend une assiette, se sert et va s’asseoir à côté de son père, près d’une fenêtre. Dehors, le paysage a changé. Le fond de la vallée est devenu un estuaire où naviguent des bateaux. Son père lui demande où est passé l’homme qui l’accompagnait. Elle lui répond qu’il est devant le chalet, en train de débiter les branches d’un mimosa…
Sursaut. Cœur battant. Souffle court. Élise ouvrit les yeux.
Au fond de la pièce obscure, elle distingua les braises qui rougeoyaient dans le foyer du poêle. Son rêve s’effaçait rapidement.
Elle rêvait souvent de Goulwen et se demandait pourquoi. Cela faisait un an et demi qu’ils s’étaient séparés. Elle venait alors de découvrir qu’elle était enceinte de lui, et avait décidé de garder l’enfant sans rien lui dire. Jamais il n’avait su qu’il était le père d’une petite fille.
Goulwen ne lui manquait pas. Elle pensait très peu à lui. En fait, elle ne le côtoyait qu’en songe où il tenait toujours un rôle secondaire. Les mois passaient, il continuait de lui apparaître, alors qu’elle ne rêvait jamais de Léna, ce qui pourtant aurait été normal, vu l’importance prodigieuse que son enfant avait prise dans sa vie.
Élise s’enfouit sous la couette et tenta de repousser le flot de souvenirs qui remontaient des profondeurs. S’y attarder était aussi dangereux que marcher sur une ligne de crête aux pentes vertigineuses. Elle devait trouver un replat, un endroit stable où elle ne risquait pas de perdre l’équilibre.
Penser aux traductions dont elle allait s’occuper demain.
Penser à son nouveau voisin. Gentil, agréable, assez lisse pour glisser sur le présent sans y laisser de traces.
Penser à la neige, au vent, au paysage métamorphosé qui entourerait Kornog, au lever du jour.
Boucler. Censurer. Verrouiller.
Élise serra les poings. Le trésor devait rester au fond du coffre hermétiquement fermé. Si elle s’en donnait la peine, si elle y travaillait avec obstination, il finirait par se dessécher, se racornir, se transformer en caillou qu’elle pourrait jeter sans remords, dans la rivière des souvenirs.
Elle voulait y croire. Elle n’avait pas d’autre choix que d’y croire. Voilà pourquoi, dans l’immédiat, elle devait s’efforcer de se rendormir.
Quand elle se réveilla pour la seconde fois, les rougeoiements du poêle s’étaient éteints. Le vent grondait toujours, mais ses clameurs semblaient affaiblies. C’était un bruit étranger à la tempête qui l’avait tirée de son sommeil.
Elle repoussa la couette et leva la tête. Elle sentit aussitôt que le froid avait envahi la maison mais, à part ça, tout lui parut normal. Elle allait se blottir dans la tiédeur de son lit lorsqu’un ronflement de moteur puis le gémissement de roues qui patinent percèrent la nuit.
Il y avait une voiture près de la maison.
Elle tendit la main pour allumer, mais tout resta dans le noir. L’électricité était coupée. Elle saisit la lampe torche posée par terre, enfila ses pantoufles et une robe de chambre puis gagna la cuisine et entrouvrit le rideau. Les phares d’un véhicule à l’arrêt éclairaient les troncs des pins, mais la carrosserie était noyée dans l’ombre et les tourbillons de neige. Rien ne bougeait.
Perplexe, Élise regardait cette voiture échouée là, apparemment incapable de repartir. Que faire ? Elle ne pouvait laisser les occupants enfermés dans l’habitacle, sans leur porter secours.
Elle chaussa ses bottes, passa un anorak. Elle tournait la clé dans la serrure quand elle entendit une portière claquer. Dehors, dans la lumière diffuse des phares, elle distingua quelqu’un debout, à côté de la voiture. Elle leva le bras et lui fit de grands signes.
— Venez ! Venez à l’intérieur !